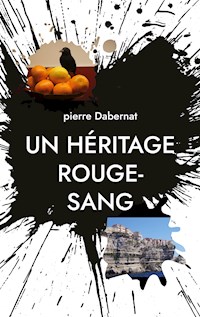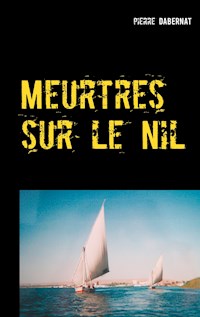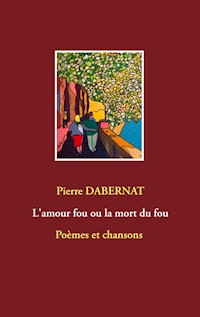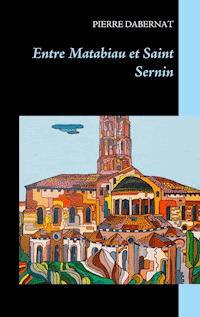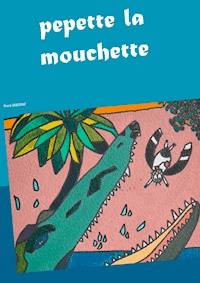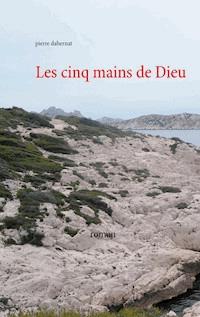Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Sur la balustrade, un oiseau me regardait. Mon oiseau ! C'était une hallucination... Le psychiatre m'avait expliqué ce processus diabolique... Lorsque mon cerveau se mettait enfin au travail, qu'il élaborait quelques hypothèses fumeuses et tortueuses, lorsqu'il cherchait avec énergie l'astuce capable de confondre un criminel, cela au prix d'une immense cogitation, un oiseau apparaissait et il me causait dans un langage que moi seul comprenait. Marcello Visconti déprime comme toute la France en cette période de pandémie. "L'Artiste", lui se fiche du Covid 19. Il est déjà contaminé. Son virus c'est peindre le corps de ses victimes, puis de les assassiner dans des lieux choisis, pour ensuite les mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Si "L'Artiste" était le seul malfaisant que doit débusquer le commissaire et son piaf, cela pourrait être simple ! Mais c'était sans compter avec quelque chose de plus dangereux, de plus pernicieux et qui s'appelle la "haine invisible" et qui va corser la sauce.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Un sourire salace sur le visage
Il s’était trompé sur toute la ligne
Les hommes travaillaient en silence
J’avais connu Montalembert quelques années plus tôt.
Tu parles d’un arrêt cardiaque !
Vous désirez inspecteur ?
Ce n’était pas la règle mais il y avait le fric
Tout le monde se leva et quitta la pièce
Bon tu rappliques !
Il portait une cagoule noire
La sexualité de certains était bizarre
Il n’y a pas de femmes en ligne
Mon cœur battait la chamade de plus en plus
Cela me manquait
Ce qui faisait sept avec lui
Je stoppai brutalement.
Pour l’heure, j’avais d’autres chats à fouetter
J’étais en train de boire le calice jusqu’à la lie
La veille de Noël la foudre nous tomba dessus.
J’étais parti sans masque
La réponse du front dégarni me surprit
Le gros lard gisait sur le tapis
J’avais dit le jour de la Saint Valentin
Je lui contais ma mésaventure
Vous avez trouvé quelque chose ?
Une fleur mâle
On n’a pas le choix !
Vous avez vu commissaire ?
Les commandes de quoi ?
Mais tu es cinglé.
Les jours filèrent
Je sonnais à plusieurs numéros
On m’introduisit dans une salle
Le corse avait une poule
Elle hésita.
Le Glock le long de ma cuisse j’entrai
Il faut remonter à notre enfance
Un sourire salace sur le visage
Marion Bergé était une avocate. Elle avait la trentaine, brune et elle était d’un naturel enjoué. Ceux qui l’aimaient disaient que c’était une femme intelligente, engagée dans la cause des féminicides. Ceux qui ne l’aimaient pas disaient que c’était une salope et qu’elle méritait qu’on s’occupe d’elle.
Elle avait été enlevée la veille, en sortant de son bureau de la rue Bayard à Toulouse. Elle avait travaillé tard sur un dossier qui lui tenait particulièrement à cœur. Celui d’une cliente, la mère d’une jeune fille qui avait été violée et qui avait fini par se suicider
Elle avait perçu les premières notes de Tangueando, une école de danse qui occupait tout un étage dans un immeuble voisin. Les cours venaient de débuter. A vingt heures, alors qu’elle se préparait à quitter les lieux pour aller chercher sa voiture au parking de la gare Matabiau, quelqu’un avait sonné à sa porte. Deux hommes, bien mis, vêtus de costumes et de cravates lui étaient apparus dans son judas. Elle avait ouvert en se fiant à l’apparence correcte de ces hommes. Bien mal lui en avait pris.
Le plus jeune, et le plus costaud, dès que la porte fut ouverte, l’avait poussée violemment en arrière. Elle avait crié avant de s’affaler dans le couloir. En essayant de se maintenir, elle avait emporté avec elle une table sur laquelle il y avait un vase, avec des fleurs coupées, pour souhaiter la bienvenue aux éventuels visiteurs. Avant même qu’elle n’ait eu le temps de se relever, l’agresseur s’était jeté sur elle et il avait enfoncé un mouchoir dans sa bouche. Le deuxième inconnu avait aidé alors son complice à relever l’avocate et ils avaient lié ses mains dans son dos. Puis ils l’avaient installée sur une chaise. Celui qui paraissait avoir la soixantaine, avait extrait, de la poche de son pantalon, une petite bouteille en plastique, tandis que l’autre brandissait un long couteau dans sa main.
- Je vais ôter le mouchoir ! Si tu cries mon jeune ami t’égorge comme une sale truie. Si tu as compris tu hoches la tête.
La jeune femme tétanisée, par ce qui lui était tombé dessus, avait fait ce que le vieux lui avait demandé. Il avait enlevé le bâillon et elle avait ouvert la bouche pour respirer. Aussitôt, l’inconnu était passé derrière elle, avait passé son bras autour de sa tête et il lui avait pincé le nez. De l’autre, il lui avait mis le goulot de la bouteille dans la bouche et il l’avait obligée à boire tout son contenu. Il l’avait bâillonnée à nouveau avec le mouchoir et ils l’avaient laissée dans le couloir.
Ils étaient allés fouiller le local.
Marion Bergé travaillait seule. Elle débutait et elle ne faisait pas partie d’un cabinet. Elle avait une secrétaire qui travaillait en ligne et qui prenait tous ses rendez-vous... Par conséquent, la visite du bureau qui se résumait à deux pièces, avec un petit coin cuisine pour grignoter, fut vite expédiée. L’avocate vivait à Pamiers. Habituellement elle se déplaçait chaque matin avec le train. Mais depuis que le Covid 19 sévissait, elle préférait prendre sa voiture.
Les premiers effets du GHB ne se manifestaient qu’à partir d’une quinzaine de minutes. Voire plus suivant les doses et les personnes concernées. Marion ressentit une chaleur l’envahir et une certaine ivresse, comme si elle avait avalé de l’alcool. Son visage s’empourpra. Le vieux lui ôta le mouchoir et lui demanda si elle allait être gentille. Elle répondit d’une petite voix qu’elle allait bien se tenir. Il lui détacha les mains. Elle vacilla et s’accrocha à l’homme. Elle s’excusa d’une voix monocorde. Le deuxième lui jeta son manteau sur les épaules, lui glissa son sac à main sous son bras, et il la fit sortir sur le palier de l’immeuble. Le vieux téléphona. Ils descendirent le vieil escalier, traversèrent la cour en croisant des danseurs de Tango, et se retrouvèrent dans la rue. Juste au moment où une voiture débouchait. Le vieux fit monter Marion à l’arrière et il s’installa à côté tandis que son compère montait devant. A peine les portières fermées, la voiture démarra en trombe et fila en direction du canal du Midi.
Quinze jours plus tard, un deuxième enlèvement eut lieu. Le dimanche 27 septembre.
Elle avait vingt-cinq ans et elle était blogueuse.
Elle s’appelait Brigitte Silverado et elle avait des milliers de followers sur Twitter et Instagram. Elle se filmait la journée, parfois dans des tenues trop dénudées, possédait une opinion sur tout, et faisait partie de cette catégorie d’influenceurs qui parvenaient à vivre de cette façon. Elle était une jeune femme qui affichait une totale liberté de pensée féminine qui collait à celles des jeunes adolescentes qui la suivaient depuis trois ans. Elle abordait sans pudeur les problèmes sexuels des filles, parlait de la contraception, de l’avortement, de la mode et de la façon de s’habiller pour séduire les garçons, sans oublier aussi de dénoncer les mauvais penchants des hommes, enfin elle parlait de tout ce qui intéressait son réseau.
Ceux qui l’aimaient disaient d’elle que c’était une jeune fille moderne et intelligente, très belle et très sexy, et ceux qui ne l’aimaient pas disaient que c’était une pute et qu’il fallait que l’on s’occupe d’elle.
Elle habitait dans un quartier chic de Rennes. Dans une de ces maisons traditionnelles, bâties pour durer mille ans. En réalité, elle y occupait un modeste logement, au premier étage, avec une entrée indépendante. Les propriétaires, des retraités, qui occupaient le reste de la maison, étaient partis se confiner dans leur villa sur l’île de Noirmoutier. Tout le monde ne se confinait pas de la même manière... Brigitte qui avait toute la confiance du couple avait eu en garde la nourriture des deux chats de la maison.
Alors qu’elle tchatait sur le net, elle entendit sonner. Elle enfila un pull et chaussa ses pantoufles.
Elle se pencha à la fenêtre et aperçut un jeune homme, brun, qui lui fit un signe de la main. Il était vêtu d’un jean anthracite et d’un pull-over marin. Elle avait remarqué qu’il s’agissait d’une marque. Le jeune homme avait dit qu’il recherchait son chien qui s’était échappé. Il l’avait en photo sur son téléphone et il voulait le lui montrer dans le cas où elle l’aurait aperçu.
Brigitte n’hésita pas. Elle descendit pour aller ouvrir la porte. Avec un peu de chance, elle allait pouvoir raconter sur son blog cette nouvelle et sympathique rencontre.
A peine la porte fut elle ouverte qu’elle sentit un coup violent porté entre ses deux seins qui lui coupa le souffle. Elle perdit l’équilibre et partit en arrière dans le couloir. Le sympathique jeune homme lui avait appliqué avec une brutalité inouïe cette poussée du plat de la main. Il était grand et costaud. Dans les secondes qui suivirent, un autre homme sortit d’un utilitaire stationné devant la maison. Ils empoignèrent la jeune femme encore à moitié sonnée, qui tentait de reprendre son souffle, et l’entraînèrent, sans ménagement, à l’intérieur du véhicule... La porte latérale se referma sèchement, le charmant jeune homme prit le volant et démarra en trombe. Par la porte restée ouverte, un chat sortit prudemment une patte, puis deux et tout le corps et s’en alla à la découverte de la rue. Deux minutes plus tard, le deuxième félin prit à son tour la tangente.
Le deuxième homme profita de la faiblesse de Brigitte pour lui lier les mains dans le dos. La fourgonnette était celle d’un artisan peintre. Elle avait été volée la veille et débarrassée des pots de peintures qu’il y avait à l’intérieur, afin de faire de la place. Sur la porte arrière, il y avait un logo et une adresse qui indiquait une entreprise de l’agglomération de Chantepie.
Le Ford roulait prudemment. L’homme qui était resté avec la jeune blogueuse lui avait donné de l’eau à boire, dès qu’elle avait repris ses esprits. Le GHB allait la calmer dans peu de temps. Il rejoignit son complice à l’avant et sortit son portable.
Il était tard quand le véhicule pénétra sur un chemin de terre. Ils étaient en rase campagne, à quelques kilomètres de Saint-Malo. Cahotant dans les ornières, le Ford continua sa route. Il passa à travers un bosquet d’arbres et d’une végétation dense qui lécha le capot. Ce chemin n’était plus entretenu depuis pas mal de temps. Enfin, un vieux corps de ferme se profila devant le ciel de la nuit. Une partie du toit était défoncée mais une aile de la bâtisse tenait encore debout. Il y avait un cadenas à la porte mais le jeune homme avait la clef.
Brigitte s’était assoupie durant le trajet. Ils la réveillèrent et elle n’opposa aucune résistance pour les suivre. Ils la firent entrer dans la ferme. Il y avait une grande pièce avec de vieux meubles d’autrefois, un évier en béton avec un robinet en cuivre qui suintait. Le carreau de la petite fenêtre, au-dessus de l’évier, était brisé et crasseux. Au milieu de la pièce, il y avait une table en bois ronde, dont le plateau avait été lardé par dans années de maltraitance à coup de lames pointues. Il y avait des inscriptions, devenues illisibles par la saleté qui s’y était incrustée. Une vieille gazinière était branchée à une bouteille de Propane. Un meuble auquel il manquait les portes affichait une panoplie d’ustensiles de cuisines, digne de finir à la déchetterie. Le carrelage du sol était dans un piteux état. Dans le fond, il y avait une porte qui donnait sur la deuxième pièce.
C’était une chambre ou ce qui tenait lieu d’être. Un lit de cent quarante, en fer, à moitié déglingué, avec un matelas moisi et crevé. Pas de draps ni de couvertures. Sur le côté, il y avait une armoire brisée et renversée. Des hardes s’en échappaient. Une chaise et un plafonnier sans ampoule. De toute façon, il n’y avait pas d’électricité dans ce foutoir perdu, dans ce trou du cul du monde breton. Il y avait une fenêtre et des planches toutes neuves avaient été vissées sur le rebord pour qu’on ne puisse pas l’ouvrir.
Le jeune homme gentil, d’apparence, poussa Brigitte sur le lit. Son complice ayant allumé une lampe de camping et l’ayant posée sur la table ronde, tira une chaise sans dossier et sortit son paquet de cigarettes, le regard porté sur la chambre, sur le lit, par la porte restée ouverte. Un sourire salace sur le visage.
Brigitte sentit les mains du jeune homme qui lui arrachait les vêtements. En un rien de temps, elle fut nue et cela ne l’étonna point. D’être ainsi traitée, cela ne lui faisait ni chaud, ni froid. L’effet de la drogue anesthésiait complètement sa volonté. Le violeur se déshabilla et enfonça son sexe tendu dans la bouche de sa victime. Il demanda à son pote s’il voulait aussi profiter du cadeau mais ce dernier déclina son invitation. Cependant, son truc c’était de reluquer et il commença à bander. Quand il vit la brute sodomiser la jeune femme, il défit sa braguette mais il se ravisa aussitôt. Il avait honte.
Puis le brave et charmant jeune homme se reculotta, satisfait de sa performance. Ils attachèrent Brigitte aux montants du lit. Le plus vieux, alla chercher la lampe et la déposa à côté d’elle. Il prit son portable et fit plusieurs photos du corps dénudé. Il en fit aussi une dernière plus rapprochée du visage. C’était la consigne. Demain, il y avait plusieurs heures de route avant d’aller livrer le colis en question. Ils fermèrent la maison et ils allèrent chercher une voiture qui était restée cachée sous un vieil hangar. Il n’était pas question de passer la nuit dans ce trou pourri. Ils prirent la route de Saint-Malo où ils avaient réservé des chambres dans un hôtel du centre-ville.
Il s’était trompé sur toute la ligne
Le capitaine Hélios Salvador se réveilla le cerveau en pétard. Il avait abusé de l’écran durant une partie de la nuit. Il avait commencé par surfer sur les sites pornographiques, puis son délire sexuel terminé, il avait failli raccrocher quand il était tombé accidentellement sur un blog particulier. Il avait tenté de l’ouvrir mais il s’était vite rendu compte que ce site-là était bouclé. Il fallait des codes qu’il ne possédait pas et cela avait aiguisé sa curiosité. Certes, il était calé en informatique, mais pas assez pour ouvrir ce blog dont on ne voyait qu’une image floue. Une femme agenouillée, dans un décor de sable et de rocailles, un capuchon sur la tête, face à un islamiste qui la tenait en joue avec une kalachnikov. Il n’y avait aucun titre hormis cette page d’écran.
Salvador avait appelé un hackeur malgré l’heure avancée de la nuit. Il lui avait évité de longues années de prison et il le tenait, pour ainsi dire, par les couilles, et à disposition, vingtquatre heures sur vingt-quatre. Il lui avait ordonné d’ouvrir illico la porte de ce foutu site qu’il présumait être un ramassis d’extrémistes radicalisés. Il était officier de police et pensait avec conviction que les religions étaient la cause des guerres qui fracassaient l’humanité depuis des millénaires. Pour cette raison, les islamistes étaient particulièrement dans sa ligne de mire. Un copain d’enfance, militaire au cinquième bataillon de chasseurs alpins de Grenoble, avait perdu la vie au Mali. Son véhicule blindé avait sauté sur une mine. C’était une des motivations qui l’avait poussé à vouloir pénétrer dans ce site. L’hacker l’avait rappelé une heure plus tard. C’est-à-dire aux alentours de trois heures du matin. Il lui avait dit comment il devait procéder. Il fallait passer par le darknet. Salvador avait noté le chemin à suivre sur son carnet et il avait raccroché.
Le darknet, il connaissait vaguement ce que c’était… Durant une enquête pour meurtre, il avait bossé avec des agents, d’un service spécialisé en informatique et qui traquait les réseaux pédophiles. Il avait appris, à l’époque, qu’il n’y avait pas que cela sur la toile obscure. Le Darknet était un réseau superposé à internet où certains logiciels, avec des configurations et des autorisations spéciales, permettaient à des utilisateurs doués d’y accéder. Ces utilisateurs, c’était ceux du marché noir, de la drogue, de la fausse monnaie, des médicaments et la liste ne s’arrêtait pas là. Ils utilisaient la plate-forme Agora qui était l’équivalent d’Amazon. Celle du cheval de Troie de la Citadelle permettait aux hackers malhonnêtes de détourner les données personnelles à des fins d’escroquerie. Il y avait aussi le site Hitman qui offrait à quiconque la possibilité d’engager des tueurs à gages, et plusieurs autres qui, suivant la rumeur, facilitaient le recrutement des cerveaux en informatique, en les attirants avec des jeux compliqués, par des gouvernements peu scrupuleux. On y retrouvait bien sûr Al-Qaïda, des bandes mafieuses et terroristes. Parfois des journalistes se servaient de la messagerie anonyme pour contacter certaines personnes sur des territoires en guerre et pour percer aussi les secrets de pays comme la Corée du Nord. Le darknet crée en 2012 avec des fonds de plus d’un million de dollars, fonctionnait avec la même efficacité que la Nasa. Il avait servi principalement à fomenter le Printemps Arabe. Bref ! Le darknet s’ouvrait à toutes les perspectives.
Hélios Salvador avait percé le coffre de ce site vingt minutes plus tard. Il avait dû montrer patte blanche et s’inscrire en donnant un pseudo pour aller de l’avant et voir de quoi il en retournait.
Il s’était trompé sur toute la ligne. Ce n’était pas un groupe d’islamistes. Mais tout autre chose… Il y avait des photos, des vidéos, des témoignages et il était resté deux heures durant à surfer et à chater en direct avec des mecs noctambules.
Puis, les yeux explosés, il était allé se coucher et il avait eu un mal fou à trouver le sommeil.
Quand l’alarme de son téléphone portable s’était déclenchée, il avait été brutalement évacué d’un rêve bizarre... Il était dans une maison délabrée, et une vieille femme, lui expliquait qu’il devait déguerpir car sa famille allait prendre possession des lieux. Elle lui demandait de faire sa valise et de ne plus jamais revenir. Salvador se frotta les yeux pour gommer ces images et resta assis quelques secondes, sur le rebord du lit. Fatigué de ce réveil contre nature, il se leva et alla préparer son thé. Il venait d’emménager et il y avait des cartons un peu partout. Depuis une semaine, il avait incorporé la brigade criminelle de Toulouse et il prenait à peine ses marques dans cette ville rose qu’il ne connaissait pas encore. Il avait passé une partie de sa carrière à Lyon. Il avait fait plusieurs services avant de bosser aux stups. Il avait eu l’opportunité de postuler pour un poste à Toulouse qui venait de se libérer, suite à un départ en retraite, et à sa grande surprise, il avait été choisi. Il avait loué un appartement, au troisième étage d’un immeuble au bord du canal du Midi.
Dès qu’il fut habillé, il s’en alla. Il traversa la résidence, passa le portillon et longea le canal jusqu’à la passerelle. Il arriva à la station de métro Saouzelong, au cœur de la cité Rangueil, pour rejoindre le commissariat central de l’Embouchure. Le temps était maussade. On approchait du mois de novembre, avec son lot de chrysanthèmes, sur les tombes des cimetières, qui allait bientôt leur donner un air de fête, comme tous les ans.
Le commandant Frédéric Costessec était assis à son bureau, à moitié caché par une pile de dossiers, de toutes les couleurs, et il discutait âprement avec un homme qui tournait le dos à Salvador. Comme la porte était ouverte, celui-ci se manifesta par un raclement de gorge et en levant la main à l’intention du chef de groupe. L’inconnu se retourna. C’était un type costaud, d’une bonne cinquantaine, avec un visage aux traits rudes, mais dont le regard affichait un voile de tristesse bordé d’une certaine jovialité. Il avait une barbe drue, mi-teintée de blanc, d’une semaine. Le crâne n’était pas encore dégarni et sa peau était celle d’un homme vivant au grand air. Le commandant Costessec coupa court à la discussion. Il se leva pesamment et présenta son invité.
- Capitaine Salvador, je vous présente le commissaire Visconti.
- Enchanté ! J’ai entendu parler de vous.
- Je n’en doute pas cher collègue... Ma réputation de barjo me précède toujours.
Le capitaine Salvador ne sut que répondre. Il préféra botter en touche, et s’adressa directement au commandant.
- Demain, je dois passer la visite médicale. C’était juste pour vous prévenir que je serais absent le matin.
- No problèmo ! Le lieutenant Sendker et le lieutenant Michel vous attendent...
Salvador tourna les talons et partit à leur recherche. Magali Sendker se trouvait dans un bureau avec son collègue Michel. C’était une longue et belle femme, avec un corps d’athlète, à la démarche souple. Elle était coiffée d’une coupe au carré impeccable, d’un blond cendré, qui mettait en valeur des traits d’une beauté faite d’un mélange nordique et asiatique. Le trio s’installa autour d’une table sur laquelle Michel déposa un tas de dossiers. Ils s’en saisirent et commencèrent à les étudier.
La journée terminée, le capitaine Salvador reprit le métro pour rentrer chez lui. Il s’arrêta à la boulangerie pour s’acheter une baguette, à la boucherie de la charcutaille et des steaks. C’était de la nourriture facile à cuisiner. L’homme n’aimait pas mettre la main dans les casseroles. C’était un solitaire qui vivait seul depuis plusieurs années. Il avait partagé une vie de couple avec une femme lyonnaise mais cela avait foiré. Il avait eu quelques autres aventures, mais sans succès. Il avait tenté une approche gay et cela ne lui avait pas plu. Depuis, il repoussait avec force cette éventualité.
Il s’enferma chez lui, négligea, une fois de plus le vidage de ses cartons, prit une douche et prépara son repas protéiné. Il ouvrit une bouteille de Madiran, un vin qu’il découvrait, et s’installa à son ordinateur. Il était pressé de retourner sur le site de la veille.
Il retrouva ces internautes, oiseaux de nuit, qui déversaient sur la toile des immondices masculines. Cela pouvait être des photographies de femmes battues, des scènes de viol filmées à chaud, des commentaires salés sur le physique de certaines célébrités ou de simples anonymes, des récits empreints d’une violence sans égale à l’encontre des femmes. Sous les pseudos affichés, le capitaine devinait le parcours chaotique de ces hommes dévoyés par leur rancune maladive, obsessionnelle. Certains se réclamaient d’une couleur politique, d’un racisme affiché, d’une violence latente prête à exploser dès la moindre étincelle.
Le capitaine Salvador avait été attiré par ces discours comme l’éphémère par la pollution lumineuse. Il avait conscience de la perversion de ces hommes qui prônaient sans complexe la haine des femmes en général. Ces phrases à l’acide, ces vidéos à vomir, toutes ces photographies dégueulasses, remuaient au plus profond de lui-même, des souvenirs douloureux.
Le capitaine Hélios Salvador était d’origine mexicaine. Son enfance avait mal démarré. Sa mère avait épousé un jeune du même quartier qu’elle, et tout aussi pauvre. Pour subvenir aux besoins de sa famille, qui s’était agrandie avec trois enfants, son père s’était acoquiné avec des trafiquants de drogue. En quelques années, il était devenu le bras droit d’un patron du cartel. Durant ces années, ils avaient vécu dans une certaine opulence jusqu’au jour où une belle indienne, qui évoluait au sein du clan mafieux, fit perdre les pédales au chef de famille. Prenant un jour le couple adultère sur le fait, son épouse folle de rage, les abattit à coup de révolver. Puis sous le coup de sa folie, elle tua son jeune fils de cinq ans, sa petite sœur de dix mois et vida les dernières balles de son arme sur son aîné. Le jeune Hélios avait survécu par miracle après une opération qui avait duré plusieurs heures. Il n’avait alors que dix ans.
Sa mère, ce jour-là, n’ayant plus de munitions dans son arme, avait eu la bonne idée et le courage de se jeter du haut du toit d’un immeuble dans l’heure qui avait suivi le drame.
Le jeune Hélios avait été adopté, plus tard, par un couple qui vivait à Mexico et qui avait émigré l’année suivante en France. A dix-huit ans, il avait obtenu la double nationalité, ce qui lui avait permis de préparer le concours de l’école de police.
Ces déboires sentimentaux étaient liés à la crainte qu’il avait des femmes. Des femmes qui étaient capables d’éliminer, par déception amoureuse, la totalité de leur famille. Cependant, le capitaine était au courant, que ce geste-là, égoïste et désespéré, était plutôt l’apanage des hommes. Mais cela ne l’empêchait pas d’être méfiant vis-à-vis des femmes. Il savait qu’il aurait dû voir un psychiatre mais il n’avait jamais franchi le pas.
Salvador comprenait le délire de ces hommes. Chacun devait posséder une blessure profonde qui les avait livrés à de telles extrémités. Il compatissait mais en même temps le capitaine n’arrivait pas à accepter ce torrent de violence et de haine. Les hommes qui tabassaient leurs femmes étaient des malades qui, à la longue, et par un concours de circonstance malheureux, étaient devenus des meurtriers. Ces types du darknet étaient tous des assassins en puissance.
Les hommes travaillaient en silence
La nuit était complice.
La camionnette s’arrêta sur la petite route qui longeait le site. C’était un Trafic Renault jaune. Un véhicule de la poste. Sa présence était singulière. Les facteurs se levaient rarement à quatre heures du matin pour entamer leur tournée. D’autant qu’ici, il n’y avait que des platanes qui se perdaient dans le noir de la nuit. Les étoiles n’étaient pas au rendez-vous et la lune demeurait cachée quelque part. Un hérisson s’approcha du Trafic. Il passa sous l’utilitaire et continua sa randonnée à la recherche de sa pitance nocturne. Rien ne l’avait effrayé. A l’intérieur de la camionnette, il n’y avait eu aucun mouvement, aucun bruit. Enfin, la porte latérale glissa dans un crissement métallique. Un pied, pointure quarante-quatre, chaussé d’une chaussure de sport, de marque connue, noire, avec des lacets jaunes, se posa avec précaution sur le bitume. Un homme, vêtu d’un blue-jean gris et d’un blouson en cuir se profila dans la porte. Une silhouette sombre et athlétique qui agissait avec lenteur. Cet homme aux aguets, à l’évidence, interrogeait la nuit. Il fit le tour du Trafic puis il passa la tête à l’intérieur et chuchota un ordre.
Un deuxième inconnu sortit du camion, puis un troisième, un quatrième et pour finir un cinquième... Tous avec la même hésitation, la même lenteur. Le premier homme tenait un sac. Il y plongea la main et en retira plusieurs cagoules en coton que ses compagnons s’empressèrent de mettre. Toute cette préparation, sans échanger aucune parole. A l’évidence, ils connaissaient tous les gestes à faire.
Celui qui avait distribué le sac semblait être le meneur. Il se pencha dans le ventre du camion et en extirpa des pinces, des torches, des tiges métalliques, un sac de boulons accompagné de plusieurs clefs à pipe. Il distribua le tout, toujours avec la même parcimonie des gestes. Puis, il remonta à l’intérieur et il en ressortit trente secondes plus tard en tirant derrière lui une sixième silhouette.
Déjà, les hommes s’activaient auprès de la clôture avec les pinces coupantes afin de créer un passage. Quand le grillage tomba, ils se faufilèrent rapidement les uns derrière les autres.
La sixième silhouette contrastait singulièrement avec les cinq autres. C’était une femme. Elle était entièrement nue et tout son corps, le visage y compris, était recouvert de couleurs. Ce n’était pas une simple décoration. On devinait, quand on était proche d’elle, que celui ou celle qui l’avait peinte ainsi était un as du pinceau. Un artiste... Cette femme était magnifique. Avec un corps splendide, avec des hanches fines, des jambes élancées et des seins hauts placés. Une femme dans sa pure jeunesse. Ses grands yeux, aux contours d’un rouge carmin, figuraient le cœur d’une fleur. Ils semblaient éteints... Ils ne reflétaient aucune peur, aucune angoisse, aucune surprise d’être là, présente, parmi ces inconnus masqués, dans cette nuit profonde et fraîche, menée comme une esclave, les mains liées, à travers ce grillage détruit.
Elle était pieds nus. Ils étaient peints aussi en rouge. Son sexe entièrement rasé, était de cette même couleur. Sur le reste du corps qui avançait péniblement sur de l’herbe mouillée, puis sur du sable pour encore revenir sur de l’herbe, les couleurs étaient multiples. L’artiste avait fait d’elle, de cette femme perdue, livrée à la nuit, une fleur tropicale, en pleine éclosion. Elle avait du mal à suivre cette ombre qui la tenait en laisse. Curieusement, lorsqu’elle s’arrêtait pour souffler, lorsqu’elle hésitait à avancer, l’homme s’arrêtait, attendait avec patience qu’elle veuille repartir. Durant ce temps, le reste des hommes s’était avancé et ils avaient commencé leur tâche.
Les nuages avaient fui. Le vent s’était levé. On y voyait plus clair. Un arbre immense se dessina sur le gris éclairé par la lune revenue. En s’approchant, on distinguait un autre arbre, qui était tombé et dont la base avait été tronçonnée. Il avait été déshabillé de ses ramures et un bouquet de branches, les plus anciennes, les plus robustes, avait été découpé de façon à lui offrir une assise horizontale. Son tronc avait été dépouillé de ses écorces en son milieu avec une extrême précision.
Les hommes travaillaient en silence. Ils montèrent les barres métalliques qu’ils avaient amenés et les fixèrent à l’aide des boulons. Cela ressemblait à un siège. Un siège qui épousait parfaitement la rondeur du tronc. L’un d’eux sortit d’un sac à dos des cordes fines de montagne et fixèrent ledit siège sur le tronc à l’aide de pieux qu’ils enfoncèrent dans le sol meuble. Lorsque la pose de cette chaise bizarre fut terminée, ils se reculèrent respectueusement. L’inconnu athlétique qui avait mené la jeune femme s’approcha ensuite du tronc. Il la défit de sa laisse et lui intima de se laisser faire. Ce qu’elle fit avec résignation. La drogue du violeur avait annihilé sa volonté.
Puis le géant, la souleva avec une grande facilité et il l’installa à califourchon sur le tronc. Il l’obligea à s’appuyer sur le siège métallique et il lui attacha les mains dans le dos, en reliant celles-ci au dossier.
Enfin, il écarta le pan de sa veste et sortit de son étui une arme. Il se retourna et ordonna à ses hommes de retourner au camion. Quand il fut seul, il attendit cinq bonnes minutes en observant son œuvre. Puis lentement, il vissa son silencieux. Durant ce temps, la jeune femme, dans cette posture grotesque, sous l’emprise du GHB, ce produit psychotrope très puissant utilisé par les lâches et les impuissants du cerveau, n’avait toujours pas bronché d’un poil.
L’inconnu s’approcha, posa le canon de l’arme sur la tempe de sa victime et tira. Le flop résonna à peine dans la nuit. Le sang avait giclé sur sa main et le trou creusé par la balle avait fait peu de dégâts. Le tueur avait pris ses précautions pour ne pas gâcher son œuvre en choisissant une arme de petit calibre. Il essuya le pourtour de la blessure et pour éviter que le sang ne se répande, il bourra l’orifice de la plaie avec un mastic à prise instantanée.
Sous l’impact de la balle, la mort avait été instantanée. La tête de la jeune femme avait plongé sur le côté droit. Le corps était resté droit car il était maintenu par les mains liées dans le dos du siège.
L’homme sortit de sa poche un fil nylon épais mais invisible et le passa autour du cou du cadavre. Il l’attacha au siège de façon que la tête reste droite. Avec le même genre de fil, il le passa sous les seins et consolida le corps au siège de façon que celui-ci ne bascule pas quand il aurait libéré les poignets attachés dans le dos. Ce qu’il fit juste après. Il arrangea les mains, l’une sur l’autre, à même le tronc, devant le sexe écarté par l’écartement des jambes, à cheval sur l’arbre. Mais un bras retomba et défit son œuvre... Avec cette même patience qui semblait le caractériser, il reprit un bout de ce fil nylon et attacha les poignets de manière à bloquer les bras.
Satisfait, il recula et contempla sa création. Puis, il sortit son portable et fit plusieurs photographies. Il rangea avec lenteur son appareil dans sa poche poitrine et toujours aussi avare de ses mouvements il desserra son ceinturon et fit tomber son pantalon sur ses chaussures. Il n’avait pas de caleçon. Il prit son sexe dur qui n’en pouvait plus depuis des heures et avec délectation, il se masturba. Il éjacula un long jet puissant. A ce moment de l’orgasme, il jura à mi-voix envers sa victime, afin de la châtier une dernière pour avoir été une femme. Juste une femme. Pas plus. Ni moins.
Il se réajusta, regarda encore le corps de la jeune femme, puis il rejoignit d’un pas tranquille le Trafic qui démarra avec la plus grande douceur lorsqu’il grimpa à côté du chauffeur. La besogne n’était pas terminée.
Le trafic libéra tous ses occupants sur un parking d’une zone industrielle déserte. Des voitures étaient garées là, à l’abri des regards. Les hommes avaient ôté leurs cagoules.
Ils se saluèrent comme des vieux potes qu’ils semblaient être et chacun monta dans sa voiture personnelle. Le géant sortit du coffre de sa propre voiture un bidon d’essence et aspergea le véhicule de la poste qu’il avait volé en début de soirée. Il sortit des allumettes. Précautionneusement, il alluma un cube d’un allume-feu qu’il balança dans le Trafic. Celui s’embrasa aussitôt et les flammes qui jaillirent commencèrent à lécher les murs du bâtiment contre lequel était garé le véhicule.
L’inconnu monta vivement dans sa voiture et démarra avec la satisfaction du travail bien fait. Il n’était pas de cette ville et il fut obligé de mettre le GPS pour se rendre à son lieu de rendez-vous matinal.
C’était une cité de banlieue comme il en existait des centaines en France. Une cité avec des barres d’immeubles qui malgré leur embellissement récent n’avait jamais pu empêcher les jeunes de tomber dans la délinquance ou dans la radicalisation. Il coupa le contact et sortit son portable. Il était bientôt six heures du matin. Il fit un numéro. Il attendit dix minutes. Les jeunes des banlieues, comme partout, se couchaient tard et se levaient rarement tôt. Sauf ceux qui allaient bosser. Celui-là, se pointa à bord d’un scooter cabossé. Il stoppa au niveau de la Kangoo. Le géant qui avait l’air coincé dans l’habitacle de la voiture, comme un maquereau introduit de force dans sa boite, baissa la vitre et lui tendit une liasse de billets. Puis il recomposa le numéro et expédia les trois photos de son œuvre à l’adolescent qui n’avait pas attendu pour aller se recoucher.
J’avais connu Montalembert quelques années plus tôt.
Je n’avais jamais assisté à ce genre d’évènement… et j’étais impatient d’arriver. Je conduisais un van California flambant neuf. J’avais gardé la nostalgie de mon vieux camping-car qui avait cramé lors d’une enquête. Puisque j’avais maintenant les moyens je m’étais offert pour moins de cinquante-mille billets ce petit bijou de technologie routière. Certes, j’étais un adepte du camping, mais j’aimais mon confort. Et mon piaf aussi, qui était venu, au plus fort de certaines réflexions, se matérialiser à l’intérieur de l’ancien.
A l’entrée du site, un gardien muni d’un badge accréditant son autorité, me demanda mon laisser-passer. Nous étions jeudi soir. Comme convenu, j’avais appelé la personne qui m’avait invité et qui m’avait octroyé, pour cette superbe compétition, un rôle officiel pour entrer avec mon bahut et ne pas avoir à payer le droit d’entrée qui était de trente-neuf euros par jour. Le gardien m’avait fait garer sur le côté dans l’attente de Anne Marie Georges Haut de Montalembert. Un pur aristocrate qui participait à ce complet de haut niveau, le célèbre 5 étoiles de Pau. Ce complet c’était comme le Roland Garros du cheval. Il n’y avait que cinq compétitions de ce niveau dans le monde. Ce cher Montalembert, comme je l’appelais, en occultant tout ce qu’il y avait devant, arriva sur son vélo tout terrain.
C’était un long gaillard, longiligne et musclé. Il possédait un regard clair qui allait droit devant, qui vous pénétrait et qui allait parfois se perdre derrière vous. Il était militaire et faisait partie du Cadre Noir de Saumur. Il me salua d’un bref signe de main avant d’aller au plus pressé. C’est-à-dire, indiquer au gardien mon état de second groom, et m’ouvrir de la sorte la barrière pour aller positionner mon van à côté de son énorme camion. Là où étaient stationnés tous ceux des plus grands cavaliers de la planète. Il me donna l’accolade, me dit qu’il était ravi que j’aie accepté son invitation, puis il sauta avec l’agilité d’un gamin sur son vélo pour me montrer le chemin. De Montalembert était un cavalier de renom. Il avait participé à plusieurs olympiades, il avait été trois fois champion de France et vice-champion du monde. Ce sportif, de haut niveau, était loin de prendre sa retraite malgré ses cinquante-deux ans passés. Mais dans ce milieu particulier, il fallait prendre en considération la monture. Depuis huit ans Montalembert avait la chance de monter un magnifique étalon qui venait des haras nationaux qui sautait très haut, avec beaucoup de classe et qui n’était pas mauvais au dressage.
Il était dix-sept heures. Le parking était rempli de ces bahuts qui pouvaient transporter à la fois plusieurs chevaux et abriter un logement très confortable pour les cavaliers. J’avais croisé sur le chemin une folle ambiance et bon enfant. Du monde de partout, des chevaux que l’on menait par la longe ou que l’on montait, des attelages, des familles avec les mômes, des ados des mioches, des chiens, des cavaliers reconnaissables à leur bottes, des employés du site sur des voitures électriques, des couples de propriétaires, bras-dessus, bras-dessous, très chics, avec leur suite amicale, des marchands de ballons, des Food truck, ainsi que de nombreux stands dans le village. Bref, un monde grouillant, heureux d’être là. Tout le monde portait un masque. Le couvre-feu planait comme une épée de Damoclès à cause du Covid 19. Je m’étais demandé, au volant de mon beau Volkswagen, pourquoi, par les temps qui couraient, cette manifestation qui allait drainer des milliers de gens, avait été autorisée. Comme il fallait s’y attendre, il y avait toujours de mauvaises langues qui laissaient entendre que le maire de la ville, qui avait ses entrées à Paris, y était pour quelque chose. J’avais eu peur de tomber dans un milieu huppé qui se la pétait et c’était tout le contraire, malgré le fric qui s’étalait dans ces camions et ces chevaux de race. Montalembert ne faisait pas exception. Il portait une culotte de cheval crottée qui avait perdu pas mal de sa blancheur, un blouson noir sponsorisé et une casquette d’une autre marque. Il me fit garer le long de son camion.
Contrairement à ses camarades du Cadre Noir, il participait au complet 5 étoiles de Pau, à titre personnel car il avait acheté, récemment son Pégase de Chiron, au haras national qui avait bien voulu le lui céder, pour une jolie fortune. Mais lui n’avait rien à voir avec un aristo fauché. Son camion, un gigantesque Renault bleu nuit avec sa capacité pour trois chevaux et son appartement pour sa famille était superbe. Sa fille faisait aussi du complet mais elle n’avait pas encore le niveau pour être qualifiée sur celui-là. Par contre, elle avait fait Pompadour et elle s’était classée vingtième avec sa jument de six ans. Dans ce sport, soit-dit, le plus dangereux après la Formule 1, peu importait le classement. On s’estimait heureux de n’être pas tombé, d’avoir évité le Samu et l’hôpital, et d’avoir conservé le cheval en bonne santé.
Montalembert me présenta à sa femme, une jeunette de trentehuit ans et à sa fillette de six ans. Son autre fille, qui faisait office de premier groom, était née d’un autre mariage, vingt ans auparavant. Les présentations faites, je laissai mes hôtes à leur occupation habituelles et m’installai à mon tour. Après avoir pris une douche chaude dans les préfabriqués montés à cet effet, juste à côté, j’avais branché mon van au Renault et j’étais allé faire un tour sur le site.
Nous avions convenu de nous retrouver à vingt heures dans un des restaurants du village. Je désirais les inviter. J’avais au préalable proposé vingt-et-une heure mais mon pote cavalier, m’avait dit qu’il voulait se coucher tôt pour être en forme le matin. Il était convoqué pour le dressage à dix heures trente mais il désirait se lever tôt.
Au repas, il m’expliqua qu’il avait déjà reconnu plusieurs fois le parcours du cross afin de le mémoriser au maximum. Il y avait une bonne quarantaine d’obstacles et le cheval devait être dirigé au millimètre pour les avaler sans coup férir. Il me proposa de l’accompagner le lendemain-matin, à six heures, J’avais tiqué mais noblesse obligeait… je lui devais bien ça et j’avais hâte de connaître les particularités techniques de ce sport que je découvrais.
J’avais connu Montalembert, quelques années plus tôt. Il avait été accusé d’avoir descendu raide-mort, à l’aide de son fusil de chasse, un cambrioleur sur son domaine ancestral, en bord de Loire. En réalité c’était un de ses employés qui l’avait tué, pour une histoire de fesses et de chantage, que mon piaf avait résolu en quelques jours. De lui avoir ôté cette épine de sa botte de cavalier avait permis la naissance d’une discrète mais fidèle amitié.
Debout bien avant l’aube, nous étions fin octobre et le jour se manifestant plus tard, j’avais à peine avalé mon café brulant que Montalembert toquait à ma porte. Il m’invita à le suivre aux écuries pour me présenter Pégase. Sa fille était déjà à l’œuvre pour le bichonner. C’était une magnifique bête et en observant Montalembert, je mesurai l’amour qui unissait un cavalier de sa trempe à son cheval. Il l’avait payé une fortune car l’amour n’avait pas de prix.
A peine la clarté du jour eut-elle fait son apparition, que ce bougre de Montalembert m’entraîna au pas de course sur le circuit. La veille, il m’avait dit que celui-ci faisait plus de sept kilomètres. J’avais jugé plus prudent de me munir de mes chaussures de randonnés qui ne quittaient jamais le camion. En outre, il y avait eu l’humidité de la nuit avec une fine pluie et mieux valait être paré pour affronter l’herbe mouillée et la boue dans certains passages.
Le comte, car en plus, le gars possédait un titre de noblesse avançait vite en m’expliquant le parcours. Dès les premiers obstacles je fus soufflé de constater la hauteur des barres et la longueur que le cheval devait sauter. Nous passâmes devant une représentation, grandeur nature d’une belle vache blanche à tâches noires, devant sa cabane, qui avait l’air d’attendre le départ du complet qui n’avait lieu que le samedi.
Nous arrivâmes rapidement au niveau du premier guet. Le cavalier devait sauter une barre entre des bouquets de fleurs pour retomber plus bas dans l’eau, galoper dedans pour sauter ensuite dans la foulée par-dessus trois autres obstacles. Je vis, avec un certain ébahissement, monsieur le comte enlever ses baskets, ses chaussettes, remonter son pantalon, et chaussures à la main, aller franchement dans la flotte. L’homme compta ses enjambées jusqu’au premier obstacle, puis il revint sur ses pas et recompta une deuxième fois, passa au suivant et ainsi de suite. Revenu sur la terre ferme, il m’expliqua que la foulée de son cheval correspondait à un certain nombre de ses pas et de cette façon, il pouvait calculer l’endroit exact où il allait ordonner à sa monture de prendre son élan. En fait, le cheval ne faisait pas ce qu’il voulait... Tout était une question de confiance entre le cavalier qui tenait les rênes et le cheval qui devait réagir en toute confiance au quart de poil et de ne point refuser de sauter, ce qui arrivait parfois.
Puis toujours à la même cadence, je commençais à suer le burnous, nous attaquâmes la suite du parcours. Le soleil avait fait une timide apparition et nous étions toujours les premiers sur le circuit. En quittant le guet, j’avais aperçu un autre gars qui commençait à patauger dans l’eau. Mais celui-ci, avait mis une paire de bottes. Ce qui n’était pas con. Mais plus ardu au niveau de la marche.
En réalité, Montalembert, comptait chaque fois le nombre de ses pas. Il m’expliquait à chaque nouvelle difficulté ce qu’il escomptait faire, comment il allait s’y prendre, quelle courbe il devait choisir. J’étais ravi d’entendre ses explications pour deux raisons. La première, il alimentait ma curiosité sportive et la seconde cela me permettait de reprendre mon souffle.
Nous arrivâmes sur la partie de l’hippodrome d’entraînement. Nous avions amorcé la boucle du retour quand Montalembert se mit à galoper comme un fou furieux. Un instant étonné, en voyant ce grand escogriffe allonger ses grandes guiboles de cavalier dans un sprint effréné, je restai là planté, à le regarder ainsi courir. Je levai les yeux et mon regard se porta sur ce qu’il avait vu. Et putain, moi aussi, je me mis à courir comme lui. Mais en moins efficace.
L’obstacle suivant était un simple tronc d’arbre. Il y avait déjà
une cavalière. Mais elle était morte. C’était étrange et morbide. La victime était nue, toute peinturlurée, à cheval sur le tronc et maintenue par un siège métallique, fait de tubes boulonnés. J’étais flic et ce n’était pas la première fois que je voyais un cadavre. Celui-ci était bizarre dans sa présentation.
Montalembert était blanc. Il fixait la femme avec horreur. Il n’était plus question de compter ses pas.
J’avais mon portable sur moi et j’appelais aussitôt le SRPJ de Pau. Nous devions sécuriser au plus vite cette partie du circuit avant que les autres participants au concours ne se pointent. Montalembert appela de son côté la sécurité du site pour qu’ils agissent rapidement. Et cinq minutes plus tard, deux voitures électriques montrèrent le bout de leur capot.
Puisque le boulot me rattrapait, et cela même lorsque j’étais en vacances, je fis les premières constations... A l’évidence, cette fille avait été tuée d’une balle dans la tempe par un petit calibre et la blessure avait été obstruée par je ne sais quoi… Sans doute, le tueur n’avait-il pas voulu abîmer son œuvre... Cela paraissait évident. Ce qui l’était aussi, au vu des traces de pas sur le sol sableux, et de toute cette mise en scène qui avait demandé un certain travail. Le tueur n’avait pas agi seul.
Le capitaine Moulinot du SRPJ de Pau arriva le premier, suivi de peu par son coéquipier, le lieutenant Majorel qui avait été chercher, au passage, un jeune juge, dont on oublia de me dire le nom. Les gendarmes rendus sur place, s’activèrent afin de sécuriser les lieux. Puis les officiels du concours se pointèrent et même le préfet qu’on avait tiré du lit arriva une heure après. Tout ce petit monde avait un problème important à résoudre. Mais fort heureusement le cross n’avait lieu que le samedi et le légiste avait tout son temps pour faire son job. Je fis mon rapport au capitaine Moulinot et lui promis de venir le voir au commissariat. Il accepta de ne pas convoquer Montalembert. Officiellement c’était moi qui étais arrivé le premier sur la scène de crime.
Montalembert était reparti à son camion, dès qu’il avait pu, pour s’habiller suivant l’usage pour l’épreuve du dressage. Un quart d’heure avant son passage, je m’étais éclipsé de la scène de crime. J’étais venu à Pau pour assister à cette compétition. Je n’avais pas l’intention d’y renoncer.
Accoudé à la barrière, parmi la foule, j’avais donc assisté au passage de Montalembert. Son image était apparue aussitôt sur les écrans géants, placés un peu partout sur le site. Seuls les spécialistes pouvaient juger du comportement du cheval et de son cavalier. Pour ma part, j’avais trouvé que le couple, avait une fière allure. A la fin de son parcours, le sourire du comte avait montré sur tous les écrans qu’il était satisfait de sa prestation.
Plus tard, nous nous retrouvâmes tous pour l’apéro. Victoria, l’épouse du comte, qui était d’origine galicienne, avait dressé une table de camping, à l’avant du camion, sur un bout de pelouse, derrière l’estrade métallique où des curieux et des acheteurs avaient pris place, face au stand consacré à la vente des chevaux. D’où nous étions, nous pouvions voir cependant une partie du spectacle.
On me servit un petit blanc bien frappé avec quelques huitres tandis que l’animateur vantait au micro les atouts d’un jeune alezan qui galopait autour de la piste en sautant une barre afin de démontrer ses capacités. Son prix était de vingt mille euros. Le suivant, ne coûtait que neuf mille euros mais sa lignée était moins noble. J’avais compris que dans ce business sportif, la côte d’un cheval dépendait du nombre de ses bons résultats dans les complets nationaux et internationaux. Le prix d’un cheval pouvait atteindre des sommes folles... L’investisseur pouvait aussi perdre sa mise sur une chute brutale s’il fallait abattre la bête, comme malheureusement parfois cela arrivait.
Deux cavaliers et amis de Montalembert se joignirent à nous pour l’apéritif. Un célèbre vétéran tricolore Jean Teulière, au palmarès éblouissant, champion du monde en 2002, et un non moins cavalier émérite, Jean-Lou Bigot avec des résultats tout aussi impressionnant, notamment avec son titre de champion d’Europe en individuel avec son célèbre cheval Twist la Beige en 1993. Que des pointures ! J’étais impressionné.
Puis mon portable sonna.
- Je suis occupé ! répondis-je peu amène.
C’était le capitaine Moulinot et j’avais répondu un peu trop vite. Je me radoucis aussitôt.
- Excusez-moi commissaire ? me dit-il. Je vais vous envoyer quelqu’un vous chercher à quinze heures, cela vous va ?
- C’est bon ! Je ne comptais pas faire la sieste.
Je raccrochai et me replongeai dans l’écoute de la discussion qui animait ces piliers de l’équipe de France d’équitation. Puis Jean-Lou Bigot me demanda ma profession.
- Il est commissaire, répondit à ma place Montalembert.
Cela eut l’air de les impressionner, mais à peine le temps d’un froncement de sourcils, puis le trio reprit leur discussion… La découverte macabre commençait à faire parler d’elle. Mais, à priori, ces messieurs avaient autre chose à penser... Le cross démarrait à treize heures trente le lendemain et il n’y avait que cela dans leurs têtes. Ce que je comprenais. Moi c’était pareil quand je cogitais sur un meurtre.
Après avoir fait ma déposition officielle, Moulinot m’invita dans son bureau.
- Que pensez-vous de ce crime ? dit-il.
- Cela ne sent pas bon... Il y a beaucoup de préparation dans cette mise en scène. J’ai peur que cela ne soit pas un cas isolé.
- On vient de nous alerter que des images du corps couraient sur les réseaux sociaux.
- Déjà ? m’étonnai-je. Il y a eu des fuites ?
- Non ! D’après le peloton de surveillance des réseaux de la gendarmerie, les photos ont été mises en ligne bien avant la découverte du corps. C’est sans doute l’assassin lui-même qui a fait ça.
- Ils ont pu remonter la source ?
- Pas encore, mais c’est parti d’un quartier populaire de Pau, L’Ousse des Bois.
- Merde alors ! Vous avez visionné les vidéos de surveillance. J’ai aperçu ce matin des tas de caméras de télévision, sous des bâches, positionnées déjà dans l’attente du cross de demain. J’imagine que cela doit coûter pas mal de pognon et que les organisateurs ont prévu une surveillance adéquate.
- Exact ! On a des images mais le domaine de Sers est grand. On n’a rien pour la scène de crime. La seule chose de positif que nous détenons c’est le nombre des protagonistes. Ils ont découpé la clôture et pour accéder à l’obstacle, ils ont traversé une piste sableuse. Nous avons pu relever ainsi les empreintes. Ils étaient nombreux. Cinq au total. Il y a une sixième trace mais c’est celle d’un pied nu de femme... Par contre il n’y a pas d’empreinte. Les types devaient porter des gants. Une analyse plus poussée de recherche d’ADN sur le corps et le tronc d’arbre est en cours par la scientifique. La jeune femme a été transporté à l’IML de Pau pour l’autopsie.
A ce stade l’enquête démarrait à peine. Je n’étais qu’un simple citoyen qui avait découvert le corps. J’étais en vacances et je comptais bien en profiter. Je remerciai le collègue et le laissai bosser. Le lieutenant Majorel me ramena au 5 étoiles.