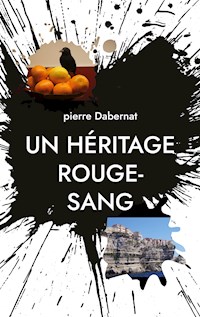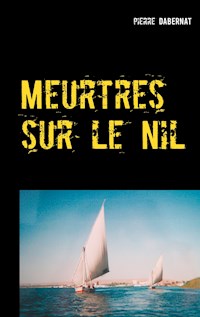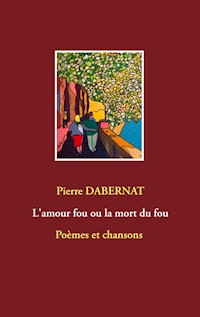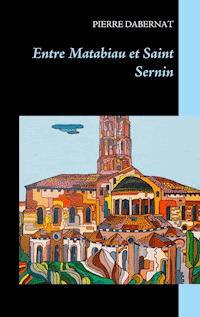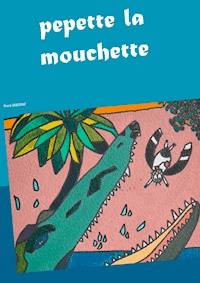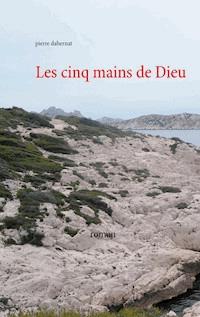Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Mirida jeune berbère, contrainte de se marier à un vieil homme riche, recueille et protège un jeune fou perdu dans la montagne. Ce jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus est un étranger et sa présence au col de L'arbre est surprenante. En outre elle constate que le jeune garçon parle aussi sa langue, le dialecte Tachelhaït, celui des tribus berbères de l'Atlas. A la fin de l'été le joli jnoun comme elle l'a baptisé recouvre en partie sa mémoire. Elle comprend alors que derrière tout cela se cache un lourd secret.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce livre est dédié à Rosita
Sommaire
Préface
Il mange la terre
Le collier de l’existence
C’est un diable
Qui se coupe le doigt
Mathias
Moi Simoan sans autre nom que celui-ci
Il ose m’affronter derrière sa mort
Il n’était qu’un fantôme
La loi du plus rude, du plus rusé
Être saint ne veut pas dire être dupe
A mort les étrangers
Dieu s’est fourvoyé
Le poison va devenir remède
C’est alors qu’il vit le cheval
Voici l’argent
Des ongles de buveurs de sang
Préface
Je me souviens du jour où j’ai décidé d’écrire ce roman. C’était durant le mois de février 1976 à Tours. Plus exactement entre Joué-lès-Tours et le parc Grammont.
J’étais installé sur ma mobylette, les voitures me frôlaient et je les ignorais. J'étais pris par ma cogitation, la main soudée sur la poignée des gaz. C’était un matin frileux et humide avec un plafond de nuages gris obstinément immobiles. Je me rendais au boulot. J’étais un simple gratte-papier à EDF (Électricité de France). Je passais le temps à aligner des sommes monstrueuses pour la construction de plusieurs centrales nucléaires, Chinon, Dampierre, Saint-Laurent et d’autres...
« On » m’avait volé mes études.
J’avais voulu m’inscrire à la faculté des lettres. « On » en avait décidé autrement. « On » c’était moi. « On » c’était surtout ma lâcheté. Devant l’autorité de mon père, qui ne désirait que mon bonheur, je n’avais pas eu le cran de dire non et de passer outre. « On » c’était mon mariage car, en ce temps-là, on se mariait jeune. « On » c’était aussi ma fille qui me ravissait le cœur avec son sourire. « On » c’était l’obligation de travailler, d’assurer un salaire ! « On » me chavirait l’esprit...
Ce matin-là, « On » me souffla l’idée d’écrire un livre, pour me prouver enfin que je n’étais pas un moins-que-rien, moi le petit bachelier qui avait passé le baccalauréat à l’arraché, qui avait peine à écrire, et qui se battait avec l’orthographe, la grammaire et qui ne possédait comme culture générale que celle offerte par l’éducation nationale de l’époque.
Cette décision bouleversa ma vie. Sans plus attendre et poussé par cette soif dévorante, le soir même, je rentrais, comme l’on dit, en littérature avec la belle innocence de l’adolescent attardé que j’étais. Quelques années auparavant, j’avais commencé à scribouiller quelques chansons derrière les murs du pensionnat lorsque la solitude me pesait trop. Cela se passait à Toulouse, chez les pères jésuites, pendant que mon père construisait des barrages au royaume du Maroc. Je n’avais rien trouvé de mieux pour communiquer avec ce « On » qui barrait mon existence que d’aligner des alexandrins bancals, dans une poésie blessée qui calmait mes angoisses.
Mes parents vivaient à Rabat depuis 1968. J’avais lu avec beaucoup d’intérêt un recueil de poèmes qui s’intitulait « Les chants de la Tassaout ». Ce recueil datait de 1972. Il était signé par un certain René Euloge qui avait été un jeune instituteur au Maroc. Celui-ci avait rencontré en 1927 une jeune berbère qui était en même temps hétaïre et poétesse sur le souk d’Azilal. Elle s’appelait Mririda n’ait Attik. Ces chants-là relevaient de la tradition orale des tribus qui vivaient depuis la nuit des temps dans les hautes vallées de l'Atlas.
Elle avait touché ma sensibilité.
René Euloge explique que cette jeune femme n’avait pas atteint la trentaine. Les sous-officiers français du Goum n’étaient pas familiarisés avec le dialecte Tachelhaït. Ils ne se souciaient pas de ces poèmes et chants pour eux complètement inintelligibles. René Euloge avait donc eu l’excellente idée de les traduire en sauvant cet héritage précieux.
Ces textes représentent la mémoire de ce peuple. Ils décrivent la détresse des montagnardes. J’étais en admiration devant ces poèmes. Mririda pour éviter la honte à sa famille avait toujours caché de quel village elle était native. Le mystère de la jeunesse de cette jeune femme enflamma mon imagination et m’offrit le premier personnage de mon roman.
Le deuxième personnage ressemble au jeune garçon que j’étais puisque cet ouvrage est le premier que j’ai écrit.
Durant des mois, des années, en leur compagnie, j’ai donc vécu le long de l’oued Tassaout. Avec eux j’ai appris à vivre et aussi à grandir. Ce livre je l’ai écrit plusieurs fois, en l’améliorant.
C’est ce roman qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui : un écrivain humble parmi tant d’autres, mais un écrivain toutefois, et qui se penchera sur ses feuilles, sur ses carnets, jusqu’à son dernier souffle, jusqu’à l’ultime crispation de sa main.
Je ne voulais plus travailler à EDF, société ou mon père m’avait fait rentrer. Par fierté, en 1980, j’ai démissionné. Je suis revenu vivre à Toulouse, ma ville natale, avec mon épouse Rosita, ma fille et mon manuscrit tandis que mon père après douze ans de service rendu au royaume du Maroc, retournait en France afin de terminer sa carrière d’ingénieur, après avoir été décoré par le roi Hassan II lors de l’inauguration du barrage de Ksar-et-Souk. Maintenant appelé Errachidia.
Je pensais avoir réglé ma vie mais je m’étais encore fourvoyé. J’ai payé cette nouvelle erreur chèrement en passant vingt ans dans un magasin à vendre des costumes dans une boutique de famille. Suant et transpirant derrière des cravates en soie, j’en devins après des années de labeur le directeur. Mais je n'étais toujours pas un homme serein.
J’ai donc démissionné, pour la deuxième fois de mon existence, à l’aube de ce nouveau siècle. Je suis devenu écrivain public, agent immobilier, pompiste, pour enfin oser, en ravalant ma fierté, aller taper à la porte de quelqu’un de bienveillant qui m’a ouvert celle de la médiathèque José Cabanis à Toulouse où j'ai terminé ma carrière professionnelle.
Le beau temps a succédé à la tempête.
Mes livres seront-ils rangés sur les étagères d’une bibliothèque, en compagnie des écrivains obscurs ou célèbres ? Je n'en sais rien et je m'en fiche. Ce que je sais c'est que j’écris pour être lu mais aussi pour rester vivant après ma mort. J’écris pour ma deuxième vie. Tant que mes manuscrits, mes carnets, existeront, à travers eux, j’existerai encore. Toutefois je sais que viendra le jour où il n’en restera rien, lorsque personne ne sera là pour se souvenir de moi, pour lire mes livres, écrasés par le pilon du temps.
Ce jour-là, je sais qu’il faudra me résoudre à ne plus être Pierre.
Mais peu importe ! Je dois écrire.
Il mange la terre
Mirida, légère de son quatorzième printemps était à bout de souffle. Les cheveux emmêlés, le visage rougi par l’effort d’être arrivée la première elle s’arrêta sous les noyers.
Elle encouragea Madia qui s’éreintait sur le sentier abrupt, brûlant, inondé par le soleil écrasant de cette belle matinée d’été. Haletante, écarlate, la jeune fille rejoignit son amie. Elle s’écroula sur le sol rocailleux, enleva ses sandales puis desserra sa ceinture de laine. Mirida éclata de rire :
- Tes jambes sont si délicates que tu veuilles déjà te reposer !
Madia avait jeté ses dernières forces pour suivre le rythme de Mirida, véritable petite chèvre. Elle n’avait plus d’énergie pour ouvrir la bouche et répondre à l'impertinence de son amie. Le reste de la troupe composé d’une poignée de femmes déboucha peu après. Certaines n'étaient plus très jeunes. Malgré la peine qu'elles avaient eue pour gravir le sentier elles n'étaient guère fatiguées de la langue. Elles imitèrent la souriante Madia.
- Mettons-nous à l’ombre, annonça l’une d’elles. Nous serons assez tôt l’échine courbée sur le champ d’Astor notre chef. Sa rapacité inaltérée par la chute de ses vieilles dents tombées, après la corvée du bois, du maïs, des noix, de l’orge et du blé, et aussi du désherbage nous ordonne chaque fois la dernière… Aujourd’hui, c’est celle du blanc navet.
Une sonate cristalline de rires lâchés, notes claires, s’éleva au-dessus de ces têtes brunes et se noya dans le vieux silence des gorges de l’Assif Timouta.
Astor avait toujours abusé de ses privilèges de chef de village. Quand le pouvoir repose au creux de la main il brûle les doigts qui l’enserrent. C’était un homme au visage édenté, bedonnant, et qui souriait peu. Il avait la charge de son village qui relevait de la juridiction du cheikh de Demnate.
Les femmes prirent le temps pour se mettre à la tâche. Aucune n'avait envie de faire du zèle pour un tel maître. Lorsqu’en fin de journée, il arriva, suivi de ses mulets, la cueillette n’était pas finie. Les sourcils froncés, en maugréant, il déchargea les sacs.
Il les entassa méticuleusement sur le sol, puis il s’approcha des femmes. Elles s’étaient toutes remises à travailler comme si un orage allait éclater. Astor campé dans sa colère balbutia devant les travailleuses :
- Ainsi… les navets… Ainsi…les navets…
La rage l’empêchait de parler.
Mirida ne craignait pas les hommes, malgré leur barbe et leur bâton. Elle se releva droite, les mains sur les hanches. Le visage encadré par sa chevelure noire, elle mouilla ses lèvres séchées et répondit malicieusement :
- Tu nous as envoyées à la tâche sans nous avoir souhaitées suivant la bienséance la formule sacrée : « Nous t’invoquons Dieu pour que tu bénisses notre travail ! » Notre colère, notre humiliation est profonde. C’est la raison de notre retard.
Madia, derrière tant de courage se jeta bravement à son tour dans la joute aux excuses. Avant qu’Astor ne puisse répliquer, elle ajouta :
- Les muletiers de Demnate sont venus pour nous importuner. Nous avons couru pour leur échapper, attendre qu’ils repartent.
Astor, face à ce bouclier de paroles inventées de toutes pièces, riposta d’une voix grinçante :
- Menteuses ! Langues de serpent… Il n’y a pas eu de muletiers aujourd’hui. Et la formule je l’ai dite. Mais vous étiez tellement occupées à causer que vous ne n’avez rien entendu. Remplissez donc les sacs si vous ne voulez pas goûter à ma fureur. Allez Femmes ! Dépêchez-vous... N’oubliez pas qu’ensuite il faudra suspendre les navets le long de mes murs.
Mirida n’insista pas et se remit à l’ouvrage. Elle chuchota en direction de Madia :
- J’espère que l’hiver sera long. Qu’il sera obligé de les manger tous et qu’il en mourra étouffé !
Les mulets chargés, elles prirent le chemin du retour, les reins courbaturés, la langue coupée par le travail effectué.
Lorsqu’elles arrivèrent, la nuit était déjà tombée. Astor, écœuré, les renvoya non sans les avoir convoquées pour le lendemain. Mirida remonta le village accroché à la pente. Sa vivacité avait succombé au champ d’honneur du navet. La maison de ses parents était la plus haute perchée. La plus isolée. Une des plus modestes aussi…
Ce soir-là, avec un féroce appétit et bouche pleine, elle conta l’attitude du chef du village à sa mère, de quelle façon elle avait répondu. Devant le plat de légumes bouillis, la vieille femme conclut :
- Ce n’est qu’un vulgaire hibou !
Mirida se leva et chercha un verre pour servir du thé à sa mère.
- Avons-nous des nouvelles de la guerre ?
- Quelques-unes ! Moulay Hafid notre sultan court encore après son frère Abdelaziz le traître. Puisse Dieu lui faire mordre la poussière avant qu’il nous réduise en esclavage !
- Madia m’a affirmé que le capitaine d’Amade n’avait pas osé s’en prendre à notre armée. Il a bien trop peur de nos cavaliers et de nos sabres.
- Détrompe-toi ! Il a le courage du sanglier. Les soldats français sont braves et bien payés. J’ai peur qu’ils ne viennent à bout de nos vaillants guerriers. Les nôtres n’ont que la foi pour soutenir leur poignet, aiguiser leur regard.
Elle baissa le ton comme si les murs avaient une oreille. Sur un air de confidence elle répéta à sa fille ce qu’elle avait entendu la veille chez le guérisseur. Moulay Hafid avait proclamé contre son frère une guerre sans merci. Ce frère qui était devenu par mollesse le valet des envahisseurs.
- Ses lieutenants le harcèlent. Ils attendent le restant de l’armée partie déjà depuis trois jours. La grande bataille ne devrait plus tarder…
- Pourquoi tant de haine ?
- Ils se disputent le pouvoir. Moulay Abdelaziz a renié tous ses ancêtres. Il joue à la balle en tapant avec un bout de bois sur des terrain de terre battue. Il se déplace dans son palais en équilibre sur des engins en ferraille. Il enferme les âmes de ses courtisans dans des boites en bois montées sur pieds. Il s’entoure d’objets qu’ils appellent d'un ton enjoué « ses jouets mécaniques ». Les impôts dont il nous accable ne lui suffisent plus. Maintenant il emprunte aux étrangers et il dépense sans compter l’argent dans un luxe inutile. Il a même acheté des charrettes qui n’ont besoin d’aucun bestiaux pour rouler. Nos mulets font moins de tapage ; ils sont bien plus propres et grimpent sans aide le long de nos sentiers. Il est temps qu’Abdelaziz soit corrigé ! Le fourbe doit retrouver le chemin de la piété s'il veut qu'Allah lui pardonne. Et ses amis n'ont qu'à retourner chez eux !
- Mère calme-toi… Tu veux faire la guerre toute seule, avec le fer de ta colère. Méfie-toi, elle est capable de se retourner, de te tuer.
Elle dévisagea longuement sa fille. Le regard brouillé dans son visage ravagé par le labeur, elle murmura :
- Ton père est encore vivant... C’était le meilleur de tous il y a quelques années à peine.
Dans la faible clarté de l'âtre rougeoyant, sans y croire, elle ne put s’empêcher de rajouter fièrement :
- Je suis sure qu’il ramène à chaque attaque une tête suspendue à la selle de son cheval.
- Il doit être beau...
- Ton père ! Tu peux le dire ma fille…
- Non, pas lui ! Je parle du sultan Moulay Hafid, le pur. Parfois je l’imagine parmi les fantassins déguenillés, les fiers cavaliers, les marchands et les femmes des souks. Tu crois qu’ils ont des prisonniers ?
- Des centaines ma fille ! Enchaînés par vingt ou trente, ils sont à l’arrière du convoi.
Blottie dans le nid des coussins épais, alléchée par la curiosité, Mirida implora sa mère :
- Raconte-moi !
La mère se servit une autre tasse de thé à la menthe. Elle avala lentement une gorgée puis elle ferma les yeux. Pour mieux se souvenir. Sa jeunesse... Toute une époque.
La nuit enveloppa Magdaz. Le sommeil couvrit les maisons de son épais manteau gris. Mirida, les yeux fixés sur la multitude étoilée, rêva longuement qu’un de ces altiers et jeunes cavaliers venait la chercher pour rejoindre le sultan.
Les yeux encore gonflés par le sommeil de cette nuit fraîche et sans lune, tourmentée par les clameurs de la bataille, par les cris des fiers guerriers couverts de sang, par les envolées des sabres scintillants, par les têtes hurlantes, décapitées dans des soleils de gouttes rougeâtres, nuit tragique dans laquelle le récit de sa mère l’avait entraînée, Mirida se réveilla.
Elle se leva péniblement puis, le ventre vide, rejoignit les filles du village qui attendaient devant la plus belle, la plus spacieuse des demeures. Bien sûr celle d’Astor. Elles saluèrent Mirida par des rires et des moqueries.
- Tu étais la première au champ Mirida. Tu as trop couru hier. Ce matin tu es la dernière. Les guirlandes de navets ne doivent pas attendre…
Penaude, elle se réfugia près de Madia. Le groupe calmé, elle se renseigna :
- Astor s’est-il aperçu de mon absence ?
- Non ! Il était trop pressé d’aller se recoucher avec sa nouvelle femme quand nous sommes arrivés.
Le travail cessa quand toutes les guirlandes furent suspendues, prêtes à la cuisson du soleil. Madia annonça :
- Le soleil commence à redescendre et moi j’ai faim. Tu viens Mirida ?
- Oui ! Mais avant je dois ramasser du bois. Notre cheminée a perdu sa flamme.
Quand elles revinrent les derniers rayons du soleil rasaient les toits. Les ombres se lovaient comme des couleuvres sur le sol. La température baissait. Contentes de leurs fagots, les jeunes filles trouvèrent la mère baignée de pleurs. Elle s’arrachait les cheveux. Elle se frappait les joues et les griffait avec les ongles de ses pauvres mains ridées. Effondrée, juste après hystérique, elle était entourée par des femmes du village qui tentaient de la calmer. L’une d’elles se rua à leur rencontre.
- Pleure Mirida ! Petite reine, pleure donc… Ton père est mort. Le vaillant guerrier a péri dans la bataille, le foie coupé, malgré le tatouage sur son épaule qui le rendait invincible. Le poignard d’un chien bâtard lui a dérobé la vie. Il a roulé par terre pour la manger, retrouver sa naissance. Console-toi quand même fille du malheur ! L’ennemi n’a pas eu sa tête. Elle n’a pas été salée par le juif au grand regret des mouches. L’imposteur a perdu la face. C’est le grand, le vénéré Moulay Hafid qui impose sa loi aux chiens arrogants, à ces impies qui nous méprisent de haut de leur richesse, de leurs palais de marbre.
Mirida sentit comme une pierre pénétrer dans sa bouche. Une pierre qui forçait le passage de sa gorge. Souffrance...
Elle eut l’impression de se vider de son sang et brusquement se précipita dans les bras de son amie. Elle éclata en sanglots. En cris aussi. Impétueusement. La peine était lourde, trop brutale. Elles s’assirent à l'écart, à même la terre, dans la poussière du sentier, jambes croisées, écrasées par la nouvelle affreuse.
Dans l’affolement de la situation, la mère les rejoignit et se jeta sur sa fille ; elle s’empara de sa main et sur sa poitrine maigre la serra nerveusement.
- Tu es la fille de l’homme, de mon mari ! Tu es sa fille unique. Maintenant il est mort. Je n’ai plus que toi. Je lui avais promis de faire un fils et c’est une fille qui est venue. Je lui avait répété qu’il était trop vieux pour aller se battre, et suivre le seigneur Moulay Hafid. Mais sa jeunesse poussait sous sa barbe blanche. Ses jambes serraient encore bien le ventre du cheval. Il est mort et je ne lui ai pas donné de fils. Qu’allons-nous faire ma fille ? Qu’allons-nous faire sans lui ?
Mirida se dégagea de la pauvre femme qui sous l’emprise de la peine éparpillait son esprit dans le silence noir de la vallée. Elle se leva et courut se réfugier sous un rocher au bord du torrent. Elle trempa dans l’eau froide son visage de larmes. Sans bruit, en petite fille elle pleura de tout son être.
Son père, son héros, si beau, si courageux, cet homme si doux était mort. Le seul homme du village qui lorsqu’il parlait aux femmes n’élevait pas le ton. Le seul aussi qui refusait de battre son épouse et sa fille. Le seul qui avait osé dire, lorsque le chef du village de la basse vallée était venu la demander en mariage, qu’il n’était pas d’accord pour vendre sa fille. Elle était libre de choisir son mari. C’était le seul homme qu’elle ait connu et qui pensait cela. Cet homme était son père. Maintenant il mangeait la terre.
L’eau sourde à ses gémissements continuait sa course folle et bouillonnante. Le ciel était étoilé et la lune était revenue. Elle baignait le haut de la vallée de l'oued Tassaout d'une luminosité dorée. Mirida se releva et réintégra la maison le visage défait. Des pleureuses se tenaient près de la mère. Effondrée dans un recoin sombre de la pièce, celle-ci, véritable loque, montrait un regard hébété sur ces trois femmes venues pour perpétuer une tradition qui n'avait jamais plu au défunt. Mirida le savait. Elle ne put en supporter davantage. Elle se rendit chez Madia où elle demanda une place pour dormir, se reposer loin de ce simulacre de tristesse.
Le lendemain, épuisée, flageolante, elle s’en alla quérir auprès d’Astor le récit de la mort du père. D’une voix de circonstance, le chef du village lui expliqua qu’après avoir succombé à une vilaine blessure, son père, son vieil ami, avait été mis avec ses compagnons dans une fosse commune à cause de la chaleur. Puis, il la pria de s’asseoir sur un pouf et lui conta la bataille qui avait eu lieu sur l’oued Tassaout.
- Moulay Abdelaziz a été lâchement abandonné par sa harka. Après la débandade, il a fui sous la fusillade de nos villages. Il a réussi à rejoindre un détachement de soldats français qui l’a pris sous sa protection. Malheureusement Allah n’a pas voulu qu’il périsse. Le renégat s’est réfugié à Casablanca.
Elle le remercia d'une petite voix. En signe de reconnaissance, de respect, elle lui baisa la main. Puis elle rejoignit sa mère qui dormait. La maison était vide et désertée. Elle avait reprit son habitude silencieuse. Mirida alluma le feu et elle fit bouillir de l’eau.
La mère avait trop gémi. Maintenant elle acceptait cette fatalité avec un sentiment absolu de lassitude. Ainsi tout était fini. Elle se redressa cependant ;
- Il faut songer à l’avenir, ma fille… Il faut y songer…
A bout de nerf, Mirida s’écria :
- Je ne fais que cela, mère ! Les blés n’attendent pas. Et si les navets d’Astor sont suspendus, les nôtres sont loin de l’être. Je ne pense pas que ce vieux bouc viendra m’aider à les ramasser.
Le collier de l’existence
Mirida se leva soudainement. Elle empoigna le balai et chassa, à grands renforts de cris et de gestes, l’abeille qui venait de la piquer. Sa mère qui somnolait dans le fond de la chambre se réveilla et demanda pourquoi tant de tapage. N’obtenant aucune réponse elle se retourna sur sa couche et attendit que le calme reprenne possession des lieux.
Pourquoi avait-elle mangé la veille au soir du mariage de sa fille l’andouillette grossière, ce plat pour inférieur, ce plat pour démuni et ventre tenaillé ? Elle avait bu pour apaiser la douleur une tasse de thé froid saupoudrée d’une pincée de feuilles de Talidrar. Malgré le fait d’avoir tout évacué, pareil au nouveau-né, les jeux du démon persistaient en ses entrailles.
Le futur mari de sa fille était un homme riche qui habitait plus bas dans la vallée, à une demi-journée de marche de Magdaz. Il possédait une retraite d’adjudant des Goums, un troupeau de vaches et autant de moutons que les doigts de sa femme et de ses enfants réunis. Il était venu demander la main de Mirida… Quelle bénédiction de Dieu ! avait loué la mère. Plus de tripes dans le plat de terre et plus d’oripeaux sur le corps mais du lait de Bouba la vache dans le bol et du bon fil de laine pour le manteau sur ses épaules l’hiver prochain. Si la belle ensorcelait, comme il se doit, son futur vieux mari, elles pourraient quitter ensemble leur bicoque et habiter dans la belle maison ocre, dressée au flanc de la montagne.
Mirida écrasa l'ouvrière des fleurs. Vengeresse piteuse, elle eut aussitôt honte de ce crime facile. Mais par ce geste, elle avait l’impression d’avoir tué son ressentiment envers les hommes et envers leurs coutumes injustes. Pourquoi devait-elle épouser ce vieil ours à la barbe de henné? Sa mère voyait dans cette union inespérée une faveur divine. L’occasion de les sortir enfin de la misère où la mort du père les avait plongées.
Mirida depuis ce jour maudit était moins soumise à la volonté de Dieu. Ce chemin dans lequel s’était engagé son cœur restait un secret bien enfoui. Le clan n’aurait pas toléré une fille folle qui remettait en cause l'autorité du créateur. Combien de fois ne lui avait-on pas répété qu’elle devait obéissance à son père et maintenant à sa mère ! Pourtant combien il aurait était bon et doux de suivre la volonté de celui qu’elle chérissait tant. Par contre se plier à la volonté d'autres que son père était une idée qui lui était difficile à accepter. Mais où se réfugier ? Elle se cognait sans espoir au lendemain. Un vieillard allait être son mari, son premier amant. Demain elle serait obligée de frotter sa peau tendre et douce contre la pelure de cet homme, au corps pareil à l’écorce d’un cèdre. Ce goumier qui n’avait connu que les filles des souks, qui ignorait l’emplacement des sources fraîches où il est si agréable de se laver.
Elle posa le balai dans un coin. Agenouillée dans la pénombre, près de la vieille, créatrice de ses jours, elle demanda :
- Pourquoi dois-je l’épouser ?
La malade se retourna sous sa couverture.
- Tu parles comme la pie ! Sans connaître le son de ta chanson.
- Faut-il que je l’épouse ?
Le bon sens montagnard, solide, égal au roc, lui avoua sincère :
- Parce que tu es pauvre et qu’il est riche. Tu es belle et qu’il est vieux !
La mère péniblement se mit debout. Mirida osa alors une parole outrageante.
- Si je ne voulais pas l’épouser, que ferais-tu ?
- J’appellerais les hommes du village, répondit la vieille sans sourciller. Je leur dirais que tu n’es plus ma fille…
- Tu n’oserais pas !
- Naïve… Tu n’es qu’une fille ingrate. Tu es indigne de mon ventre.
- Ainsi, répondit Mirida, je n’ai pas le droit de choisir le sentier de ma mule ?
- Mon mari était fou, ponctua-t-elle résolument. C’est lui qui t’a fichu de pareilles idées dans le crâne
- Je suis consciente de notre dure existence, reprit la vaillante Mirida. Moi aussi je souhaiterais un avenir meilleur. Ne puis-je épouser un homme jeune ? Je ne suis pas fanée, mes appâts ne manquent pas de charme. Il me serait facile de trouver un autre prétendant.
- L’hiver approche à grands pas... Notre réserve est basse. Mes reins sont plus fragiles et je ne peux guère t'aider au potager. Je suis malade aussi. Je n’ai plus la force d’attendre. Il n’y a pas de flammes dans la cheminée sans un homme pour souffler.
- Ce sont ses vaches et ses brebis qui souffleront à sa place.
- Ne sois pas moqueuse, Mirida ! Si je n’étais pas si âgée, tu ne serais pas si arrogante… Tu aurais eu la réponse à tes questions comme il se doit. Avec le bâton… Demain tu épouseras celui qui t’a été désigné. Crois-tu que je me sois rebellée contre mon père quand il m’a dit de m’allonger sur la couche de celui qui fût mon époux ? Non ! Car c’est la loi. Tu dois la respecter. Tu dois obéir ma fille…
- Je n’aime pas la famille, rétorqua en colère la jeune Mirida. Elle me tue. Elle m’ensevelit.
La mère repoussa vivement la couverture et parvint à se relever grâce au restant d'énergie alloué par cette désolante discussion. Pour apitoyer Mirida elle fit semblant de chanceler et s’appuya contre le mur. Cette discussion l’agaçait et l'épuisait en même temps. Soudain une brusque douleur aiguilla son ventre et elle se plia en deux sous la force d'une toux douloureuse. Elle ne simulait plus. Elle lâcha le mur et se dirigea vers sa fille. Elle lui agrippa les épaules et planta son regard de colère droit dans les yeux :
- Méchante fille ! Raille tant que tu le peux... Demain tu seras moins fière.
- Je retiendrai mes pleurs. Mes lèvres souriront mais dans mon cœur tout sera froid.
- Petite sans cervelle. Pense à la nourriture. A la bonne chaleur du foyer. Aux lourds bracelets d’argent qui te pareront.
Mirida attrapa les mains de sa vieille mère et se détacha d'elle. Sous l’emprise de l’émotion, de ce désespoir profond, d’une voix de fillette éclose parmi les cailloux et les chardons, elle sanglota :
- Mes nuits, ma mère, tu y songes ? Ton mari toi était jeune !
La mère éclata d’un rire édenté.
- Il ne te fatiguera pas longtemps ma fille... Le vieux mourra bientôt. Tout comme moi ! Il faut que tu l’épouses.
Mirida continua, têtue :
- Et son autre femme ? Crois-tu que c’est d’un honnête homme d’avoir deux épouses ? Pourquoi une femme riche ne pourrait-elle pas avoir deux maris ?
- Tu as raison. Elle n’aura pas deux maris mais elle pourra jouer à la courtisane.
- Pour être jetée ensuite aux crocs des chiens, s’exclama Mirida dominée par la colère naissante… Crois-tu que son épouse sera heureuse de me voir arriver rivale dans sa maison. Elle a l’âge d’être ma mère.
- Ta mère c’est moi ! Allons cesse de te lamenter... Songe que cette femme est trop grosse. Elle ne cesse de manger. Un jour elle éclatera comme la pierre du four et toi maligne tu seras la maîtresse.
Les deux femmes sortirent. Mirida suivit le dos voûté de sa mère qui lentement, à petits pas réguliers et traînants, se dirigea vers l’énorme bloc rocheux ; privé de ces hauteurs il ornait le terre-plein devant la maison depuis des années.
La mère s’assit dessus suivant des gestes relevant d’une longue habitude. Mirida préféra s’accroupir sur ses talons et joua avec la terre. Du bout de son ongle aiguisé, elle tria une poignée de cailloux. Elle marmonna boudeuse et pleine de sous-entendus :
- Je n’attendrais pas la mort de sa femme pour aller me plaindre au chef du village... Je lui apporterais une paire de babouches comme le veut la tradition.
- Il ne te croira pas... Ton mari est trop vieux pour avoir des mœurs contre nature.Tu oublies qu’il a déjà quatre filles. Tu seras la risée du village.
- De toutes ces filles qu’en ferais-je si leur mère éclate ?
- Donne-lui un fils… Plus tard il te protégera mieux qu’une fille surtout si elle est mangée par tes idées.
- Sceptique, Mirida se releva et tourna autour de sa mère. Elle répondit :
- Crois-tu qu’il aura la force de m’en faire un ? Peut-être ne voudra-t-il même pas...
- Tu demanderas au fils du forgeron... Il sera très heureux de te coucher sous les noyers. Et ton mari sera obligé de reconnaître l’enfant s’il ne veut pas perdre la face. Mais je pense que tu n’auras pas besoin d’agir comme une sorcière. Il est vieux mais sa fierté le fera mettre raide pour t’ensemencer.
- Tu es certaine ?
- Oui ! Sinon il ne serait pas venu te demander.
Mirida jeta à la volée le tas de cailloux.
- Si moi la jeune je ne veux pas d’enfant... Si je ne veux pas me pencher la nuit sur le berceau pour laver les fesses pisseuses, faire taire les cris par mes seins alourdis ?
- Tu dois avoir le ventre gros... Une épouse doit se soumettre et mériter ainsi la confiance du mari.
- Alors si je t’écoute, nous les femmes, nous ne sont faites que pour obéir et nous taire. Puis quand vient l’heure du mâle nous devons nous allonger sur le lit. Même si nous sommes fatiguées par le travail de toute une journée la virilité de l’homme doit être apaisée. Voilà notre vie ! Mettre au monde des enfants, travailler au champ, tenir la maison, préparer les repas pendant que le mari, accroupi à l’ombre d’un mur, passe ses journées en palabres et chimères d’hommes. Quand le mari meurt pourquoi ne pas nous mettre aussi dans le trou ?
La vieille femme réprima un tressaillement douloureux. Ses mains déformées par le sang de la vieillesse tremblaient.
- Aide-moi donc à rentrer au lieu de me dire des choses que je ne veux pas comprendre.
Mirida prit la pauvre femme par les épaules et la soutint de sa jeune vigueur. Elle perçut avec amertume le tremblement qui agitait maintenant le corps de sa mère. Elle le prit comme un chantage physique, un subtil mélange d’égoïsme et d’amour, Pour la calmer, afin d’entériner cette contrariante discussion Mirida se força et jeta entre ses dents :
- Ne t’inquiètes pas ! Je l’épouserai le vieil arbre.
- Je le sais bien ma fille ! Je le sais bien... Tu vas me donner une couverture et me préparer à manger. Ensuite, tu rejoindras les jeunes du village. Ils préparent le bûcher qu’ils allumeront ce soir à ton honneur. Tu danseras et tu chanteras. Moi je resterai ici. Je suis trop fatiguée…
Mirida rejoignit à contre-cœur la place du village. La plupart de ses amis étaient là. Il y avait aussi des villageois. Les festivités étaient rares dans la vallée. Mirida alla s'asseoir sur les talons, à côté de Madia qui l'accueillit d'un sourire d'encouragement. Un homme accroupi jouait du tambourin en sourdine. La plainte mélodieuse apaisa la tristesse qu'elle véhiculait depuis la mort de son père. La lune, le soleil de l’obscur, faucille de la main fortunée donnait aux visages de ces gens un mouchoir de clarté pour que chacun puisse se reconnaître.
Les cheveux noués, collier d’ambre autour du cou, bracelets de laines multicolores et fibule dorée au carrefour de ses voiles, la jeune berbère se releva avec lenteur, suivie par ses camarades. Ce modeste groupe de danseuses entama une ondulation, du bas vers le haut, langoureuse et progressive, suivant le rythme de la cadence sourde du tambourin encore un peu timide.
Mirida appréciait beaucoup ces prémices, cet instant éphémère où le quotidien devenait oubli, où la puanteur devenait parfum, et le travail repos. Peu à peu le cercle se forma. Les danseuses se déplacèrent en épousant le balancement commun. Les gestes étaient les mêmes depuis des siècles. Il n’y avait que le feu qui savait d’où ils venaient ; il était le seul à pouvoir dire de quelle gorge originelle était née cette mélopée, quelle était la main qui avait jeté dans l’air immuable de la vallée ce rythme impérieux, compliqué et mystérieux.
La nuit promettait une relative douceur. L’hiver, ce marchand éternel de la mort, s’était annoncé, cette année, avec du retard. Aussi la soirée se para avec la joie, l'insouciance, de ces jeunes personnes. Ces brindilles de sentiments, ces pensées incertaines s’envolèrent dans la nuit au-delà des rocs à la recherche du rêve de chacun.
Puis la danse s’éteignit comme elle avait commencé ; les filles quittèrent la ronde progressivement puis elles retournèrent dans le groupe redevenu immobile et résigné.
Mirida resta seule. Elle attendit que tous les participants soient assis. Réfugiée dans son balancement de hanche, afin de fuir les regards, elle ferma les yeux.
D’une voix grave elle entonna un vieux refrain qui parlait d’un bel amour impossible. Un chant défendu que son père lui avait appris, un chant qu’il tenait du sien qui remontait à une époque ancienne où les femmes n’étaient pas encore soumises.
Puis le calme revint. Le tambourin demeura silencieux. Chaque participant abandonna l’assemblée. Madia à son tour s'en alla, reprit le chemin de sa maison. Il ne resta près du feu scintillant qu’une ombre frêle et immobile, recroquevillée. Mirida, visage sillonné par des rigoles amères, qui pleurait sur sa lâcheté.
La blanche couche nuptiale eut sa tâche de sang. L’honneur fut sauf. Il n'y eut pas besoin d'écorcher un poulet sur l’autel de la virginité.
De longues semaines passèrent, mornes, les nuits relayant les jours, les chamailleries des enfants succédant aux câlineries, la joie pure des naissances repoussant l’absence des morts, et les semences offrant leurs récoltes.
Le vieil homme avait pris la fille... Il avait épousé la jeunesse pour ramener la sienne propre. Sous l’emprise de cette illusion il avait catégoriquement refusé d’héberger la mère de Mirida, malgré sa promesse. Son autre femme suffisait largement à lui rappeler son âge. Pour compenser son manquement, en retour, Mirida eut alors la permission de se rendre une fois par semaine chez sa mère pour lui apporter nourriture et affection.
Ce jour-là, au levé du jour, plusieurs hivers après son mariage, elle prit la mule et accrocha un sac rempli de provisions. Elle ajusta sa jolie robe, grimpa sur le dos robuste de la bête et calée sur l'épaisse couverture tressée, elle prit la direction de Magdaz. Le sentier tortillait parmi les rochers et les obstacles de toutes sortes. Elle parvint à son village natal en fin de matinée. Elle ne disposait que de quelques heures à peine avant de repartir, pour éviter d’être surprise par la fin du jour.
Elle stoppa un instant sa mule pour contempler le village qui s'étirait en contrebas. Les grandes bâtisses édifiées sans mortier ni crépis étaient accrochées sur l'autre versant, de l'autre côté de l'oued. Elles se fondaient au paysage montagneux et terreux. Sa maison que l'on voyait à peine, à l'écart des imposants greniers, offrait un piètre spectacle. Tant de souvenirs qui revenaient et qui soudain la submergeaient. Maintenant elle s’apercevait avec effroi que les murs s’abîmaient. Cela lui serra le cœur.
Sa mère était sourde. Par contre son appétit avait décuplé. Elle attendait la venue de sa fille au panier plein avec l’impatience de l’estomac Dès l’apparition du soleil, elle prenait position devant la maison, sur la grosse pierre et attendait. Elle n’avait rien d’autre à faire qu’à guetter, à se souvenir du temps passé. Son esprit prenait maintenant plaisir à s’y égarer.
Quand Mirida descendit de sa mule, elle se rendit compte que pour la première fois sa mère n’était pas à son poste. Alarmée, elle se dépêcha de rentrer. Le feu était éteint. Au fond sur le lit reposait la vieille femme. Elle était prise de fièvre, enfouie sous les couvertures mouillées dégageant une odeur très désagréable. Elle faisait face au mur, couchée sur le côté. Mirida posa le sac. Agenouillée auprès de la malade, elle s’empara de sa main et l’embrassa. Elle était brûlante. Les yeux cernés disparaissaient dans les plis de la vieille peau froissée. Ils s’ouvrirent lentement et déposèrent un regard inexpressif sur le visage de la jeune femme.
- Mère ! Me reconnais-tu ? C’est moi. Mirida…
Elle se rappela qu’elle n’entendait plus. La main restait inerte et chaude dans la sienne. Sous l’emprise de la peine, elle la serra de toutes ses forces. L’étreinte resta sans réponse. Alors, elle la reposa délicatement sur la couche et une larme glissa sur sa joue. Cette main, ce paysage futur de la mort, alors qu’elle était encore une enfant, lui avait caressé le front pour la consoler, un jour de chagrin. Elle avait découvert un oiseau inerte et froid dans la neige. Elle avait constaté pour la première fois de sa vie l’aspect repoussant d’un corps sans vie. Ce geste si doux de cette main si fine d’avant émergea du puits des souvenirs. Elle changea les couvertures, secoua les coussins puis d’un geste nerveux s’essuya les yeux.