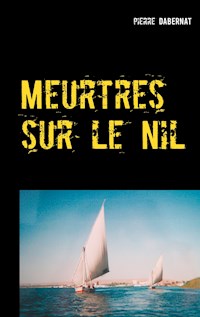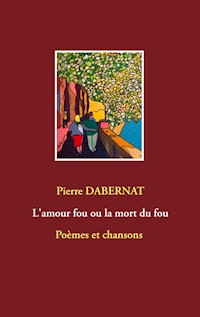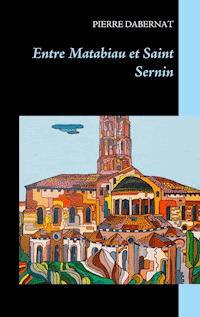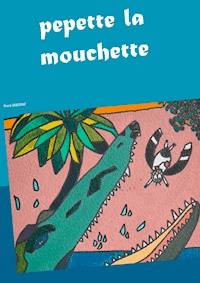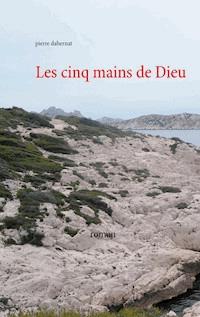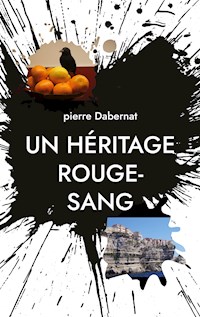
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Putain d'oiseau
- Sprache: Französisch
"Sur la balustrade un oiseau me regardait. Mon oiseau ! C'était une hallucination. Le psychiatre m'avait expliqué ce processus diabolique. Lorsque mon cerveau se mettait au travail, qu'il élaborait des hypothèses tortueuses et fumeuses, lorsqu'il cherchait avec énergie l'astuce capable de confondre un criminel, tout cela au prix d'une immense cogitation, un oiseau apparaissait et me causait dans un langage que moi seul comprenais." Visconti a donné sa démission. Il pense couler des jours paisibles dans son chalet camargais mais un notaire vient lui annoncer qu'il vient d'hériter. Un héritage qui va lui révéler les secrets enfouis dans sa famille. A la recherche de ce passé, il va repartir illico sur les routes sinueuses de la Corse et de la Sicile avant d'aller prendre un bain de mer du côté de Port Vendres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contact : [email protected]
Dans la série
Putain d’oiseau
Sommaire
Putain ! En voilà une nouvelle
La bâtisse était majestueuse
Je cherchai les livres de comptes
Son métier comportait certains risques
Je bouclai la maison et l’on fila vers Figeac
Où est la petite dame ?
La façade de l’hôtel était anonyme
Le secret de famille
Ce sont les mâles
Il avait aussi perdu un soldat
Le piaf m’avait filé les jetons
Premier monté et dernier descendu
Je remerciai le comptable
Le vent sifflait
Une balade en moto
Vittorio Tunasi fit un autre numéro
J’avais agi comme un imbécile
En début d’après-midi
Un digne descendant de Sempiero
Il était de taille petite
Il me traita encore de barjo
Je rangeai le van à proximité du port
Je te présente Estebanito
Le flic d’Ajaccio tenta de me réconforter
Cette confidence joua en ma faveur
Je n’avais d’autres choix
Il m’indiqua un chemin de terre
Vint le baiser
Toulouse... Huit jours plus tard
Le navire était au mouillage
Les pièces biscornues du puzzle
Il avait fait l’école primaire à Saint-Florent
Je me faufilai tel un fantôme
Les évènements nocturnes s’étaient succédés.
Où sont Maria et Thomas ?
Elle n’avait donc rien à craindre
J’avais vu un truc incongru
J’avais flirté pour l’unième fois avec la faucheuse
Putain ! En voilà une nouvelle
Il était neuf heures du matin. J’avais hésité à tomber du pieu.
Il faisait jour depuis longtemps mais j’avais tiré les rideaux en prévision de ma fainéantise matinale. Nous étions au début de l’été et le temps était maussade, depuis une quinzaine. J’avais filé ma démission de la police et j’étais comme une branche emportée par le courant d’une rivière folle. Je n’avais aucune idée où il allait me jeter. Au prix d’un effort qui me coûta, je hissai ma carcasse hors du lit et enfilai un survêt que j’avais laissé traîner sur le plancher.
Je n’avais pas encore digéré la manipulation dont j’avais été la victime de la part de ma hiérarchie. A mon retour de Biarritz, j’avais rédigé une lettre pour mon commissaire divisionnaire à Paname, au grand dam de mon ami Frédéric Costessec qui était toujours commandant à la criminelle de Toulouse... Ma volonté n’avait pas failli quand j’avais expédié, à la poste du Grau-du-Roi, le recommandé en question. Depuis, je n’avais qu’une question qui occupait ma charge mentale : comment relancer le temps qui s’était arrêté.
Je faisais quotidiennement des exercices physiques, de longs footings, pour tenter de sauver le restant de mon capital santé que j’avais largement abîmé depuis des années. J’avais cessé de fumer et je ne buvais qu’une fois par semaine, le week-end.
Si mon corps me remerciait mon mental déprimait.
Après avoir ingurgité trois cafés serrés et avalé trois biscottes aux graines pour remplacer la cigarette du matin, je mis le nez à la fenêtre. Le ciel camarguais avait retrouvé sa pureté. Enfin !
m’étais-je dis, avec un soupçon de bonne humeur qui revenait de je ne sais où. Cela faisait plusieurs jours que le temps était couvert. Soudain, Gueule d’amour, se mit à grogner. C’était un malinois bringé, que j’avais trouvé errant, et dans un sale état, en bordure d’une départementale, il y avait une quinzaine de jours.
Au retour de Biarritz, après mon unième déception amoureuse, et celle-là, méritait le pompon, l’idée de prendre un clébard m’avait effleuré, comme un onguent sur la blessure de mon amour propre. Les rencontres se font ainsi... Sur une pensée fugace qui s’allie au hasard. Je rentrais de Marseille où j’étais allé voir ma fille et mon petit-fils. Sur le retour un chien avait surgi de nulle part et j’avais pu l’éviter à la dernière seconde.
Heureusement, il y avait peu de roulage, ce soir-là, et j’avais freiné brutalement en faisant un écart sur le bas-côté. A peine avais-je eu le temps de reprendre mes esprits, que l’animal était venu gratter à la portière du California.
J’étais descendu du van et nous avions fait connaissance. Il était crotté et semblait épuisé. J’avais une bouteille d’eau et il avait lapé la moitié. Puis avant que je ne dise ouf, il avait sauté sur le siège passager et il m’avait regardé avec un air qui en disait long. Il n’avait pas de collier, aucun tatouage. A priori, il était la victime d’un abandon. Je n’eus pas le cœur de lui refuser ce qu’il me demandait : aide et assistance et surtout une amitié à durée illimitée. C’était moi qui désirais un chien mais c’était lui qui m’avait choisi. Comme je n’étais pas un type à me poser des questions, j’avais redémarré et nous nous étions mis en ménage dès le premier soir.
Je me rendis à l’entrée où il y avait l’écran de télésurveillance.
Le chalet était construit sur un étang, sur pilotis, derrière des roseaux et à l’abri des regards inopportuns. Il y avait plusieurs caméras, cachées sur le faîte des arbres, qui dataient du temps où Herma, le tueur repenti, habitait ici.
Il y avait une caisse avec un type que je ne connaissais pas. Il se dirigeait vers les écuries. Mes locataires étaient partis la veille pour quelques jours et ils avaient laissé le soin, à mon fils adoptif, de s’occuper de leurs chevaux durant leur absence.
Mais si celui-ci était capable de cette tâche, le face à face, avec un inconnu, pouvait le perturber. Dans son monde d’autiste, ce genre de confrontation inopinée pouvait le déstabiliser.
Aussi, m’empressais-je d’actionner l’escalier pour descendre sous le chalet et de sauter dans la barque pour gagner la rive.
Gueule d’amour, n’attendit pas que je démarre le moteur. Il sauta dans la flotte et nagea vigoureusement. Ce clebs adorait l’eau. Le bruit discret du moteur électrique arriva cependant aux oreilles du visiteur. Il se retourna et revint sur ses pas.
Quand je débarquais, l’homme était déjà là et m’attendait. Il portait un costard anthracite à légères rayures, sur une liquette blanche gâchée par une cravate de mauvais goût. Il avait un visage sévère, rasé du matin, avec une égratignure au menton et des lunettes à écaille qui lui donnait l’air d’un hibou. Une petite quarantaine avec un corps longiligne. Il serrait contre lui un vieux cartable en cuir comme s’il s’agissait d’un trésor.
Gueule d’amour lui tourna autour et tenta de lui renifler le cul.
- Retenez votre chien ! minauda le type.
- Ne craignez rien ! Il ne mord que si je lui demande de le faire, mentis-je.
J’avais compris, dès le début, que Gueule d’amour n’obéirait qu’à son seul instinct. Un peu comme mézigue !
- Le chien ! Stop ! Vous voulez quoi ?
- Je suis notaire et j’ai besoin de vous parler...
Un notaire ! Il ne manquait plus que ça... Intrigué, je l’invitais à grimper dans la barque. Il hésita mais comme j’insistai, il finit par attraper ma main. J’avais bien compris que le gars n’était pas un dégourdi et je n’avais pas envie qu’il boive la tasse avant de me parler.
Dans le salon, je le fis asseoir sur un fauteuil et m’amusai à voir son étonnement au sujet du chalet. Il y avait de quoi.
J’allais au-devant de sa question.
- La bicoque tourne sur elle-même en fonction du soleil. C’est une maison autonome en énergie et il y a un ordinateur qui gère tout ça.
- Cela doit coûter ?
- Sans doute... Bon ! Vous voulez me dire quoi ? Vous n’êtes pas venu me dénicher ici sans une bonne raison. Vous savez au moins qui je suis.
- Oui ! Vous êtes le commissaire Marcello Visconti.
- Ex commissaire... Je ne suis plus en fonction.
- Ah ! fit-il perplexe.
Il se reprit.
- Cela n’a aucune importance. Comme je ne vous ai jamais rencontré, je voudrais être sûr que vous êtes cette personne.
Puis-je vous demander une pièce d’identité ?
Putain ! Cela prenait un tour solennel auquel je ne m’attendais pas. Je lui filai ma carte républicaine et cela eut l’air de lui suffire.
- Bon ! Allez l’ami... De quoi s’agit-il ?
Le notaire vissa son fessier sur le fauteuil pour être sûr d’être bien installé avant d’attaquer. Il avait posé son cartable sur ses genoux. Il l’ouvrit et il sortit une photographie qu’il me tendit.
Il s’agissait d’un portrait, celui d’une jolie jeune femme d’une vingtaine d’années, vêtue d’un pantalon moulant vert et d’une chemise blanche à rayures noires, nouée sur le devant, laissant apparaître une peau bronzée. Les années avaient altéré les couleurs de la photo. Une photo de soleil et de mer que l’on discernait à l’arrière-plan.
- Qui est-ce ? dis-je étonné.
- Elle s’appelait Maria Visconti.
- D’où sortait-elle ? Était-ce une cousine ?
Le notaire eut l’air embarrassé. Il redonna un tour de vis sur le fauteuil avec son postérieur et tout de go, jeta :
- C’était votre sœur ?
Putain ! En voilà une nouvelle... J’avais une autre frangine et je n’étais pas au courant. Mon père avait-il fauté ? Je posai la question.
- Non commissaire ! Votre mère me l’a confirmé au téléphone.
Elle était bien sa fille. Avec votre père, ils avaient coupé les ponts avec elle en 1968... Elle n’a pas voulu m’en dire plus !
Je reconnaissais bien là ma chère mère. Elle avait toujours eu un sacré carafon. J’étais abasourdi... Je me levai et allai me servir un scotch. Cela tombait bien, nous étions un samedi et il m’était permis de boire un coup. Le corbeau accepta un verre d’eau.
J’avais bien connu et aimé, le papé, Giovanni Visconti. Il nous avait quitté en 1984, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Avec la grand-mère, Simonetta, il avait fui l’Italie et le régime de Mussolini en 1925. Le couple avait déposé les valises dans la ville phocéenne pour une vie simple et laborieuse de réfugiés.
Ils n’avaient eu qu’un fils unique, Aldo, mon père, né durant l’année 1927. A priori, l’histoire de famille, que l’on m’avait servie, était fausse... Mon père avait rencontré une fille de Provence, Mireille. A cette époque, l’on se mariait jeune et il l’avait épousée en 1949. Moi j’étais arrivé au monde que beaucoup plus tard en 1966. Et ma sœur, Josépha, deux ans plus tard. Malheureusement celle-ci était décédée d’un cancer du poumon. Ce qui risquait de m’arriver aussi un de ces jours...
Nos parents nous avaient toujours raconté qu’ils avaient eu des difficultés pour concevoir des enfants et qu’un jour, n’y croyant plus, ma sœur et moi avions sonné à leur porte, pour leur plus grand bonheur. Ma mère avait dépassé à cette époque la quarantaine.
- Cette autre sœur est née quand ?
Le notaire consulta un papier... Il me répondit :
- Le 12 juin 1950 à 10h30...
- Je n’en demandais pas tant ! Si je calcule bien elle avait seize ans de plus que moi... Je ne me rappelle pas d’elle... Bizarre vous ne trouvez pas ?
- Je ne saurais dire...
Si ma chère mère n’avait rien voulu dire au notaire, avec moi, cela allait être une autre paire de manche.
- J’imagine que cette sœur est décédée ?
- Oui ! Elle avait soixante-onze ans et vivait dans le Lot, près de Figeac. Elle est venue me voir à l’étude pour commencer à rédiger sa succession. Elle m’a dit qu’elle était malade, sans rien préciser de plus. Elle m’a confié aussi, sans que je ne lui demande, qu’elle avait vécu en Italie, avant de s’installer en France.
- Où ça en Italie ?
- A Cefalu puis à Rome ...
- C’est où ce bled ?
- Dans le nord-est de la Sicile... Pour un Italien d’origine vous ne connaissez pas ? C’est un lieu balnéaire connu et la vieille ville possède une cathédrale de style arabo-normande datant de 1131.
- Vous avez l’air de vous y connaître, monsieur le notaire...
- Maître Dutilleul, Henri Dutilleul, de Figeac, précisa-t-il.
J’avoue que je me suis documenté avant de venir vous voir.
- Trop aimable ! Si nous en revenions à cette sœur ? Comment est-elle décédée ?
- Je ne sais pas exactement... J’ai reçu une avis de décès d’un docteur de l’hôpital Rangueil à Toulouse.
- Elle était donc malade ?
- Sans doute ! Oui... elle avait fait un testament en votre faveur.
- Fichtre ! Elle connaissait mon existence ? Et j’ai hérité de quoi au juste ?
- De la maison du Lot et de quelques milliers d’euros sur son compte bancaire.
Je restais songeur. D’avoir hérité d’une maison dans le Lot ne m’emballait pas plus que ça. Ma méfiance naturelle m’incitait à la prudence. Parfois un héritage était un nid d’embrouilles.
D’autant que dans le tableau familial cette frangine avait été gommée ? Quel était-donc ce secret de famille ?
- Elle n’avait pas des enfants ?
- J’ai cherché mais en vain. Elle n’a jamais été mariée...
- Que faisait-elle dans la vie ?
- Rien ! Elle était, semble-t-il, rentière...
- Elle était riche ? m’enquis-je incrédule d’apprendre que l’on pouvait vivre toute une vie sans rien faire.
- A ma connaissance non ! Elle était propriétaire de sa maison du Lot depuis 1977. Ses avoirs bancaires ont été bloqués dans l’attente de régularisation. Ils sont d’une vingtaine de milliers d’euros, ...
- Elle payait comment ses factures ?
- J’avoue que je n’ai pas d’informations à ce sujet.
Le notaire sortit de son cartable des papiers qu’il me fit signer.
Puis il me donna un trousseau de clefs et me remit le nouvel acte de propriété de la maison. Il y avait d’autres démarches, notamment pour débloquer les fonds à la banque, mais la suite des formalités allait se faire par mail, me précisa-t-il.
A la fin de l’entretien, je lui proposai un autre verre d’eau qu’il refusa. Je le raccompagnai à sa voiture et la regardai filer en cahotant sur le chemin de terre en pensant que dorénavant, le temps s’était remis en mouvement. Ce n’était pas une enquête policière qui débutait mais il y avait sous cet héritage matière à réflexion. Pourquoi Maria était-elle devenue le paria de la famille qu’elle avait fuie, quand j’avais deux ans ? Était-ce à cause de l’ambiance folle et contestataire de la jeunesse de l’époque ? Ce qui était bizarre, c’était que je n’en avais pas de souvenir.
La bâtisse était majestueuse
Le village d’Issepts était une commune rurale qui faisait partie de l’arrondissement de Figeac. Un lieu tranquille dans le Lot.
Le GPS me conduisit à l’adresse de la maison. Je stoppai le van devant un portail en fer hérissé de pointes. J’ouvris la portière et Gueule d’amour fila pour aller arroser le pylône qui jouxtait la route. Il avait dormi durant tout le trajet sur le siège passager, qui ressemblait maintenant à un tapis de poils de chien. La maison de ma défunte sœur se trouvait sur un promontoire qui dominait une grande vallée verdoyante. Le portail possédait une serrure. Je trouvais la bonne clef dans le trousseau que m’avait remis le notaire. Je l’ouvris en grand et rentrai le California. La bâtisse majestueuse, traditionnelle, possédai un étage, et elle était flanquée de deux tours carrées de chaque côté. Le toit était constitué de lauzes, ces pierres sèches, qui servaient aussi à couvrir les gariottes, cabanes de bergers ou de vignerons que les touristes pouvaient découvrir encore sur les bords des chemins.
La façade en pierre était couverte par une treille ancienne qui avait profité de l’absence du sécateur pour se développer en hauteur. Sur la gauche, il y avait une grange en bon état, plus loin à ce qui ressemblait à un poulailler et dans le fond du parc un pigeonnier qui possédait une vue plongeante sur un décor apaisant et bucolique. Il était seize heures et le soleil était bas et se cachait derrière un matelas de nuages blanchâtres. Le chien était parti en reconnaissance dans le champ voisin. Il y avait un troupeau de vaches mais à priori, les ruminants le laissaient complètement indifférent. Il remuait la queue et humait l’air comme s’il avait flairé la piste d’un chevreuil.
Les pièces étaient remplies de beaux meubles hétéroclites qui montraient le goût inné de la propriétaire pour la fréquentation des brocanteurs. Je déambulai dans la maison, en passant d’un salon à un autre, m’arrêtant pour feuilleter les innombrables livres qui s’entassaient n’importe où, ouvrant les placards de la cuisine afin de cerner l’identité culinaire de cette sœur qui avait vécu dans ses murs anciens, et de si longues années. Il y avait aussi de nombreux tableaux de la même veine créatrice.
Aucune œuvre n’était signée mais chacune possédait la date de sa création. Les toiles étaient chargées de couleurs. Elles représentaient un couple devant des paysages différents. La femme ressemblait à Maria. Elle était peinte à différents âges mais l’homme, par contre, n’avait pas vieilli. A leurs côtés, il y avait aussi parfois un enfant ou un adolescent. Je restai dubitatif devant le plus imposant. Il était accroché au-dessus de la cheminée. Le couple était peint, assis sur banc et se tenant par la main, devant une plage couverte de parasols. Plus tard, dans le fond d’un réduit, je découvris un chevalet couvert de tâches colorées, des pots remplis de pinceaux, des toiles de lin et des flacons d’huile et de vernis. Un sac en osier était rempli de chiffons. J’avais ma réponse. C’était bien ma sœur l’artiste. Je me mis en quête d’albums photos.
J’eus beau fouiller la maison, je n’en trouvais aucun et cela me parût étrange. Pourquoi ma sœur aînée avait-elle choisi de vivre dans le Lot ? Loin de tout, loin de Marseille et de l’Italie où semblait-il, elle y avait laissé une partie de sa vie.
A la longue, ne sachant quoi chercher, ni où chercher, je pris la décision de laisser la maison en l’état et de remettre à plus tard le soin de trouver les réponses aux questions que je me posais, depuis la visite du notaire au chalet. Sur le point de quitter les lieux, mon regard tomba sur une vieille clef en fer, d’une bonne quinzaine de centimètres, accrochée à un clou, à côté de la porte d’entrée. Que faisait-elle là ? Il y avait une étiquette, sous un film plastique, marquée d’une lettre « B ».
Je fourrai la clef mystérieuse dans ma poche et sortis de la maison. J’inspectai le parc et les divers bâtiments mais il n’y avait pas de serrures susceptibles d’accepter la clef. Au pied du pigeonnier, je m’arrêtai et sortis mon paquet de tabac. Puis je me ravisai. Certes, j’avais cessé de fumer mais je continuais à me rouler une cigarette quand l’envie était trop pressante.
Un fois sur deux je la jetai rageusement et la piétinai pour ne point succomber. Une vieille charrette en bois déglinguée, à moitié recouverte de lierre, me servit d’appui pour cette pause inopinée face à ce tableau naturel et apaisant. Un vent léger caressait mon visage, atténuait la chaleur du soleil qui dardait ses flèches à travers les nuages immobiles. Maria avait vécu des années dans cette maison et elle avait contemplé cette vue superbe tout au long de sa vie. Homme des villes, confronté aux violences, j’avais découvert, depuis mon installation en Camargue, les vertus de l’isolement, au cœur d’une aimable nature. Cependant, j’étais persuadé que celle-ci pouvait être hostile à l’homme sous ses couverts charmants. La cigarette terminée, je restai là songeur... Le briquet était au fond de ma poche. En soupirant je la lançai d’une chiquenaude dans un buisson de ronces.
Cette clef me posait un problème. L’instinct qui avait géré ma vie de policier me titillait les neurones. Mon piaf n’avait pas digéré ma démission et il ne s’était plus manifesté. Toutes ces années j’avais cherché la manière de guérir de l’hallucination, même si c’était elle qui avait construit ma carrière, alors qu’il avait suffi de n’être plus flic pour que l’oiseau s’envole hors de mon imagination. Sous le coup d’une impulsion, je décidai de rester et de fouiller méthodiquement la maison. Avec un objectif, celui de trouver une piste qui pouvait me conduire à une autre maison. Je pouvais me tromper et penser que Maria avait conservé cette clef comme l’on garde un bibelot dans un coin, mais je n’avais rien d’autre à faire et cela m’amusait de jouer à nouveau au détective.
Nous étions en fin d’après-midi. Je réintégrai la maison et me dirigeai en priorité vers une pièce où j’avais vu un ordinateur, posé sur une petite table en acajou. Je le branchai, mais sans le mot de passe, je n’en tirais rien. Accolé au mur d’un autre salon, mais dédié à la lecture, avec un vieux fauteuil de cuir, sous un abat-jour jaunâtre, les tiroirs d’un bureau de style, ne m’apprirent rien. Il n’y avait que du papier et un fouillis de crayons et de stylos. Dans la bibliothèque, ce n’était que des livres de collection, beaucoup étaient reliés, mais il n’y avait pas de dossiers administratifs. Maria, comme chacun, devait payer des impôts, des taxes, des factures d’eau et électricité, posséder des relevés de comptes et des talons de chèques, mais il n’y avait rien de la sorte... Découragé, je m’attaquai aux autres pièces. Durant une heure, j’ouvris tous les placards, toutes les boites, fouillai toutes les étagères des armoires, les boites à chaussures dans les penderies, sans oublier le grenier, mais à ma grande surprise je ne trouvais absolument rien de la sorte. Comment était-ce possible ? Puis je repensai à la clef.
La lettre « B » ne voulait-elle pas dire : « Bureau » ?
Dans la cuisine j’avais déniché un lot de bouteilles d’un vin blanc sec. Un Chardonnay du Pays d’Oc. J’en ouvris une et me servis un verre. Si j’avais été en fonction, le piaf se serait manifesté, à coup sûr. Mais il m’ignora et je dus réfléchir tout seul. Dans le congélateur, appareil indispensable quand on vit loin des commerces, il y avait du pain. J’en sortis une baguette et la fis décongeler au micro-ondes. J’avais faim. Le vin blanc avait attisé mon appétit. Dans un réduit au fond de la cuisine, il y avait des saucisses sèches suspendues et qui avaient l’air d’être de production locale. J’en coupai un bout et commençai à manger en déambulant autour de la table en chêne au centre de la cuisine. Je ne comprenais pas pourquoi je n’avais rien trouvé. Ma faim calmée je m’assis et me roulai une cigarette.
Conscient de succomber, je décidai pour me conforter dans ma faiblesse, que je continuerai donc de fumer, en m’asseyant sur la culpabilité permanente que notre société moralisatrice distillait, par l’intraveineuse médiatique, depuis des années, sur ce sujet-là.
Je finissais mon verre. Sur la porte du frigo, dans la plupart des maisons, il y avait aujourd’hui des stickers aimantés issus des vacances, des papiers avec des listes, des rendez-vous, et sans oublier les dessins affreux mais si touchants des mômes, des calendriers, enfin des tas de trucs qu’il n’y avait pas ici.
Sauf une carte de visite. C’était celle d’un taxi avec un numéro de téléphone. Le papier en était écorné et il semblait avoir été manipulé plus d’une fois. Soudain, cela me parut évident. Il n’y avait aucun véhicule sous le hangar ni-même dans le local qui se trouvait derrière la maison. Maria ne devait pas avoir de voiture. J’avais juste vu un vieux vélo dégonflé et couvert de toiles d’araignées. Quand elle désirait aller quelque part, ma sœur faisait certainement appel à ce taxi. J’appelai aussitôt.
Un type décrocha et je m’expliquais sur le pourquoi de ma démarche.
L’homme habitait les alentours et il me proposa de venir chez lui. Il connaissait très bien ma frangine qui avait été sa fidèle clientèle et qui, au fil des années, était devenue une amie. Il se nommait Marcel Vidal et vivait dans une ferme avec ses parents. Il était veuf et avait un fils qui habitait à Toulouse.
Devant un autre verre de blanc, il m’expliqua que sa voisine faisait appel à ses services, depuis plus de vingt ans, pour se rendre à Figeac, chaque fin de mois. Il la laissait toujours au même endroit et il la reprenait le soir même ou parfois un ou deux jours plus tard. Mais jamais plus... Je lui demandai s’il l’avait amenée un jour à la gare ou à un aéroport mais à son avis, elle n’avait jamais quitté le Lot. Mais il n’était pas le seul taxi dans le coin et elle avait pu très bien faire appel à l’un d’eux...Marcel n’était plus tout jeune et il affichait une peine sincère. Il répétait que Maria avait été une belle personne et je soupçonnais qu’il en avait été amoureux. Avant de repartir, je notai dans mon calepin de policier, que je n’avais pas pu me résoudre à abandonner, le lieu exact où, régulièrement, il avait laissé ma sœur. Après un autre verre pour la route, je montai dans mon van et pris la route de Figeac.
Le taxi débarquait Maria à l’entrée de la place Carnot. J’avais laissé le van sur l’aire municipal de camping-car près du stade du Calvaire et j’avais rejoint, en me promenant, cette ancienne place des halles, avec son lot de maisons à colombages, aux volets multicolores, et sa majestueuse maison de Cisteron et sa tourelle, coiffée d’un chapeau pointu à rebord, couvert de vieilles tuiles, qui lui donnait l’aspect d’une sorcière de pierre, veillant sur la populace, qui se pressait régulièrement, lors du marché sous la halle qui en occupait le centre. A ma Breitling, il était l’heure de se mettre les pieds sous la table. Cette longue journée dans le Lot m’avait ouvert l’appétit, d’autant que je n’avais rien mangé, ou si peu, lorsque j’avais fait une halte sur l’autoroute. Un bar brasserie, le Sphinx, au numéro sept, possédait une carte alléchante. Il y avait une place et n’hésitai pas à l’occuper. Je commandai une tête de veau, une spécialité du coin et un vin du cru. Le nom du restaurant faisait allusion à l’empreinte égyptienne de la ville, avec son célèbre musée Champollion et sa place des Ecritures, avec la réplique de la pierre de Rosette, sculptée dans un granit noir du Zimbabwe.
Mon plan était simple. Ce soir, j’allais faire les cents pas dans la vieille ville, avant de rejoindre l’aire de camping-car et de passer une nuit peinarde à l’intérieur de mon confortable van, en compagnie du chien que j’avais laissé, attaché à une roue, en attendant mon retour. J’avais l’intention, le lendemain, de faire le tour de la place, de parcourir toutes les rues adjacentes, avec la fameuse clef à la main, afin de dénicher la serrure qui allait m’ouvrir la voie sur une hypothétique maison, que je supposais ancienne, et qui pourrait répondre à certaines des questions que je me posais. En outre, la tâche allait s’avérer compliquée. Les vieilles portes étaient sacrément nombreuses dans cet ancien fief du Moyen Âge.
Le lendemain matin, frais et dispos, je me rendis place Carnot et commençai aussitôt mes recherches par la rue du Consulat à proximité de la brasserie où j’avais mangé la veille. Je revins sur mes pas et attaquai la rue Gambetta. N’ayant rien trouvé, je fis demi-tour pour aller inspecter la rue de la République puis dans la foulée la rue Caviale. Il commençait à faire chaud et j’avais la pépie. Au Casino Shop, je m’achetai une bouteille d’eau plate et repris mes recherches. J’étais un homme têtu et quand j’avais une idée, je devais aller au bout. J’espérais juste de ne pas me taper la ville entière. En toute logique, si le taxi avait laissé Maria à la place Carnot, la maison que je cherchais, si elle existait réellement, devait se trouver dans cette zone...
Après une autre pause clope, je me remis en marche. Derrière la place Carnot, il y avait la rue Séguier. A quelques mètres de l’impasse de la Monnaie qui menait à la reproduction de la pierre de Rosette une vieille porte accepta enfin l’introduction de la clef. J’étais en nage mais quand j’entendis le déclic dans la serrure, je sus que j’avais eu raison de m’obstiner... Avant d’entrer, je reculai de quelques pas et observai la maison. Elle était ancienne, conformément à mes suppositions. Le bas était construit en pierre de taille, avec une arcade et un petit escalier qui permettait d’accéder à la porte massive. Elle était de forme ovale. Au-dessus, la façade en colombages, soutenue avec des étais en bois, dépassait d’un mètre environ par rapport au rez-de-chaussée, bâti en dur. Il y avait deux étages avec une seule fenêtre à chacun. Les volets rouges étaient fermés. La maison était relativement étroite.
Je cherchai les livres de comptes
Avec une pointe d’adrénaline, je poussai lentement la porte.
Je me trouvais dans une vaste pièce sombre qui occupait tout le rez-de-chaussée. Autrefois, cela devait être une échoppe.
Ce n’était pas meublé. Le sol, défoncé à certains endroits, était en tomettes. Au fond, un escalier en bois menait au premier.
J’avais laissé la porte ouverte. Je n’avais pas vu de compteur électrique ni d’interrupteurs. En haut de l’escalier, je tombai sur une porte qui s’ouvrit sans difficulté. Il y avait un vieil interrupteur en fer et la lumière, cette fois-ci, jaillit. J’en eus le souffle coupé. J’étais dans un bureau... Si dans la maison d’Issepts il n’y avait aucun papier, ce n’était pas le cas ici...
Tous les murs étaient couverts d’étagères métalliques avec des dossiers dans des chemises en carton étiquetées. Un bureau en verre occupait le centre. Il était nickel. Un sous-main en cuir était posé au milieu, avec un organiseur en métal dans lequel il y avait un carnet, des stylos, et un calendrier. Maria semblait être une personne très ordonnée et rien ne dépassait. Avant de me lancer dans l’étude des dossiers, je poursuivis la visite des lieux. A côté, il y avait une chambre modeste avec une douche et un lavabo. Une cuisine équipée au strict minimum. Rien d’exceptionnel ! Il n’y avait pas d’objets personnels. Ma sœur ne devait pas y dormir souvent. Au-dessus, ce n’était qu’un grenier avec de belles poutres apparentes. Je redescendis dans le bureau et j’ouvris la fenêtre et poussai les volets. La lumière transforma la pièce. J’avisai une photographie, accrochée au mur. Au premier plan, il y avait un couple devant une plage remplie de baigneurs et de parasols. Il s’agissait de ma sœur, jeune, avec un homme qui la tenait enlacée. C’était le portrait craché du personnage des tableaux. Certainement un fiancé, un amant, mais pas un mari d’après le notaire qui avait certifié qu’elle n’avait jamais été mariée. Sur le bureau, sur la gauche du sous-main, il y avait un cadre doré, retourné, auquel je n’avais pas prêté attention, en prime abord. Je le redressai.
C’était le portrait d’un homme plus âgé, en costume et cravate, qui arborait une fine moustache sur un sourire figé et supérieur.
Je cherchai en priorité les livres de comptes. Pour connaître la vie des gens il n’y avait rien de tel pour cela. A condition bien sûr de ne pas tomber sur un panier percé qui ne faisait jamais ni une soustraction, ni une addition. Le seul ordinateur que je connaissais de Maria était celui de la maison d’Issepts, mais ici, à priori, il n’y en avait pas. Sur une des étagères, une série de cahiers noirs, grand format, cartonnés, était soigneusement rangée par année. Cela commençait en janvier 1974. Il y avait quarante-huit cahiers au total. Presque une vie ! me dis-je. Je m’emparai du premier. Il n’y avait pas beaucoup d’écritures.
Sur la première page, étaient notés, soigneusement, le compte et le numéro d’une banque française. Sur la première ligne, dans la colonne des avoirs, il était marqué une somme modeste en francs. Certainement son pécule de l’époque quand elle avait quitté l’Italie pour Paris. Après un acompte pour un loyer en chèque, plus divers retraits en liquide sans doute pour son quotidien, je trouvais le premier versement d’un salaire d’une brasserie à Paris. Maria avait trouvé un emploi. Je passai au cahier suivant. Au début du mois de Mai 1975, en plein milieu d’une page, était écrit, en majuscules épaisses, un numéro de compte. A ma grande surprise, il s’agissait d’un compte-joint, avec un intitulé au nom de Monsieur ou madame Bouyssou . Un nom assez courant dans le Lot. Une somme entamait la colonne des avoirs. Je restai perplexe. Elle était importante... Plusieurs pages plus loin, en découvrant des dépenses liées à une cérémonie de mariage, je compris, contrairement à ce que m’avait dit le notaire, que Maria s’était mariée. Je repris la photographie de l’homme à la moustache. Ce devait être lui... Je poussai un peu plus loin ma lecture. Dans le courant de l’année suivante, je m’aperçus qu’il y avait des dépenses pour des visites chez un médecin. Puis début 1976, des achats pour une chambre d’enfant. Ma sœur avait donc eu un bébé... Je n’y comprenais plus rien... S’il était vivant, c’était lui qui aurait dû hériter.
Intrigué, je feuilletais le cahier de compte suivant. Celui de l’année 1977. Avec toujours cette écriture fine, je tombais, non sans étonnement, sur un règlement à une entreprise de pompes funèbres de Figeac. Maria avait précisé et souligné entre parenthèses : « Obsèques de Louis. ». La date de cette écriture était celle du 20 octobre 1977. Après, je dénichais d’autres modifications. Le compte-joint avait été remplacé par un autre, avec un intitulé unique, celui de Maria Bouyssou.
Elle avait perdu son mari alors qu’elle était à peine mariée.
Un notaire de Figeac avait viré une somme importante, certainement la succession numéraire de son époux. Quelques semaines plus tard, elle achetait la vieille maison qui allait lui servir de bureau durant toutes ces années. Cette démarche me laissait de plus en plus perplexe.
Mon piaf m’avait lâchement laissé tomber. J’aurais bien aimé avoir son avis là-dessus. La Buissonnière à Issepts devait être la maison de famille de Louis et Maria ne l’avait plus jamais quittée. Puis, durant janvier et février de l’année suivante, je vis avec stupeur des encaissements importants sur le compte, provenant de plusieurs sociétés. Maria avait noté, en face de chaque chiffre, le nom de la société. Il s’agissait de dividendes.
Fiévreusement je relevai cinq lignes, cinq sociétés différentes.
Je levai les yeux. Je remarquai alors les classeurs rangés au-dessus des cahiers de comptes. Il y en avait sur trois étagères Mais il y avait six couleurs différentes. Je me levai et saisis le premier de la file. Il était rouge... Dedans, il y avait les plans d’un hôtel cinq étoiles qui se trouvait en Corse. Dans un autre, de couleur jaune, c’était des factures d’une grande brasserie parisienne. La même où Maria avait travaillé à ses débuts. Je réalisais qu’elle avait dû épouser son patron. Les trois autres couleurs correspondaient, à un hôtel à Nice, un restaurant de luxe à Antibes, et une société en Provence, qui produisait de l’huile d’Olive. Dans le dernier, un porte-monnaie d’actions assez conséquent. Il y en avait pour une petite fortune... Je repris le livre de comptes. D’autres encaissements étaient inscrits. Dans la colonne libellé Maria avait écrit des numéros correspondant à des dividendes d’actions diverses.
J’additionnais le montant total de ces dividendes. Je fus effaré du résultat. Cela faisait plusieurs millions de l’époque... Mais là où je faillis tomber de la chaise ce fut, quand je vis en mars de cette même année, un virement de la quasi-totalité sur un compte intitulé Astérie. Juste un simple nom... Qui était cet Astérie ? Ma frangine percevait en toute légalité des sommes folles, qui semblait-il, lui revenait, puisqu’elle avait hérité du patrimoine de son mari, Louis Bouyssou, qu’elle s’empressait de reverser. Du coup, je passai aux cahiers suivants et j’allai directement au début de chaque année... Le même manège, sur ces foutus cahiers de compte, s’était reproduit à chaque fois. Toujours au nom de ce putain d’Astérie. Puis ce fut des versements en euros dans les années 2000. L’argent ne restait jamais plus d’un mois sur le compte de ma frangine. Elle ne gardait, à chaque fois, que le strict minimum pour subvenir à ses besoins durant l’année. Elle provisionnait aussi de quoi payer ses impôts car elle était assez lourdement taxée. Là, je compris que cela sentait mauvais...Après avoir regardé avec attention le dernier cahier où je relevai un dernier versement en mars 2021, à ce mystérieux bénéficiaire Astérie, je laissai tomber la paperasse et rejoignis la brasserie de la veille.
La lecture de la comptabilité secrète de Maria m’avait ouvert l’appétit.
Après avoir passé une bonne heure attablé au restaurant du Sphinx, à prendre mon temps pour manger, apprécier le café, et déguster le verre d’Armagnac, je réintégrai le bureau caché de Maria. J’avais fait le tour des cahiers de comptes. Il restait les dossiers. Une trentaine au total. A l’intérieur des cartons, je découvris des bilans comptables, avec des photographies de devantures de bars et d’hôtels de standing, des nomenclatures techniques, un fatras de fonctionnement d’entreprise avec des factures de travaux. J’écrivis sur mon calepin, les adresses de cet ensemble hôtelier. Une bonne partie s’étalait sur le littoral méditerranéen. J’avais du mal à comprendre.
Si mon oiseau avait été là, il m’aurait vertement tancé sur mon manque d’imagination et mon absence de logique. Toutefois, je parvins à la même conclusion que l’hallucination qui me faisait défaut. A priori, mon subconscient avait trouvé un autre chemin, au cœur des méandres compliquées de mon marécage neurologique. Pourquoi ma sœur aînée avait-elle pris de telles précautions ? A quoi rimait toutes ces rentrées d’argent et ces versements immédiat à l’Astérie. Était-ce une société dans un paradis fiscal ? Je continuai à fouiller.
Dans un tiroir, il y avait un carnet avec une couverture en cuir rouge, avec des adresses de fournisseurs, d’artisans et autres professionnels. Il y avait aussi les coordonnées des directeurs et des gérants des diverses sociétés. Et surtout une enveloppe.
C’était une lettre pour le notaire. Elle s’était ravisée et désirait compléter les clauses du testament qu’elle avait déposé chez lui. Elle rajoutait à la succession la propriété de cette vieille maison ainsi que toutes les sociétés dont il était question dans ce bureau. Elle indiquait le dossier où étaient rangés les actes de propriétés, les papiers officiels. Pourquoi ne lui avait-elle pas donné tout ça, lors son entrevue à l’étude ? Il y avait aussi un brouillon de lettre qui commençait par « Petit frère », trois lignes ensuite qui ne m’apprirent qu’une chose : elle n’avait pas prévu de mourir si vite. C’était la raison pour laquelle, Maria ne m’avait pas mis au courant de l’existence de ce bureau clandestin. Mon flair de flic m’avait fait découvrir son emplacement mais ce mystère me laissait plutôt pensif.
Être si riche et vivre si chichement, comme une recluse. Maria avait tenu des livres de comptes, toute sa vie. Ce n’était pas une exception. C’était dans son caractère. Ce qui était bizarre c’était l’achat de cette vieille baraque, juste après le décès de son mari, dans le seul but d’y planquer sa comptabilité ?
Espèce de naze !
Je me retournai vivement croyant apercevoir mon piaf. Mais il n’y avait rien. Même pas un bout de plume ! Pourtant j’avais bien entendu. Je n’avais plus qu’à revenir à la Buissonnière.
Je devais tenter d’identifier qui était l’Astérie.
Je retournai à l’aire des camping-cars. Il y en avait pas mal de neufs. La pandémie avait fait exploser le marché. La plupart des tracteurs étaient des Fiat Ducato, mais il y avait aussi des Ford et des Mercedes. Mon California, à côté de certains gros, faisait figure de jouet. Gueule d’amour me fit la fête. Je le détachai pour qu’il se dégourdisse les jambes cinq minutes. Il en profita pour aller pisser sur quelques roues.
A Issepts, le portail était ouvert et cela m’interpella. Je l’avais fermé en partant, mais je savais que la voisine avait les clefs.
Je garai mon Volkswagen, sans me presser. La porte d’entrée était verrouillée et je fouillai dans le trousseau à la recherche de la clef. A l’intérieur, je sentis immédiatement qu’il y avait un truc qui clochait. Une odeur, un parfum subtil, aérien, avec des nuances d’agrume, flottait dans le grand salon. Je scrutai le mobilier mais tout paraissait en ordre. Le seul désordre était celui que j’avais occasionné lorsque j’avais fouillé la maison méthodiquement. Les sens en alerte, je revisitai la demeure de fond en comble. Dans la bibliothèque, je retrouvai encore des effluves légères de ce parfum. Quelqu’un avait visité les lieux durant mon absence. Une femme certainement. Sans doute la voisine, me dis-je, comme pour me rassurer. Mais rassurer de quoi ? Je n’étais pas sur une enquête même si la découverte des dossiers avait chatouillé mon imagination.
Soudain quelqu’un agita la clochette suspendue à l’entrée. Je fis demi-tour et allai lui ouvrir. C’était une petite femme d’une soixantaine d’années, les cheveux longs, d’un blanc naturel, avec un visage rond, souriant, et tanné par le soleil, vêtue d’un tablier de travail, chaussée de bottes en caoutchouc, portant un panier d’osier sous le bras.
- Je suis Sylvie... La voisine...
- Ah oui ! J’ai entendu parler de vous... Le notaire m’a dit que vous aviez les clefs de la maison.
Sylvie changea de physionomie.
- Vous désirez les reprendre ?
- Non rassurez-vous. Si ma sœur vous a fait confiance il n’y a pas de raison pour que je vous les enlève.
- Je vous ai apporté des girolles en signe de bienvenue, ajouta-t-elle, ayant retrouvé son sourire.
La voisine sentait un mélange d’odeurs campagnardes mêlées à celle d’une transpiration due à la cueillette des champignons.
Ce n’était donc pas elle qui était venue me rendre visite. Je la remerciai chaleureusement mais je ne l’invitai pas à rentrer.
Sylvie, m’abandonna son panier et rentra chez elle, suivie par un chien jaune, au poil court que je n’avais pas remarqué au début. Je refermai la porte dubitatif. J’entendis les clebs qui aboyaient. J’ouvris à nouveau la porte mais ils ne faisaient que jouer.
J’allai dans la cuisine et me servis un verre de vin. Je me roulai une clope. J’avais besoin de réfléchir.
Ma chère frangine, dont on m’avait soigneusement caché son existence, vivait solitaire dans cette belle maison perdue au fond du Lot. Elle possédait une comptabilité cachée qui disait qu’elle était propriétaire d’un patrimoine très conséquent. Elle percevait depuis des années d’importants revenus qu’elle ne conservait pas, alors qu’elle était assujettie à l’impôt sur la fortune. Pourquoi faisait-elle transiter ces différentes sommes vers ce mystérieux destinataire qui portait le nom bizarre de l’Astérie ? Il y avait, en outre, cette photographie au mur, en couleur, avec cet homme devant une plage bondée qui avait dû servir de modèle au grand tableau du salon de la maison.
Et comment Louis, Bouyssou, le mari à la moustache, celui du cadre doré, sur le bureau de Figeac, était-il mort ? Surtout qu’était devenu cet enfant ? Il devait avoir aujourd’hui 45 ans.
Je ne savais même pas si c’était une fille ou un garçon. C’était peut-être cet homme ou cette femme, pensai-je, qui pourrait m’expliquer l’étrange comportement de Maria. Si seulement je parvenais à l’identifier... Sauf que je n’avais rien trouvé, pas de carte-postales, pas de lettres, aucune pièces d’identité et pas même un album de photos, comme dans toute famille qui se respecte.
Les croutes aux murs espèce d’abruti !
Je fis volte-face ! Toujours pas de piaf. Ce connard de volatile jouait avec mes nerfs. Il avait décidé de me snober depuis que j’avais donné ma démission. En réalité, je savais très bien que puisque je ne cogitais plus sur des meurtres, il n’avait plus de raison de venir.
Je laissai tomber... L’oiseau ou simplement mon inconscient avait raison. Dans la vingtaine de toiles qui étaient accrochées sur les trois cent mètres carrés de la Buissonnière, il y avait peut-être un indice. Sur les toiles, la plus ancienne, il y avait un enfant d’environ deux ans... Sur la première, datée de 1978, elle l’avait peint, blotti dans ses bras. Puis au fil des ans, sur d’autres peintures, elle avait représenté l’enfant avec un corps qui grandissait, mais Maria avait conservé les traits de ses deux ans... C’était saisissant. Je n’y avais pas prêté attention sur le moment. Après avoir parcouru les autres peintures de la maison, je constatai qu’à partir de 1990, il n’y avait plus de représentations de l’enfant. Maria l’avait gommé. Elle s’était lassée de peindre son fils sur un corp disproportionné. En tous cas, j’avais une partie de ma réponse. C’était un garçon.
J’avais plusieurs options. La première faire parler l’ordinateur de Maria. Ensuite, demander à une copine, Viviane qui bossait à la financière de fouiller sur cet Astérie. Puis avant de me pointer sur la Côte d’Azur et prendre le bateau pour la Corse, une discussion sérieuse s’imposait avec ma digne mère. Elle était âgée mais elle possédait encore sa tête. Elle en avait avoir besoin pour m’avouer pourquoi un tel secret de famille !
Je refermai le cahier et je me mis à cuisiner les girolles. Je n’avais rien de mieux à faire.
J’avais l’intention de repartir le lendemain à Toulouse et de confier l’ordinateur aux bons soins du lieutenant Michel, au commissariat de l’Embouchure. Lui seul pouvait le craquer...
Et du con ! Tu n’as pas oublié l’essentiel ?
Merde ! Encore mon oiseau invisible... Toutefois je pris, cette fois, sur moi et lui répondis :
- J’ai oublié quoi ?
Fait activer une recherche sur l’existence du marmot par tes petits copains de l’Embouchure...
J’avais perdu mes reflexes de policier ! Il était évident que je devais commencer aussi par cela.
Son métier comportait certains risques
Bergamote Duclair avait dépassé la quarantaine... Elle était blonde comme les blés. Ce n’était qu’une couleur qu’elle se faisait elle-même car elle n’avait jamais le temps, ni l’envie d’aller chez le coiffeur. Sa couleur de brune, lui procurait un visage trop déterminé. Dans son métier, se faire passer pour une blonde, lui permettait de duper les hommes. Bergamote Duclair était toujours célibataire et avait alterné les conquêtes amoureuses, masculines et féminines, pour respecter une parité qui lui convenait parfaitement. Elle ne pratiquait aucun sport et n’aimait que le béton. Elle trouvait la nature hostile.
Elle ne faisait pas de vélo, n’était pas écolo et ne mangeait pas bio... Bergamote n’aimait pas jardiner, mettre les mains dans la terre était pour elle un fort dégoût au même titre que l’existence des araignées et des insectes en général. Seules les fleurs coupées revêtaient à ses yeux de la beauté car elles fanaient rapidement. Elle dévorait les livres, ne regardait pas la télévision, écoutait Nostalgie dans sa Mercedes et les commentaires de rugby sur Sud Radio en souvenir du grand-père. Le matin, elle branchait les informations et s’intéressait aux faits divers. C’était une déformation professionnelle car elle était détective depuis huit ans. Avant cela, elle avait bourlingué sur les continents ce qui lui avait donné une certaine assurance, indispensable dans son métier. Quant à son côté maternel, elle avait décidé qu’il était inutile de faire des gosses et qu’il y en avait suffisamment sur terre. En outre, il n’était pas question de prendre un animal de compagnie, pour compenser un manque quelconque d’affect. Son père avait été un haut gradé de la gendarmerie, et venait de prendre une retraite méritée en Savoie.
Elle avait profité du départ de l’ex-commissaire pour visiter la maison que son client lui avait désignée. Ce n’était pas légal mais dans sa profession il n’existait pas de procédure. A peine un règlement déontologique qu’elle avait à peine lu. Elle était revenue bredouille et aussi passablement étonnée. On lui avait demandé de récupérer un simple carnet d’adresses ou ce qui pouvait lui ressembler. Or, elle n’avait rien trouvé... Ce carnet devait avoir une certaine importance aux yeux de son client car il lui avait réglé un acompte substantiel afin de mener à bien sa mission. La fouille avait été pratiquée dans les règles de l’art. Elle était presque certaine que ce carnet n’y était pas.
L’anomalie du manque de paperasse, lui avait sauté aux yeux.
Cet ancien flic qu’elle connaissait de réputation et dont on lui avait dit de se méfier, était reparti quasiment toute la journée.
Quand Visconti était revenu, en fin de journée, de son poste d’observation, elle l’avait vu sortir de son van California, les bras chargés de cahiers noirs. Elle ne savait rien d’autre... Ni à qui appartenait cette grande maison, ni ce qu’était venu faire cet ex-policier dans le Lot. Avait-il trouvé le carnet d’adresse ?
Et quels étaient ces cahiers qu’il avait ramenés avec lui ?
Elle avait abandonné sa planque devant la Buissonnière, puis elle était repartie à Figeac. Elle rajouta de l’eau chaude dans la baignoire de sa chambre d’hôtel. Comme le vieux Churchill, sans le cigare, elle réfléchissait mieux dans l’eau moussante d’un bain. Toujours enfouie sous la mousse, elle rappela son client et lui fis un premier rapport. La personne à l’autre bout du fil haussa le ton. Il exigeait une solution rapide. Le carnet existait bien et il ne devait pas tomber aux mains de ce policier à la très mauvaise réputation.
Elle sauta hors de la baignoire et se sécha avec la serviette de l’hôtel. Devant la glace, elle observa un moment son corps et accepta le verdict de sa nudité. Elle enfila un pantalon stretch noir et une chemise anthracite. Il faisait bon et elle n’avait pas besoin de se vêtir davantage pour ce qu’elle comptait faire. A vingt heures, dans la salle du restaurant, elle commanda une salade accompagnée d’une bouteille d’eau minérale. Puis, elle sauta dans sa Mercedes coupé et reprit la route d’Issepts.
Visconti avait ramené, semblait-il, de la paperasse. Sans doute avait-il mis aussi la main sur le carnet ? Il ne restait plus qu’à repénétrer dans la maison et fouiller dans ses poches. Tâche autrement plus compliquée que la discrète visite qu’elle avait faite dans l’après-midi. Le métier comportait parfois quelques risques. Il lui arrivait d’agir illégalement mais comment faire autrement si l’on voulait des résultats ? Son client demandait de voler un carnet qui ne lui appartenait pas. Elle se voilait la face. Seul comptait le solde important qu’on lui avait promis et qui résoudrait, pour un temps, le découvert de son compte en banque.
Elle aimait, en outre, cette montée d’adrénaline.
Le problème ce n’était pas le chien. Elle connaissait son nom.
Elle avait entendu le commissaire l’appeler fortement pour le faire rentrer... Dans son métier, elle avait appris que seuls les chien dressés étaient capables de refuser un bout de viande sanguinolent. Pour l’occasion, elle avait acheté un steak. Elle y avait inoculé, à l’aide d’une seringue, une drogue pour le faire roupiller un bon moment.
Gueule d’amour, ne se fit pas prier et engloutit, sans presque le mastiquer, ce bout de viande, qu’une gentille dame venait de lui jeter par-dessus le portail, lorsque son maître l’avait fait sortir pour aller pisser avant de faire dodo.
Visconti l’appela, et se remit sur le canapé. La série policière arrivait au dénouement. Il s’était endormi au milieu, mais le chien avait gémi pour sortir et l’avait tiré de sa somnolence.
Marcello avait trouvé une bouteille d’eau de vie de poire et il avait oublié qu’il s’était juré de ne boire que le week-end. Il avait abusé. Plus tard, quand il monta se coucher, il emporta une bouteille d’eau. En gravissant les marches de l’escalier, il songea qu’il ne s’était pas trompé sur l’assassin de la télé. Les réalisateurs de ces téléfilms manquaient parfois d’imagination.
Gueule d’amour était resté au pied du canapé.
Au milieu de la nuit, Visconti entendit le tonnerre et la griffure violente d’un éclair traversa la nuit. Il avait laissé la fenêtre ouverte et la pluie commençait à envahir la chambre. Il se leva en maugréant, à moitié endormi et la referma. Puis, l’envie de pisser le prit. Il sortit, pieds nus, et rejoignit le couloir. Il buta contre un corps mou. Il n’avait pas allumé la lumière mais ses pieds reconnurent le pelage chaud du chien. Il le poussa pour que monsieur daigne libérer le passage mais Gueule d’Amour continua à ronfler comme un bienheureux. Intrigué et inquiet, il se pencha et le secoua vigoureusement.
Sans succès pour autant...
Son instinct de flic le fit se relever doucement. A ce moment-là, une déflagration monstrueuse éclata près de la maison et le battage de la pluie redoubla sur le toit et sur les vitres. Visconti comprit que Gueule d’amour avait été drogué. Ce sommeil de plomb n’était pas naturel. Avec un orage pareil, le chien aurait dû être inquiet et sur ses gardes... Le commissaire se souvint du parfum discret qu’il avait décelé l’après-midi et subodora immédiatement que la visiteuse était revenue.
Il était en caleçon et torse-nu. Il hésita à descendre dans cette tenue. Si la visiteuse était encore là, cela le gênait... Il revint dans la chambre, enfila à la hâte son pantalon et sa chemise et entreprit de gagner le rez-de-chaussée à pas de loup, ayant au préalable, jeté un coup d’œil rapide dans les autres pièces du premier. Profitant du boucan de l’orage, il descendit une à une les marches de l’escalier. Celui était en marbre et il ne risquait pas de craquer. Les sens aux aguets il déboucha dans le couloir.
Soudain, une ombre se profila dans sa vision. L’espace d’un éclair qui avait éclairé le grand salon, il l’avait vue, enjamber la fenêtre. Il avait eu le temps d’apercevoir qu’elle tenait un sac passablement rempli.
Bergamote Duclair pesta intérieurement sur cet orage qui était venu bouleverser la chaude quiétude de cette nuit d’été. Elle avait trouvé les cahiers et le fameux carnet d’adresses qui était rangé dans le tiroir du bureau. Sa visite de la veille lui avait permis d’aller vite en besogne. A la seule différence, elle avait été obligée de découper un carreau de la fenêtre pour entrer car l’ex-policier n’avait pas oublié, cette fois, de fermer la porte qui donnait sur l’arrière de la maison. Giflée par les rafales de la pluie, elle longea le jardin dans sa partie sombre, sous les arbres, et se délesta de son sac en le jetant par-dessus le portail fermé à clef. Elle prit son élan et l’escalada avec une certaine difficulté. Elle avait garé sa voiture à une centaine de mètres. Complètement trempée, elle se réfugia vivement à l’intérieur de la Mercedes et déposa le sac sur le siège du passager. La détective dégoulinait. Sa chevelure blonde de starlette n’était plus qu’une tignasse imbibée. Ses vêtements lui collaient au corps. La détective Duclair sortit de la boite à gants un paquet de mouchoirs en papier. Elle s’essuya le visage. Son rimmel avait coulé. Elle appuya sur le bouton du démarreur. Il était temps de s’éloigner et de réintégrer le confort de sa chambre d’hôtel.
Soudain, la portière s’ouvrit violemment. Une poigne de fer l’attrapa par les cheveux et la tira hors du véhicule. Elle hurla de douleur et de rage de s’être laissée surprendre comme une débutante. Sur l’asphalte, la surprise passée, elle retrouva ses réflexes de défense et parvint à se dégager. Toutefois l’homme était vigoureux. Il savait aussi se battre. Ils s’empoignèrent et elle tenta plusieurs prises mais sans succès. A l’évidence, son adversaire évitait de la frapper avec ses pieds et ses poings. Il essayait juste de la maîtriser. Elle reconnut l’ex-commissaire dans cet homme, échevelé.
Elle, par contre, n’avait pas ces réticences et si elle avait pu le mettre KO elle ne se serait pas gênée. Visconti parvint à se placer derrière elle et lui coinça les bras. Mais Bergamote rua comme une pouliche et les deux corps perdirent l’équilibre et roulèrent dans le fossé. Leur chute dans l’eau boueuse ne mit aucun frein à leur ardeur au combat. Aucun ne voulant lâcher prise. La jeune femme profita d’un instant de relâchement de son adversaire, pour prendre la fuite dans le champ labouré.
Ce fut une mauvaise et peu glorieuse décision. Visconti la rattrapa et il la plaqua.
Ils roulèrent dans la terre grasse et bientôt ne ressemblèrent plus à rien. L’orage s’en été allé vers d’autres lieux, plus au nord, mais la pluie n’avait pas cessé. Hors d’haleine, les deux combattants n’en pouvaient plus. Debout, face à face, et les pieds dans la boue collante, ils s’observèrent un moment en chien de faillance. Ils tentaient, l’un et l’autre, de reprendre leur souffle. Enfin, ce fut l’ex-policier qui parla en premier.