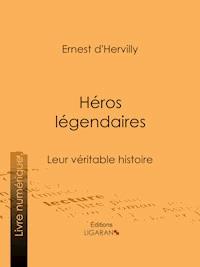
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dagobert Ier était mort depuis plus de mille ans quand Molière donna sa comédie des Fâcheux. Et ce fut bien heureux pour le poète ! Car si le roi Dagobert, que la chanson, infiniment trop populaire, hélas ! qualifie de bon, bien à tort, attendu qu'il n'y allait pas de main morte quand il s'agissait de faire passer les gens, et par milliers, de vie à trépas, – si le roi Dagobert, dis-je. avait été encore vivant sous Louis XIV, il n'aurait pu écouter sans fureur..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dagobert Ier était mort depuis plus de mille ans quand Molière donna sa comédie des Fâcheux.
Et ce fut bien heureux pour le poète !
Car si le roi Dagobert, que la chanson, infiniment trop populaire, hélas ! qualifie de bon, bien à tort, attendu qu’il n’y allait pas de main morte quand il s’agissait de faire passer les gens, et par milliers, de vie à trépas, – si le roi Dagobert, dis-je, avait été encore vivant sous Louis XIV, il n’aurait pu écouter sans fureur la spirituelle satire du chasseur des Fâcheux, et il aurait prié son royal cousin de lui en livrer l’auteur, pieds et poings liés, pour en disposer à sa guise.
Le sage saint Éloi aurait eu beau lui dire :
– Ô mon Roi, nous ne sommes plus au VIIe siècle, et ce sont les mœurs d’à présent…
Le roi Dagobert aurait répondu en grinçant des dents :
– Ce grimaud est le dernier des misérables, et il convient de le supprimer illico !
– Mais, Sire !…
– Il n’y a pas de mais !… Sans doute, et je l’accorde volontiers, ce Molière a raison de faire dire à son fâcheux :
car un chasseur qui donne mal à propos du cor dans une chasse est digne des plus grands supplices ; mais ce Molière se rend coupable d’un crime de lèse-majesté en se moquant des chasseurs en général et même des porteurs de huchet, car sans les chasseurs et surtout sans les sonneurs de huchets, de cornets, de grand cor, de trompe à deux ou à six tours, je serais aujourd’hui, moi le roi Dagobert, moi le Nemrod mérovingien et chevelu, moi enfin le chasseur sans pareil, je serais, mon brave Éloi, absolument ignoré du monde entier, et plus anéanti dans les royales poussières de Saint-Denis qu’un grain de sable au fond de l’océan. Donc, en raillant les chasseurs qui seuls perpétuent mes exploits et mon nom dans la mémoire des fils des Francs. Molière insulte mes infatigables amis et moi-même ; donc Molière mérite la mort.
– Ô mon Roi !
– Non, non ! Qu’on l’attache, non par sa perruque, mais par ses propres cheveux, à la queue de divers chevaux, et fouette cocher.
– Sire, encore un mot ?
– Parle.
– Réfléchissez, Sire, avant d’en arriver à cette extrémité regrettable. Écoutez les avis désintéressés de votre orfèvre, de votre ministre, de votre ami. Vous ne vous en êtes jamais mal trouvé, je pense.
– Non, ça, c’est vrai.
– Eh bien, épargnez Molière. C’est un homme d’esprit et de bon sens. Vous fûtes jadis un amateur fin de beaux émaux, de joailleries pleines d’art, de monnaies bien frappées. Molière est une intelligence superbe, un artiste de grand goût, un homme marqué au bon coin. Laissez-le vivre.
– Allons, je t’accorde cela ; Molière vivra et moi aussi, longtemps encore, en dépit de sa boutade contre la chasse et les chasseurs.
Deux siècles plus tard, la conversation entre le roi Dagobert et son fidèle orfèvre et maître des monnaies aurait pu prendre une tournure différente, et saint Éloi aurait pu invoquer de bien autres arguments.
En effet, au XVIIIe siècle, les antiques paroles comiques relatives à Dagobert que des générations de chasseurs et de piqueurs avaient adaptées, pour se les bien graver dans la mémoire, aux mots ou sons primitifs d’un certain air de chasse, avaient été considérablement revues et surtout augmentées.
Aux premiers couplets, brodés sur les paroles du Moyen Âge, s’étaient ajoutés, de siècle en siècle, des couplets composés sans doute après boire à la fin des franches lippées des jours de chasse. Et le refrain de chasse était devenu, petit à petit, une interminable complainte.
L’époque moderne elle-même n’est pas restée en arrière. Elle a apporté sa part poétique à ce monument grotesque.
Voici quelques couplets de la chanson :
Après la campagne de Russie et le retour précipité de Napoléon Ier, on chanta :
Mais c’est le XVIIIe siècle qui a le plus contribué à l’accroissement de la légende cynégétique du bon roi Dagobert.
Aussi, au XVIIIe siècle, si, revenu de nouveau à la vie, le roi Dagobert avait pris encore une fois le parti des chasseurs qui font vivre son nom, le brave saint Éloi lui aurait répondu :
– La chanson populaire que vous savez, Sire, proclame, – à côté de cent sottises qu’une connaissance plus approfondie de l’Histoire aura bien de la peine à détruire dans l’esprit de la foule, – ces deux vérités exactes : la première, que vous fûtes un grand et intrépide chasseur ; la seconde, que vous écoutiez assez docilement les avis de votre Éloi, tout en les recevant d’abord avec quelque ironie.
– C’est vrai, Éloi, et puis ?
– Eh bien, Sire, à mon avis, ne prenez pas aussi haut la défense des chasseurs et de leur chanson…
– Et pourquoi cela ?
– Pour deux raisons. D’abord cette chanson, si la Reine l’examine de près, vous attirera quelques désagréments dans votre ménage ; nous en reparlerons tout à l’heure. En second lieu, si vos réclamations forcent l’Histoire à examiner, de près aussi, ce que la chanson rapporte de vous, la partie ignorante de la nation française apprendra enfin, à votre dam, qu’au lieu d’être le bon roi conciliant et goguenard qu’elle connaît, vous n’avez été qu’un barbare vaniteux ajoutant les brillants vices romains aux sauvages mœurs d’un Franc ; que vous étiez un chasseur farouche, c’est vrai, mais aussi un débauché terrible, un ivrogne et un abominable bourreau, digne petit-fils de ces monstres qui s’appelaient Chilpéric et Frédégonde.
– Eh ! eh ! saint Éloi, vous allez un peu loin !
– Vous savez bien que non, Sire ! Croyez-moi, les peuples de France vous soupçonnent bien de quelque insensibilité, puisque la chanson dit que vous m’envoyâtes noyer, moi votre vieil ami, avec vos chiens couverts de gale ; mais ils ignorent que, froidement, après avoir offert l’hospitalité en Bavière à dix mille Bulgares chassés par les Avares, vous les avait fait égorger en une seule nuit, parce qu’ils vous gênaient et que vous n’en saviez que faire…
– Nécessité politique, saint Éloi !
– Soit. La chanson ne dit pas non plus que vous êtes mort à trente-six ans à peine, de la suite de vos excès de toute sorte. Vous vous piquiez de lettres étrangères, comme votre grand-père Chilpéric…
– Et de théologie aussi, mon cher saint Éloi ; mais ce que la chanson a tort de ne pas mentionner, ce sont mes fondations pieuses… ou plutôt celles que vous faisiez avec mes libéralités. Enfin, j’ai honoré en votre personne un grand artiste et je l’ai mis à même, ce qui est plus rare, de se livrer à la réalisation de ses rêves, en lui confiant des métaux et des pierreries.
– C’est vrai, Sire, et je ne vous ai pas volé d’un liard.
– Non, au contraire. Avec les matières précieuses qu’un autre orfèvre me demandait pour fabriquer un siège royal, vous, vous m’en avez fabriqué deux, et d’une élégante magnificence.
– Sire…
– Aussi votre probité et votre désintéressement joints à votre talent m’ont fait vous choisir pour mon conseiller, mon ministre, mon orfèvre, mon monétaire et mon ami.
– Je vous aimais, Sire, en dépit de vos faiblesses, de vos fautes, de vos crimes.
– Je le savais bien. Aussi, je vous écoutais avec soumission, et la chanson le dit.
– En cela, elle ne ment pas.
– Alors, si elle ne ment pas, cette chanson, pourquoi disiez-vous tout à l’heure, mon frère Éloi, qu’elle pourrait apporter quelques troubles dans mon ménage.
– Certainement, Sire, si la Reine en avait connaissance…
– La Reine ? Quelle Reine, Éloi ! Ou plutôt laquelle ? Car, comme vous le savez, j’eus trois femmes, toutes trois légitimes, en même temps. Enfin de quelle Reine parlez-vous ? Est-ce de Gomatrude, de Manthilde, ou de Raguetrude ?
– De celle que vous voudrez, ô mon Roi ! Croyez-vous qu’elle serait satisfaite d’apprendre ce que vous en révélez, d’après la chanson de ces mêmes chasseurs qui ont tout votre cœur à présent.
– Bah ? Et qu’est-ce que chantent ces chasseurs ? Je ne me le rappelle plus.
– Hélas ! Sire, ils changent :
Ah ! ça, ce n’est pas galant, j’en conviens ; mais je n’ai jamais fait cet aveu. Ces chasseurs sont des imposteurs dangereux, et ils me feraient avoir des querelles dans mes ménages. Je ne les défends plus : ils sont très coupables. Qu’on les attache par les cheveux à la queue de divers chevaux…
– Sire, c’est inutile, ils sont morts.
– Vraiment il est affreux de voir ainsi travestir l’Histoire.
– Chut, ô mon Roi, et pour tout au monde n’en appelez pas à l’Histoire. Il ne serait pas bon pour vous, encore une fois, de réveiller ce chat qui dort. Il a des griffes.
– Et vous me les faites sentir diablement.
– Chut encore, Sire ! – Ne parlez pas de diables, car ils vous connaissent bien…
– Moi ? moi qui ai achevé et doté la basilique de Saint-Denis !
– Justement, à Saint-Denis même.
– Où est mon fauteuil de bronze, dans le Trésor !
– À Saint-Denis même, Sire, bien des siècles avant cette absurde chanson de chasseurs qui a si étrangement déguisé votre histoire véritable, un sculpteur qui n’aimait pas la musique, assurément, mais qui se souvenait sans doute de vos… peccadilles…, a sculpté un bas-relief où vous êtes représenté réclamé par des diables auxquels vous échappez à grand-peine…
– Ah ! le misérable ! Qu’on l’attache par les cheveux à la queue…
– Et fouette cocher ! Sire. Mais il est trop tard. – Et d’ailleurs les chroniques existent et elles relatent ce qui a donné lieu à cette œuvre d’art. C’est la vision d’un ermite. Cet ermite habitait près de Stromboli. La bouche du volcan était regardée comme l’entrée de l’enfer. Or, une nuit, cet ermite vous vit, vous, bon Roi Dagobert, passer dans une barque emportée par des diables. Vous alliez être englouti dans les flammes, lorsque survinrent trois saints pour lesquels vous aviez une dévotion particulière et qui vous délivrèrent.
– Oh ! soient remerciés saint Maurice, saint Martin et saint Denis !
– Sans doute. Mais reconnaissez. Sire, que l’on ne vous croyait guère digne du Paradis au moment de votre mort, et c’est pourquoi, loin d’invoquer l’Histoire, gardez le silence, si vous êtes prudent, – et ne parlez même pas de la chanson…
Nous qui ne sommes pas les amis de ce Dagobert si mal connu ; nous que sa chanson éclatante trouble, en automne, dans les bois, et au printemps, par les jours de carnaval, dans la ville, nous n’avons pas l’indulgence de l’honnête saint Éloi, et nous avons cru devoir mettre en parallèle l’histoire et la chanson de cet homme qui fut l’un des fléaux couronnés sous lesquels gémirent nos pauvres aïeux.
Je tiens l’histoire suivante d’un homme fort aimable, mais arracheur de dents de son état, je dois l’avouer, ce qui vous laisse, ô lecteurs, toute liberté de penser ce que vous voudrez de la véracité du narrateur et de la vraisemblance de certains faits contenus dans son récit.
Un soir de 1870, peu après l’investissement complet de Paris, me disait ce… consolateur de l’humanité souffrante, je vis arriver chez moi une brave femme de mon quartier qui me supplia de la suivre immédiatement, afin de donner les secours de mon art à quelqu’un de dangereusement malade.
Le mot me donnait à réfléchir. Mon art ? Sans doute on peut se faire arracher une dent, même pendant un siège, cela est certain, et de plus, en y réfléchissant, on arrive de trouver logique l’idée de diminuer le nombre de ses dents au moment où diminue aussi ce qui les nécessite. Pourtant, un instant après, je fus convaincu que la bonne femme, trompée par un léger subterfuge de ma façon, et lisant sur une plaque de cuivre à ma porte les deux lettres D.M. qui signifiaient Dentiste Mécanicien, avait cru y lire Dentiste Médecin. De là sa visite et son appel à mon art !
L’humanité me faisait un devoir de ne pas détruire son erreur, car, si je ne suis pas médecin, je sais assez bien conseiller et soigner les malades. Aussi je suivis la bonne femme sans retard.
En route, elle m’informa qu’elle tenait un hôtel garni dans les environs et que c’était dans un cabinet de cet hôtel que j’allais trouver la personne en question.
– Mais j’ai peur que vous n’arriviez trop tard, fit-elle avec une réelle bonté. Voilà bien des mois que je n’ai vu la couleur de son argent, à ce pauvre homme, et je crois bien qu’il n’a pas mangé son saoul depuis des mois plus nombreux encore. Je ne veux pas le tourmenter. Tout le monde souffre à présent. Ce n’est donc pas le moment de montrer les dents.
Je pensais en moi-même que la brave femme émettait sans s’en douter, hélas ! une opinion qui m’allait au cœur, car on ne me montrait guère les dents, en effet, depuis pas mal de semaines.
Enfin nous arrivons à l’hôtel. Précédé de la loquace propriétaire, je grimpe beaucoup d’étages et enfile de nombreux corridors, et nous voilà devant le numéro du malade.
L’hôtelière frappe, refrappe. Point de réponse. La clef était à la porte. On ouvre. Un grand silence dans le cabinet. Nous nous approchons du lit. Hélas !
La bonne femme avait conjecturé avec justesse : Le secours arrivait trop tard.
Le malade avait cessé de vivre.
Un regard promené dans la chambre me révéla l’affreuse misère du défunt. À part les objets nécessaires et qui faisaient partie du mobilier, il n’y avait rien, linge ou vêtements de rechange, qui indiquât que l’infortuné eût jamais possédé quelque chose à lui. Il n’y avait même pas de chaussures, chose étrange, souliers, espadrilles ou chaussons, sur le parquet.
– Tiens, c’est vrai, dit la bonne femme à qui j’en faisais l’observation ; il avait pourtant une paire de bottes ! Où diable sont-elles ? Oh ! Elles étaient assez grosses pour n’avoir pu disparaître dans un trou. Il a dû les vendre, voyez-vous, monsieur, et rentrer ici les pieds nus. Je ne sais pas ce qu’il faisait, cet homme-là. Il allait travailler dans les bois, à ce qu’il disait, et le soir il revenait, et il lisait toute la nuit, ou du moins il en avait bien l’air, car une chandelle lui durait à peine une nuit. Il lui en fallait toujours de nouvelles, et même ça me coûtait assez cher. Enfin, le voilà mort. C’est fini. Il n’en usera plus.
– Oui, ma bonne dame, et il n’y a plus pour vous qu’à aller faire votre déclaration et à attendre le médecin des morts.
Et je la quittai sur ces mots.
Le lendemain, l’hôtelière revint à la maison et m’apporta quelques feuillets manuscrits trouvés par elle sur une chaise, sous l’unique vêtement du mort de la veille.
– Lisez-moi ça, je vous prie, monsieur, car, c’est ennuyeux de le dire à mon âge, mais je n’ai pas été à l’école. Lisez, c’est peut-être un testament.
Or voici, continua le… réparateur de la mâchoire humaine, ce que contenait le mince manuscrit du mort :
Qu’on n’accuse personne de ma mort : c’est à l’inanition que je succombe. Je n’ai pas eu la présence d’esprit de franc-filer au bon moment et ces quelques dernières semaines d’abstinence ont suffi pour m’amener à l’état où je suis en écrivant ces lignes. On comprendra sans peine que les privations, que d’autres supportent et supporteront vaillamment encore, m’aient si vite réduit à l’agonie, quand on saura que je suis (j’avoue enfin ce triste secret) un ogre, le dernier survivant de ces ogres dont la légende et même un peu l’histoire racontent l’appétit formidable et surtout… cannibalesque. Dieu soit loué, je n’ai pas à me reprocher d’avoir mangé des petits enfants comme mes ancêtres l’ont fait, à ce que disent les Contes, mais pour vivre, pour satisfaire aux demandes impérieuses et incessantes d’un estomac farouche, légué par une déplorable hérédité, j’ai mangé de tout ; j’ai ingéré et digéré, en même temps que les comestibles français ou exotiques, des choses dont la description ferait frémir d’horreur. Parmi les plus honnêtes, je citerai pourtant les natures mortes, extrêmement mortes, hélas ! que les peintres de ce genre de sujets laissent « à la pose » pendant des semaines entières, tandis qu’ils sont à boire des bocks dans les cafés. Après l’ouverture du Salon, je parcourais les ateliers de ces messieurs et j’emportais les poissons, les lièvres, les faisans et les crustacés dont le ton avait par trop changé. Enfin, avec cela et les morceaux que les halles me fournissaient soir et matin pour quelques sous, j’arrivais à « boulotter. » Je ne mangeais pas à ma faim, mais je vivais et j’étais quelques heures tranquille. Et pourtant, la nuit, que de fois, avec la sensualité d’un Cosaque, que de fois j’ai dévoré la chandelle de mon honnête hôtesse.
Mais le siège est pour moi le dernier coup. Il n’y a plus à manger suffisamment pour un pauvre homme de mon espèce, à Paris.
J’ai tout tenté. Je suis vaincu. J’ai faim et je meurs.
Et tout à l’heure encore, hélas ! j’essaierai d’un aliment suprême qui, s’il ne m’étouffe pas sur-le-champ, apaisera peut-être pour un instant mon féroce appétit.
Je veux parler de mes bottes fées, léguées d’ogre en fils depuis des siècles, de mes chères bottes de sept lieues, si précieusement conservées par mes aïeux et par moi.
Car le Chat-botté et le Petit Poucet les ont en vain dérobées jadis à mes ancêtres.
Le Chat-botté, qui, lorsqu’il fut devenu riche, ne courait plus après les souris que pour se divertir, dit M. Perrault, les ayant laissées traîner un jour et le marquis de Carabas les ayant fait jeter aux ordures, nos bottes volées furent retrouvées un matin par d’autres ogres, les parents et les amis de ma famille.
Car les ogres de jadis, je le dis avec orgueil, avaient beaucoup d’amis et étaient fort aimés des leurs ; et la preuve, c’est que le Chat-botté et le Petit Poucet trouvent toujours les ogres en train de préparer quelque beau repas pour leurs camarades. C’est écrit.
Oh ! la chair fraîche ! ! !
Mais c’est assez parler de moi, parlons un peu de ces admirables aïeux dont, je le confesse, si l’estomac était insondable, l’intelligence paraît avoir été fort mince.
En effet, se changer en souris, à la demande d’un chat, c’est révoltant de naïveté !
Il est vrai qu’ils avaient pour les excuser l’exemple de personnages considérables, un peu ogres aussi de toutes les façons, qui se sont laissé duper et vaincre par des ennemis petits et rusés : on se rappelle Polyphème et Ulysse, Goliath et David.
Hélas ! notre grand ancêtre à tous, le premier mangeur d’enfants irréfléchi dont fasse mention l’histoire mythologique, nous avait tracé la route des déceptions.
Saturne, puisqu’il faut l’appeler par son nom, avalait gloutonnement, avec satisfaction, des cailloux recouverts de langes que son épouse Rhéa lui présentait comme sa propre progéniture, et il a sans doute transmis son manque d’esprit et de tact à tous ses descendants.
Le brave Hercule lui-même, dans les comédies grecques, est traité sans cesse d’ogre insatiable et légèrement imbécile. Mais pourquoi plonger plus avant dans ma généalogie. Qu’il me suffise de dire que, comme ogre mangeur d’enfants, je repousse absolument et avec mépris cet Hérode qui tuait les innocents, non pour se nourrir, mais par un lâche calcul de féroce politique.
D’où vient notre beau nom terriblement sonore, et dont je suis fier encore sur ce grabat ? Voilà ce que beaucoup se demandent. Les uns le font venir de Og, le gigantesque et cruel roi de Basan dont parle la Bible ; un être magnifique dont le corps couvrait sept arpents de terrain. Il eut, dit-on, la chance d’échapper au déluge en s’étalant la nuit sur le toit de l’arche. Mais, hélas ! nul n’évite son sort, et plus tard il fut tué par les soldats de Moïse. D’autres érudits affirment que notre nom nous a été donné au Ve siècle de l’ère chrétienne, à la suite de l’invasion formidable, dans la Germanie et jusqu’en Gaule, de sauvages dévastateurs appelés les Oïgours, avec lesquels marchaient les Hongrois, ou, comme on les a longtemps nommés, les Hongres.
Oïgours, Hongres, Ogres, telle serait la gradation.
Ces barbares étrangers, impitoyables, voraces, tuant tout, les enfants et les femmes, ces mangeurs de chair crue, ces buveurs de sang dans le crâne de leurs ennemis, laissèrent partout de leur passage une trace ineffaçable. L’épouvante qu’ils inspirèrent se perpétua proverbialement ; et bien longtemps, des siècles après leur retraite, les mères faisaient encore taire leurs enfants criards en les menaçant de les faire dévorer par l’Hongre ou l’Ogre ! M. Perrault, de l’Académie française, ne les a donc pas crées, il a ramassé le nom dans les contes de nourrice pour l’insérer dans les siens, et les ogres et leur réputation ont été ressuscités pour la plus grande terreur des petits enfants.
Pour moi, je le répète, si j’ai soutenu la réputation de mes aïeux, c’est seulement à la manière de Gargantua et de Pantagruel. Il peut m’être beaucoup pardonné, parce que si j’ai beaucoup mangé, ce n’est pas de la chair fraîche et encore moins celle des petits enfants. J’ai croqué de nombreux marmots, mais métaphoriquement.
Mais je m’arrête. La force m’abandonne comme elle abandonna Ferragus, le géant qui avait six coudées de hauteur, quand il fut occis par Roland. Mon Roland à moi, c’est la faim. Mais il fallait, en vérité, que la plus grosse ville du monde fût en péril pour que la mort atteignît le dernier des gros mangeurs de l’univers.
Maintenant, tout est dit. L’heure est venue, sur le radeau de la Méduse où je m’éteins, de procéder au repas qui doit ou me permettre d’attendre, ou me tuer sur-le-champ.
Je vais manger mes bottes de sept lieues !
…
Ici s’arrêtait la confession du dernier des ogres.
Je rendis le manuscrit à la bonne femme, qui n’en revenait pas de cette révélation, et elle s’en alla, en hochant la tête, après m’avoir remercié.
Nous ne voudrions pas contrister les amateurs, collectionneurs et prôneurs des produits de l’ancienne imagerie populaire, parmi lesquels nous avons de bons amis.
Pourtant nous croyons de notre devoir de leur démontrer une fois de plus, en usant de la vieille métaphore du fleuve bourbeux qui roule quelques paillettes d’or mêlées à ses graviers et à ses vases, que l’imagerie populaire d’autrefois, si elle a servi de véhicule, de temps à autre, à de rares bonnes vérités et fourni parfois d’utiles renseignements, en revanche elle a surtout contribué à propager de fausses notions et des erreurs de toute sorte, historiques, religieuses, scientifiques, littéraires, orthographiques. Elle a surtout perpétué, comme les almanachs, des superstitions, des préjugés, des routines, des anachronismes de costumes et de décors. Enfin, elle a puissamment aidé à pervertir le goût et l’œil dans les classes paysannes en les accoutumant à supporter en paix de terribles assemblages de couleurs criardes et fausses de ton, et à regarder de grossiers dessins comme des œuvres d’artistes.
Pour les curieux instruits, cuirassés de bons principes esthétiques, rien de plus récréant, rien de plus intéressant à voir que l’imagerie de jadis. Sa contemplation est pour eux sans danger.
Mais pour les ignorants, c’est tout autre chose.
La Chanson et le convoi de l’invincible Malbrouck que nous avons sous les yeux en ce moment et qui sort des vieilles imprimeries de Metz va nous servir à prouver ce que nous avançons.
La gravure d’abord :
Dans le costume et dans les armes des personnages qui portent et entourent le prétendu cercueil, rien ne rappelle les armes ou le costume des soldats de la fin du règne de Louis XIV.
On dirait plutôt des gens de guerre du XVIe siècle.
Et même cela nous fait songer que Le Roux de Lincy, dans son recueil des chansons historiques de France, donnant comme moule de la complainte de Malbrouck la chanson du convoi du duc de Guise, il se pourrait bien que la gravure que nous avons sous les yeux soit le vieux bois qui a servi à illustrer le convoi du duc de Guise ?
En tout cas, si cela est matière à réflexion pour nous, cet anachronisme de costume ne peut qu’induire en erreur les classes populaires.
Ensuite, et comme complément historique de la complainte de Malbrouck, où, bien entendu et comme il est d’usage dans les complaintes, il n’est fait allusion à aucun des traits et des actions véritables du héros qu’elles chantent, voici ce que l’imagerie populaire nous dit :
« Le célèbre Malborough naquit en Angleterre en 1650. Ce fut sous le maréchal de Turenne qu’il commença à porter les armes en France. Grand capitaine et négociateur habile, le duc de Malborough fit bien du mal à la royauté de Louis XIV.À Hochstett, à Oudenarde, à Ramillies, il se montra le digne émule de Condé et de Turenne ; son nom faisait la terreur et l’admiration du soldat. Il fut tué à la bataille de Malplaquet, en 1723, à l’âge de soixante-treize ans. »
Relevons les légères erreurs de cette notice.
Oui, John Churchill, qui devint duc de Marlborough, et non Malborough, naquit en Angleterre à Ashe, comté de Devon, en 1650. C’est exact.
Enseigne des gardes à dix-sept ans, il porta effectivement les armes en France, ou plutôt en Flandre, mais pour la France, l’Angleterre étant alors l’alliée de Louis XIV. Turenne le remarqua et le grand roi le félicita.
Il montrait déjà de belles qualités militaires, c’est vrai, mais s’il n’avait pas été très favorisé alors par la favorite de Charles II, la duchesse de Cleveland, et si sa propre sœur Arabella n’avait pas été la favorite du duc d’York, il est probable que son avancement aurait été beaucoup moins rapide qu’il ne le fut. Churchill devint colonel à vingt-deux ans.
Il fut dans la suite grand capitaine et négociateur habile. De plus, grâce à sa propre femme, Sarah Jeanning, qui dominait entièrement la reine Anne et la pétrissait comme une cire molle, il eut la chance inouïe de pouvoir projeter, faire adopter et mener à bonne exécution, presque sans contrôle, les actes politiques qui ruinèrent la royauté de Louis XIV et le pauvre pays de France. Mais s’il ruinait notre pays, ce grand Anglais ne se contentait de cette seule gloire. Il était thésauriseur comme pas un et insatiablement avide de richesses. Il s’en procurait par tous les moyens. Jeune, il trichait au jeu à la cour de Charles II et se faisait doter par la favorite du roi ; dans l’âge mûr, il puisait à pleines mains dans les indemnités de guerre payées par les vaincus.
Il est malheureusement très exact encore qu’à la bataille de Hochstett ou Hochstadt (que les Anglais ont appelée Blenheim), ainsi qu’aux batailles d’Oudenarde et de Ramillies, il battit les généraux français, en digne élève des grands hommes de notre pays, Condé et Turenne.
Mais s’il gagna, hélas ! la bataille de Malplaquet, avec une extrême difficulté d’ailleurs, et au prix de pertes énormes en hommes, artillerie et étendards, il est faux de dire qu’il y ait été tué et qu’il y mourut à l’âge de soixante-treize ans.
En cet endroit de la notice historique, il y a un entassement fait comme à plaisir de folles erreurs.
Premièrement, la bataille de Malplaquet fut perdue par nous en 1709 et non en 1723 ; deuxièmement, le duc de Marlborough n’y fut pas tué.
Troisièmement, enfin, même en admettant qu’il y fût mort, il n’y serait pas mort à l’âge de soixante-treize ans, attendu qu’il n’en avait alors que cinquante-neuf.
La vérité, c’est que le 8 juin 1716, il fut frappé d’apoplexie en son château de Blenheim, lequel lui avait été donné par la reine Anne, et avait coûté au peuple anglais douze millions et demi. Il y vécut, si cela s’appelle vivre, dans un état d’enfance jusqu’en 1722.
Sa veuve, qui ne monta jamais à la tour du château de Blenheim pour voir venir son page tout de noir habillé, ne mourut que vingt-deux ans après lui !
C’est une longue inconsolabilité ?
Voici maintenant la suite de la notice donnée par l’imagerie populaire.
« Dans cette bataille, si glorieuse pour les Français, le maréchal de Villars fut blessé au genou, lorsqu’il allait envelopper le duc de Malborough et l’écraser entre les deux ailes de l’armée française. C’est au bivouac de Quesnoy, où se répandit le bruit de la mort de Malborough, qu’un chansonnier badin lui composa cette oraison funèbre. Cette chanson fit fureur à la cour ; adoptée par la bourgeoisie de Paris, elle passa successivement de ville en ville, de pays en pays, et se perpétua jusqu’à nos jours. »
Commentons et rectifions.
Oui, la bataille de Malplaquet fut glorieuse pour la France, et évidemment si Villars n’y avait pas été blessé, ce général, aidé du brave et dévoué Boufflers aurait sans doute battu l’ennemi complètement.
C’est en effet, de l’avis unanime des historiens, au bivouac du Quesnoy, où l’armée française reprit haleine après Malplaquet, que fut composée par des soldats anonymes la complainte que tout le monde connaît, sur le bruit de la mort de Marlborough.
Elle est d’une haute fantaisie, et, comme nous l’avons dit, ne rappelant en rien les exploits ou le caractère du général anglais, elle pourrait parfaitement s’appliquer à tout autre personnage.
Mais si la chanson fut pendant un temps en vogue dans l’armée, elle ne fit nullement fureur à la cour de Louis XIV, et la bourgeoisie d’alors l’adopta si peu que, soixante ans à peine après la mort réelle de Marlborough, on ne chantait guère cette complainte que dans les campagnes où l’avaient rapportée les soldats redevenus laboureurs.
Et encore ne la chantait-on plus qu’à cause de son air plaintif et gracieux.
Quant à la bourgeoisie de Paris et des villes, elle l’ignorait parfaitement.
La preuve, c’est que nul n’en savait plus rien, lorsque, par suite d’un hasard tout à fait singulier, Marlborough et sa complainte, celle-ci ressuscitant celui-là, revinrent à la mémoire publique en 1783.
Ce hasard, le voici :
En 1783 – l’année où Montgolfier lançait son premier aérostat, où le chanteur Garat se révélait, l’année où Robespierre, alors avocat obscur à Arras, plaidait dans un procès pour le maintien d’un paratonnerre sur un toit, l’année où Mesmer exploitait le magnétisme animal, où Diderot mourait, où paraissaient les Confessions de Jean-Jacques ; en 1783, une heureuse et simple villageoise, comme dit le cousin Jacques qui l’a célébré dans un poème, allaitait l’enfant de Marie-Antoinette et de Louis XVI.
Un jour, cette heureuse et simple villageoise, qui portait le nom prédestiné de Mme Poitrine, ou que l’on désignait ainsi à la cour, se mit à bercer le royal marmot en lui chantant une vieille chanson.
Marie-Antoinette l’entendit. Elle fut charmée par l’air, et les paroles la firent sourire.
Elle interrogea Mme Poitrine sur cette berceuse bizarre.
Mme Poitrine lui répondit qu’elle l’avait apprise de sa propre mère et que cela s’appelait la complainte et le convoi de l’invincible Malbrouck.
La reine apprit à son tour la chanson et la fredonna.
À l’instant la cour la répéta, bien entendu, avec transport, et la transmit à la ville, où il n’y eut pas jusqu’aux petits Savoyards qui ne la chantassent.
C’est alors, et seulement, que la chanson de Malbrouck fit fureur à Paris ; que le nom du héros anglais, absolument oublié par la foule, éclata de nouveau dans toutes les bouches et se grava dans les mémoires, pour jamais cette fois.
Il n’en est plus sorti depuis.
Tout fut « à la Malbrouck » pendant un an et plus, à partir du jour ou Mme Poitrine révéla qu’il y avait eu un Malbrouck et une complainte faite sur ce général soixante-quatorze ans auparavant.
Cannes, peignes, chapeaux, chignons, habits, boutons, ragoûts, tout était à la Malbrouck.
Et nous avons nous-mêmes, à cette heure, pendu à notre muraille un plat à barbe en faïence qui date de cette époque, et au fond duquel on lit ces mots qui témoignent de l’engouement du temps :
AU RAZOÏER
À LA MALBROU
On ne parlait que de Malbrouck. On peignait et on gravait son convoi et sa complainte jusque sur les éventails.
Nicolet jouait Malbrouck en pantomime à grand spectacle.
Beffroy de Reigny (le cousin Jacques), auteur d’opuscules humoristiques, d’agréables comédies et de charmants airs, composa, pour répondre au vœu général, un poème en « prose rimée » de quelques centaines de vers qu’il intitula : Marlborough, et dédié au Dauphin en maillot.
Il obtint un grand succès qu’il ne méritait pas. Mais ce poème contient du moins pour nous la preuve que ce fut bien la nourrice du Dauphin qui apporta à Paris la complainte oubliée.
Paris était alors réellement fou de Malbrouck ainsi que de sa complainte.
Et c’est ce qui explique pourquoi Beaumarchais faisait chanter Chérubin sur l’air à la mode, dans Figaro, quelques mois plus tard. Il était sûr d’avance du succès de cette chanson langoureuse et naïve.





























