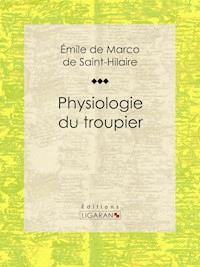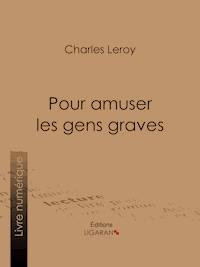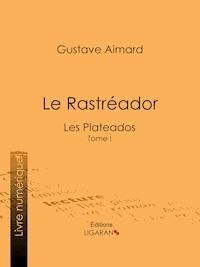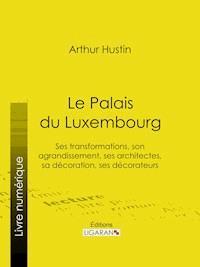Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : ""Tout est perdu fors l'honneur", écrivait François Ier à sa mère après le désastre de Pavie. Tout est perdu fors le crédit, a-t-on pu penser après la catastrophe de Sedan. C'est, en effet, le crédit, cet honneur des temps modernes, qui nous permet de nous relever des déplorables conséquences de nos fautes. Et nous n'entendons pas seulement ici le crédit public, mais encore le crédit particulier."À PROPOS DES ÉDITIONS Ligaran : Les éditions Ligaran proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants : • Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin. • Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Tout est perdu fors l’honneur », écrivait François Ier à sa mère après le désastre de Pavie. Tout est perdu fors le crédit, a-t-on pu penser après la catastrophe de Sedan. C’est, en effet, le crédit, cet honneur des temps modernes, qui nous permet de nous relever des déplorables conséquences de nos fautes. Et nous n’entendons pas seulement ici le crédit public, mais encore le crédit particulier, sans lequel le pays n’aurait pu supporter l’exil perpétuel de cinq milliards de capitaux, après la perte, pour tout le monde, de cinq à six milliards, à ne parler que de la France.
Dans ce volume nous ne nous occupons que de l’histoire du crédit particulier, et, encore, sous une de ses faces, mais la plus importante, celle qui, après tout, les réunit toutes, l’Institution de crédit. À chaque jour son œuvre.
Qu’est-ce que l’institution de crédit ? C’est la compagnie ou l’individu, qui fait profession de faciliter le prêt d’un capital du propriétaire qui ne peut le faire rapporter que peu, à l’emprunteur qui peut l’utiliser à meilleur compte. Une commission, sous une forme ou sous une autre, est son bénéfice unique. Tout est là, et en analysant les opérations utiles des banques, on ne trouve rien autre chose que cette intervention de leur part et ce prélèvement en leur faveur.
Mais notre intention ici n’a pas été d’exposer les principes suivant lesquels opèrent les banques, les procédés qu’elles doivent employer pour justifier leur raison d’être ; des maîtres, que nous avons eu maintes fois l’occasion de citer, l’ont fait avant nous.
L’exposé des faits relatifs à notre pays, quelques critiques que, çà et là, ces faits nous amènent à hasarder, la recherche des conséquences ou des causes qui les ont motivés, tel est l’objet que nous nous sommes proposé.
Ici se place une observation qui viendra à l’esprit de maint lecteur. Avez-vous, nous dira-t-on, assez étudié la matière pour vous faire une opinion ? si oui, vous ne saurez être impartial, quelque désir que vous en ayez ; si non, vous ne pouvez faire un choix judicieux des faits utiles à exposer historiquement.
Il est certain que c’est là le dilemme qui se présente à tout écrivain consciencieux ; et nous devons avouer que, suivant nous, l’historien doit se tenir à égale distance de ces deux écueils, le parti pris ou l’absence d’opinion. Il ne doit pas être sceptique, mais il doit aussi se rappeler que les sciences font chaque jour des progrès, les sciences morales et politiques comme les autres, et que l’opinion qu’il professe consciencieusement aujourd’hui peut lui apparaître demain comme une erreur, il ne doit pas s’étonner de ne pouvoir tout expliquer ; il doit le confesser franchement lorsque l’occasion se présente. Il doit pouvoir sans cesse dire avec Montaigne : C’est icy un livre de bonne foy, lecteur. Le père de l’histoire, Hérodote, fournit, à cet égard, un exemple que l’on doit avoir sans cesse devant les yeux. Dans le livre IVe de son histoire, il parle du voyage autour de l’Afrique entrepris par les Phéniciens sur l’ordre de Nechao, roi d’Égypte, 600 ans avant notre ère. « Ils ont rapporté, dit-il, un fait que je ne crois pas et que d’autres peut-être croient ; en faisant le tour de la Libye, ils ont eu le soleil à leur droite. Ainsi la Libye fut pour la première fois connue. » Pour les anciens qui ne fréquentaient que l’hémisphère nord, tout voyageur de l’est à l’ouest devait avoir le soleil à sa gauche. Or les Phéniciens allaient de l’est à l’ouest ; mais, traversant l’équateur, c’est-à-dire, entrant dans l’hémisphère sud, ils avaient alors le soleil à leur droite, ce qui renversait toutes les idées astronomiques d’Hérodote. Sans la bonne foi de l’historien grec qui rapportait fidèlement les faits notables, même s’ils ne lui semblaient pas plausibles, nous n’aurions pas, aujourd’hui, la certitude que le tour de l’Afrique a été fait dès cette époque, soit deux mille ans avant Vasco de Gama.
C’est dans cette ligne de conduite que nous avons cherché à nous maintenir ; l’indulgence du lecteur nous pardonnera, en faveur de l’intention, si parfois, à notre insu, nous en avons dévié.
Il n’existe, en France, aucune trace de tentative de fondation de banque de circulation et d’escompte antérieurement au règne de Louis XV. L’arbitraire en finances était peut-être trop à l’ordre du jour sous le règne de Louis XIV pour qu’une institution basée sur la confiance, le bon ordre et l’équité fût possible.
Cependant, à la mort de Louis XIV, nous voyons une banque de circulation opérer à Londres depuis vingt ans ; c’est la Banque d’Angleterre encore existante aujourd’hui. Bien avant cette institution, d’autres banques avaient été fondées à l’étranger ; mais c’étaient des banques de dépôts servant à remédier aux mutations ou à la diversité des monnaies, mais n’émettant pas de billets au porteur et à vue, dits vulgairement billets de banque. C’est ainsi que fonctionnèrent les banques de Venise, Barcelone, Gênes, Nuremberg, Amsterdam, Rotterdam, etc. ; c’est ainsi que fonctionne encore la Banque de Hambourg, la seule de cette nature primitive d’institution de dépôts et de comptes courants qui subsiste encore.
En fait de banques de circulation, nous voyons, par ordre de dates, se fonder la Banque d’Angleterre à Londres en 1690, la Banque d’Écosse à Édimbourg en 1695, la Banque d’Autriche à Vienne en 1703 (ne pas confondre avec la Banque nationale d’Autriche actuellement en activité, mais depuis 1816 seulement), la Banque royale d’Écosse à Édimbourg en 1727, la Compagnie Linière britannique (british Linen Company), à Édimbourg également, en 1746, la Banque de Prusse à Berlin et la Banque de Breslau en 1765, la Banque d’assignation à Saint-Pétersbourg en 1770, la Banque d’Irlande à Dublin en 1783, la banque des États-Unis à New York en 1790 (différente de celle renversée par Jackson), etc.
Ainsi donc, à la mort de Louis XIV, en 1715, trois banques de circulation, sans parler des banques de dépôt, existaient en Europe : à Londres, à Édimbourg et à Vienne. La première émettait des coupures minimum de 20 livres sterling (environ 500 fr.) ; la seconde de une livre sterling (25 fr.) dès 1704 ; nous ignorons l’importance minimum des coupures de billets de la Banque d’Autriche à cette époque.
Nous allons relater ce qui eut lieu en France une fois terminé le règne du Roi Soleil.
Louis XIV laissait la France dans le plus triste état que l’on puisse imaginer. Un publiciste financier d’une grande érudition esquisse ainsi la situation du Trésor à la mort de ce roi qu’il serait inopportun d’appeler grand en ce moment :
« Louis XIV laissait à son successeur, à un enfant de cinq ans ces tristes fruits de sa dernière guerre : 86 009 310 liv. en rentes dont le remboursement aurait coûté plus de deux milliards ; 542 063 078 liv. en charges et offices divers et en augmentations de gages ; 596 696 959 liv. en billets divers ; 137 222 259 liv. en dépenses anticipées sur les revenus des années suivantes ; et environ 185 millions de dettes diverses dont le paiement n’avait pas encore été assigné ; en total une dette de près de 3 460 000 000. »
Ce n’était rien encore que cela, avec de l’ordre et du temps on eût fini par en sortir ; mais il y avait chaque année un déficit écrasant. Le budget annuel, tel que nous le présente M. Levasseur pour l’une des dernières années du règne de Louis XIV (1707) donne les résultats suivants :
Sans entrer dans la discussion du détail de ces chiffres, contentons-nous de remarquer qu’ils nous accusent un désordre grave qui devait rendre une régence pleine de difficultés.
Après le mort de Louis XIV, arrivée le 1er septembre 1715, un conseil de finances fut institué. Ce conseil, sous la présidence effective du duc de Noailles, accepta dignement la charge et repoussa comme une insulte la proposition de ne pas tenir les engagements du dernier règne, et de sortir par là des difficultés que l’on entrevoyait de tous côtés.
La première opération du conseil de finances fut la révision des billets de toute sorte laissés dans la circulation par le dernier gouvernement, c’est-à-dire l’examen de leur validité et l’annulation de tous ceux que l’on appréciait résulter de doubles emplois ou même n’ayant pas une origine suffisamment claire.
Cette mesure, mauvaise en ce que le conseil chargé de subvenir aux difficultés du moment pouvait être considéré comme juge et partie, réduisit la somme des billets divers de 596 696 959 livres à 360 millions, et même, par une seconde révision, à 276 149 813 liv. On créa 250 millions de billets d’État, portant un intérêt fixe de 4 %, à l’effet de ramener tous ces effets à un type unique.
La seconde opération produisit, et à juste titre, une impression encore plus fâcheuse : on institua un tribunal extraordinaire, une justice exceptionnelle, une Chambre de justice,
« Puisqu’il faut l’appeler par son nom, »
à l’effet de rechercher l’origine de la fortune des plus riches financiers de l’époque. Certes le désordre de ces temps peut faire supposer qu’il avait dû y avoir bien des fortunes acquises au détriment de la masse des contribuables ; mais, il faut l’avouer, le moyen était violent et surtout en dehors des formes de justice, même de ce siècle. L’arrêt qui institua cette Chambre de justice est du 17 mars 1716 ; ses travaux durèrent un an. Les restitutions auxquelles elle condamna 4 410 particuliers montèrent à 219 478 391 livres ; mais des faveurs et des réductions exceptionnelles ne firent rentrer, en réalité, au Trésor qu’une centaine de millions : ainsi donc, violences et faveurs de cour, telle est l’histoire abrégée de la Chambre de justice de 1716.
La troisième opération fut la réduction sur les rentes :
Toutes les rentes sur l’État payées hors de l’Hôtel-de-Ville, montant en capital à 104 378 974 liv., et en revenu à 6 699 589 liv., furent réduites au capital de 79 849 374 liv., aux arrérages de 3 483 973 liv. le bénéfice de cette réduction, véritable spoliation, fut en capital de 24 529 600 liv. et en rente de 3 215 616 liv. Les nouvelles rentes furent constituées au denier 25 (soit du 4 %) ; mais la réduction sur le capital ne porte que sur les rentes émises contre des papiers décriés, et ayant, au moment de l’émission des rentes, une valeur inférieure au taux nominal pour lequel ils avaient été reçus. Les rentes sur l’Hôtel-de-Ville montaient, à la même époque, en capital, à 1 280 000 000 liv., et en arrérages à 32 443 429 liv. L’ensemble de la dette publique en rentes perpétuelles montait donc à cette époque, en capital, à 1 359 849 374 liv., et en arrérages à 35 659 045 liv.
La quatrième fut la refonte des monnaies. On sait à cet égard combien de fois en France on changea les monnaies, soit de poids, soit de titre, sans faire subir à leur valeur nominale des réductions proportionnelles. Pour résumer toutes ces variations de Charlemagne à l’époque qui nous occupe, il suffit de rappeler que du temps de Charlemagne on taillait 2/3 de livres dans le marc et que par la fixation du 1er juin 1718 on en tailla 42 liv. 12 s. et 1 d. Du XIIe siècle à 1718, il y eut 250 fixations de la valeur de l’argent seulement ; on jugera par là quels troubles durent occasionner dans les relations commerciales des variations dans la valeur des monnaies qui, en moyenne, eurent lieu tous les deux ans. Ce fut à ce moyen désastreux que l’on eut recours, et, malgré l’opposition raisonnée du duc de Noailles, on décida la refonte des monnaies. « L’édit parut au mois de décembre 1715. Les louis d’or valaient 14 livres, et les écus 3 livres 10 sous. Les particuliers reçurent l’ordre de les porter aux hôtels des monnaies, où ils furent reçus pour 16 livres et pour 4 livres ; les pièces nouvelles, pesant exactement le même poids, devaient valoir, les louis 20 livres, et les écus 5 livres. L’État avait espéré faire un bénéfice considérable sur les 1 200 millions de numéraire qui existaient en France ; mais on ne rapporta à la refonte que 379 237 000 livres, et les profits ne dépassèrent pas 90 millions. Le commerce, dont ces violences arrêtaient l’essor, perdait peut-être à ces opérations une somme dix fois plus forte. Quelque temps après, on se décida à supprimer cette nouvelle monnaie ; on ordonna, au mois de novembre 1716, une fabrication de nouveaux louis de 30 livres, et, le 15 janvier 1717, le roi décria les pièces fabriquées en vertu de l’édit de décembre 1715. »
Tel fut l’ensemble des mesures adoptées par le conseil de finances institué après la mort de Louis XIV sous la régence. Le duc de Noailles, le principal moteur de toutes ces mesures, y ajoutait, comme élément indispensable, le temps, cet associé si utile et si souvent mis hors de cause ; et le régent, avec des moyens brillants mais peu solides, avec un jugement prompt mais peu profond, avec une imagination ardente mais peu expérimentée, trouvait tout cela trop long.
Pendant que toutes ces mesures s’accomplissaient, sans égard pour les plaintes du commerce et sans apporter de soulagements à la misère générale, l’augmentant, au contraire, par le ralentissement des affaires que toutes ces décisions décourageaient, une institution, fruit de l’association de quelques particuliers, fondée par un étranger, venait trancher sur ce tableau d’une manière de plus en plus frappante. Une banque analogue à la Banque de France, comme elle commanditée par des actionnaires, escomptait à 5 % le papier des particuliers, émettait des billets payables au porteur et à vue, et qui, étant remboursables en écus du poids de ce jour (du jour de la date de l’édit) ne pouvaient souffrir de la réduction de la valeur des monnaies. Des comptes courants étaient ouverts aux particuliers, qui, comme de nos jours, pouvaient, sous un droit minime de 1/4 00/00, soit délivrer des mandats payables en espèces à ceux qui n’avaient pas de compte à la Banque, soit délivrer un bulletin de virement à ceux qui en possédaient.
Quel était donc cet homme qui, au milieu des violences et des spoliations, créait une institution fondée sur la confiance ; qui, après les immoralités financières des dernières années de Louis XIV, enfantait le crédit, cette fleur si fragile mais si consolante pour l’honneur de l’espèce humaine ; qui enfin, quatre-vingts ans avant la Banque de France, donnait le modèle sur lequel cette institution a calqué ses statuts.
C’était Jean Law, Écossais de naissance, habitué dès son enfance (son père était orfèvre, profession qui, à cette époque, comprenait celles de banquier, changeur, etc.) aux spéculations sur métaux précieux, d’une merveilleuse facilité de conception, ayant beaucoup voyagé, beaucoup étudié tout ce qui regarde les monnaies et le crédit dans toute l’Europe, menant grand train, joyeuse vie, enfin, joueur intrépide et si habile que beaucoup de ses contemporains attribuèrent à une adresse peu consciencieuse les gains énormes qu’il acquit de cette manière. Hâtons-nous de dire que sa vie financière a été si loyale d’ailleurs que l’on ne peut s’arrêter un seul instant à ce soupçon.
Plus praticien que théoricien, il ne creusait pas les vérités que son intelligence facile lui faisait promptement entrevoir, et par suite, son raisonnement se viciait bien vite par l’absence de logique ; joueur par passion, il était cependant sectaire dans ses opinions, au point de négliger ses intérêts propres pour l’accomplissement de ce qu’il croyait utile au bien général. Pour le bien connaître, il est indispensable d’analyser son ouvrage principal : Considérations sur le commerce et le numéraire, qu’il écrivit en Écosse, bien avant de soupçonner les destinées, bonheurs et malheurs, qui l’attendaient. Après avoir établi que l’argent numéraire a une valeur intrinsèque comme toute autre marchandise, puis (confondant le capital, l’ensemble des moyens de production, avec le numéraire, (partie de ce tout) que plus une nation a d’espèces, plus elle est riche, il propose, afin d’augmenter les espèces, d’établir (contrairement à sa première proposition) un papier hypothécaire servant de monnaie et ayant cours forcé. Ainsi donc, dès ce premier ouvrage (qui date de 1700 environ : il avait alors 29 ans) on voit un homme de génie parvenant à dégager d’un brouillard de préjugés quelques notions claires et précises, mais ne pouvant s’empêcher de mêler, faute de logique, une forte dose d’alliage au métal pur précédemment obtenu. Ainsi le verrons-nous dans l’action. Il n’est pas inutile de rappeler, comme source de bien des erreurs, que Law croyait à la théorie de la balance du commerce. Quesnay (1758) et Adam Smith (1776) n’avaient pas encore combattu ce préjugé, si général, même de nos jours.
Law, donnant à la création d’un papier de circulation, pouvant servir de monnaie, une importance exagérée, proposa, pour arriver à son idéal, l’établissement d’une banque commanditée exclusivement par le roi (l’État d’alors) au lieu de l’être par une compagnie. C’est là son innovation, sur laquelle il revient sans cesse et qui différencie son projet des établissements de crédit existant alors, tous dirigés et commandités par des particuliers. Cependant, n’ayant pu arriver à faire admettre son plan dans son ensemble, il se résigna à fonder, avec les fonds des particuliers, sous le titre de BANQUE GÉNÉRALE, un établissement qui fut, par lettres-patentes du 2 mai 1716, autorisé à émettre des billets en écus d’espèces sous le nom d’écus de banque « du poids et titre du jour. » Le fonds capital était composé de 1 200 actions nominatives de 1 000 écus, soit 1 200 000 écus de banque ou 6 millions de livres (l’écu étant apprécié à ce moment valoir 5 livres). L’ouverture de la souscription eut lieu le 1er juin 1716, chez Law, place Louis-le-Grand (Vendôme). La banque ne devait commencer ses opérations qu’après la souscription du capital entier, mais comme dans cette souscription on admettait le billet d’État, dont il a été parlé au chapitre précédent, jusqu’à concurrence des trois quarts de la somme souscrite, elle ne tarda pas à être couverte. Ce qui contribua à accélérer la souscription fut le fait que le capital n’était appelé que par quart, chaque quart se composant de :
25 % espèces ;
75 % billets d’État perdant 70 à 80 %.
On n’a jamais versé que le premier quart, soit, en espèces, 375 000 liv. !
Une assemblée des actionnaires eut lieu après la clôture de cette souscription pour établir le règlement et nommer le personnel. Les voix, dans cette assemblée générale et dans les suivantes, se comptaient ainsi : Une voix par cinq actions, sans limite du nombre de voix par personne. En juin et décembre on dressait le bilan de la compagnie, et une suspension d’affaires de cinq jours (du 15 au 20) était autorisée pour cette opération. L’assemblée générale avait lieu deux fois par an, les 20 juin et 20 décembre.
La banque faisait l’escompte ; elle pouvait émettre des billets payables à vue, mais non payables à terme, et ne pouvait non plus emprunter, sous quelque prétexte ni de quelque manière que ce puisse être ; il en est de même de nos jours pour la Banque de France. Des mesures de prudence étaient prises pour ne pas laisser de trop fortes sommes entre les mains du caissier : mais il n’y avait aucun rapport imposé entre la quantité de billets en circulation et le numéraire en caisse. Il était interdit à cette banque de faire, par terre ni par eau, aucun commerce en marchandises, ni assurances maritimes, et de se charger, par commission, des affaires de négociants, tant au dedans qu’au dehors du royaume. Les billets de banque étaient au porteur et par coupures de 10, 100 et 1 000 écus (50, 500 et 5 000 livres). Ils eurent d’abord un peu de peine à prendre, mais petit à petit le public apprécia leur commodité, et les créations, de la fondation à décembre 1718, montèrent à 51 millions de livres.
Law administrait seul cette société avec le titre de directeur.
Cette banque commença à fonctionner en juin 1716 ; l’escompte des lettres de change se faisait au taux de 5 % ; nous n’avons vu nulle part quel était le nombre de signatures exigées. Les comptes courants furent ouverts aux conditions relatées au commencement de ce chapitre ; avoir un compte courant à la banque s’appelait à cette époque avoir un compte en banque.
Telle est la première conception que Law (un peu gêné dans ses idées, il est utile de le rappeler) mit à exécution. Nous nous y arrêtons avec complaisance, car c’est l’époque, en réalité, la plus utile de la vie de cet homme qui était, sans contredit, au-dessus de son siècle. Aussi le public, appréciateur des services que rendit cette création nouvelle en France, commença-t-il à remarquer la différence de résultats des moyens employés par le conseil des finances et par Law, et, ne distinguant pas encore la nuance essentielle qui sépare les fonctions de l’État de celles des particuliers, il jeta, dans sa détresse, un regard d’espérance vers cet homme qui lui parut un dieu, et alors commença à naître la popularité du financier écossais.
Mais, ne l’oublions pas, l’idée de Law, à aucune époque de sa vie, n’a été de s’arrêter à cette forme qu’il n’accepta que comme pis-aller. Les succès de la banque ne devaient pas tarder à lui donner moyen de sortir du cercle qu’on lui imposait. En effet, « dès le mois d’octobre 1716, tous les officiers des finances recevaient l’ordre de faire leurs remises sur Paris en billets de banque et d’acquitter à vue ces mêmes billets dès qu’ils leur seraient présentés. » Première faute.
Par arrêt du 10 avril 1717 on ordonnait que « les billets seraient reçus comme argent pour le paiement de toutes les espèces de droits et d’impositions, fermes et autres revenus du roi ; et que tous les officiers comptables, fermiers et sous-fermiers, tous leurs receveurs et commis-comptables, et autres chargés du maniement de ses deniers (des deniers du Roi), seraient tenus d’acquitter à vue et sans escompte les billets qui leur seraient présentés. » Deuxième faute.
La troisième faute, relativement à la banque, la plus grave de toutes, fut, comme nous le verrons plus loin, la reprise de la banque par l’État et sa conversion en banque royale (décembre 1718) ; mais n’anticipons pas.
Jusqu’alors Law ne nous apparaît que comme un homme prudent, presque méthodique, ne voulant devoir son crédit qu’au temps, à sa sagesse administrative, à son ordre et à son intégrité. Nous allons le voir sur un nouveau terrain, celui qui l’engouffra en se dérobant sous lui et avec lui le système, c’est-à-dire tous les capitalistes qui se laissèrent aller, sans mesure, à l’entraînement de son exemple. En un mot, pour nous servir d’une expression de nos jours, nous allons voir Law devenir un faiseur et employer à la réussite de ses idées un instrument, l’agiotage, dont il ne connaissait pas encore la portée.
Les diverses compagnies privilégiées de commerce en Amérique et en Afrique, constituées principalement sous Sully, Richelieu ou Colbert, végétaient et s’endettaient. Law vit dans la reconstitution de toutes ces compagnies en une seule, avec un capital important, une spéculation de présent et d’avenir, et comprit la possibilité d’attirer le public dans ses idées, en lui montrant tous les avantages que son imagination, un peu ardente dès cette époque, lui faisait supposer. Pour se rendre l’État favorable, il l’intéressa à sa combinaison de la manière suivante : Une société par actions serait fondée au capital de 100 millions de livres, divisé en 200 000 actions de 500 livres, payables en billets d’État qui, comme on sait, perdaient à cette époque plus des deux tiers de leur valeur nominale. L’État ne paierait à la compagnie que la rente au denier 25 (4 %) des billets d’état retirés par ce moyen. La première année d’arrérages (4 millions) serait encaissée par la compagnie et lui servirait de fonds de roulement. Les arrérages des autres années seraient distribués régulièrement aux actions à titre d’intérêt fixe. Cette combinaison était habile ; elle relevait le crédit de l’État sur qui Law fondait dans l’avenir toutes ses espérances ; elle donnait aux capitaux un sujet de placement, ce qui devait, avec de l’ordre et de l’économie dans l’administration, faire infailliblement monter les actions ; enfin, elle prouvait la puissance de l’association, puisque, par ce procédé, elle fondait une société au capital de 100 millions, ce qui ne s’était jamais vu jusqu’alors ni en France, ni ailleurs. La combinaison fut agréée par le conseil, et un arrêt du 28 août 1717 autorisa cette société sous le nom de Compagnie d’Occident. Le public l’appela souvent Compagnie du Mississippi, même lorsque le nom de Compagnie des Indes lui fut accordé ; et, encore de nos jours, beaucoup de personnes ne la connaissent que sous ce titre. L’arrêt du conseil fut enregistré au Parlement le 6 septembre suivant. Son privilège, qui embrassait une durée de 25 ans à partir du 6 septembre 1717, comprenait ceux des compagnies suivantes :
1°Deuxième compagnie du Mississippi ou de la Louisiane ;
2°Deuxième compagnie du Canada ou du Castor ;
3°Quatrième compagnie du Sénégal ;
4°Compagnie royale de Guinée ou de l’Assiente.
Elle embrassait donc dans ses opérations le commerce de la Louisiane, du Canada et des côtes occidentales d’Afrique. Elle jouissait de tous droits de souveraineté sur les terres qu’elle possédait. « C’était un souverain-marchand, une royauté par association ».
Les actions étaient au porteur et libérées. Remarquons que c’est la première fois que nous voyons en France des actions au porteur, car on se rappelle que les actions de la Banque générale étaient nominatives. Il y avait des coupons de une et de dix actions. Tout actionnaire avait droit d’assister à l’assemblée générale annuelle s’il possédait cinquante actions, et avait autant de voix que de fois cinquante actions, sans limitation du nombre de voix. Enfin, un bilan était dressé chaque année, fin décembre, et c’était l’Assemblée générale qui décidait l’importance des dividendes à répartir, les intérêts à 4 % se trouvant toujours payés par suite de la dette de l’État.
Trois directeurs administraient l’affaire ; Law était l’un d’eux, mais sans autre pouvoir distinctif que l’ascendant de son talent et de sa popularité.
La souscription fut lente à se couvrir, et on verra plus loin que ce ne fut qu’en juillet 1718 qu’elle fut close.
Telle fut la pose de la première pierre du système ; on sait que c’est ainsi que l’on a coutume d’appeler l’ensemble des actes financiers de Law.
L’envie ne tarda pas, on le soupçonne, à s’attacher aux pas d’un financier si rapidement heureux. En outre, quelques esprits d’élite commencèrent à éprouver une certaine inquiétude de la hardiesse des nouveautés de Law. Ces deux sentiments agitèrent tout particulièrement quatre frères dauphinois, les Pâris, fils d’un aubergiste, arrivés par leur talent et leur mérite à des fonctions financières dont ils s’acquittèrent avec honneur. Le Parlement, quelques membres du conseil des finances, le chancelier lui-même, le marquis d’Argenson, étaient ennemis déclarés ou secrets du directeur de la Banque. Ils appuyèrent donc la combinaison suivante, que présentèrent les frères Pâris, combinaison qui, comme on le verra, avait le tort d’être une imitation, un peu servile, de la conception de Law.
Sous l’épithète de Fermes royales, on comprenait, à cette époque, la majeure partie des impôts indirects du budget d’alors, et ces impôts, au lieu d’être directement régis par l’État, comme ils le sont de nos jours, étaient cédés, moyennant une redevance fixe et annuelle, à des particuliers associés qui, sans s’écarter de certains tarifs établis dans le cahier des charges, percevaient à leur manière lesdits impôts, et bénéficiaient de la plus-value sur la redevance fixe due à l’État. De là le nom de Fermes. D’argenson, qui joignait les finances aux sceaux, adjugea le bail desdites fermes aux frères Pâris moyennant une redevance annuelle de 48 500 000 livres. Selon l’usage, un prête-nom fut inscrit dans l’acte comme adjudicataire, et ce prête-nom fut Aymard Lambert, le propre valet de chambre de d’Argenson. Les frères Pâris transférèrent leur droit à une société par actions, au capital de 100 millions, divisés en 100 mille actions au porteur de 1 000 livres, payables en papiers divers, qui encombraient la place à cette époque, et du capital desquels l’État était débiteur. Un dixième était payable en souscrivant, et les neuf autres dixièmes le 1er janvier 1719. L’inventaire était clos fin décembre, et, en avril, l’Assemblée générale fixait le dividend (dividende). On avait, dans ces assemblées, une voix par cinquante actions. L’arrêt du Conseil qui consacre ces dispositions est du 16 septembre 1718. La durée du bail était de six ans.
Cette combinaison fut appelée Anti-système ; c’était, en effet, une concurrence directe à la Compagnie d’Occident, concurrence redoutable, car l’objet de la Compagnie des Fermes était plus certain et plus palpable pour le public que celui de la Compagnie d’Occident. Mais, encore une fois, en élevant autel contre autel, les frères Pâris n’avaient pas fait de grands frais d’invention.
Malgré cette opposition, le crédit et l’influence de Law augmentaient. Le régent, son protecteur constant, qu’il avait converti à ses idées dès la fin du règne de Louis XIV, lors d’un premier voyage en France, n’avait pas d’abord été assez fort pour déterminer le Conseil à accepter en entier les projets de l’Écossais. Le succès qui semblait s’attacher à chacune des choses que touchait cet habile administrateur, parvint à triompher des obstacles qui, d’abord, l’avaient arrêté, et, le 4 décembre 1718, le roi, par une déclaration confirmée par arrêt du Conseil du 27 du même mois, remboursa en espèces aux actionnaires de la Banque les fonds par eux versés, soit numéraire, soit billets d’État. C’est ainsi que la Banque générale devint Banque royale. Law continue à en être directeur.
N’oublions pas que cette déplorable décision fut prise sur l’incitation de Law. Elle conduisait à l’abîme. Pour faciliter l’usage des billets, on ouvrit des bureaux à Lyon, la Rochelle, Tours, Orléans et Amiens, c’est-à-dire dans les principales villes où il n’y avait pas de parlement. Il ne faut pas assimiler ces bureaux aux succursales actuelles de la Banque de France, car ils n’avaient pour objet que de rembourser ou mettre en circulation des billets, mais nullement d’escompter les effets ni même d’ouvrir des comptes en banque ou comptes courants. Le cours des billets n’était pas forcé, à cette époque ; les employés des finances étaient bien tenus, comme on l’a vu, de les recevoir et de les rembourser avec les fonds qu’ils avaient en caisse, mais les particuliers pouvaient les refuser. On ne voulait encore employer que la conviction. Cela dura peu.
Nous avons vu que l’écu de banque était poids et titre du jour de l’édit d’institution, et que les billets étaient jusqu’alors stipulés payables en écus de banque. En convertissant la Banque générale en banque royale, on eut le grand tort de ne plus faire de billets remboursables en écus de banque, mais bien en livres tournois, c’est-à-dire de remplacer une monnaie invariable comme poids et titre par une monnaie sujette à des variations. Ajoutons, pour être vrai, que l’édit de décembre 1718 disait bien que l’on ferait des billets de banque en écus de banque ou en livres tournois, au choix du porteur ; que même l’arrêt du 5 janvier 1719 autorisa la création de billets pour 2 millions d’écus de banque, mais en réalité on ne mit plus en circulation de billets en écus de banque à partir de l’édit de décembre 1718, et même les 51 millions de livres de billets de banque émis payables en écus de banque antérieurement à la conversion de la Banque générale en Banque royale, furent petit à petit retirés et remplacés par des billets stipulés en livres tournois.
Les nouveaux billets furent par coupures de 10, 100 et 1 000 livres tournois.
Le 22 avril 1719, pour obvier aux inconvénients de ce fâcheux changement, on arrêta que les billets en livres tournois ne seraient pas sujets aux diminutions qui pourraient survenir sur les espèces. C’était pousser le public à préférer les billets aux espèces ; mais n’était-ce pas aussi avouer que la déclaration du 4 décembre 1718 avait un peu diminué la confiance du public ? Cependant, si ce moment d’hésitation exista, il fut de courte durée, car on commença à pousser aux fortes émissions ; en deux ans et demi on n’avait encore émis que 51 millions de billets ; de décembre 1718 au 22 avril 1719 (en moins de cinq mois) on en créa pour 59 millions. Le total des billets en avril 1719 montait donc à 110 millions.
Il ne sera pas inopportun de donner, dès à présent, tant pour ce que nous venons de dire que pour ce qui suivra, l’état des billets émis par la Banque sous la Régence : seulement, en regard de l’état officiel annexé à l’arrêt du 10 octobre 1720, nous mettrons l’état non officiel, mais exact, fourni ultérieurement par le trésorier même de la Banque, le sieur Bourgeois, le 15 novembre 1723. Que le lecteur, à l’aspect de ce tableau, ne nous accuse pas trop vivement de légèreté s’il trouve à la fois dans ce tableau des billets retirés et ceux qui devaient les remplacer, car, à cette époque, on se faisait peu de scrupule de reverser dans la circulation des billets qui auraient dû être annulés :
On se rappelle que le principal chapitre de l’actif de la Compagnie d’Occident consistait dans la rente de 4 millions que lui payait le roi pour le retrait des 100 millions de billets d’État, perdant alors 75 %. La Compagnie d’Occident se ressentit longtemps de cette origine boiteuse. Law eut beau employer à la souscription du capital de cette société les fonds versés par les actionnaires de la Banque générale (1 500 000 livres, dont 1 125 000 en billets d’État et 375 000 en espèces), cette souscription, ouverte en août 1717, ne fut fermée, comme nous l’avons déjà dit, qu’en juillet 1718. En mai 1719, les actions de 500 livres n’en valaient encore que 300. À cette époque, Law acheta publiquement 200 actions à 500 livres dont 200 livres de prime livrables dans six mois. Cette opération à prime prouva que l’auteur du système avait foi dans ses idées et aida à la hausse des actions, qui ne tardèrent pas à gagner le pair. Mais cette hausse fut due à d’autres mesures que l’opération précitée ; ce sont ces mesures dont nous allons nous occuper.
Les tabacs, à cette époque, étaient affermés moyennant une redevance annuelle de 2 millions ; le bail expirait. Law offrit, au nom de la Compagnie d’Occident, de se charger de cette entreprise pour neuf ans, moyennant une redevance annuelle de 4 020 000 livres. Le Gouvernement accepta ; comme ce dernier devait à la Compagnie d’Occident une rente de 4 millions, cette Société n’eût à payer à l’État qu’une soulte annuelle de 20 000 livres. La Compagnie, qui semblait faire une mauvaise affaire, en fit au contraire une bonne ; outre la compensation dont nous parlons plus haut, compensation qui, à cette époque, avait sa valeur, puisqu’elle éteignait un risque, la Compagnie d’Occident obtenait ainsi le monopole du débouché pour les tabacs qu’elle tirait de la Louisiane, sa propriété, et la vente des tabacs s’étendant, elle retrouvait facilement la somme qu’elle s’engageait à payer. Le matériel de la Compagnie du Sénégal lui procura de suite une marine et un fonds de marchandises. Tout cela témoignait de l’habileté chez l’heureux novateur ; aussi le public, à la suite de ces mesures, prit-il confiance dans l’avenir de cet homme qui ne doutait pas de lui-même ; les actions montèrent. En mai 1719 (à l’époque où nous avons laissé la banque) la Compagnie d’Occident possédait une encaisse de plus de 3 millions et demi, 750 000 livres de marchandises en magasin, et 21 bâtiments dans les ports ou en mer. Les colonies, d’abord peu productives, se ressentirent de cet état de choses, et les produits que l’on en tirait donnaient les meilleures espérances sur l’avenir de la Société.
C’est à ce moment (mai 1719) que la Compagnie d’Occident absorba les privilèges des Compagnies des Indes occidentales et de la Chine ; elle prit, à cette occasion, le nom de Compagnie des Indes, qui lui est resté jusqu’à sa chute, en 1769. Le même édit l’autorisa à augmenter son capital de 25 millions par l’émission de 50 000 nouvelles actions de 500 livres ; seulement cette émission se fit contre espèces ou billets de banque et au prix de 550 livres l’action. Pour aider au placement de ces actions, on échelonna les versements sur vingt mois ; le premier (en souscrivant) comprit la prime (50 livres) plus un vingtième (25 livres) soit 75 livres ; chaque mois suivant on opéra un nouveau versement de 25 livres ; on pouvait se libérer par anticipation, mais sans bonification d’escompte. L’engouement du public pour ces actions fit arrêter (20 juin 1719) la nécessité de posséder quatre actions anciennes, que l’on appela mères à cette occasion, pour souscrire une nouvelle que l’on appela fille par opposition. C’est à propos de cette souscription que commença cet agiotage fiévreux qui ne se ralentit qu’à la chute du système.
Enfin, en juillet 1719, la Compagnie des Indes absorba la Compagnie d’Afrique. Il ne restait plus, en fait de compagnie privilégiée en dehors de la Compagnie des Indes, que la Compagnie de Saint-Domingue, qui ne se fusionna qu’en 1720 (10 septembre), à la même époque où le privilège du commerce des nègres de Guinée (libre à cette époque) fut concédé à la dite Compagnie des Indes.
À la fin de juillet 1719, les actions de la Compagnie des Indes valaient 1 000 livres.
Mais toutes ces souscriptions et celles qui suivirent occasionnèrent un mouvement d’espèces trop considérable pour la quantité de numéraire alors en circulation en France. On fut donc conduit à multiplier les émissions de billets de banque servant alors de monnaie ; et c’est ce qui explique comment le public se prêta à la rapide extension de ces émissions pendant l’année 1719.
L’activité dévorante de Law ne connut plus de bornes à partir de ce moment. La fabrication des monnaies, l’exploitation des fermes générales et le remboursement des rentes et des offices eurent peine à satisfaire cette âme de feu.
La fabrication des monnaies fut abandonnée à la Compagnie des Indes pendant neuf années, moyennant 50 millions payables en quinze mois à partir du 1er octobre 1719.
Pour payer à l’État ces 50 millions, Law eut recours à une nouvelle émission d’actions ; 50 000 actions de 500 livres émises à 1 000 livres (soit 500 livres de prime) faisaient juste le capital nécessaire pour payer l’État. La souscription, autorisée par arrêt du Conseil du 27 juillet 1719, fut promptement couverte. Pour y participer, il fallait pour une nouvelle action (appelée petite-fille) posséder cinq actions (mères ou filles) anciennes. Le paiement des 1 000 livres devait être opéré en vingt versements mensuels de cinquante livres chacun. Law s’engagea à cette époque, (26 juillet 1719) en pleine assemblée générale, à faire rapporter aux actions 6 % du cours actuel (1 000 livres) à partir du 1er janvier 1720.
Les fermes, comme nous l’avons vu plus haut, avaient été adjugées aux frères Pâris, qui avaient formé à cette occasion une société par actions. Le prix annuel, on se le rappelle, était 48 millions et demi. Law, par son influence, obtint de faire casser ce bail et de se le faire adjuger moyennant 52 millions. Du même coup, il tuait l’Anti-système, et, grâce aux réformes administratives qu’il projetait, obtenait pour la compagnie qu’il dirigeait une affaire fructueuse. Le contrat qui consacra cette double victoire est du 28 octobre 1719.
Enfin l’entreprise la plus colossale que l’on eut jamais vue (le remboursement des rentes et des offices) vint compléter l’édifice prodigieux auquel il se dévouait. La somme nécessaire pour ce remboursement fut évaluée à 1 500 millions. Le gouvernement prit l’engagement de payer annuellement à la compagnie 3 % de cette somme. Le 12 octobre 1719, un arrêt du conseil autorisa cette vaste opération. Law, pour la mener à bonne fin, eut encore recours à des émissions d’actions, entreprises, cette fois, sur une échelle étourdissante. Dès le 27 août il avait promis 1 200 millions ; trois émissions successives de 100 000 actions de 500 liv. chacune (13 septembre, 28 septembre et 2 octobre 1719) eurent lieu sur le pied de 5 000 livres l’action, payables par dixième de mois en mois. Il ne fut plus nécessaire pour cette souscription de posséder ni mères, ni filles, ni petites-filles ; tout individu put souscrire autant d’actions qu’il possédait de fois 500 livres. Aussi l’empressement fut-il prodigieux, grâce à la hausse que les actions éprouvèrent depuis la fin de juillet, sous l’empire des excitants auxquels Law soumit le marché.
« L’Europe assista, pour la première fois, aux grandes luttes de la cupidité dans lesquelles les passions, agitées comme aux époques solennelles de l’humanité, faisaient oublier, par leur sauvage énergie, la bassesse de leur cause, et dans lesquelles l’égoïsme lui-même acquérait une certaine grandeur. »
L’ardeur des souscriptions fit un instant tomber les anciennes actions à 4 000 livres, tandis que les cinq cents (on appelait ainsi les nouvelles actions sur lesquelles on ne versait d’abord que 500 livres) montèrent à 8 000 livres ; c’est que l’on réalisait les anciennes pour en employer le montant à souscrire des nouvelles. Le produit de cette souscription devant servir à rembourser les créanciers de l’État, ces derniers, par cette combinaison, ne pouvaient utiliser leurs fonds en souscrivant des actions. Sur leur réclamation, on rendit, le 26 septembre, un arrêt qui n’autorisait plus pour les souscriptions que les versements en créances sur l’État remboursables sur les 1 500 millions. De cette façon, les porteurs de ces titres purent participer au mouvement, et les dettes de l’État purent être remboursées par une simple compensation. En même temps on se jeta avec fureur sur tous ces contrats de dette publique, et tel titre qui perdait 70 à 80 % en 1715, dépassa le pair à cette occasion. Une dernière émission de 24 000 actions, non autorisée par le conseil, eut lieu le 4 octobre 1719 aux mêmes conditions, et porta le nombre des actions émises à 624 000. Le capital nominal de ces 624 000 actions était 312 millions ; mais aux prix d’émission cela faisait 1 797 millions et demi, soit 1 485 millions et demi de prime.
Mais arrivait le quart d’heure de Rabelais : les versements. Sous la nécessité des sommes énormes à débourser les actions allaient baisser, et le succès du système pouvait être compromis aux yeux de son auteur. Un arrêt du conseil du 20 octobre convertit les neuf versements de un dixième chacun à effectuer de mois en mois, en trois versements de trois dixièmes chacun à effectuer à la fin de chaque trimestre (31 décembre 1719, 31 mars, 30 juin 1720). De cette sorte, les joueurs eurent deux mois devant eux ; la hausse continua et les actions atteignirent 10 000 livres (novembre 1719). C’est à ce moment que la fièvre de l’agiotage atteignit son paroxysme.
Signalons de suite que ce dévergondage, ce dérèglement de mœurs financières amena la hausse de toutes choses, d’abord des objets de consommation immédiate et de luxe, puis de propriétés mobilières et même immobilières.
Le 30 décembre 1719 eut lieu l’Assemblée générale ; elle fut présidée par le régent ; se composant de tous les propriétaires d’au moins cinquante actions, le personnel de cette réunion fut des plus variés. Nobles, financiers, négociants, commerçants s’y coudoyaient avec d’anciens portefaix, domestiques, tous enrichis et devenus par suite, par le relâchement des mœurs du moment, les égaux de leurs anciens maîtres ou patrons. À cette assemblée, Law produisit le budget d’évaluation d’une année d’exercice de la Compagnie, et en conclut un revenu net de 91 millions, après avoir donné à tous les chiffres, une exagération qui échappa à l’aveuglement universel. On décida en conséquence, que le 1er janvier 1720, on distribuerait aux actionnaires un dividende de 200 livres par action. Ce n’était, après tout, malgré la fausseté des allégations de Law, qu’un revenu annuel de 1 2/3 % et encore sur le pied de 12 000 livres.
Cependant, le soir même de cette assemblée, les actions firent 15 180 l. ; et le 6 janvier 1720, elles atteignirent 18 000 livres, le plus haut cours auquel elles soient jamais parvenues.
Nous avons rapidement parcouru les principaux incidents de cette époque singulière et instructive ; nous ne nous sommes occupés jusqu’alors que des faits saillants, négligeant les causes et surtout les moyens employés pour arriver à cette mise en scène. Nous allons actuellement tâcher de combler cette lacune, en exposant causes et moyens d’après les auteurs contemporains et les brillants et érudits écrivains qui ont judicieusement reconstruit avec des matériaux bruts cet édifice auquel on peut justement appliquer les vers du poète :
Et d’abord quels furent les moyens (bons ou mauvais, justes ou iniques, modérés ou violents) employés par l’auteur du système pour faire parvenir ses actions à ce taux fabuleux qui n’a jamais eu son pareil avant ou après, en France ou à l’étranger.
Nous en distinguons principalement cinq au point de vue financier :
1° Exiger la possession d’anciens titres pour en souscrire de nouveaux ;
Comme les nouveaux avaient sur les anciens l’avantage de versements échelonnés, il était à craindre que l’on ne vendît les anciennes actions pour en souscrire de nouvelles, et que les premières en baissant n’entraînassent les secondes. Par la mesure précitée on soutenait les anciennes et on reculait le moment de la baisse jusqu’à l’époque de la clôture de la souscription ; cette opération permettait donc de faire réussir la souscription, sauf la baisse à se produire ensuite sur une échelle plus importante. Ce système ne fut adopté que pour la souscription des 300 000 premières actions ; on a vu que l’on ne s’en servit pas pour les 324 000 dernières ; aussi, un moment les anciennes menacèrent-elles, par leur baisse, de compromettre la souscription, qui ne réussit que par l’énergie de l’engouement général.
2° N’appeler que des versements successifs et minimes (1/10, 1/20) ;
Par là on permettait, avec peu d’argent disponible, de souscrire ou acheter de grandes quantités d’actions ; ce moyen a été également pratiqué de nos jours, particulièrement en 1845-46 lors de l’émission des promesses d’actions de chemins de fer.
3° Consentir des avances sur dépôt d’actions ;
La Compagnie, sur l’incitation de Law, avança aux porteurs d’actions qui le demandèrent, et au taux minime de 2 % par an, une somme qui alla jusqu’à 2 500 livres par action. Ce moyen a été également mis en application chez nous, surtout depuis 1852.
4° Racheter des actions sur le marché pour soutenir les cours dans leurs moments de défaillance.
La Banque générale, antérieurement à sa réunion à la Compagnie des Indes (février 1720), avait employé de la sorte une somme de 276 millions, sur le pied moyen de 9 600 livres par action. La Compagnie des Indes employa de la même manière 800 millions ; enfin la conversion d’actions en billets sur le pied de 9 000 livres (mars 1720) absorba 1 213 476,11 livres. Toutes ces sommes d’actions rachetées formaient la garantie de semblables sommes de billets en circulation. On comprendra facilement le danger de cette situation, danger que, d’ailleurs, les évènements se chargèrent de mettre en relief.
De nos jours encore, ce procédé, le rachat d’actions en vue de soutenir les cours, est fort usité. Cependant il a de graves inconvénients ; il affaiblit la caisse qui achète et crée, dans le public, des illusions, en lui laissant croire à un état de choses qui n’est pas.
5° Rendre l’état légal des monnaies très instable par le moyen de variations multipliées.
Par les entraves que cet état de choses apportait à la possession d’espèces métalliques, on amena le public à leur préférer, momentanément du moins, le billet de banque, déclaré invariable comme nous l’avons vu plus haut.
Au point de vue industriel, il y eut une série de moyens employés ; les uns révélant chez leur auteur des talents dignes d’un meilleur emploi ; d’autres qui sont déplorables pour la mémoire de Law, et qui montrent combien l’abus du pouvoir, peut entre les mains d’un sectaire (nous avons vu que ce financier croyait à la possibilité et à la réussite de son système), pervertir le sens moral et pousser aux crimes les plus révoltants.
D’abord on se rappelle que Law, à l’Assemblée du 30 décembre 1719, annonçait un revenu annuel de 91 millions par an ; Dutot, son admirateur passionné, ne crut pouvoir évaluer les mêmes bénéfices en mai 1720, qu’à 80 millions et demi. Voici la subdivision dans les deux hypothèses :
I.– La rente sur les fermes se composant de 45 millions, intérêts à 3 % des 1 500 millions prêtés à l’État pour le remboursement de sa dette publique, et de la rente de 3 millions due à la Compagnie par son contrat primitif, se compensait avec la redevance due par la Compagnie à l’État à titre d’adjudicataire des fermes générales. Ce revenu était donc certain et d’une rentrée assurée, même en cas d’insolvabilité de l’État.
II.– Le bénéfice sur les fermes était sans doute plus aléatoire ; c’était la plus-value supposée de rentrées des impôts indirects connus sous le nom de fermes, sur la somme de 2 millions, prix du bail contracté avec l’État. Néanmoins la manière dont Law se disposait et avait commencé à gérer cette branche de revenus ne permettait pas douter du succès que lui et Dutot en attendaient.