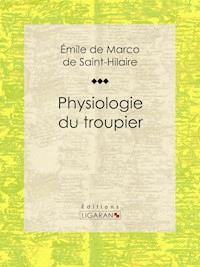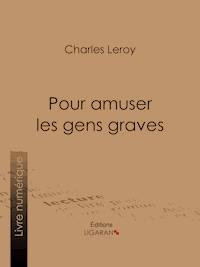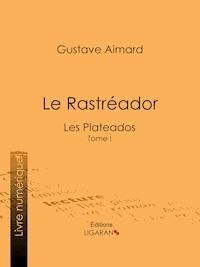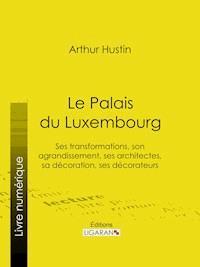Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "Le Sydney quitta Port-Jackson, situé sur la côte orientale de la Nouvelle-Hollande, le 12 avril 1806 ; il allait au Bengale. Ayant le dessein de passer par le détroit de Dampierre, je suivis aussi exactement qu'il me fut possible la route du capitaine Hogan, commandant le Cornwallis telle qu'elle est tracée sur les cartes, parce qu'elle me parut sûre et facile."
À PROPOS DES ÉDITIONS Ligaran :
Les éditions Ligaran proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sur un récif du Grand-Océan, le 29 mai 1806.
Le Sydney quitta Port-Jackson, situé sur la côte orientale de la Nouvelle-Hollande, le 12 avril 1806 ; il allait au Bengale. Ayant le dessein de passer par le détroit de Dampierre, je suivis aussi exactement qu’il me fut possible la route du capitaine Hogan, commandant le Cornwallis telle qu’elle est tracée sur les cartes, parce qu’elle me parut sûre et facile. Mais le 29 mai, à une heure du matin, nous touchâmes sur un récif ou banc de corail très dangereux, situé par les 30° 20’ de latitude australe, et les 146° 50’ de longitude orientale. Comme il n’est marqué sur aucune carte, je suppose que, pour notre malheur, nous en avons fait la découverte.
On trouva vingt-cinq brasses à l’arrière, six brasses à bâbord, seulement neuf à tribord, et douze pieds à l’avant. On mit aussitôt un canot à la mer avec une grosse ancre, mais en sondant à cinquante pieds du bâtiment, on ne trouva pas fond à soixante brasses.
La marée était certainement haute quand nous touchâmes, car nous n’avions aperçu ni récifs ni brisants ; mais à mesure que la mer baissa nous découvrîmes un banc et un grand nombre de petits rochers noirs. Le bâtiment avait heurté avec violence : l’avant commença à s’ouvrir. À trois heures, il y avait six pieds d’eau dans la cale, et elle augmentait avec rapidité. À cinq heures, l’arrière de la carène fut échoué, et les œuvres mortes se détachèrent.
Ayant tenu conseil avec mes officiers, l’avis unanime fut que le navire était entièrement perdu et que rien ne pouvait le sauver. On s’occupa donc de mettre les canots en état de recevoir l’équipage, composé de cent huit hommes : on embarqua dans la chaloupe huit sacs de riz, six barriques d’eau, un peu de bœuf et de cochon salés ; ces provisions devaient servir pour tout le monde. Notre grand nombre nous empêcha de prendre une quantité plus considérable de vivres, car les trois embarcations suffirent à peine pour nous recevoir tous.
Le 21, après midi, il y avait trois pieds d’eau dans l’entrepont. Nous jugeâmes en conséquence, qu’il était grand temps d’abandonner le navire à son malheureux sort, et de chercher notre salut dans les canots. Je m’embarquai donc dans la chaloupe avec M. Trounce, premier officier, et soixante-quatorze Lascars. M. Robson et M. Halkart, second et troisième officiers, se mirent dans le canot, et quinze Malais avec un Cipaye dans la yole.
Comme nous désirions constater la position du récif, ce qui pouvait se faire en prenant connaissance des îles de l’Amirauté, nous dirigeâmes notre route entre le nord-quart-est et l’est, vers ce groupe. Le vent fraîchit pendant la nuit. La chaloupe fit beaucoup d’eau ; nous l’allégeâmes en jetant à la mer beaucoup d’objets et deux barriques d’eau. Les trois autres canots naviguèrent de conserve, la chaloupe traînant la yole à la remorque. M’étant aperçu, au point du jour, que le canot marchait beaucoup mieux, je priai M. Robson de prendre la yole à la remorque. Malheureusement le vent augmenta avec le jour ; il survint une grosse houle, et la yole traînée par le canot coula à fond à dix heures. Nous eûmes la douleur de voir périr sous nos yeux les infortunés qui la montaient ; ce qu’il y eut de plus affreux pour nous, il ne nous fut pas possible de leur donner le moindre secours.
Le 22, à midi, nous aperçûmes les îles de l’Amirauté, à trois ou quatre lieues de distance au nord-est ; et d’après la direction que nous avions suivie, en parcourant les cinquante-huit milles de distance, depuis le récif jusqu’à ce point, nous fûmes en état de fixer exactement la position de cet écueil.
En quittant les îles de l’Amirauté nous fîmes route à l’ouest ; et, le 25, nous vîmes une petite île dont l’aspect m’engagea à y aborder pour y faire de l’eau. La pluie ayant mis nos armes à feu hors d’état de servir, je m’armai, ainsi que M. Robson et vingt de nos meilleurs matelots, de lourdes massues apportées de la Nouvelle-Calédonie, au grand étonnement des habitants et je pris terre malgré un ressac très fort : autant que nous en pûmes juger, ils n’avaient jamais vu auparavant des gens de notre couleur. Les hommes étaient grands et bien faits : ils portaient leurs cheveux tressés et redressés au-dessus de la tête : ils ne ressemblaient ni aux Malais ni aux Cafres : et à l’exception de leur teint, qui était cuivré clair, ils avaient les formes et les traits des Européens. Ils étaient absolument nus. Nous vîmes aussi beaucoup de femmes dont les traits étaient doux et agréables.
Nous fûmes reçus par une trentaine de naturels, qui nous donnèrent un coco à chacun. Nous réussîmes à leur faire comprendre que nous avions besoin d’eau, ils nous firent signe de les accompagner dans l’intérieur de l’île. Après avoir marché pendant près d’un mille, ils nous conduisirent dans un bois épais. Voyant que le monde s’accroissait rapidement, je jugeai qu’il était imprudent d’aller plus loin ; je retournai donc au rivage, et je fus alarmé de trouver un rassemblement de plus de cent cinquante naturels armés de lances de dix à douze pieds de long. L’un d’eux, vieillard d’un aspect vénérable, et qui avait l’air d’être leur chef, s’avança et jeta sa lance à mes pieds ; ce qui signifiait à ce que je suppose, qu’il désirait que nous nous défissions de même de nos massues. Nous apercevant, en ce moment, qu’une troupe de femmes avaient saisi l’étambot du canot, et qu’elles s’efforçaient de le tirer à terre, nous nous dépêchâmes de gagner la chaloupe. Les naturels nous suivirent pied à pied ; quelques-uns dirigèrent leurs lances sur nous pendant que nous faisions retraite : il y eut même quelques-unes de ces armes de lancées, mais heureusement sans succès. Il nous sembla qu’ils les maniaient très maladroitement. Quand j’entrai dans l’eau, deux ou trois insulaires me suivirent, en me menaçant de leurs lances, et quand je fus à portée de la chaloupe, l’un d’eux me lança son arme que M. Robson s’empressa de parer. Nous étions déjà dans la chaloupe et nous poussions au large, lorsqu’ils nous assaillirent d’une grêle, de traits. Il tomba au moins deux cents lances dont une seule blessa grièvement mon cuisinier ; elle entra immédiatement au-dessus de la mâchoire et lui perça la bouche.
Après avoir échappé à cette rencontre périlleuse, nous poursuivîmes notre route jusqu’au détroit de Dampierre aussi heureusement que le permettait notre état. Alors les Lascars, se voyant à portée de la terre, témoignèrent une grande impatience d’être débarqués. Je les exhortai vainement à ne pas nous quitter : ils ne voulurent écouter aucune représentation ; ils me déclarèrent qu’ils aimaient mieux trouver la mort en mettant pied à terre, plutôt que de mourir de faim en restant dans les canots. Cédant à leurs importunités, je finis par me décider à les débarquer à la pointe du nord-ouest de l’île de Céram, d’où ils pouvaient en deux ou trois jours gagner Amboine. Le 9 juin, nous nous trouvâmes vis-à-vis de cette partie de l’île et M. Robson consentit à mettre à terre un certain nombre des hommes du canot, puis à revenir à la chaloupe, et à abandonner ensuite le canot au reste des gens de l’équipage qui désiraient se joindre à ceux que l’on aurait déjà débarqués. Il alla donc à terre avec le canot : mais, à mon grand chagrin, après l’avoir inutilement attendu deux jours, il n’y eut pas d’apparence de le voir revenir, non plus que le canot.
Nous conclûmes que nos gens avaient été retenus par les Hollandais ou par les naturels ; cependant, comme le reste des Lascars demandait à être débarqué, nous nous portâmes vers la côte, et nous les mîmes à terre près du point où nous supposions que le canot avait débarqué son monde.
Nous n’étions plus que dix-sept dans la chaloupe ; savoir : M. Trounce, M. Halkart, quatorze matelots Lascars et autres et moi. Nos provisions consistaient en deux sacs, de riz et une barrique d’eau entamée, que nous supposions pouvoir durer jusqu’à Bencoulen, où nous nous décidâmes à aller au plus vite. La ration de chaque homme fut fixée à une tasse de riz et à une pinte d’eau par jour ; mais nous jugeâmes nécessaire de réduire beaucoup cette quantité.
En passant par le détroit de Bantam, nous vîmes plusieurs troupes de Malais qui ne prirent pas garde à nous : il y en eut cependant une qui nous donna la chasse pendant un jour, et qui aurait fini par nous atteindre si nous ne nous fussions pas échappés à l’aide d’une nuit très noire. Nous débouquâmes ensuite du détroit de Saypay, où nous prîmes un gros requin : cette capture précieuse nous redonna du courage. Nous nous dépêchâmes de la tirer à bord, et nous fîmes rôtir le monstre à un feu que nous allumâmes dans le fond de notre embarcation. Nous avions une faim si dévorante, qu’à la fin du jour il ne restait pas la moindre trace de cet énorme poisson qui ne pesait pas moins de cent cinquante livres. Mais nous en fûmes sévèrement punis : le lendemain nous souffrîmes tous, dans l’estomac et les entrailles, de douleurs violentes qui nous fatiguèrent beaucoup, et nous réduisirent à un tel état de langueur et d’abattement, que nous commençâmes à désespérer sérieusement de notre guérison.
Le 2 juillet, je perdis un vieux et fidèle domestique qui mourut de faim. Le 4, nous eûmes connaissance de la pointe de Java ; nous prîmes en même temps deux grands poissons qui nous procurèrent un repas bien essentiel à notre conservation. Le 9, à minuit, nous mouillâmes vis-à-vis de Poulo-Pinang, sur la côte occidentale de Sumatra ; mais, au point du jour, quand nous voulûmes lever notre ancre pour nous approcher de la côte, nous étions si exténués, que toutes nos forces réunies ne purent effectuer cette opération.
Nous fîmes alors un signal de détresse. Un champan, monté par deux Malais, vint à nous. Comme j’étais le seul homme à bord qui eût encore assez de force pour se remuer, j’allai à terre avec eux ; mais je me trouvai si faible en débarquant, que je tombai par terre, et l’on fût obligé de me porter à une maison voisine. On envoya aussitôt à ma chaloupe tous les rafraîchissements que l’on put se procurer, et nous nous remîmes avec tant de promptitude qu’en deux jours nous fûmes en état de continuer notre voyage. Nous levâmes l’ancre le 12 juillet, et le 19 nous arrivâmes à Bencoulen.
J’y rencontrai un ancien ami, le capitaine Chauvet, commandant la Persévérance. Je me fais un plaisir et un devoir de reconnaître tout ce que je dois à sa bonté et à son humanité. Le souvenir m’en sera éternellement cher. Le lendemain de mon arrivée, j’allai voir M. Pan, résident anglais, qui me combla d’attentions.
Je partis, le 17 août, sur la Persévérance, et j’arrivai, le 27, à Pinang, où je fus agréablement surpris de rencontrer M. Robson, mon premier maître, qui avait débarqué à Céram avec les Lascars. Ils avaient heureusement atteint Amboine, où M. Cranstoun, gouverneur hollandais, les avait accueillis avec une humanité et une bienveillance qui font le plus grand honneur à son caractère : il fournit à tous leurs besoins ; il fit manger Robson à sa table, lui donna à son départ d’Amboine de l’argent pour lui et pour ses gens, et refusa d’en recevoir aucune espèce de quittance ou de reconnaissance. Enfin il remit à Robson des lettres de recommandation très chaudes pour le gouverneur-général de Batavia. On ne peut trop faire connaître cette conduite d’un gouverneur envers des étrangers avec qui son pays est en guerre. Robson s’embarqua à Amboine, sur la Pallas, frégate hollandaise qui allait à Batavia ; elle fut prise dans cette traversée par deux vaisseaux anglais, et amenée à l’île du prince de Galles.
De Pinang, j’allai au Bengale sur le Varuna, capitaine Dension, et j’arrivai heureusement à Calcutta au commencement de mai 1807.
en 1807.
Nous empruntons au Voyage dans le nord de la Russie asiatique, par M. Saner, les détails de cet évènement et les faits intéressants qui s’y rattachent.
Le 17 mai 1807, le débâclement eut lieu sur la Léna ; et, le 22, nous traversâmes cette rivière pour gagner l’Yarmank, où l’on nous avait fait préparer des chevaux. Lispravinsk de Yakoutks nous accompagnait. La rivière avait inondé tout le pays, et elle chariait beaucoup d’arbres et de glaçons.
Nous nous hâtâmes de nous mettre en route, pour atteindre le lieu où la rivière de Mayo se jette dans l’Aldan. J’ai déjà parlé des plaines qui s’étendent entre Yakoutks et l’Aldan, ainsi je ne les décrirai pas de nouveau ; je dirai seulement que, cette fois-ci, nous nous arrêtâmes dans le village d’Amginskoï, habité par cent soixante-huit colons sibériens. Ils ont été envoyés pour y établir la culture du blé ; mais la terre ne paie pas généreusement leur travail. Elle ne produit du blé que pour leur seule consommation, encore ne leur en fournit-elle pas toujours assez : il y a même des années où ils n’en recueillent pas un seul grain. Les habitants d’Amginskoï vivent en grande partie des profits qu’ils font avec les Yakoutks et les Tongouths de leur voisinage, auxquels ils vendent de l’eau-de-vie et de la petite quincaillerie. – Ils nous apprirent qu’aucune des hordes errantes des Tongouths n’était encore arrivée à l’Ous-Mayo.
Nous demandâmes aux habitants d’Amginskoï comment était le chemin qu’il fallait suivre pour se rendre directement sur les bords de l’Aldama et de l’Oulkam, parce que le capitaine Billings avait promis de joindre le capitaine lieutenant Zaritscheff à l’embouchure de l’une de ces rivières : mais ils représentèrent ce chemin comme étant si mauvais, que le capitaine Billings renonça à y passer. En conséquence, il dépêcha un cosaque aux Yakoutks habitants des plaines voisines, avec un ordre de l’ispravinsk qui leur enjoignait d’envoyer immédiatement seize chevaux à l’Aldan Stanok, pour nous conduire à Okhostk par l’ancien chemin.
Le jeudi, 31 mai, nous arrivâmes à l’Oust-Mayo-Pristan, vis-à-vis de l’embouchure du Mayo. Aussitôt nous en fîmes informer le prince des Tongouths, qui a résidence environ dix verstes plus haut, sur les bords de l’Aldan. Ce prince est le chef de tous les Tongouths, et beaucoup d’Yakoutks lui sont soumis. Il est très respecté des deux nations, et il est agent du gouvernement russe auprès des Tartares Mongouls qui vivent sur les frontières de la Chine, ainsi qu’auprès des Tongouths et des Yakoutks.
Le prince tongouth vint nous joindre le premier juin, de fort bonne heure. Il nous dit que le chemin que le capitaine Billings s’était proposé de prendre était très difficile ; que les députés des hordes errantes n’étaient pas encore arrivés ; qu’il enverrait une lettre au capitaine-lieutenant Zaritscheff, et que si cet officier était sur la côte, près de l’embouchure de l’Oulkan ou de l’Aldama, on en aurait la réponse dans vingt jours. En conséquence, le capitaine Billings écrivit à M. Zaritscheff pour le prier de le venir le trouver sur-le-champ à Okhotsk, parce qu’il comptait que les deux vaisseaux qu’on y construisait étaient déjà prêts à être lancés.
L’on nous procura des bateaux, et le 4 juin, nous commençâmes à descendre l’Aldan. Le 7, à six heures du soir, nous arrivâmes à l’ancien embarcadère de l’Aldan, qui est à cent cinquante verstes du lieu de notre départ. Depuis huit jours, le temps était pluvieux et orageux.
Nous ne trouvâmes à l’embarcadère ni les chevaux demandés aux Yakoutks, ni le cosaque qui était allé les chercher ; mais l’on nous fournit douze chevaux de trait, avec lesquels nous nous mîmes en route, le 8 juin à midi, pour Okhotsk, et nous y arrivâmes le 21. Le plus grand des vaisseaux en construction était déjà prêt à être lancé, et l’autre ne pouvait pas tarder à l’être. Tous les objets destinés pour l’expédition étaient arrivés en bon état, et toutes les personnes qui devaient en être paraissaient remplies d’ardeur et de santé. Vers la fin du mois, le capitaine-lieutenant Zaritscheff arriva à Okhotsk, d’après la lettre qui lui avait été écrite de l’Oust-Mayo-Pristan.
Le docteur Merck s’était rendu sur les montagnes de Mariakan, pour y recueillir des objets d’histoire naturelle. On lui manda de revenir à Okhotsk, attendu que nous devions mettre en mer le 15 août.
Vers la mi-juillet, on lança le plus grand de nos deux vaisseaux. Il sortit heureusement du chantier ; mais les hauts-fonds de la rivière furent cause qu’on mit près de trois semaines à le faire descendre à l’entrée de la baie, où il reçut une partie de ses agrès. On le fit alors passer sur les bancs de sable qui sont en dehors de la baie, et il mouilla à cinq mille au large, par six brasses d’eau sur un fond de sable et de pierres.
Nous nous servîmes de nos galiotes de transport pour porter à bord du vaisseau les canons, les munitions navales et les vivres. Il eût été inutile et dangereux d’embarquer ces objets pendant que le vaisseau était dans la baie ; car il n’aurait pas pu franchir les bancs de sable, même avec tout son lest. D’après les ordres de l’impératrice, ce vaisseau fut nommé la Slava-Rossia.
Le 8 août, nous lançâmes le second vaisseau, auquel on donna le nom de la Dobroya-Namerenia. Il fut gréé et prêt à faire voile dans les premiers jours de septembre. Cependant il fallut attendre les fortes marées pour lui faire passer hauts-fonds. On chargea les objets les plus pesants dans une galiote qui se tint prête à l’accompagner.
Dans la soirée du 7 septembre, le capitaine Billings résolut de faire sortir ce vaisseau de la baie le lendemain matin. M. Loftoff, premier pilote du port d’Okhotsk, fut chargé de le conduire, et de faire tenir armés tous les canots du port, pour qu’en cas que le vent faiblit on pût touer le vaisseau. Les canots de la Slava-Rossia furent également prêts à aider à la sortie de la Dobroya-Namerenia. Le capitaine-lieutenant Hall qui avait le commandement de ce vaisseau, coucha à bord.
Le 8, à six heures du matin, je me rendis à bord pour chercher un livre que j’avais laissé dans la chambre. Avant que j’eusse atteint le vaisseau, le capitaine Hall me demanda si j’apportais des ordres pour qu’il sortît de la baie. Je lui répondis que non, et je lui demandai, à mon tour, s’il croyait qu’il fût possible de sortir. Le vent était favorable, mais très faible. Une forte houle venait du sud-ouest, et la lame se brisait contre le rivage avec une extrême violence. Je pensais, d’après cela, que la brise allait passer au sud-ouest ; en outre, le temps était très brumeux.
Le capitaine Hall me dit qu’il ne croyait pas qu’on pût mettre en mer, et que certainement il ne sortirait pas de la baie, à moins qu’il n’en reçût l’ordre exprès, et que le capitaine Billings ne vint lui-même à bord.
M. Koch, commandant du port d’Okhotsk, était à bord du bâtiment de transport, en arrière de la Dobroya-Namerenia. Il demanda au capitaine Hall s’il devait le suivre. – « Non, répondit le capitaine Hall, à moins que vous ne vouliez être jeté à la côte : mais certes, moi, je ne sortirai pas, si je puis l’éviter. »
À sept heures et demi, le capitaine Billings se rendit à bord ; et après un court entretien avec le capitaine Hall, il répondit aux objections de ce dernier : – « Le pilote en décidera. » – Le pilote arriva. Le capitaine Hall le pria de considérer tout le danger qu’il y avait à sortir, et ajouta que peut-être M. Loftoff ne songeait pas assez à la différence qui se trouvait entre un vaisseau tel que celui dont il allait se charger et une galiote de soixante tonneaux.