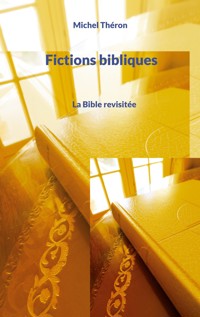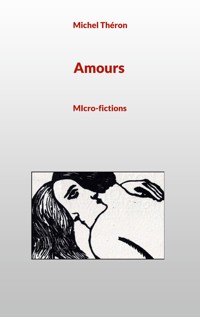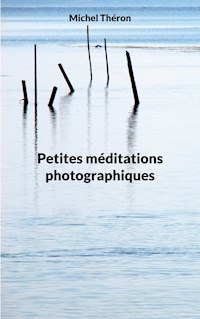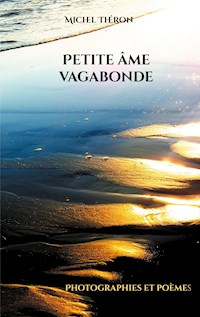Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce livre est destiné à tous ceux qui veulent écrire et améliorer leur style, comme par exemple ceux qui fréquentent les ateliers d'écriture. Il fait comprendre les enjeux de l'écriture par des comparaisons constantes avec le langage des arts visuels (photographie, peinture). Tout les monde peut bien écrire. Pour cela, il suffit de bien scruter le langage qu'on emploie, et d'y valoriser la part de la pure sensibilité, contre la soumission aux injonctions de l'École et du catéchisme social.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table
Avant-propos
L’écriture entre amnésie et mémoire
L’amnésie
La mémoire
Spiritualité et poésie
Rhétorique et art moderne
Langage, Culture, Société
Le langage, soubassement de la culture
L’appauvrissement du lexique
Négligences et approximations
La fin des hiérarchisations
Euphémisations et anesthésies
Déculturation et unidimensionnalité
Psychasthénies et recours
Conclusion
Quelques conseils pratiques
La poésie
La narration (nouvelle, roman)
Autres petits conseils
Poésie
Nouvelle
Pour ne pas conclure
Du même auteur
Avant-propos
Ce livre comporte d’abord quatre chapitres généraux : L’écriture entre amnésie et mémoire, Spiritualité et poésie, Rhétorique et art moderne, et Langage, Culture, Société. Ils sont issus de conférences que j’ai données en 2006, 2011 et 2013, ainsi que d’un ouvrage collectif auquel j’ai participé, L’Art aujourd’hui, publié en 1993. On ne s’étonnera pas s’il reste encore dans mon texte un peu du langage oral propre aux conférences.
À la fin de l’ouvrage j’ai ajouté deux petits ensembles consacrés à des conseils pratiques ponctuels concernant l’écriture poétique et la narration. On pourra s’en inspirer pour écrire, mais en ayant bien présentes à l’esprit les considérations générales exposées dans les quatre premiers chapitres, qui en sont le sous-bassement.
Dans ces derniers j’ai mis l’écriture en rapport avec des domaines a priori distincts : les rapports de la poésie et de la recherche spirituelle dans le deuxième ; la comparaison du texte et des arts visuels dans le troisième ; et une réflexion sur le langage dans une société en voie de déculturation dans le quatrième.
Mais tout se tient dans l’esprit, et quand on s’exprime sur l’écriture et l’état du langage qu’on pratique (est-il vivant ou mort ?), on est automatiquement renvoyé à cette organisation générale de l’être spirituel dont parle Baudelaire dans ses Curiosités esthétiques (1868) :
Car il est évident que les rhétoriques et les prosodies ne sont pas des tyrannies inventées arbitrairement, mais une collection de règles réclamées par l’organisation même de l’être spirituel.
De cette « organisation même de l’être spirituel » dépendent tous les domaines qui relèvent de l’humain. L’art d’écrire ne se réduit pas à l’application de procédés techniques, tels que les présentent « les rhétoriques et les prosodies ». Il n’est pas une simple technique, mais beaucoup plus largement une façon de voir les choses.
On pourra donc le mettre successivement en rapport avec 1/ la réhabilitation de la sensibilité pure mais aussi avec le rattachement nécessaire à l’héritage culturel (premier chapitre), 2/ la recherche d’unification de l’être dont s’occupe la quête spirituelle (deuxième chapitre), 3/ le problème de la communicabilité de l’expression verbale et plastique à l’époque moderne (troisième chapitre), et 4/ l’exigence d’un langage vrai et authentique dont nous avons besoin en notre époque de déculturation (quatrième chapitre).
M.T. – juin 2024
L’écriture entre amnésie et mémoire
Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, dames persécutées s’évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu’on tue à tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes.
(Flaubert, Madame Bovary, extrait du manuscrit)
L’écriture entre amnésie et mémoire
Pour écrire de façon vivante, intéressante et substantielle, il faut deux choses apparemment contradictoires : une amnésie et une mémoire. Une amnésie vis-à-vis du langage abstrait, un oubli du langage ordinaire, informatif et communicationnel. Et une mémoire, qui s’exerce sur deux plans. C’est d’abord un travail intellectuel de rappel des points de départ, de ce dont on s’est éloigné, s’occupant de communiquer au moins un peu ce qu’on veut transmettre. C’est ensuite une curiosité à l’affût de tout l’héritage culturel dont nous sommes formés, dont la mention plus ou moins discrète peut enrichir considérablement l’expression. Ce sont ces deux pôles antagonistes et complémentaires, l’amnésie et la mémoire, qu’il s’agit d’évoquer ici, à partir d’exemples tirés de maîtres du style. Car de leur examen on apprend beaucoup. Avant d’écrire, il faut lire. Avant de se jeter sur la feuille blanche, il faut méditer longuement les exemples des maîtres qui nous précèdent en écriture.
L’amnésie
Tel que nous le parlons selon les normes de l’éducation et de l’école, notre monde est mis en ordre en vertu de ce que nous appelons la logique. Elle renvoie à une façon rationnelle de percevoir, ou d’organiser nos perceptions, qui n’est pas en nous première, mais seconde car elle est apprise. C’est elle qu’il s’agit donc d’oublier si on veut écrire de façon vraiment expressive et vivante, c’est sur elle que doit porter l’amnésie.
Au bénéfice de quoi ? Du resurgissement en nous de la perception sensible, qui était par exemple celle que nous avions étant enfant, car nous portons encore en nous l’enfant que nous avons été. Celle aussi que nous pouvons avoir quand nous parlons, non pas selon les codes de la doxa sociale (l’opinion), mais de façon spontanée, naturelle.
*
Il faut ici prévenir un malentendu très fréquent. On croit ordinairement que le langage expressif est d’abord le langage logique, simplement agrémenté ou enjolivé en un second temps d’ornements que nous pouvons lui ajouter, par exemple les fameuses figures de style. Elles impressionnent souvent, comme on dit, parce qu’elles ont des noms bien savants, et on fait devant elles comme un complexe d’infériorité. Ainsi on se jette sur des manuels censés nous les apprendre, comme si l’écriture était une question de savoir-faire, de technique, comme s’il y avait des recettes d’écriture comme de cuisine. Mais quand on approche l’écriture (ou la création en général), c’est de la façon de voir le monde qu’il doit être question, de la nature de cette vision : est-elle sensible, ou au contraire abstraite, conceptuelle ? Les procédés eux-mêmes sont subordonnés à cette question. « Le style, dit Proust, est une question non de technique, mais de vision ». Il faut poser ici la bonne question. Dans quelle vision de la vie se situe-t-on quand on veut écrire ?
Mais nous avons tant d’inhibitions ou de complexes devant notre feuille blanche, que nous tendons au contraire à 1/ élever, comme on dit, notre style dans un registre plus soutenu et noble (pensons-nous) que celui de la conversation courante (surtout, comme on nous l’a dit, il ne faut pas écrire comme on parle), et 2/ ensuite, rajouter çà et là quelques figures pour enrichir, faire plus joli (quelques métaphores, par exemple).
En quoi nous nous trompons complètement. Ce langage que nous pensons élevé ou noble n’est en réalité qu’un langage abstrait, notionnel et mort. Souvent il ne fait qu’euphémiser et anesthésier. Et nous avons le tort de prendre pour un bien nouveau à acquérir (les figures, tours ou tropes) ce que constamment nous pratiquons quand nous parlons sans contrôle et sans ambition d’écrire.
En réalité, les figures de style, bien loin d’être des ornements du discours logique, ne sont que la perception sensible saisie à sa racine, immédiatement (sans médiation ou analyse intellectuelle). La preuve, s’il en fallait une, est que nous faisons constamment de telles figures dans notre langage parlé : simplement nous ne connaissons pas leurs noms. Il se fait plus de figures dans une conversation de rue que dans un livre de « haute » écriture.
Nous voyons la voile, et non le bateau ; le toit, et non la maison. Les synecdoques particularisantes, ici, ne sont pas là pour orner un langage ordinaire et en fait abstrait, qui serait premier. Elles sont en réalité ce que nous percevons immédiatement. Et la « rectification » qu’on nous dit de faire (comprendre bateau, maison) consiste à remplacer du vu ou du perçu par du su – et à tuer la vision sensible. La logique ainsi devient un massacre d’impressions, et le langage s’assèche.
Comme Monsieur Jourdain de la prose, nous faisons donc des figures sans le savoir. La conversation quotidienne est, pour le vocabulaire, pleine de synecdoques, de métonymies, de métaphores (« tirelire », ou « cafetière », pour « tête », qui lui-même originellement est métaphorique : « coquille dure »). Et pour la syntaxe, de prétendues incorrections comme les énallages, les zeugmes, ou les hyperbates, etc. Ces mots n’ont rien qui doive effrayer. Ce ne sont pas des noms de maladies, ou de monstres préhistoriques, que sais-je ? Ils désignent des façons de parler que nous pratiquons à chaque instant, dans la vie de tous les jours.
Bref, l’amnésie de l’écriture ne concerne pas du tout le langage parlé, qui est au contraire éminemment sensible, mais le langage idiomatique, standardisé, basique, que l’école et les médias nous inculquent, et qui tourne le dos à la vraie sensibilité.
Je donnerai plus loin quelques exemples concrets de figures sensibles. Je les ai analysées en détail, à côté des autres procédés de style, dans mon ouvrage consacré à l’étude du style La stylistique expliquée – La littérature et ses enjeux (BoD, 2017). Pour en prendre une connaissance complète, on pourra se reporter à ce livre, qui n’est pas un catalogue formel : j’y ai toujours souligné, comme j’en ai dit plus haut la nécessité, à quelle vision, à quel type de perception du monde les figures renvoient.
J’ai défendu aussi, dans trois livres illustrés de mes photos et aussi publiés chez BoD, Petite initiation à l’Art (2021), Quand parlent les images (2022), et Le Style par l’image (2018), l’idée que chaque figure a son exact équivalent visuel, donc que toutes les figures ne sont pas des ornements intrinsèques et autonomes surajoutés au discours, mais des catégories générales de la perception, concernant aussi bien le monde du visible que celui du verbal. Tout cela vise moins le prétendu « art d’écrire », au sens de seules recettes techniques, que la structure même de notre esprit, ou encore, comme dit Baudelaire, l’« organisation générale de l’être spirituel »...
*
Il faut comprendre d’abord qu’écrire ou redonner vie au langage n’est pas s’adresser à l’intelligence abstraite du lecteur. Roger Caillois raconte l’anecdote suivante. Un mendiant aveugle avait mis dans la rue devant lui un écriteau : « Aveugle de naissance », et personne ne lui donnait rien. Un jour, il s’avisa d’inscrire au contraire : « Le printemps va venir, je ne verrai pas. » Et tout le monde lui fit l’aumône. Là est toute la définition de l’écriture sensible, et aussi pourrait-on dire de la Littérature en général.
C’est qu’« aveugle de naissance » est un concept, c’est-à-dire un écran intellectuel, qui nous voile la réalité de la chose, et ne peut pas nous la faire ressentir. Et au contraire « Le printemps va venir, je ne verrai pas » est une réalité sensible, qui peut entraîner de notre part sympathie et empathie (projection, mise à la place de...). En allemand : Einfühlung.
Pareillement, le mot « mort » ne dit rien, car c’est un mot abstrait. Mais une chaise vide dit tout. C’est ici le génie de la figure appelée métalepse (littéralement : transposition), variante de métonymie par laquelle on dit une chose au moyen de ce qui la précède ou de ce qui la suit. Ainsi pour « Il est mort » on peut dire « Il vécut » (ce qui précède), ou « Nous le pleurons » (ce qui suit). La figure, loin d’être un ornement, est beaucoup plus vivante que la mention du fait brut, car plus concrète. Les larmes, la chaise vide, etc., disent mieux la mort que la simple mention de ce qui les cause. La figure ici montre vraiment les choses, et quand on veut écrire au sens plein du terme il faut montrer de façon sensible, et non pas démontrer de façon didactique.
À cet égard il peut être habile quand on écrit de refuser une analyse psychologique qui peut être facile, explicative et stéréotypée, souvent recopiée de mauvais textes, et de la remplacer par une présentation concrète, de type comportementaliste ou behaviouriste, qui permet au lecteur de sentir vraiment les choses. On lui laisse aussi deviner ce dont il s’agit. Ne pas dire par exemple : « J’ai de la peine », mais : « Des larmes coulent sur mes joues », ou bien : « Mes yeux se mouillent », etc. Dans la vie, le résultat physique sensible de la peine vient toujours avant que la cause en soit comprise et énoncée. Comme dans la métalepse susmentionnée, on constate l’émotion par son résultat. Ainsi à une séquence « Je vois un ours – J’ai peur – Je tremble », qui est une analyse et explique tout d’emblée, il vaut mieux en substituer une autre, comme : « Je vois un ours – Je tremble – J’ai peur. » Sensiblement, on ne tremble pas parce qu’on a peur, mais on reconnaît la peur par le tremblement.
*
Dans le contenu de ce que nous disons, il faut donc oublier les concepts abstraits par quoi nous substituons ce que nous savons à ce que nous pouvons ressentir. Par exemple, si j’écris : « Je fais mon complexe d’Œdipe », cela n’est pas du langage vivant. Mais si j’écris : « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voudrais pas que ma mère se remarie », ce qui dit exactement la même chose, mais autrement, alors c’est vivant, et le lecteur, au lieu d’être gavé passivement, sera intrigué, invité à chercher, donc associé à la découverte qu’il pourra faire finalement à partir de cette phrase.
Il y a une propension fâcheuse du langage, dit Bergson dans un texte essentiel de son livre Le Rire, à coller des étiquettes sur les choses. Écrire, c’est donc désétiquetter les choses. C’est comme quand on fait un cadeau : il ne faut jamais laisser le prix sur l’étiquette. Ces étiquettes ce sont ici des façons abstraites de parler, qui remplacent par des concepts, par ce qu’on sait, ce qu’on perçoit ou ce qu’on sent. Elles constituent autant de voiles ou de voilements que le langage social met entre nous et les choses. Voilement : le voile ment.
*
Pour bien voir la différence entre langage sensible et langage abstrait, il suffit de relire le début de L’Étranger, de Camus :
Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : ‘Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués’. Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier...
« Maman » est sensible, et « Mère » non. « Morte » aussi est sensible, et pas « décédée ». N’écrivons pas comme pour remplir les feuilles de Sécu. Ne disons pas : Mon « épouse », qui est ridicule, mais simplement : « Ma femme » ... Ce nom est si beau ! Voyez comment commence le poème de Breton Union libre :
Ma femme à la chevelure de feu de bois…
Heureusement qu’il n’y a pas : « Mon épouse » ! Parler de façon administrative classe celui qui le fait. C’est un bourgeois hyper-respectueux des convenances et des hiérarchies, un pilier de l’ordre social, s’imaginant lui-même grandi s’il s’y soumet : « Je vous présente mon épouse... » – La vraie écriture n’a rien à faire avec cette comédie sociale. Mieux, elle est la destruction de cette comédie.
Les medias pareillement : ils nous en imposent, nous les sacralisons. Et nous nous imaginons qu’il faut, pour parler bien, parler comme eux. Toujours notre complexe d’infériorité... Mais le résultat est une bouillie conventionnelle, un sabir. On ne sait pas assez l’inculture des journalistes. « Au niveau du vécu ça m’interpelle quelque part... » Parler comme cela est le propre d’un perroquet : psittacisme.
On n’écrit vraiment que quand on est en rupture avec un monde senti comme factice, pour aller à la rencontre d’un monde plus profond, perdu ou oublié, qui veut à cette occasion remonter à la surface. Ce monde a été connu dans l’enfance, avant que ne s’effectue le dressage de l’animal humain. Et il peut réapparaître à tel ou tel moment de la vie d’adulte, en opposition à ce qu’on lui a inculqué. On ne peut donc utiliser le langage même du monde factice pour lutter contre lui. Car parler selon le consensus social serait aussi penser comme lui.
*
De façon assez bizarre, l’écriture sensible, comme la littérature en général, est bien plus intéressante quand elle est dissonante par rapport à l’idéologie sociale que consonante avec elle. Elle est dans son meilleur rôle quand elle fait du hors-sentier intellectuel, quand elle n’emprunte pas les chemins de grande randonnée, les GR. L’oubli des codes imposés, des voies banalisées et balisées est donc essentiel : se déprendre des normes imposées du langage, aussi bien dans sa conduite grammaticale ordinaire (la fameuse correction !), que dans son contenu (dépersonnalisant, fait de clichés et de stéréotypes). Il faut abandonner le catéchisme social, où selon l’étymologie du mot l’on ne fait que répéter en écho (ekhein) une voix descendue d’en haut (kata).
Pour ce faire, notez bien que la littérature pratique souvent le discours intenable, le second degré, l’ironie ou l’antiphrase : « Les enfants dégradent » (Montherlant). « Assommons les pauvres ! » (Baudelaire). « Salauds de pauvres ! » (Autant-Lara). « Ah ! Dieu, que la guerre est jolie ! » (Apollinaire). Ou encore l’oxymore : « boucherie héroïque » (Voltaire). Cela n’est pas de la provocation gratuite, mais s’explique par un contexte approprié qu’il s’agira pour vous de trouver et de mettre en scène, et qui sera le signe d’une pensée « à rebours ».
Rien n’est plus hostile à l’art d’écrire que le « politiquement correct ». N’ayez pas peur de vous aventurer sur ce terrain-là, destructeur de la rhétorique sociale qui anesthésie, subjugue, et ôte l’esprit critique. En vous éloignant ainsi de la doxa et de sa vision conventionnelle de la vie, vous y gagnerez la liberté, vous vous émanciperez des conditionnements : n’oubliez pas qu’on prend les hommes comme les lapins, par les oreilles.
Et quant à la façon de s’exprimer, vos figures doivent être libres, et non imposées, pour parler comme dans le patinage. La liste serait longue des soi-disant incorrections, en réalité très vivantes et expressives (anacoluthes, zeugmes, énallages ...). Exemples :
L’apprenti-écrivain, la prudence le perd. (anacoluthe) Il veut bien écrire, et la gloire. (zeugme) Il l’a dit, tu le crois, je m’en doutais. (énallage – pronominale et temporelle)
Qui ne voit que ce sont là aussi des façons spontanées et ordinaires de parler ? Finalement il faut d’abord s’écouter parler ou écouter parler les autres dans la vie courante, avec une grande attention, pour s’en convaincre : dans un livre de figures on ne trouvera, dûment répertorié et classé, que le mode naturel qu’on a de s’exprimer, spontanément et sans y penser, quand on est vraiment vivant et non sous la coupe de convenances quelconques ou abrité derrière le masque social (la persona jungienne).
*
La vie sociale, la vie pratique, sont extrêmement utilitaires. Le langage y est utilisé dans sa fonction uniquement référentielle, injonctive (« Passe-moi le sel ! »), et très souvent prédatrice. En regard, la littérature est selon le mot de Kafka un « bond hors du rang des meurtriers ». Elle est moins conquête qu’enquête.
Au départ même, on ne doit pas écrire comme beaucoup le pensent pour régler ses comptes (sauf peut-être avec soi-même, en manière de thérapie...). Une pareille intentionnalité est impure. La littérature, recherche de la vie sensible, n’est pas finalisée : vie sensible, vie sans cible. Elle n’instrumentalise pas le langage, elle est simplement à son écoute.
En vérité, on n’écrit pas sur, on écrit dans : dans l’inconnu encore des sensations et sentiments, et aussi la forêt des signes du langage, parfois si proches, parfois si lointains... Écrire, c’est toujours réfléchir aux mots. Nous les servons plus que nous nous en servons. Ils sont plus grands que nous, de toute façon.
Et cette enquête est difficile, car toute détermination est une négation : elle implique des choix, qui sont autant de refus. Deux choses sont nécessaires pour écrire : un stylo, et une corbeille à papier. Littérature : lis tes ratures...
*