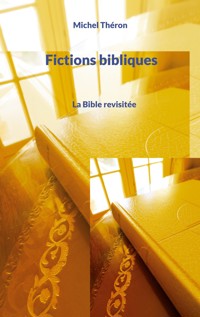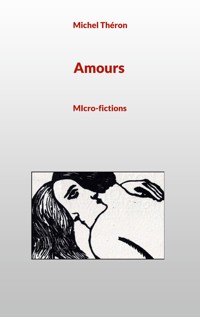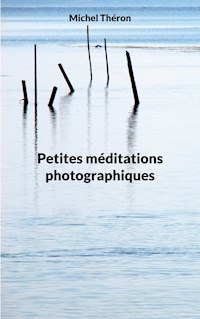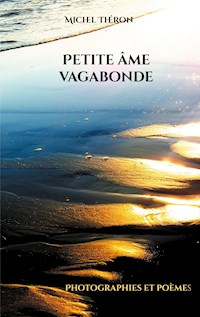Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Ce livre raconte un itinéraire personnel, un chemin de vie, où le sourire de l'humour apparaît comme un remède, un moyen de conjurer, sans la nier, l'essentielle imperfection de l'existence.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE
Avertissement
Les Moments parfaits
Les Chutes d’Icare
La TSF de la vie
Rires
Le Masque arraché
La Voie du non-savoir
La Fin du sérieux
Paradoxes
Les Mythes revisités
Décalages et pas de côté
Ambiguïtés
L’humour noir
Épilogue
Notes
AVERTISSEMENT
Ce livre n’est pas un traité universitaire ou académique, il ne prétend pas à un savoir objectif, et il ne se contente pas d’exposer quelques caractéristiques de l’humour. Il s’applique à montrer ce que l’humour peut combattre, et à quoi il peut porter remède. Par exemple, pour moi, un sentiment de déception devant une vie hétérogène et mêlée alors qu’on la voudrait toujours également pleine et satisfaisante. C’est une question essentielle que je me pose depuis toujours : Comment vivre après cette désillusion ?
Les pages qui suivent racontent un itinéraire personnel, un chemin de vie, où le sourire de l’humour apparaît comme un remède, un moyen de conjurer, sans la nier, l’essentielle imperfection de l’existence.
M.T.
Février 2024
Ces pages sont inspirées d’une conférence que j’ai donnée à la Maison du Temps Libre de Palavas-les-Flots, dans l’Hérault, le 20 avril 2023.
LES MOMENTS PARFAITS
Aenfants ont eu le même désir que moi, ou si c’est propre à mon tempérament qui est peut-être plus sensible que certains autres : c’est un fait que les choses m’atteignent plus profondément, me semble-t-il, qu’elles ne le font pour la moyenne des gens.
Je me souviens alors de beaucoup de retranchements en solitude que j’ai opérés, à l’écart de mes parents, pour réfléchir à ces moments, les organiser pour l’avenir. Je me disais sûrement ou au moins sentais que la vie devait être homogène dans la satisfaction qu’elle donne, et que les déceptions qu’elle nous procure étaient comme une sorte de moins-être en regard de ce qu’on en attend. Bref je voulais que la vie fût pleinement elle-même : que la vie fût vie.
Certains moments vécus en elle me faisaient bien miroiter et pressentir ce qu’elle pouvait être. Alors pourquoi ne pas vouloir qu’elle le fût tout le temps ? La vraie vie miroite bien dans le langage même, tel que celui que je viens d’employer : « Que la vie fût vie » oppose deux états de la vie, un état déchu, et un état idéal. Je ne connaissais pas, enfant, le nom de cette figure, l’antanaclase, mais j’étais bien sensible à son esprit. Et du simple miroitement (antanaklasis) je ne pouvais me satisfaire. Je voulais conjurer la ussi loin que je remonte dans mon enfance, j’ai toujours voulu connaître des moments parfaits. Je ne sais si tous les déchéance affectant la vie ordinaire, dans laquelle je souffrais d’être plongé.
Au lycée, j’ai appris l’existence de Platon, et là je me trouvai en total pays familier. J’avais toujours senti que ce que nous voyons d’habitude n’était en quelque sorte qu’irréel, fantomatique, et que derrière tout cela existaient, fidèles, des modèles seuls porteurs de vérité, soit pour Platon les Idées. Simplement, si je me souviens, la vision d’un monde déchu, en exil loin de l’essentiel, m’amenait alors plutôt au désir de le restaurer dans sa pureté initiale qu’à un désespoir causé par sa dégradation, et encore moins à une disposition mentale, comme celle de l’humour, propre à le relativiser.
Enfin, adulte, j’ai étudié la gnose, qui est une platonisation du christianisme. Et bien sûr je me suis trouvé là, encore une fois, en parfait territoire familier. J’ai accueilli avec plaisir, pour m’y reconnaître, l’idée d’un monde en morceaux, reflet d’une Totalité brisée, méconnaissable dans son apparence actuelle, comme les reflets grimaçants d’un arbre sur l’eau n’en donnent plus qu’une image brouillée. Dans ce monde déchu on se sent en exil loin du monde essentiel. Et récemment j ’ai illustré cette situation et ce sentiment dans mes Méditations photographiques, mes derniers livres.
J’ajoute à toutes ces influences celle de la métaphysique indienne, que je crois aujourd’hui tout à fait en concordance avec la philosophie de Platon : qu’est-ce que la maya, le voile que les dieux agitent devant nos yeux pour nous berner, sinon le voile du monde phénoménal qui dissimule les Idées selon Platon ?
*
Je pense que le sentiment d’être en exil ne m’a jamais quitté. Comme tous les enfants venant d’un milieu catholique, j’ai été élevé dans in hymnis et canticis – dans les hymnes et les cantiques. Je me souviens du Salve Regina que j’entendais à l’église où on m’amenait le dimanche. La mélodie en est encore présente à mes oreilles, et je pense qu’elle ne me quittera jamais. Mais il m’a fallu devenir adulte pour en bien saisir les paroles, les voix qu’elle transmettait. Elles s’adressaient à la Vierge, qu’elles invoquaient comme fils exilés d’Ève, gémissants et pleurants dans cette vallée de larmes. Fils d’Ève à mon tour, j’étais en exil. Et c’est ainsi que j’étais amené à voir la vie. Plus tard j’ai appris la devise prise par Victor Hugo, inscrite au-dessus de la porte de la salle à manger de Hauteville House, dans son exil à Guernesey : Vita exilium est – la Vie est un exil.
De toujours m’a accompagné l’impression d’être d’ailleurs, allogène comme disaient les anciens gnostiques. Quand à mon adolescence j’ai lu Rimbaud, je m’y suis encore reconnu : « Nous ne sommes pas au monde. La vie est ailleurs... » Une chaîne fraternelle s’est ainsi nouée au fil de mes lectures. Il est bon de faire ces découvertes progressives d’alliés substantiels : on se sent moins seul au monde.
Ce sentiment mélancolique n’était pas triste à ressentir, car il faisait la substance même de mon être, et je n’aurais pas supporté de ne plus l’éprouver. Simplement il me semblait plus sérieux et plus profond que la joie superficielle que je voyais ou supposais autour de moi, à commencer par celle de mon frère ou de mes cousins.
Il n’est pas étonnant que parmi toutes les musiques que j’ai aimées, et que j’aime encore, il y a celles qui parlent le plus à une âme en peine, comme la saudade, le fado, le tango, les mélopées corses, etc. De ces mélodies tristes il suffit de quelques notes pour me chavirer, tandis que je peux rester complètement froid à l’audition d’une imposante symphonie. Alors, sitôt ces quelques notes entendues, le voile de Maya se déchire, le monde qu’on dit réel se réduit à néant.
Très tôt aussi, il me semble, j’ai été fasciné par la beauté de certains visages. La sidération qu’ils provoquaient me clouait sur place. À l’époque je ne pouvais éclaircir leur pouvoir, mais je comprends maintenant pourquoi je ferme encore les yeux pour m’en protéger, ou bien je m’empresse de les fuir. C’est qu’ils m’arrachent trop à ma médiocrité, et me font miroiter un niveau d’existence auquel je ne peux prétendre. C’est comme l’effleurement d’une grande aile, qui indique un Essentiel qu’elle interdit en même temps. Un Ange passe, pour le bonheur à la fois et le malheur des hommes...
*
Mais peu importent au fond toutes ces remarques, propres au professeur que je suis devenu et dont je ne pourrai sans doute jamais me défaire, pour le pire et le meilleur. Elles ne font pour moi qu’accréditer une intuition profonde qui a accompagné toute ma vie, de mon enfance à mon état présent : le monde qu’on voit d’habitude est déchu, imparfait et un autre monde est possible au pur avènement duquel j’ai voulu depuis toujours contribuer. Sans doute, comme dit Platon, en gardons-nous le souvenir (anamnèsis), et le connaître n’est-il que le reconnaître.
Je me revois à cet égard, seul battant la campagne, et méditant sur ce que pourrait être ma vie future. J’imaginais des scénarios, je voulais tout mettre en scène, j’avais toute licence dans mes rêves d’agencer les choses selon mon désir. Tout ne serait que nécessaire, et rien ne serait voué à la contingence. L’imperfection disparaîtrait avec la maîtrise que je mettrais à tout organiser.
Bien sûr, rentré à la maison et au milieu de mes parents, je constatais qu’ils étaient loin de correspondre à leur définition archétypale : le père que je voyais n’était pas le Père, pas plus que la mère, Mère. Je devais résilier la vision de la Famille idéelle, et me contenter de celle que j’avais.
J’aimais aussi beaucoup la lecture, et là je retrouvais le monde tel que je voulais le construire. Les histoires que je lisais, par la nécessité inhérente au monde des mots, échappaient à toute imperfection. Du début à la fin elles se déroulaient dans une atmosphère pure, exempte de scories et de doutes, destinale. Je ne voyais pas d’autre monde que celui dans lequel le héros évoluait, et qui contrastait avec le mien, voué à l’ambiguïté et à l’hésitation. Dans ce monde, tout était parfait, ni le sordide ni l’insignifiant n’avaient leur place.
Puis j’ai découvert le cinéma. Et là aussi j’ai adhéré à un univers magique, débarrassé de tout ce qui peut rendre mêlé, contingent, impur. Le héros et sa belle voulaient-ils s’unir ? Aussitôt après le baiser en gros plan, l’image dans un magnifique fondu montrait un beau feu dans la cheminée. J’aimais ce passage, cette transition abrégeante, qui gommait toute l’impureté potentielle du réel.
Bien plus tard j’ai compris que le cinéma, comme la littérature, est un système d’ellipses, dont le teasing rend la vie séduisante simplement par de systématiques et gigantesques suppressions. À ce prix sont de vrais moments parfaits.
Mais aussi au fil du temps j’ai expérimenté, à mon cœur défendant, que les moments parfaits n’existent pas dans la vie réelle. Dans la réalité le baiser de cinéma, et sa magie due au maquillage magnifiant les acteurs (make up) ainsi qu’au talent de l’éclairagiste, on ne les voit ni ne les vit. On s’avance, hésitant, vers le partenaire, on rougit sans pouvoir dérougir, on transpire, on a les mains moites, etc., et dans le monde réel il n’y a pas de fondu pour poétiser la séquence.
Quand je lisais un texte, j’admirais aussi ce monde où les mots désignaient chaque chose de façon pure et sans mélange. C’était un tissu étroitement serré (textus), qui ne s’effilochait pas, à la différence de la vie ordinaire, où tout se désagrège. Était-il question d’amour, ou de haine ? Les mots aussitôt prenaient une valeur définitionnelle, archétypale. Ils appartenaient au monde des Idées, non à celui où nous vivons. Dans ce dernier, ni amour ni haine n’existent : simplement des états flous, indistincts, ambigus. Il y a là comme disent les philosophes une chute ontologique, un enlisement dans la contingence, alors que le monde des mots, comme celui de toutes les œuvres de l’art, est celui de la nécessité. Il n’y a qu’eux pour évoluer dans une atmosphère de destin.
... Maintenant, quand je repense à mon enfance et mon adolescence, je les trouve admirablement décrites dans deux beaux vers baudelairiens :
Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, Traversé çà et là par de brillants soleils...
LES CHUTES D’ICARE
En somme, je voulais que la vie soit poétique, envolée sur les ailes du rêve, et que tous les jours soient dimanche. La littérature m’en montrait des exemples, de Don Quichotte à Madame Bovary, et depuis bien longtemps je n’ai pas compris ceux qui voyaient du ridicule dans ces désirs et ces souhaits. Bien plutôt ces personnages me touchaient comme des victimes tragiques de la prose de l’existence. Et même s’ils poursuivent un but absurde, en regard de leurs opposés enlisés dans la banalité matérialiste (le valet Sancho Pança, le pharmacien Ho-mais), je ne peux m’empêcher de penser, même aujourd’hui, que ce qui n’a pas de sens peut avoir un sens supérieur à ce qui en a.
En somme, je cherchais constamment à m’approcher le plus possible du soleil, comme fit, dit-on, Icare. Mais on sait le sort qui lui fut réservé : les attaches de cire de ses ailes fondirent, et il fut précipité dans la mer, où il se noya.