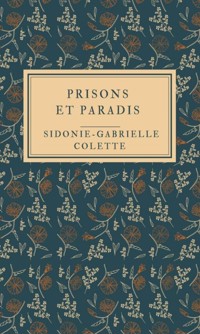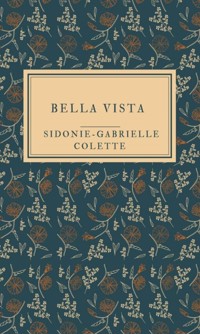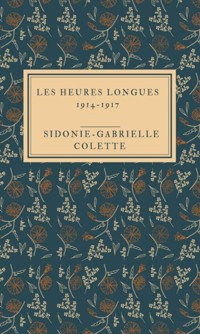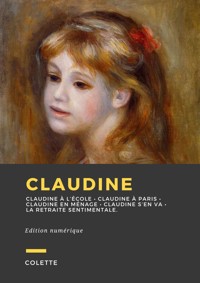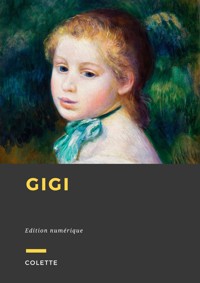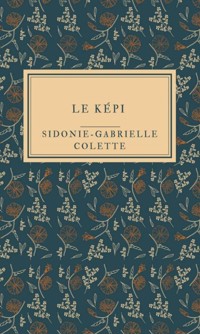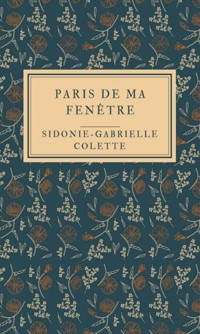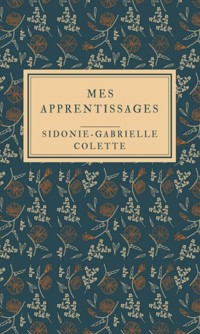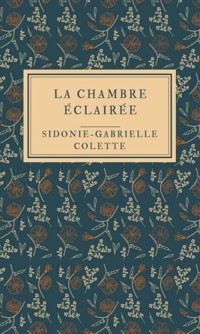
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Bel-Gazou, baignée de soleil, clame ironiquement le deuil des lumières artificielles. Juin finit, et la voici cuite comme un pêcheur breton. Mon nez, surpris par l'insolation, pèle ; le sien, bien raccordé aux plans des joues par des couleurs empruntées aux bronzes, aux céramiques, aux fruits vernissés, me fait envie. Ses pieds de romanichelle, nus, sonnent sur la dalle et sur les vieux parquets. Un chapeau de toile blanche voltige au bout de ses bras, coiffe le chien, ou se perche dans un arbre ; Bel-Gazou se contente de son calot de cheveux châtains, coupés droit au-dessus du sourcil et sur la nuque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Chambre éclairée
Colette
LA CHAMBRE ÉCLAIRÉE
FANTÔMES
CONTE DE BEL-GAZOU À SA POUPÉE
BEL-GAZOU ET LE CINÉMA
LES BÊTES ET L’ABSENCE
LE RETOUR DES BÊTES
PRÉSAGES
UNE LETTRE
LA NUIT PAISIBLE
UNE RÉPONSE
LES FOINS
CONFIDENCES SANS SIGNATURE
NOUVEAUX RICHES
« UN TIMBRE À 0 FR. 60, S. V. P. ! »
LE “ MAÎTRE ”
PLOMBERIE ET GAZ
LA “ TRANSFORMISTE ”
LA BARRIÈRE
ii. — le jeune premier
iii. — la femme-du-monde et la lettre
iv. — le luxe au cinéma
RÊVERIE DE NOUVEL AN
MALADE…
DIMANCHE
RÉPIT
J’AI CHAUD
CONVALESCENCE
LES “ PETITES FILLES ”
CINÉMA
LA CHAMBRE ÉCLAIRÉE
« Pas de pétrole, Pas de l’essence, Pas de la bougie, Quel-le malheu-re ! »
E
n sautant d’un pied sur l’autre, en chantant à pleine voix, ainsi Bel-Gazou va, propageant l’expression de la triste vérité. C’est un fait : le pétrole manque à Brive et à Varetz, l’essence a vécu, la bougie coûte quatre francs vingt-cinq la livre, et devient rare…
« Pas de pétrole, Pas de l’essence… »
Bel-Gazou, baignée de soleil, clame ironiquement le deuil des lumières artificielles. Juin finit, et la voici cuite comme un pêcheur breton. Mon nez, surpris par l’insolation, pèle ; le sien, bien raccordé aux plans des joues par des couleurs empruntées aux bronzes, aux céramiques, aux fruits vernissés, me fait envie. Ses pieds de romanichelle, nus, sonnent sur la dalle et sur les vieux parquets. Un chapeau de toile blanche voltige au bout de ses bras, coiffe le chien, ou se perche dans un arbre ; Bel-Gazou se contente de son calot de cheveux châtains, coupés droit au-dessus du sourcil et sur la nuque.
« Quel-le malheu-re ! Quel-le malheu-re !… »
Elle bondit, rayée de rouge et de blanc sous son maillot marin, et s’enfonce, bue soudain par l’ombre, dans la maison.
Midi. Un milieu de journée sans nuage, sans brise, un midi qui dilate les boiseries vermoulues, fane la rose enlacée aux balustres de la fenêtre, assagit les oiseaux. Le soleil perce de part en part la bibliothèque et cloue sur un panneau l’ombre cornue de l’araucaria. Les abeilles qui logent dans le mur travaillent avec une frénésie innocente, tissent un filet d’or volant dans la pièce, heurtent une vitre, butinent la digitale rose debout dans un long vase, cinglent ma joue, la joue de Bel-Gazou, et ne piquent point.
Jusqu’à sept heures, le jour d’été va triompher de l’épaisseur des murs, de la profondeur des embrasures obliques. En déclinant, le soleil fera, des plats pendus aux murs, autant de miroirs pour sa gloire. Mais, après sept heures, il quittera ce large pan de ciel libre tendu devant nous, et tombera derrière les peupliers d’abord, puis derrière une tour… Nous tirerons sur le balcon la table à lire, et le fauteuil, et aussi le pliant de Bel-Gazou, et je pourrai compter encore sur une grande heure de jour. Lorsqu’une fraîcheur à peine sensible, perçue seulement par les narines et les lèvres, ignorée des surfaces grossières de la peau, montera de la vallée, je lèverai la tête, étonnée que la page du livre, rose tout à l’heure à cause du couchant, bleuisse à présent comme une pervenche…
Ce ne sera pas encore la nuit, non, non, pas encore ! En approchant de la porte-fenêtre le guéridon nappé, nous dînerons, Bel-Gazou et moi — « Bel-Gazou, on ne dessine pas des allées dans les épinards avec sa fourchette ! Bel-Gazou, je t’ai vue mettre la cuiller à sel dans ta poche ! » — nous dînerons sans lampe ni bougie. Mais quand Bel-Gazou sautera à bas de sa chaise et me souhaitera son « bonsoir » qui commence si cérémonieux et finit si tendre, il faudra bien que je me rende à l’évidence : noire est la porte ouverte sur le salon, noir le vestibule ; et seule Bel-Gazou court partout comme un petit lynx, saisit les loquets, évite les angles sculptés, trouve la boîte d’allumettes dans sa chambre. J’entends sa voix appeler :
— Nursie-Dear !
Et le claquement de sa porte me séquestre dans les ténèbres. Oh ! je sais bien que, si je voulais, je me donnerais le luxe d’allumer les deux flambeaux à deux lumières, ou même cette mirifique lampe où l’on me verse, goutte à goutte, le peu de pétrole disponible… Les quatre bougies vont haleter contre l’ombre captive sous les poutrelles peintes, et ne seront pas les plus fortes. La flamme de la lampe basse et son halo rosé ne forent pas jusqu’aux murs un tel cube de nuit. Ce ne sont pas les fantômes que craignent mes yeux faibles, mais justement la certitude que personne n’erre ici, la certitude que le pas du maître de cette demeure ne fera plier, ni cette nuit ni la nuit de demain, les lames amincies des parquets anciens et sonores. Il n’y a pas de nuits courtes à qui attend.
Mais, avant d’accepter la nuit, je sais encore une chambre… Une chambre à la porte de laquelle je vais m’asseoir, la tête appuyée contre le bois. Derrière la porte, Bel-Gazou est déjà couchée. Nursie-Dear a emporté l’unique bougie, et vaque à des soins quotidiens, avant de revenir. Pendant une demi-heure, Bel-Gazou a le droit de ne pas s’endormir. Et seule, dans sa chambre noire, sans veilleuse, elle jette son chant impérieux de rossignol d’ombre. Bavardages anglais, apostrophes en patois limousin, refrains interrompus, improvisations sur un thème qu’elle chérit : « Viens, Noël, viens ! », variantes brodées sur des fables, et « Madelon, Madelon ! », et « Where are you going, oh ! my pretty maid ! »… La voix est éclatante, l’accent se fait caressant ou despotique ; entre les mots, entre les chansons, il y a les rires… Ô cascades d’argent sur des graviers blancs, ô fusées ascendantes que l’instant de retomber allume, gammes dont la note la plus aiguë est comme un brandon, paillettes, bluettes d’un cristal à mille feux, — il y a là, derrière la porte, dans cette chambre noire, mon dernier trésor de lumière : la voix, les rires de Bel-Gazou.
FANTÔMES
D
e la porte-fenêtre du salon, je vois tout ce que fait Bel-Gazou sur la terrasse.
Elle est en pleine possession de ce monde invisible que nous avons tous, jadis, mérité, créé, puis perdu. Enfant solitaire, elle arche partout accompagnée, comme je fus autrefois, de favoris, de serviteurs et d’adversaires qui sortent quand elle le veut de l’inconnaissable et qu’elle bannit, d’un signe, à la desséchante approche des grandes personnes.
Pour l’instant, elle m’a oubliée. Elle joue avec feu. Sûrement j’assiste à une heure de brillante inspiration, à une débauche imaginative. Elle occupe toute la longue terrasse chaude où ce n’est presque jamais l’hiver. Pas d’autres accessoires qu’une pelle, un râteau, deux fauteuils de rotin, deux tas de sable. Mais le plus beau du décor m’échappe, car Bel-Gazou va, vient, porte dans ses bras, en geignant sous leur poids, des fardeaux qui n’existent pas, ouvre avec peine une porte d’air dont la serrure dit « cric ; crac », gravit un escalier que je ne discerne point, se penche vers des espaces vertigineux et crie des avertissements trilingues, où le français et l’anglais s’agrémentent de patois limousin…
Elle redescend, rouvre la porte d’air (cric, crac), passe devant quelqu’un d’impondérable à qui elle adresse en même temps un raide salut militaire et un « oh ! pardon » très mondain. Puis elle se laisse tomber dans un des fauteuils de rotin, soupire « ouf ! » et s’essuie le front… Goûtera-t-elle un repos bien gagné ? Non, car un souci urgent la remet debout ; elle ouvre un intangible bureau dont le couvercle dit : « Couin ! » comme celui qui est dans la bibliothèque, et elle écrit. Elle écrit, sans papier, sans encre ni plume ; elle écrit, la bouche pincée, avec des pauses, des mordillements hésitants du petit doigt, des ratures, une mimique parfaite d’écrivain, elle qui ne sait pas, ou si peu, écrire… Ah ! qu’écrit-elle ? Et à qui ? Je n’y peux tenir. Je tombe lourdement au milieu de son jeu raffiné :
— À qui écris-tu, Bel-Gazou ?
Par chance, le charme résiste à ma voix. Bel-Gazou ne s’éveille pas à la réalité et répond du fond de son rêve ;
— J’écris à mon frère.
— À ton frère !!! Tu as un frère ?
Petit sourire dédaigneux. Petit haussement d’épaules. D’où est-ce que je sors, pour ignorer qu’elle a un frère ?
— Comment s’appelle-t-il ?
— Il s’appelle Louis Tragomar.
Je n’attendais qu’un prénom, mais le personnage complet, soigné, existe, muni de son état-civil, de son âge…
— Au fait, quel âge a-t-il, Bel-Gazou ?
— Huit ans.
— Où est-il ?
— Il est en Angleterre.
Pas la moindre hésitation. Bel-Gazou est maintenant assise dans le vieux fauteuil, elle balance ses pieds déchaussés (allons, bon, où a-t-elle encore laissé ses sabots ?) et ne me regarde pas. J’ai l’impression de profiter, déloyalement, d’une hypnose passagère…
— Il te ressemble, dis ?
— Il me ressemble en plus blond. Surtout les yeux.
— Comment est-il habillé ?
— Le dimanche, en blanc. Mais pour tous les jours, il a un costume marin, avec une petite cravate rouge. Il ne veut que des cravates rouges.
« Il ne veut que des cravates rouges… »
Très loin, très loin dans mon souvenir, je vois se lever une pâle petite forme, — je ne l’avais donc pas oubliée ? — la créature de mes premières divagations d’enfant, une petite compagne inventée ; je la nommais Marie, et je lui faisais place le soir dans mon lit de fer… (« Mais quelle manie prend cette enfant de coucher sur l’extrême bord de son lit ? », s’écriait ma mère.)
…Elle s’appelait Marie, et ne voulait porter que des tabliers à carreaux. J’ai envie de confier ce détail à Bel-Gazou. Il me semble que cette confidence me hisserait très haut dans son estime. Il me semble qu’elle comprendrait, enfin, que nous sommes parentes, que nous sommes pareilles. Mais j’y renonce vite, par crainte du regard qu’elle a lorsque je lui raconte des histoires de mon enfance, un regard réticent, où la courtoisie apprise tempère l’incrédulité.
— Que fait-il en Angleterre, ton frère, Bel-Gazou ?
— Il fait les minitions, té.
Il n’y a rien à redire à cela, mais je suis choquée. C’est trop d’actualité pour un fantôme enfantin…
— Et que penserais-tu d’avoir une sœur, Bel-Gazou ?
— Meé, j’en ai une, voyons !…
— Ah !… Oui ? Elle s’appelle ?
— La Bellaudière.
— Simplement… Elle est plus grande que toi ?
— Je pense. Y a si longtemps que je l’ai vue !…
— Pourquoi ? Elle habite loin ?
— Hé, elle est faite prisonnière, la pôvre, chez les Boches…
— Encore ! C’est stupide !
J’ai parlé haut, et malgré moi. Bel-Gazou s’éveille, me rend son regard d’où l’étonnement et la gaieté ont chassé le mystère, jette, avec une légèreté d’oiseau parleur, ce mot que tous lui apprennent ici :
— Té, c’est la guerre !
Et s’en va à cloche-pied vers la cuisine. Mais, restât-elle, je ne tenterais pas aujourd’hui d’ouvrir, contiguë au domaine point assez fantastique où Louis Tragomar tourne les obus, une autre patrie de fantômes, une zone de préservation où s’épanouirait, humble, oisive et tutélaire, Marie-au-tablier-à-carreaux…
CONTE DE BEL-GAZOU À SA POUPÉE
A
ssis-toi dans le grand fauteuil, à cause que c’est Noël, ma fille. Vos mains, mademoiselle ? où vous les avez-t’y fourrées, pour qu’elles soyent aussi sales ? Enfin, passons là-dessus. Pasque c’est Noël, permission de ne pas se laver les mains. Et, en plus, vous aurez une histoire, pasque c’est Noël. Vous aurez pas celle que maman m’a racontée. Mais maman est tellement contente de me raconter des histoires pas très intéressantes… Tenez-vous droite, mademoiselle. Vous en avez de la chance de ne pas avoir une grande personne pour mère ! Mais les enfants ne sont qu’ingraquitude… indraticule… non, indrati… j’ai oublié comment qu’on dit… Tenez, voilà pour vous apprendre à rire de vos parents ! Un mot de plus, vous m’entendez bien ? un mot !… et j’appelle mon mari !
« … Y avait une fois une jolie poule noire, jolie, jolie ! Elle s’appelait Kikine de son petit nom, et son nom de famille c’était Orpington- Pure-Race. On y donnait le pain qui reste d’après le déjeuner, et pis de l’avoine à l’heure du thé. Elle pondait tous les jours, tous les jours ! Mais, quand même, Kikine elle était pas contente pasque ses œufs on les lui prenait tous pour les porter au marché ! Alors la pauv’ Kikine elle avait bien du chagrin. Elle disait :
« — Mon Dieu, que c’est-y malheureux, que je fais tant d’enfants que j’arrive pas à en élever un !
« Alors qu’est-ce qu’elle fait, ma Kikine ? Le jour de Noël, elle attend que le petit Jésus vient, et elle lui dit :
« — Bonjour, mon cher seigneur Petit Jésus.
« — Bonjour, Kikine, qu’il lui dit. Qu’est-ce que y a donc qui ne va pas, Kikine ?
« — Y a comme ça, qu’elle lui dit, que je fais des œufs tout le temps, et que j’arrive pas à en élever un, pasqu’on me les prend !
« — Et qui donc qui vous les prend, Kikine ?
« — Mais c’est cette Pauline de la basse-cour, toujours cette Pauline !
« — Et pourquoi qu’elle vous les prend, Kikine ?
« — Pour les vende, donc. Pasque, vous savez bien, Petit Jésus, que les œufs cet hiver i’z’ont renchéri à un point qu’on les vend tois francs douze sous la douzaine au marché de Brive, pasque c’est la guerre ! Que c’en est t’honteux !
« Alors le Petit Jésus il se gratte la tête, et il dit :
« — Bouge pas, ma Kikine, moi je vas arranger tout ça. Quand que tu auras pondu une douzaine d’œufs, tu les cacheras dans le foin, et pis moi, à ce moment-là, je mettrai tois francs douze sous dans ton nid, à la place. Quand que Pauline é’ viendra, eh ben, elle aura ses tois francs douze sous. C’est tout ce qu’é veut, cette Pauline, pas ? Et comme ça tu pourras élever tes œufs.
« Kikine elle dit : « Merci » bien poliment, et elle s’en va ponde ses œufs, jusqu’à tant qu’elle en aye douze. Un, deux, tois, quate, six, sept, neuf, huit, onze, douze !… Et pis é’ les met dans le foin, cachés. Et pis, le lannemain, voilà cette Pauline qui vient chercher les œufs, et, quoi qu’é trouve ? Tois francs douze sous ! E’ les prend, et pis é regarde ma Kikine qu’était là bien gentille, qui regardait si cette Pauline elle était contente. Cette Pauline, elle dit comme ça : « Ben, c’est sttrordinaire ! »
« — Mais non, Pauline, c’est pas sttrordinaire. J’ai pondu tois francs douze sous, alors t’auras pas la peine d’aller au marché !
« — Tois francs douze sous ! qu’elle fait comme ça, Pauline. Depuis la semaine dernière, c’est pus tois francs douze sous, c’est quate francs quate sous la douzaine, ça a raugmenté pasque c’est la guerre ! Et la semaine d’après ça raugmentera encore !
« Alors, la voilà qui se met à chercher dans le foin tout partout, et en criant en colère, — vous savez comment qu’elle est, cette Pauline, — et qu’elle trouve les œufs de ma pauvre Kikine et qu’elle les emporte !… Pensez !…
« Alors, ma pauvre Kikine s’en va toute désolée, et en s’en allant elle rencontre le Petit Jésus qui se promenait du côté de la remise :
« — Eh là ! mon Dieu, ma pauvre Kikine, quoi donc que vous avez ? qu’i dit.
« — Eh là, mon Dieu ! qu’elle répond, cette Pauline m’a encore emporté mes œufs, pasqu’il y avait que tois francs douze sous dans le nid !
« — Eh ben ! qu’i fait, le Petit Jésus, c’était-y pas bien le compte ?
« — Mon Dieu, non ! qu’elle dit, ma Kikine, v’là les œufs qu’ont raugmenté et qui sont à quate francs quate sous au marché de Brive, pasque c’est la guerre, et qui raugmenteront encore la semaine prochaine, pasque c’est la guerre !
« — Ah ! c’est comme ça ! qu’i fait, le Petit Jésus. Ben, on va voir ! À partir d’à présent, c’est pus la guerre ! Allez, ça y est ! une, deux, trois : c’est pus la guerre !
« Et qui c’est qu’a été bien attrapé ? C’est cette Pauline ! Elle en faisait une figure, pasque c’était pus la guerre ! Ah ! là là ! Et Kikine était bien contente, personne voulait pus de ses œufs et elle a élevé autant de petits enfants que ça lui a plu.
« … Seulement, vous savez comment qu’elle est, cette Pauline : elle s’est revengée sur la vache Sicandoise, elle lui a pris son lait pour le vende au marché pour pas que la vache élève son petit veau. La prochaine fois que ça sera Noël, ça sera la vache Sicandoise qu’ira trouver le petit Jésus ».
BEL-GAZOU ET LE CINÉMA
Q
u’est-ce qu’on va voir, après les soldats, dis ?
— La Fille de la Forêt.
— C’est un fil américain ?
— Je crois… Ça t’intéresse, Bel-Gazou ?
— Oui. J’aime les fils américains.
— Pourquoi ?
— Pasque quand le monsieur i s’asseoit dans le panier d’œufs, le monde rit. Pourquoi tu n’as pas ri, toi, quand je m’ai assise comme lui dans