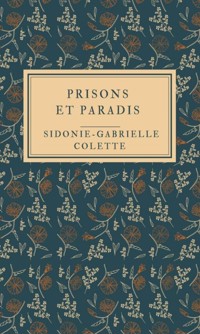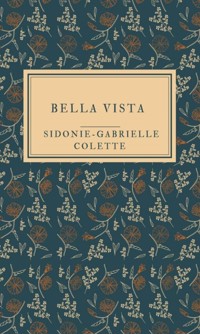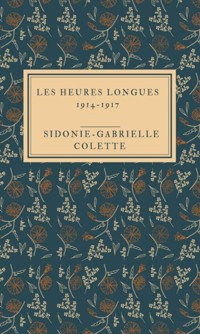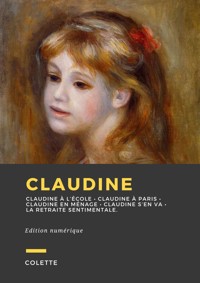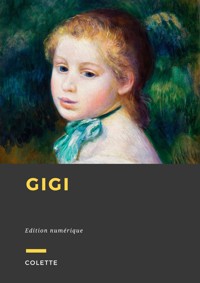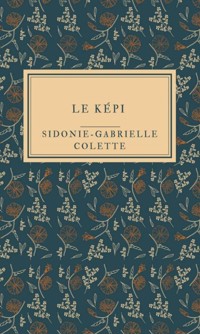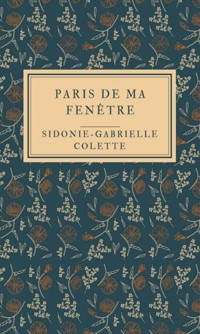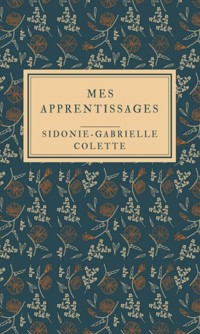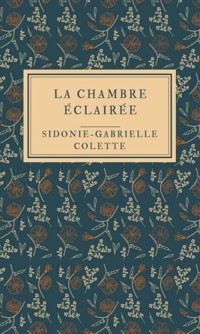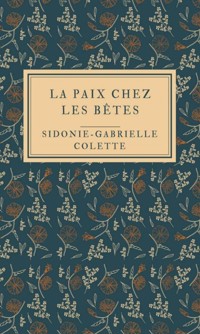Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Qu'est-ce que tu as ?… Ne prends pas la peine, en me répondant : « Rien », de remonter courageusement tous les traits de ton visage ; l'instant d'après, les coins de ta bouche retombent, tes sourcils pèsent sur tes yeux et ton menton me fait pitié. Je le sais, moi, ce que tu as. Tu as que c'est dimanche et qu'il pleut. Si tu étais une femme, tu fondrais en larmes, parce qu'il pleut et que c'est dimanche, mais tu es un homme, et tu n'oses pas. Tu tends l'oreille vers le bruit de la pluie fine — un bruit fourmillant de sable qui boit — tu regardes malgré toi la rue miroitante et les funèbres magasins fermés, et tu raidis tes pauvres nerfs d'homme, tu fredonnes un petit air, tu allumes une cigarette que tu oublies et qui refroidit entre tes doigts pendants…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLETTE
le
voyage égoïste
suivi de
quatre saisons
DIMANCHE
J’AI CHAUD
RÉPIT
MALADE
QUATRE-SAISONS (Inédits 1925)
CADEAUX DE NOËL
VISITES
PRINTEMPS DE DEMAIN
PRINTEMPS DE DEMAIN
MANNEQUINS
ÉLÉGANCE, ÉCONOMIE
VOYAGES
JARDINS PRISONNIERS
VACANCES
VENDANGEUSES
POIL ET PLUME
LES JOYAUX MENACÉS
TROP COURT
EN DESSOUS
FARDS
CHAPEAUX
SEINS
PRESSE-PAPIER
NOUVEAUTÉS
ARRIÈRE-SAISON
FOURRURES
AMATEURS
POCHES VIDES
SOIERIES
LOGIQUE
DIMANCHE
Qu’est-ce que tu as ?… Ne prends pas la peine, en me répondant : « Rien », de remonter courageusement tous les traits de ton visage ; l’instant d’après, les coins de ta bouche retombent, tes sourcils pèsent sur tes yeux et ton menton me fait pitié. Je le sais, moi, ce que tu as.
Tu as que c’est dimanche et qu’il pleut. Si tu étais une femme, tu fondrais en larmes, parce qu’il pleut et que c’est dimanche, mais tu es un homme, et tu n’oses pas. Tu tends l’oreille vers le bruit de la pluie fine — un bruit fourmillant de sable qui boit — tu regardes malgré toi la rue miroitante et les funèbres magasins fermés, et tu raidis tes pauvres nerfs d’homme, tu fredonnes un petit air, tu allumes une cigarette que tu oublies et qui refroidit entre tes doigts pendants…
J’ai bien envie d’attendre que tu n’en, puisses plus, et que tu quêtes mon secours… Je suis méchante, dis ? Non, mais c’est que j’aime tant ton geste enfantin de jeter les bras vers moi et de laisser rouler ta tête sur mon épaule, comme si tu me la donnais une fois pour toutes. Mais aujourd’hui il pleut si noir, et c’est tellement dimanche que je fais, avant que tu l’aies demandé, les trois signes magiques : clore les rideaux — allumer la lampe — disposer, sur le divan, parmi les coussins que tu préfères, mon épaule creusée pour ta joue, et mon bras prêt à se refermer sur ta nuque…
Est-ce bien ainsi ? Pas encore ? Ne dis rien, attends que notre chaleur de bêtes fraternelles ait gagné les coussins. Lentement, lentement, la soie tiédit sous ma joue, sous mes reins, et ta tête s’abandonne peu à peu à mon épaule, et tout ton corps, à mon côté, se fait lourd et souple et répandu comme si tu fondais…
Ne parle pas : j’entends, mieux que tes paroles, tes grands soupirs tremblants… Tu retiens ton souffle, tu crains d’achever le soupir en sanglot. Ah ! si tu osais…
Va, j’ai jeté sur la lampe mon écharpe bleutée ; tu vois à peine, à travers les tiges d’un haut bouquet de chrysanthèmes, le feu dansant ; reste là, dans l’ombre, oublie que je suis ton amie, oublie ton âge et même que je suis une femme, savoure l’humiliation et la douceur de redevenir, parce que c’est un désolant dimanche de novembre, parce qu’il fait froid et qu’il pleut noir, un enfant nerveux qui retourne invinciblement, innocemment, à la féminine chaleur, qui ne souhaite rien, hormis l’abri vivant et l’immobile caresse de deux bras refermés.
Reste là. Tu as retrouvé le berceau ; il te manque la chanson ou le conte merveilleux… Je ne sais pas de contes. Et je n’inventerai même pas pour toi l’histoire heureuse d’une princesse fée qui aime un prince magicien. Car il n’y a pas de place pour l’amour dans ton cœur d’aujourd’hui, dans ton cœur d’orphelin.
Je ne sais pas de contes… Te suffira-t-il, mon chuchotement contre ton oreille ? Donne ta main, serre bien la mienne : elle te mène, sans bouger, vers les dimanches humbles que j’ai tant aimés. Tu nous vois, la main dans la main et toujours plus petits, sur la route couleur de fer bleu, pailletée de silex métallique — c’est une route de mon pays…
Je te conduis doucement, parce que tu n’es qu’un joli enfant parisien, et je regarde, en marchant, ta main blanche dans ma petite patte hâlée, sèche de froid et rougie au bout des doigts. Elle a l’air, ma petite patte paysanne, d’une des feuilles qui demeurent aux haies, enluminées par l’automne…
La route couleur de fer tourne ici, si court qu’on s’arrête surpris, devant un village imprévu… Mon Dieu, je t’emmène religieusement vers ma maison d’autrefois, petit enfant policé et qui ne t’étonnes guère, et peut-être que tu dis, pendant que je tremble sur le seuil retrouvé : « Ce n’est qu’une vieille maison… »
Entre. Je vais t’expliquer. D’abord, tu comprends que c’est dimanche à cause du parfum de chocolat qui dilate les narines, qui sucre la gorge délicieusement… Quand on s’éveille, voyons, et qu’on respire la chaude odeur du chocolat bouillant, on sait que c’est dimanche. On sait qu’il y a, à dix heures, des tasses roses, fêlées, sur la table, et des galettes feuilletées — ici, tiens, dans la salle à manger — et qu’on a la permission de supprimer le grand déjeuner de midi… Pourquoi ? Je ne saurais te dire… C’est une mode de mon enfance.
Ne lève pas des yeux craintifs vers le plafond noir. Tout est tutélaire dans cette maison ancienne. Elle contient tant de merveilles ! Ce pot bleu chinois, par exemple, et la profonde embrasure de cette fenêtre où le rideau, en retombant, me cache toute…
Tu ne dis rien ? Oh ! petit garçon, je te montre un vase enchanté, dont la panse gronde de rêves captifs, la grotte mystérieuse où je m’enferme avec mes fantômes favoris, et tu restes froid, déçu, et ta main ne frémit pas dans la mienne ? Je n’ose plus, maintenant, te mener dans ma chambre à dormir, où la glace est tendue d’une dentelle grise, plus fine qu’un voile de cheveux, qu’a tissée une grosse araignée des jardins, frileuse.
Elle veille au milieu de sa toile, et je ne veux pas que tu l’inquiètes. Penche-toi sur le miroir ; nos deux visages d’enfants, le tien pâle, le mien vermeil, rient derrière le double tulle… Ne t’arrête pas au banal petit lit blanc, mais plutôt au judas de bois qui perce la cloison : c’est par là que pénètre, à l’aube, la chatte vagabonde ; elle choit sur mon lit, froide, blanche et légère comme une brassée de neige, et s’endort sur mes pieds…
Tu ne ris pas, petit compagnon blasé. Mais j’ai gardé, pour te conquérir, le jardin. Dès que j’ouvre la porte usée, dès que les deux marches branlantes ont remué sous nos pieds, ne sens-tu pas cette odeur de terre de feuilles de noyer, de chrysanthèmes et de fumée ? Tu flaires comme un chien novice, tu frissonnes… L’odeur amère d’un jardin de novembre, le saisissant silence dominical des bois d’où se sont retirés le bûcheron et la charrette, la route forestière détrempée où roule mollement une vague de brouillard, tout cela est à nous jusqu’au soir, si tu veux, puisque c’est dimanche.
Mais peut-être préféreras-tu mon dernier royaume et le plus hanté : l’antique fenil, voûté comme une église. Respire avec moi la poussière flottante du vieux foin, encore embaumée, excitante comme un tabac fin. Nos éternuements aigus vont émouvoir un peuple argenté de rats, de chats minces à demi sauvages ; des chauves-souris vont voler, un instant, dans le rayon de jour bleu qui fend, du plafond au sol, l’ombre veloutée… C’est à présent qu’il faut serrer ma main et réfugier, sous mes longs cheveux, ta tête lisse et noire de chaton bien léché…
Tu m’entends encore ? Non, tu dors. Je veux bien garder ta lourde tête sur mon bras et t’écouter dormir. Mais je suis un peu jalouse. Parce qu’il me semble, à te voir insensible et les yeux clos, que tu es resté là-bas, dans un très vieux jardin de mon pays, et que ta main serre la rude petite main d’une enfant qui me ressemble…
J’AI CHAUD
Ne me touche pas ! j’ai chaud… Écarte-toi de moi ! Mais ne reste pas ainsi debout sur le seuil : tu arrêtes, tu me voles le faible souffle qui bat de la fenêtre à la porte, comme un lourd oiseau prisonnier…
J’ai chaud… Je ne dors pas. Je regarde l’air noir de ma chambre close, où chemine un râteau d’or, aux dents égales, qui peigne lentement, lentement, l’herbe rase du tapis. Quand l’ombre rayée de la persienne atteindra le lit, je me lèverai — peut-être… Jusqu’à cette heure-là, j’ai chaud.
J’ai chaud. La chaleur m’occupe comme une maladie et comme un jeu. Elle suffit à remplir toutes les heures du jour et de la nuit. Je ne parle que d’elle ; je me plains d’elle avec passion et douceur, comme d’une caresse impitoyable. C’est elle — regarde ! — qui m’a fait cette marque vive au menton, et cette joue giflée, et mes mains ne peuvent quitter les gantelets, couleur de pain roux, qu’elle peignit sur ma peau. Et cette poignée de grains d’or, tout brûlants, qui m’a sablé le visage, c’est elle, c’est encore elle…
Non, ne descends pas au jardin ; tu me fatigues. Le gravier va craquer sous tes pas, et je croirai que tu écrases un lit de petites braises. Laisse ! que j’entende le jet d’eau qui gicle maigre et va tarir et le halètement de la chienne couchée sur la pierre chaude. Ne bouge pas ! Depuis ce matin je guette, sous les feuilles évanouies de l’aristoloche, qui pendent comme des peaux, l’éveil du premier souffle de vent. Ah ! j’ai chaud ! Ah ! entendre, autour de notre maison, le bruit soyeux, d’éventail ouvert et refermé, d’un pigeon qui vole !
Je n’aime déjà plus le drap fin et froissé, si frais tout à l’heure à mes talons nus, Mais, au fond de ma chambre, il y a un miroir, tout bleu d’ombre, tout troublé de reflets…
Quelle eau tentante et froide !
Imagine, à t’y mirer, l’eau des étangs de mon pays ! Ils dorment ainsi sous l’été, tièdes ici, glacés là par la fusée d’une source profonde. Ils sont opaques et bleuâtres, perfidement peuplés, et la couleuvre d’eau s’y enlace à la tige longue des nénuphars et des sagittaires… Ils sentent le jonc, la vase musquée, le chanvre vert… Rends-moi leur fraîcheur, leur brouillard où se berce la fièvre, rends-moi leur frisson, — j’ai si chaud…
Ou bien donne-moi — mais tu ne voudras pas ! — un tout petit morceau de glace, dans le creux de l’oreille, et un autre là, sur mon bras, à la saignée… Tu ne veux pas ? tu me laisses désirer en vain, tu me fatigues…
Regarde, à présent, si la couleur du jour commence à changer, si les raies éblouissantes des persiennes deviennent bleues en bas, orangées en haut ? Penche-toi sur le jardin, raconte-moi la chaleur comme on raconte une catastrophe !
Le marronnier va mourir, dis ? Il tend vers le ciel des feuilles frites, couleur d’écaille jaspée… Et rien ne pourra sauver les roses, saisies par la flamme avant d’éclore… Des roses… des roses mouillées, gonflées de pluie nocturne, froides à embrasser…
Ah ! quitte la fenêtre ! reviens ! trompe ma langueur en me parlant de fleurs penchées sous la pluie ! Trompe-moi, dis que l’orage, là-bas, enfle un dos violet, dis-moi que le vent, rampant, se dresse soudain contre la maison, en rebroussant la vigne et la glycine, dis que les premières gouttes plombées vont entrer, obliques, par la fenêtre ouverte !
Je les boirai sur mes mains, j’y goûterai la poussière des routes lointaines, la fumée du nuage bas qui crève sur la ville…
Souviens-toi du dernier orage, de l’eau amère qui chargeait les beaux soucis, de ta pluie sucrée que pleurait le chèvrefeuille, et de la chevelure du fenouil, poudrée d’argent, où nous sucions en mille gouttelettes la saveur d’une absinthe fine !…
Encore, encore ! j’ai si chaud ! Rappelle-moi le mercure vivace qui roule au creux des capucines quand l’averse s’éloigne, et sur la menthe pelucheuse… Évoque la rosée, la brise haute qui couche les cimes des arbres et ne touche pas mes cheveux… Évoque la mare cernée de moustiques et la ronde des rainettes… Oh ! je voudrais, sur chaque main, le ventre froid d’une petite grenouille !… J’ai chaud, si tu savais… Parle encore…
Parle encore, guéris ma fièvre ! Crée pour moi l’automne : donne-moi, d’avance, le raisin froid qu’on cueille à l’aube, et les dernières fraises d’octobre, mûres d’un seul côté… Oui, il me faudrait, pour l’écraser dans mes mains sèches, une grappe de raisins oubliée sur la treille, un peu ridés de gelée… Si tu amenais, auprès de moi, deux beaux chiens au nez très frais ? Tu vois, je suis toute malade, je divague.
Ne me quitte pas ! assieds-toi, et lis-moi le conte qui commence par : « La princesse avait vu le jour dans un pays où la neige ne découvre jamais la terre, et son palais était fait de glace et de givre… » De givre, tu entends ? de givre !… Quand je répète ce mot scintillant, il me semble que je mords dans une pelote de neige crissante, une belle pomme d’hiver façonnée par mes mains… Ah ! j’ai chaud !…
J’ai chaud, mais… quelque chose a remué dans l’air… Est-ce seulement cette guêpe blonde ? Annonce-t-elle la fin de ce long jour ? Je m’abandonne à toi. Appelle sur moi le nuage, le soir, le sommeil. Tes doigts sous ma nuque y démêlent un moite désordre de cheveux…
Penche-toi, évente, de ton souffle, mes narines, et presse, contre mes dents, le sang acide de la groseille que tu mords… Je ne murmure presque plus, et tu ne saurais dire si c’est d’aise… Ne t’en va pas si je dors : je feindrai d’ignorer que tu baises mes poignets et mes bras, rafraîchis, emperlés comme le col des alcarazas bruns…
RÉPIT
« On t’a dit qu’en ton absence je vivais seule, farouche et fidèle, avec un air d’impatience et d’attente ?… Ne le crois pas. Je ne suis ni seule, ni fidèle. Et ce n’est pas toi que j’attends.
« Ne t’irrite pas ! Lis cette lettre jusqu’au bout. J’aime te braver quand tu es loin, quand tu ne peux rien contre moi, que serrer tes poings et briser un vase… J’aime te braver sans péril, et te voir à travers la distance, tout petit, courroucé et inoffensif : tu es le dogue, et moi le chat en haut de l’arbre…
« Je ne t’attends pas. On t’a dit que j’ouvrais hâtivement ma fenêtre, dès le lever du soleil, comme au jour où tu marchais dans l’allée, chassant devant toi, jusqu’à mon balcon, ton ombre longue ? On t’a menti. Si j’ai quitté mon lit, pâle, un peu égarée de sommeil, ce n’est pas que l’écho de ton pas m’appelât… Qu’elle est belle, l’allée blonde et vide ! Nulle branche morte, nul fétu n’arrête mon regard qui s’y élance, et la barre bleue de ton ombre ne chemine plus sur le sable pur, qu’ont seules gaufré les petites serres des oiseaux.
« J’attendais seulement… cette heure-là, la première du jour, la mienne, celle que je ne partage avec personne. Je t’y laissais mordre juste le temps de t’accueillir, de te reprendre la fraîcheur, la rosée de ta course à travers les champs, et de refermer sur nous mes persiennes… Maintenant, l’aube est à moi seule, et seule je la savoure rose, emperlée, comme un fruit intact qu’ont dédaigné les hommes. C’est pour elle que je quitte mon sommeil, et mon rêve qui parfois t’appartient… Tu vois ? Éveillée à peine, je te quitte, et pour te trahir…
« T’a-t-on redit aussi que je descendais pieds nus, vers midi, jusqu’à la mer ? On m’a épiée, n’est-ce pas ? On t’a vanté ma solitude hostile, et la muette promenade sans but de mes pas sur la plage ; on a plaint mon visage penché, puis soudain guetteur, tendu vers… vers quoi ? Vers qui ?… Oh ! si tu avais pu entendre ! Je viens de rire, de rire comme jamais tu ne m’entends rire ! C’est qu’il n’y a plus, sur la plage lissée par la vague, la moindre trace de tes jeux, de tes bonds, de ta jeune violence, il n’y a plus tes cris dans le vent, et ton élan de nageur ne brise plus la volute harmonieuse de la lame qui se dresse, s’incline, s’enroule comme une verte feuille transparente, et fond à mes pieds…
« T’attendre, te chercher ? Pas ici, où rien ne se souvient de toi. La mer ne berce point de barque ; la mouette qui pêchait, agrippée au flot et battant des ailes, s’est envolée. Le rocher rougeâtre, en forme de lion, se prolonge, violet, sous l’eau qui l’assaille. Se peut-il que tu aies dompté, sous ton talon nu, ce lion taciturne ? Ce sable, qui craque en séchant comme une soie échauffée, tu l’as foulé, fouillé ; il a bu sur toi ton parfum et le sel de la mer ? Je me répète tout cela, en marchant à midi sur la plage et je penche la tête, incrédule. Mais, parfois, je me retourne aussi, et je guette — comme les enfants qui s’effraient d’une histoire qu’ils inventent : — non, non, tu n’es pas là, — j’ai eu peur. Je croyais tout à coup te trouver là, avec ton air de vouloir me voler mes pensées… J’ai eu peur.
« Il n’y a rien — rien que la plage lisse qui grésille comme sous une flamme invisible, rien que les équilles de nacre qui percent le sable, sautent, repiquent du nez, ressortent, et cousent la grève de mille lacets étincelants et rompus… Il n’est que midi. Je n’ai pas fini de t’offenser, absent ! Je cours vers la salle sombre,