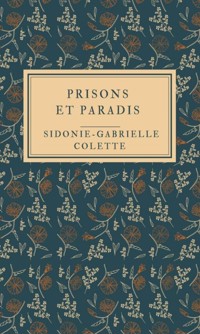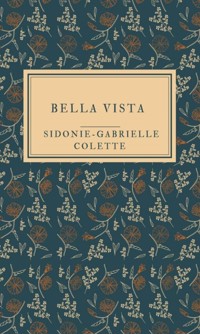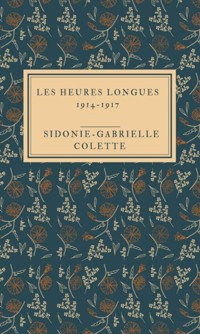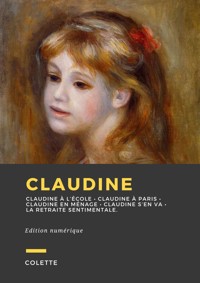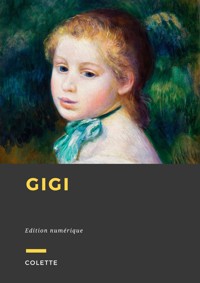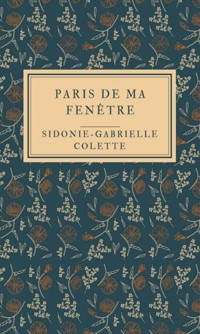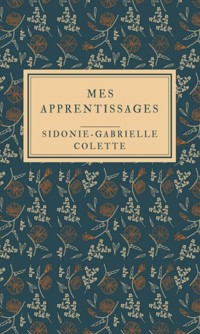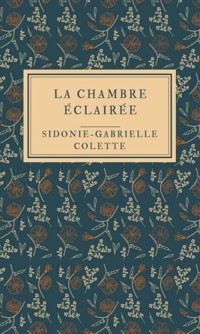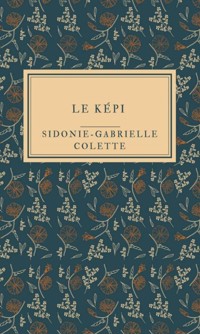
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Çà et là j'ai parlé, selon mes souvenirs, de Paul Masson, dit Lemice-Térieux. Ex-président du Tribunal de Pondichéry, mystificateur de grand mérite, — et de grand péril, — il était attaché au Catalogue de la Bibliothèque Nationale. À cause de lui, à cause de la Bibliothèque, je connus la femme de qui je vais conter l'unique aventure amoureuse. L'homme mûr, Paul Masson, et la très jeune femme que j'étais, nouèrent quelque huit années durant une amitié assez solide. Sans gaîté Paul Masson se dévouait à m'égayer. Je pense qu'il ressentait, à me voir très seule et casanière, une pitié qu'il dissimulait, et qu'en outre il était fier de déchaîner facilement mon rire
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Képi
Colette
LE KÉPI
LE TENDRON
LA CIRE VERTE
ARMANDE
LE KÉPI
Çà et là j’ai parlé, selon mes souvenirs, de Paul Masson, dit Lemice-Térieux. Ex-président du Tribunal de Pondichéry, mystificateur de grand mérite, — et de grand péril, — il était attaché au Catalogue de la Bibliothèque Nationale. À cause de lui, à cause de la Bibliothèque, je connus la femme de qui je vais conter l’unique aventure amoureuse.
L’homme mûr, Paul Masson, et la très jeune femme que j’étais, nouèrent quelque huit années durant une amitié assez solide. Sans gaîté Paul Masson se dévouait à m’égayer. Je pense qu’il ressentait, à me voir très seule et casanière, une pitié qu’il dissimulait, et qu’en outre il était fier de déchaîner facilement mon rire. Nous dînions souvent tous deux dans le petit troisième de la rue Jacob, moi en robe de chambre à prétentions botticelliennes, lui toujours vêtu de noir, poussiéreux et correct. La barbiche en pointe, un peu rousse, la peau fanée et l’œil mi-clos, son absence de signes particuliers attirait l’attention comme un camouflage. Familier, il évitait de me tutoyer, et donnait, chaque fois qu’il sortait de son impersonnalité surveillée, les marques d’une très bonne éducation. Jamais il ne s’assit pour écrire, pendant que nous étions seuls, au bureau de celui que je nomme « Monsieur Willy », et je ne me souviens pas qu’il m’ait, en l’espace de plusieurs années, posé une question indiscrète.
Par ailleurs, sa causticité m’enchantait. J’admirais qu’il fût à toute heure prêt à être agressif en termes modérés et sans trace de flamme. Et il hissait jusqu’à mon troisième étage, outre les anecdotes de Paris, une série de mensonges ingénieux, que j’aimais comme des contes fantastiques. S’il rencontrait Marcel Schwob, quelle chance pour moi ! Les deux hommes feignaient de se haïr, jouaient à s’insulter sur le ton de la courtoisie, à mi-voix. Les s sifflaient entre les dents serrées de Schwob, Masson toussotait, distillait un venin de vieille dame. Puis ils s’apaisaient, causaient longuement, et je m’échauffais entre ces deux esprits fins et faux.
Les heures de loisir, consenties à Paul Masson par la Bibliothèque Nationale, m’assuraient sa visite presque quotidienne, tandis que la phosphorescente conversation de Schwob était une fête plus rare. Seule avec la chatte et Masson, je pouvais me taire, et cet homme tôt vieilli se reposer en silence. Il notait fréquemment Dieu sait quoi, sur les pages d’un calepin à couverture de moleskine noire. La salamandre versait une torpeur carbonique sur notre attente, nous écoutions somnolents le coup de canon de la porte cochère, je m’éveillais pour manger des sucreries ou des noix salées, et je réclamais de mon hôte qui fut peut-être, en s’en cachant, le plus dévoué de tous mes amis, qu’il me fît rire. J’avais vingt-deux ans, une mine de chatte anémique, un mètre cinquante-huit de cheveux que chez moi je défaisais en nappe ondée jusqu’à mes pieds.
— Paul, raconte-moi des mensonges.
— Lesquels ?
— N’importe lesquels. Comment va ta famille ?
— Madame, vous oubliez que je suis célibataire.
— Mais tu m’avais dit…
— Ah ! oui, je me rappelle. Ma fille adultérine va bien. Je l’ai menée, pour son dimanche, déjeuner en banlieue, dans un jardin. La pluie avait collé sur la table en fer de grandes feuilles jaunes de tilleul. Elle s’est bien amusée à les décoller et nous avons mangé des frites tièdes, les pieds sur le gravier trempé…
— Non, non, pas ça, c’est trop triste. J’aime mieux la dame de la Bibliothèque.
— Quelle dame ? Nous n’en chômons pas.
— Celle qui travaille à un roman hindou… que tu dis.
— Elle peine toujours sur son feuilleton. Aujourd’hui j’ai été grand et généreux, je lui ai donné quelques baobabs, quelques lataniers pris sur le vif, un fakir, une menue monnaie de formules conjuratoires, de maharattes, de singes hurleurs, de sikhs, de saris et de lakhs de roupies…
En frottant l’une contre l’autre ses mains sèches, il ajouta :
— Elle touche un sou la ligne.
— Un sou ! me récriai-je. Pourquoi un sou ?
— Parce qu’elle travaille pour un type qui touche deux sous la ligne et qui travaille pour un type qui touche quatre sous la ligne, qui travaille pour un type qui touche dix sous la ligne.
— Mais ce n’est donc pas un mensonge que tu me racontes ?
— Il ne peut pas toujours y avoir des mensonges, soupira Masson.
— Comment s’appelle-t-elle ?
— Son prénom est Marco, comme vous auriez pu le deviner, car les femmes d’un certain âge n’ont guère le choix, quand elles appartiennent au monde artiste, qu’entre quelques prénoms tels que Marco, Léo, Ludo, Aldo… Tout ça nous vient de cette bonne Mme Sand…
— D’un certain âge ? Elle est donc vieille ?
Paul Masson laissa tomber sur mon visage, qui redevenait enfantin lorsqu’il était perdu dans mes longs cheveux, un regard indéfinissable :
— Oui, dit-il.
Puis il se reprit cérémonieusement :
— Pardon, je me suis trompé. Non, voulais-je dire. Non, elle n’est pas vieille.
Je triomphai.
― Tu vois ! Tu vois que c’est un mensonge puisque tu ne lui as pas même choisi un âge !
― Si vous y tenez… dit Masson.
― Ou bien tu déguises, sous le nom de Marco, une dame qui est ta maîtresse.
— Je n’ai pas besoin de Mme Marco. J’ai une maîtresse qui est, Dieu merci, ma femme de ménage.
Il consulta sa montre, se leva :
— Vous m’excuserez auprès de votre mari, je dois rentrer, je n’aurais plus d’omnibus. En ce qui touche la très réelle Mme Marco, je vous ferai faire sa connaissance quand vous en exprimerez le désir.
Il récita, très vite :
— Elle est la femme du peintre V…, un camarade de collège à moi qui l’a rendue abominablement malheureuse ; elle a fui le domicile conjugal où ses perfections l’avaient rendue impossible ; elle est encore belle, spirituelle et sans le sou ; elle habite une pension de famille rue Demours, où elle paie quatre-vingt-cinq francs par mois pour la chambre et le petit déjeuner ; elle fait des travaux d’écriture, du feuilleton anonyme, des bandes de journaux et des adresses sur enveloppes, donne des leçons d’anglais à trois francs l’heure et n’a jamais eu d’amant. Vous voyez que ce mensonge-là est aussi déplaisant que la vérité.
Je lui remis la lampe Pigeon allumée, et le conduisis jusqu’à l’escalier. Pendant qu’il descendait, la petite flamme colorait en rouge, par en-dessous, sa barbe en pointe un peu relevée du bout.
Quand j’en eus assez de me faire raconter « Marco », je demandai à Paul Masson de me présenter à elle, et non pas de l’amener rue Jacob. Il m’avait confié qu’elle avait le double environ de mon âge, et je me disais qu’il convient à une jeune femme de se déplacer pour rencontrer une dame moins jeune. Naturellement Paul Masson m’accompagna rue Demours.
La pension de famille qu’habitait Mme Marco V… a été démolie. Vers 1897, cette villa n’avait gardé de son jardin d’autrefois qu’une haie de fusains, une allée de gravier, un perron haut de cinq marches. Dès le vestibule je m’attristai. Car certaines odeurs, je ne dirai pas culinaires, mais échappées à une cuisine, sont des révélations affreuses de la pauvreté. Au premier étage, Paul Masson frappa à une porte et la voix de Mme Marco nous pria d’entrer. Voix parfaite, ni trop aiguë, ni trop grave, gaie, et bien placée… Quelle surprise ! Mme Marco semblait jeune, Mme Marco était jolie, portait une robe de soie, Mme Marco avait de jolis yeux presque noirs fendus comme ceux des chevreuils, un petit sillon sur le bout du nez, les cheveux touchés de henné, frisés très serré, en éponge, sur le front, comme la reine d’Angleterre, bouclés courts sur la nuque à la manière qu’on disait « excentrique » de quelques femmes peintres ou musiciennes.
Elle m’appela « petite madame », indiqua que Masson lui avait beaucoup parlé de moi et de mes longs cheveux, s’excusa, sans insister, de n’avoir à m’offrir ni porto ni bonbons. Elle désigna avec simplicité le lieu dans lequel elle vivait et son geste me fit apparaître le morceau de moquette qui cachait une table guéridon, l’étoffe lustrée de l’unique fauteuil, et sur les deux chaises deux petits coussins-galettes élimés à dessin algérien. Il y avait aussi certaine carpette, par terre… La cheminée servait d’étagère à livres.
— J’ai séquestré la pendule dans le placard, dit Marco. Mais je vous jure qu’elle ne l’avait pas volé. Par chance, un autre placard me sert de cabinet de toilette. Vous ne fumez pas ?
Je fis signe que non, et Marco passa en pleine lumière pour allumer sa cigarette. Alors je vis que la robe de soie se coupait à tous les plis. Le peu de linge visible au col était très blanc. Marco et Masson fumèrent et causèrent ensemble, Mme Marco ayant tout de suite compris que j’aimais mieux écouter que parler. Je m’efforçais de ne pas regarder le papier de tenture, à rayures vieil or et grenat, ni le lit et son couvre-lit en damas de coton.
— Regardez plutôt la petite peinture, là, me dit Mme Marco. C’est de mon mari. Elle est si jolie que je l’ai gardée. C’est ce coin d’Hyères, vous vous souvenez, Masson.
Et je considérai avec envie Marco, Masson et la petite toile, qui tous trois étaient allés à Hyères… Comme la plupart des êtres jeunes, je savais me retirer en moi-même loin de mes interlocuteurs, puis les retrouver par un bond mental, puis les quitter encore. Le temps que dura ma visite chez Marco, grâce au tact délicat de celle-ci qui m’épargna questions et répliques, je pus aller et venir sans bouger, observer et fermer les yeux. Je la vis telle qu’elle était, pour m’en affliger et m’en réjouir, car si ses traits bien en place étaient beaux, elle avait ce qu’on appelle une grosse peau, un peu grenue, masculine, rougie à certaines places du cou et sous les oreilles. Mais en même temps je pouvais être ravie par la vivacité de son sourire intelligent, la forme de ses yeux de chevreuil, un port de tête exceptionnellement fier, éloigné de l’afféterie. Plus qu’à une jolie femme, elle ressemblait à un de ces aristocrates fins et fermes qui ont paré le XVIIIe siècle et n’avaient pas honte d’être beaux. Elle ressemblait surtout, me dit Masson, à son grand-père le chevalier de Saint-Georges, brillant ancêtre qui n’a point de rôle dans mon récit.
Nous nous liâmes, Marco et moi. Et après qu’elle eut terminé son roman hindou, — quelque chose comme La Femme qui tue, ainsi en décida le type qui touchait dix sous la ligne —, Monsieur Willy rassura la susceptibilité de Marco en lui demandant des travaux de bibliothèque, moyennant quoi elle acceptait de petits honoraires, consentait, quand je l’en priais avec instances, à partager impromptu notre repas. Je n’avais qu’à la regarder pour apprendre les meilleures façons de manger. Monsieur Willy faisait profession d’aimer la distinction, il eut de quoi se contenter avec les charmantes manières de Marco et la tournure de son esprit, qu’elle avait courtois sans souplesse et un peu cinglant. Née vingt ans plus tard elle eût fait, je crois, une bonne journaliste. L’été venu, c’est Monsieur Willy qui proposa d’emmener, dans un village de montagne franc-comtois, cette compagne extrêmement aimable, et pauvre avec tant de dignité. Elle y emporta un bagage d’une légèreté à fendre le cœur. Mais je disposais moi-même, à l’époque, de fort peu d’argent, et dans l’unique étage d’une auberge sonore nous nous établîmes au mieux. Le balcon de bois, un fauteuil d’osier suffisaient à Marco qui ne marchait guère. Elle ne se rassasiait pas du repos, ni du violet vif que le soir apportait sur les montagnes, ni des framboises à pleins bols. Elle avait voyagé, et comparait à d’autres paysages les vallées que creusait le crépuscule. Là-haut je me rendis compte que Marco ne recevait pas d’autre courrier que les cartes postales illustrées de Paul Masson, et les « meilleurs souhaits de bonnes vacances » toujours sur carte postale, d’un collègue tâcheron de la Bibliothèque Nationale.
Par les chauds après-midi, sous le store du balcon, Marco entretenait son linge. Elle cousait mal, mais avec soin, et je tirais vanité des conseils que je lui donnais, tels que : « Vous cousez avec du fil trop gros pour des aiguilles fines… Il ne faut pas mettre de la comète bleu ciel aux chemises, le rose est plus joli dans le linge et près de la peau ». Je ne tardai pas à lui en donner d’autres, qui visaient sa poudre de riz, la couleur de son rouge à lèvres, un dur trait de crayon dont elle cernait le beau dessin de sa paupière. « Vous croyez ? Vous croyez ? » disait-elle. Ma jeune autorité ne fléchissait pas. Je prenais le peigne, j’ouvrais une petite brèche gracieuse dans sa frange-éponge, je me montrais experte à lui embrumer le regard, à allumer une vague aurore au haut de ses pommettes, près des tempes. Mais je ne savais que faire de la peau ingrate de son cou, ni d’une ombre longue qui creusait sa joue. Cette flamme flatteuse, dont je dotais son visage, le transformait tellement que je l’effaçais aussitôt. Poudrée d’ambre, mieux nourrie qu’à Paris, elle s’animait avec modération, me racontait quelqu’un de ses voyages d’autrefois, alors qu’en bonne épouse de peintre elle suivait son mari de bourgade grecque en village marocain, lavait les brosses et faisait frire dans l’huile les aubergines et les poivrons. Elle cessait promptement de coudre pour fumer et soufflait la fumée par ses douces narines d’herbivore. Mais elle me nommait des sites et non des amis, contait les incommodités et non les chagrins, et je n’osais pas lui en demander davantage. Les matinées, elle les employait à écrire les premiers chapitres d’un nouveau roman à un sou la ligne, que le manque de documentation, en ce qui touchait les premiers chrétiens, retardait sensiblement.
— Quand j’y aurai mis des lions dans l’arène, une vierge blonde jetée aux soldats et un exode de chrétiens sous l’orage, disait Marco, je serai au bout de mon érudition personnelle, et j’attendrai pour le reste le retour à Paris.
J’ai dit : nous nous liâmes. Cela est vrai, si l’amitié se borne à une rare perfection de rapports, à des précautions soigneusement dissimulées, à un émoussage de toutes les pointes et de tous les angles. Je ne pouvais que gagner à imiter Marco et ses dehors de « dame ». En outre elle ne m’inspirait aucune défiance. Je la sentais nette, dégoûtée de ce qui peut nuire, retirée de toutes les compétitions féminines. Mais la différence des âges, dont l’amour se rit, est plus sensible à l’amitié, surtout entre deux femmes, surtout quand l’amitié commence et voudrait, comme fait l’amour, mettre les bouchées doubles. La campagne me gonflait d’une envie terrible d’eaux courantes, de prés mouillés, de remuante oisiveté…
— Marco, vous n’avez pas envie de nous lever tôt demain, d’aller passer la matinée sous les sapins où il y a des cyclamens sauvages, des champignons violets ?
Marco frissonnait, nouait l’une à l’autre ses petites mains :
— Oh ! non… Oh ! non… Toute seule, allez-y toute seule, jeune chèvre…
Car j’oubliais de dire que Monsieur Willy, la première semaine écoulée, était retourné à Paris « pour affaires ». Il m’écrivait de courts billets. Sa prose, qui procédait de Mallarmé et de Fénéon, il la pimentait d’onomatopées en caractères grecs, de citations allemandes et de formules tendres en anglais…
Je montais donc seule vers les sapins et les cyclamens. Le contraste entre un brûlant soleil et le froid, nocturne encore, des herbes à base de mousses avait de quoi me griser. Je pensai plus d’une fois à ne pas rentrer pour le déjeuner de midi. Mais je rentrais à cause de Marco, qui goûtait le repos comme si elle eût eu à purger une fatigue accumulée depuis vingt années. Elle se reposait les yeux fermés, pâle sous sa poudre, avec un air d’accablement et de convalescence. À la fin de l’après-midi, elle marchait un peu sur la route qui cessait à peine, pour traverser le village, d’être une route forestière sinueuse, admirable, sonnant clair sous le pied.
Il ne faut pas croire que les autres « touristes » s’agitaient beaucoup plus que nous. Les gens de mon âge se souviennent qu’un été à la campagne, vers 1897, ne ressemblait pas aux villégiatures mouvementées d’aujourd’hui. Un ruisseau froid, pur et ardoisé, servait de but de promenade aux plus remuants, qui emportaient des pliants, un ouvrage d’aiguille, un roman, le goûter, d’inutiles cannes à pêche. Par les soirées de pleine lune, après le dîner qui sonnait à sept heures, des jeunes filles et des jeunes gens s’éloignaient en bandes sur la route, revenaient, s’arrêtaient, se souhaitaient le bonsoir. « Pensez-vous aller demain à bicyclette jusqu’au Saut-de-Giers ? — Oh, nous ne faisons pas tant de projets. Cela dépendra du temps… » Les hommes portaient une ceinture-gilet, à deux rangs de faux boutonnage, sous le veston d’alpaga noir ou crème, une casquette quadrillée ou un chapeau de jonc. Les jeunes filles et les jeunes femmes étaient rondes, gourmandes, en robe de toile blanche ou de tussor écru. Quand elles retroussaient leurs manches on leur voyait des bras blancs, et sous les grands chapeaux le hâle vermeil ne leur montait pas jusqu’au front. Des familles aventureuses pratiquaient ce qu’on appelait « la baignade », se trempaient l’après-midi dans la rivière élargie, à une petite lieue du village. Le soir, autour de la table d’hôte, les cheveux mouillés des enfants sentaient l’étang et la menthe sauvage.
Un jour que mon courrier était riche de deux lettres, d’un article découpé dans Art et Critique, de quelques autres broutilles, Marco, pour me laisser lire, prit son attitude de convalescente, ferma les yeux, appuya sa tête au coussin en rabanne du fauteuil d’osier. Elle portait le peignoir de toile écrue qu’elle revêtait pour ménager le reste de sa garde-robe quand nous étions seules dans nos chambres ou sur le balcon de bois. C’est vêtue de ce peignoir qu’elle appartenait fidèlement à son époque et à son âge, de par une série de traits précis, flatteurs et mélancoliques, tels que certain pli, intentionnel, des cheveux qui accusait l’étroitesse des tempes, certaine courte frange qui n’accepterait jamais d’être dirigée dans un autre sens, le port du menton imposé par un col baleiné, les genoux joints et jamais croisés, le mauvais peignoir lui-même qui au lieu de se résigner à la simplicité d’un vêtement de travail, s’ornait de fausse dentelle en jabot, en manchettes, et d’un petit drapé sur les hanches…
Ces signes d’époque et de caractère, ma génération à moi était en train de les renier. La nouvelle coiffure à l’ange, les bandeaux de Cléo de Mérode s’accommodaient du canotier en auréole, des blouses chemisier genre anglais et de la jupe droite. La bicyclette et la culotte bouffante avaient gagné toutes les classes. Je commençais à m’engouer des cols de linge empesés, des lainages bourrus venus d’Angleterre. La divergence des deux modes, la récente et la toute neuve, se faisait trop frappante pour ne pas humilier les femmes dénuées d’argent, qui tardaient à adopter l’une et à quitter l’autre. Bridée parfois dans mes élans de coquetterie, je souffrais pour Marco héroïque dans deux robes exténuées et deux blousons clairs…
Je repliai lentement mes lettres, sans que mon attention quittât la femme qui feignait le sommeil, la jolie femme de 1870, 1875, qui renonçait, par modestie et par indigence, à nous suivre jusqu’en 1898… Avec l’intransigeance des jeunes femmes, je me disais : « À la place de Marco, je me coifferais comme ci, je m’habillerais comme cela… » Puis je lui faisais excuse : « Mais elle n’a pas d’argent. Si j’avais plus d’argent, je l’aiderais… »
Marco entendit que je pliais mes lettres, ouvrit les yeux et sourit :
— Bon courrier ?
— Oui… Marco, osai-je lui dire, le vôtre ne vous rejoint pas ici ?
— Mais si. Je n’ai pas d’autre courrier que celui que vous voyez arriver.
Comme je ne disais rien, elle ajouta d’un trait :
— Je suis, comme vous savez, séparée de mon mari. Les amis de V… sont restés, Dieu merci, ses amis et pas les miens. J’ai eu un enfant, il y a vingt ans, et je l’ai perdu tout petit. Et je n’ai jamais eu d’amant. Vous voyez que c’est tout simple.
— Jamais eu d’amant… répétai-je.
Marco rit de mon air consterné.
— C’est ce qui vous frappe le plus ? Remettez-vous. C’est ce à quoi j’ai le moins songé, jusqu’à ce que je n’y aie plus songé du tout.
Mon regard allait de ses beaux yeux, reposés par l’air pur et le vert des châtaigneraies, au petit sillon sur le bout de son nez spirituel, à ses dents d’un blanc un peu teinté, mais saines et bien rangées :
— Mais vous êtes très jolie, Marco !
— Oh ! dit-elle gaîment, j’ai même été charmante. Sans quoi V… ne m’aurait pas épousée. À ne rien vous cacher, je suis convaincue que le sort m’a épargné un grand souci : celui de ce qu’on appelle le tempérament. Non, non, le sang qui monte aux joues, les prunelles révulsées, les narines qui palpitent, j’avoue que je n’ai ni connu ni regretté tout ça. Vous me croyez, n’est-ce pas ?
— Oui, oui, dis-je machinalement, en regardant les mobiles narines de Marco.
Elle posa son étroite main sur la mienne, avec un abandon qui, je le savais, ne lui était pas facile :
— Beaucoup de pauvreté, mon enfant, et avant la pauvreté le métier de femme d’artiste, dans ce qu’il a de plus… manuel, de plus voisin de l’emploi de servante à tout faire… Je me demande où j’aurais trouvé le temps d’être oisive, soignée, élégante en secret, de courir à des rendez-vous — enfin d’être amoureuse…
Elle soupira, passa sa main sur mes cheveux, les rebroussa vers mes tempes.
— Pourquoi ne dégagez-vous pas un peu le haut de votre visage ? Dans ma jeunesse, je me coiffais ainsi…
Et comme j’avais horreur qu’on mît nues mes tempes de chat de gouttière, j’échappai à la petite main, j’interrompis Marco en m’écriant :
— Pas du tout ! Pas du tout ! C’est moi qui vais vous coiffer, j’ai une idée épatante !
Confidences brèves, amusements de recluses, heures qui ressemblent tantôt à celles d’un ouvroir, tantôt aux loisirs d’une convalescence, je ne me souviens pas que nos agréables vacances aient engendré une intimité véritable. J’étais portée à un sentiment de déférence envers Marco, et contradictoirement à ne faire presque aucun cas de ses opinions en matière d’actualité ou de sentimentalité. Quand elle me disait qu’elle aurait pu être ma mère, je me rendais compte que notre bonne entente ne ressemblerait jamais à ma véritable filialité passionnée, ni à la camaraderie que j’aurais nouée avec une jeune femme. Mais je ne connaissais à cette époque-là fille ou femme de mon âge avec qui déployer une gaîté sans précautions, une complicité sans paroles, une vitalité dépensable en fous rires, en rivalités physiques, en contentements un peu brutaux que l’âge de Marco, sa délicate complexion et son caractère éloignaient d’elle et de moi.
Nous causions, nous lisions aussi. J’avais lu follement dans mon enfance. Marco s’était instruite. D’abord, je crus que je pouvais puiser à tout moment dans la mémoire et l’esprit bien ornés de Marco. Mais je m’aperçus qu’elle répondait avec une certaine lassitude, et comme méfiante de ses propres paroles.
— Marco, pourquoi vous appelez-vous Marco ?