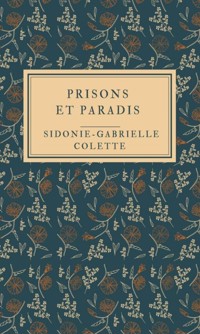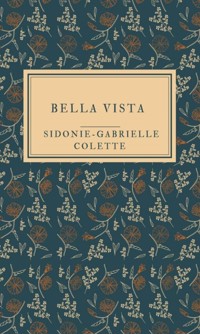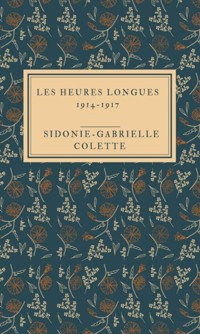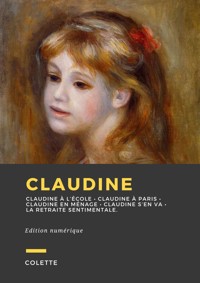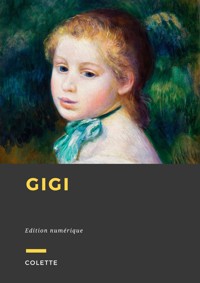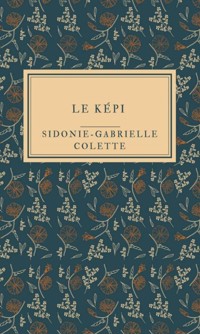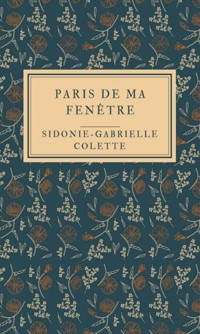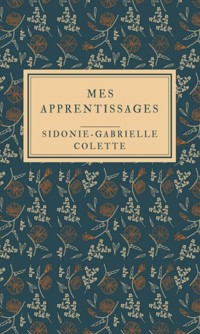
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Je n'ai guère approché, pendant ma vie, de ces hommes que les autres hommes appellent grands. Ils ne m'ont pas recherchée. Pour ma part je les fuyais, attristée que leur renommée ne les vît que pâlissants, soucieux déjà de remplir leur moule, de se ressembler, un peu roidis, un peu fourbus, demandant grâce en secret, et résolus à « faire du charme » en s'aidant de leurs petitesses, lorsqu'ils ne forçaient pas, pour éblouir, leur lumière de déclin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mes apprentissages
Ce que Claudine n’a pas dit
Colette
TABLE DES MATIÈRES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Colette et sa famille (anonyme)
Lune de miel (anonyme)
Jeune mariée (anonyme)
Caroline Otéro (anonyme)
Colette à vingt ans (prise en 1893, Reutlinger probablement Émile ou Léopold, tous deux DP
Colette en 1904 (anonyme)
Au temps des pensums (anonyme)
Marcel Schwob vu par Sacha Guitry (sous droits, caviardée)
Paul Masson (anonyme)
La vie gaie (anonyme)
L’ouvreuse (par Rip, DP)
La couverture de « Claudine à l’École » par Emilio della Sudda (DP)
Apothéose (anonyme)
Jean de Tinan déguisé en moine (anonyme)
Dans la petite retraite où j’avais emporté des livres naufragés (anonyme)
Premier chignon (anonyme)
Le domaine des Monts-Boucons (anonyme)
À califourchon, dans une culotte genre zouave (anonyme)
Francis Jammes (anonyme)
Polaire à ses débuts (anonyme)
Polaire dans « Claudine » (Henri Manuel, DP)
Polaire dans son tour de chant (photographie LAPI)
Polaire dans « Le p’tit jeune homme » (peut-être Henri Manuel, DP)
Polaire en 1935 (Henri Manuel, DP)
M. Willy venait d’inventer une paire de twins (anonyme)
Sido, lointaine et proche (anonyme)
Jean Lorrain, vu par Henry Bataille (DP)
Jean Lorrain dans son salon (anonyme)
Couverture d’un des romans de M. Willy (photos non créditées)
…Sur une monture à 10 francs l’heure (anonyme)
…Seule, avec le chien (anonyme)
…Si j’écrivais quelque jour mes souvenirs de « l’autre versant » (Photo studio Limot.)
Je n’ai guère approché, pendant ma vie, de ces hommes que les autres hommes appellent grands. Ils ne m’ont pas recherchée. Pour ma part je les fuyais, attristée que leur renommée ne les vît que pâlissants, soucieux déjà de remplir leur moule, de se ressembler, un peu roidis, un peu fourbus, demandant grâce en secret, et résolus à « faire du charme » en s’aidant de leurs petitesses, lorsqu’ils ne forçaient pas, pour éblouir, leur lumière de déclin.
Si leur présence manque à ces « souvenirs », c’est que je suis coupable de leur avoir — le sexe n’importe guère — préféré des êtres obscurs, pleins d’un suc qu’ils défendaient, qu’ils refusaient aux sollicitations banales. Ceux qui soulevèrent, jusqu’à une sorte de passion, ma curiosité, n’étaient parfois indécis que sur la manière dont ils verseraient leur essence la plus précieuse. Ils faisaient comme les gourmands qui tiennent en mépris le homard à l’américaine, parce qu’ils ne sont pas sûrs de le décortiquer proprement. Mais je disposais sans doute du geste lustral, — d’une paumée d’eau opportune le guide italien réveille, au passage, l’or assoupi des mosaïques souterraines… Une larme, ou une éclaboussure, et mes préférés se livraient.
Je ne me fais gloire de rien, sinon d’avoir heurté au passage ces êtres sapides et obscurs. Parfois leurs noms, inutiles, s’effacent, mais je les violente et ils s’inscrivent de nouveau sous les visages, qui sont lents à pâlir. Les mieux gravés n’ont pas joué, dans ma vie, un rôle fatal. Il est en moi de chérir, par la mémoire, le passant autant que le parent ou l’époux, et la surprise à l’égal du quotidien. C’est pourquoi j’ai pu donner, sans amour, une place de choix par exemple au jeune homme que je vis feindre de boire, et de fumer l’opium. Or il est plus aisé de fumer et de boire que de faire semblant, et l’abstention, rare en tous domaines, révèle une inclination vers le défi et la virtuosité. Que quêtait donc mon jeune ascète, ballotté de fumerie en beuverie, et qui restait à jeun ? Il fallut bien qu’il me le dît, à moi qui ne fumais ni ne m’enivrais. Il ne voulait que se sentir pressé, chaud de tous côtés, étayé par de vrais ivrognes et des fumeurs fervents. S’il s’expliqua mal et par bribes, je compris tout, le jour où, au lieu de dire « leur saoulerie », il lui échappa de dire « leur confiance ».
Pour l’ébriété, il s’en tirait facilement, mêlant avec adresse l’eau gazeuse et le champagne. L’opium lui donnait plus de peine, et parfois quelques nausées, — il faut ce qu’il faut. Ce qu’il lui fallait, c’était l’amitié passagère, les aveux, une jonchée de jeunes morts sans défiance, et la triste félicité de poser son front sur une épaule, un sein consentants, de rejoindre dans le demi-sommeil des alliés inaccessibles…
J’ai connu aussi la petite fille de huit ans qui laissait sa mère l’appeler longtemps, au loin, dans le parc… Elle écoutait, cachée, la voix maternelle s’approcher, s’éloigner, errer, changer d’accent, devenir, autour du puits et de l’étang, rauque et méconnaissable… C’était une petite fille très douce, mais qui en savait déjà trop, comme vous voyez, sur les diverses manières de se donner terriblement du plaisir. Elle finissait par sortir de sa cachette, imitait l’essoufflement et se jetait en courant dans les bras de sa mère : « Je viens de la ferme… J’étais… J’étais avec Anna dans le bas du potager… J’étais… j’étais… » s’excusait-elle.
— Qu’est-ce que tu feras de pire quand tu auras vingt ans ? lui reprochai-je un jour.
Elle ferma à demi ses yeux bleus délicieux, regarda dans le lointain :
— Oh ! je trouverai bien… dit-elle.
Mais je crois qu’elle se vantait. Je m’étonnai qu’elle jouât, par deux fois, son jeu devant moi. Elle ne me demandait aucune complicité ni promesse, semblait assurée de moi comme le furent, après elle, d’autres coupables, vaincus par la volupté de l’aveu et le besoin de mûrir sous un regard humain.
J’ai connu une brave créature, une de ces femmes qui, par vocation et raisonnement, sont comme la grasse prairie, le grenier d’abondance de l’homme. Elle servait de maîtresse amicale à l’un de mes amis, A… qui trouvait chez elle divertissement, soins affectueux encore qu’amoureux, la cuisine honnête, l’orangeade du soir, l’aspirine par temps d’orage, et une parfaite bénignité sensuelle. Il laissait la bonne Zaza, revenait, s’en allait et l’oubliait, la retrouvait entre le chien griffon, un feu de bois, et quelque inconnu à qui elle dispensait sans doute aussi la tasse de verveine et la nuit cordiale. B…, l’ami d’A… fut-il un peu envieux d’une liaison aussi quiète ?…
— Fais attention, dit-il à A…
— À quoi donc ?
— À cette femme. Très dangereuse. Sa pâleur de vampire, sa crinière d’un roux infernal…
— Tu me fais bien rigoler, dit A… Elle est teinte.
— Teinte ou non, mon vieux, tu ne te doutes pas du changement effrayant que subissent depuis quelque temps ton humeur, ton travail, jusqu’à ton physique… Ce genre de désagrégation rapide est toujours l’œuvre d’une femme fatale. Zaza a tout de la femme fatale. Tu vas à l’abîme.
A… se moqua de B…, continua de fréquenter Zaza, de l’oublier, de la retrouver selon le hasard, de l’emmener manger un bon dîner lourd et fin dans le quartier des Halles. Un soir il attabla B… avec eux, s’en alla au dessert sans préméditation :
— Mes enfants, j’ai une réunion syndicale à dix heures. Buvez l’armagnac à ma santé. Vieux, tu reconduiras Zaza si elle a un verre de trop ?…
Tête à tête avec Zaza, B… lui laissa deviner la suspicion et la considération effrayée qu’elle lui inspirait. « Une femme comme vous… Broyeuse d’hommes… Allons donc !… Cet imbécile d’A…, charmant mais borné, n’a rien compris… Comment ?… À d’autres !… Je suis encore capable, Dieu merci, de percer à jour… », etc., etc…, etc…
Vers minuit, B… larmoyait sur les blanches mains de Zaza qui le regardait de haut en pinçant sa grande bonne bouche. Elle ne parla de rien à notre ami A… Mais elle commença d’endosser, vis-à-vis de B…, une grande tenue complète et démodée de femme fatale. Elle l’attira, l’expulsa, le rappela, incisa sur le poignet du pauvre homme, à l’aide d’un cristal brisé, les quatre lettres de son prénom, lui donna des rendez-vous en taxi, couronna d’aigrettes de jais ses cheveux roux, porta des chemises en chantilly noir, et plus scandaleusement encore se refusa. Si bien que B…, qui n’en revenait pas, fut bien forcé de croire à la goule qu’il avait inventée, et A… s’inquiéta de B…
— Qu’est-ce que tu as, mon vieux ? Le foie ? La vessie ? Va aux eaux, consulte, fais quelque chose ! Mais ne reste pas comme ça, tu m’as l’air de filer un mauvais coton !
Il ne savait pas si bien dire, car B… mangeant mal, dormant peu, s’enrhumant pour un rien, se laissa surprendre par une consomption d’envoûté, et mourut comme à l’improviste. Sous son oreiller et dans ses papiers intimes, mêlées à des dossiers d’affaires, les photographies de Zaza ne contribuèrent pas peu à guérir le chagrin de veuve de Mme B…
Zaza elle-même, en tricotant un petit pullover bleu ciel, me conta l’histoire que je résume. Nous étions toutes seules, et elle prenait des temps, multipliait les « …mais le plus beau de l’affaire… Voilà mon B… aux cent coups… Ce n’est pas que je raffole du chantilly noir, mais ça fait romanesque… » et elle ne cessa pas, son visage mûr et aimable tout froncé de malice, d’avoir l’air de me raconter une facétie un peu poussée. Elle finit sur un geste d’insouciance qui eût donné froid à un auditeur plus sensible, et sur un mot sentencieux :
— Il ne faut pas tenter le diable, même par bêtise. Cet imbécile de B…, il a tenté le diable…
Qu’il n’y ait pas eu, de mes ténébreux amis à moi, enseignement efficace d’une vertu ou d’un vice éclatants, osmose ni même simple contagion, je ne puis maintenant que m’en réjouir. Dans le temps de ma grande jeunesse, il m’est arrivé d’espérer que je deviendrais « quelqu’un ». Si j’avais eu le courage de formuler mon espoir tout entier, j’aurais dit « quelqu’un d’autre ». Mais j’y ai vite renoncé. Je n’ai jamais pu devenir quelqu’un d’autre. Chers exemples effrénés, chers conseillers néfastes, je n’aurai donc pu que vous aimer, d’un amour ou d’une horreur également désintéressés ? Des personnages péremptoires ont devant moi passé, paradé et émis leur lumière, non point en vain puisqu’ils me demeurent agréables et lumineux. Mais je les ai découragés. On décourage toujours ceux qu’on n’imite point. L’attention qui n’alimente que la curiosité passe pour impertinence. Or je n’ai imité ni les bons, ni les autres. Je les ai écoutés, regardés. Sûr moyen d’inspirer aux bons une mélancolie d’anges, et de m’attirer le mépris des réprouvés, au sens catholique du mot. La voix du réprouvé rend des sons assurés et chauds, et n’hésite jamais, — ainsi de la voix juste et majeure, par exemple, de Mme Caroline Otero, qui me transmit en pure perte, autrefois, et sans obstination, de grandes vérités.
Je l’ai peu connue. On s’étonnera de lire son nom dès les premières lignes de mes souvenirs. Il vient sous ma plume, à propos pour donner à ces pages leur ton. Vingt pages sur le coloré, le tonique et mystérieux éphémère, — vingt lignes sur le notoire et le vénérable que d’autres ont chanté et chanteront ; — de l’étonnement devant le rebattu, çà et là une propension à dormir d’ennui au son des grands « ah ! » qu’est en train de pousser le monde devant un prodige, un messie ou une catastrophe, — voilà, je pense, mon rythme…
Il se trouve que je me souviens de Madame Otero avec plaisir. J’aurais pu cueillir, sur des lèvres plus augustes que les siennes, des paroles qui, riches d’écho, m’eussent été enseignement et profit ? Mais les lèvres augustes ne sont pas si prodigues. Au hasard et à l’inconnu, j’ai demandé des compensations, qu’ils m’ont quelquefois versées un peu comme le cocotier ses noix, pan ! en plein sur le crâne. Madame Otero, debout au milieu d’une période de ma vie pendant laquelle j’interrogeais la possibilité de gagner ma subsistance, n’a rien d’un cocotier. Elle est pur ornement. Comme tout ce qui est luxe, elle dégage des enseignements divers. Et rien qu’à l’entendre je me réjouissais que l’essai d’une de mes carrières l’eût mise sur mon chemin :
— Mon petit, disait-elle, tu m’as l’air pas très dégourdie… Souviens-toi qu’il y a toujours, dans la vie d’un homme même avare, un moment où il ouvre toute grande la main…
— Le moment de la passion ?
— Non. Celui où tu lui tords le poignet.
colette et sa famille
lune de miel
Elle ajoutait : « comme ça… » avec un geste en vis des deux mains ; on croyait voir couler le jus des fruits, l’or, le sang, que sais-je, entendre craquer les os… Me voyez-vous tordant le poignet de l’avare ? Je riais. J’admirais, ne sachant mieux faire. Magnifique créature… Je ne l’ai connue que lorsqu’elle atteignait l’âge où les femmes d’aujourd’hui estiment qu’elles doivent recourir, pour retenir et masquer leurs précieux quarante-cinq ans, à des moyens tristes, gymniques et restrictifs. Madame Otero ne songeait pas aux privations. Si je n’ai tiré aucun profit de ses rares paroles — elle était peu bavarde, du moins dans notre langue, — j’ai eu l’avantage de l’approcher dans les coulisses et loin des cérémonies publiques, soupers, répétitions générales des music-halls, qui lui infligeaient un corset de parade et lui collaient au poitrail son grand pectoral de joyaux. À l’icone immobile, émue seulement — comme l’est un arbre chargé de givre — de son propre scintillement, je préférais une autre Lina, tout aussi condescendante, qui me tutoyait d’assez haut :
— Tu viens manger le puchero, chamedi ? Viens de bonne heure, je te fais un bégigue avant de dîner.
J’imitais son tutoiement distant et, dès le seuil de son hôtel, je me sentais contente. Rarement le palais, qu’il a imaginé d’avance, enchante l’enfant qui le visite. L’hôtel de Madame Otero ne m’a jamais déçue. Celle qui l’habitait est une sorte de cariatide, taillée dans le style d’une époque qui me vit vacillante. On ne pénètre pas dans l’intimité d’une cariatide, on la contemple. En Madame Otero je contemple le site de ma trentaine environ. Le décor de sa vie privée, j’en garde un souvenir mieux que net, une évocation estompée, juste, essentielle, de certains beaux meubles anciens amarrés parmi le flot d’un satin peut-être brodé de cigognes japonaises, sous l’écumante et probable dentelle dite « application ». Si ce n’est pas la chambre d’Otero qui se vouait au Louis XV flamboyant, c’est une autre « bonbonnière » de la rue d’Offémont, de la rue de Prony, de l’avenue de Villiers… Tendus aux murs, tombant des baldaquins, drapant en festons des baies vitrées, que sont devenus un bleu pâle et serein, un rose de fraise, des brochés aurore, et ces gros damas qui se tenaient, comme on dit, debout tout seuls ?…
Les demeures des Liane, des Line, des Maud, des Vovonne et des Suzy (tenez ces diminutifs pour prénoms inventés) furent d’un luxe « écrasant », je veux le croire puisqu’il s’agissait bien, pour chacune, d’écraser quelque autre. Deux salons valaient mieux qu’un, et trois que deux, dût la majesté céder devant le nombre. Le style étouffant n’était pas près de sa fin, et l’on suffoquait de meubles. Les crémaillères se pendaient à l’étuvée. Songez que je parle là d’une époque où le luxe traitait l’hygiène intérieure et le sport en petits serviteurs. Tel boudoir « arabe » n’avait pas de fenêtre. La carrosserie automobile prenait humblement conseil du grand modiste et se réglait sur la hauteur des chapeaux. Je vois encore la Mercédès bleue de Madame Otero, boîte à aigrettes et à plumes d’autruches, limousine si étroite et si haute qu’elle versait mollement aux virages.
Le théâtre lui-même en voyait de dures avec la mode, par ce temps de grands corsets qui soulevaient la gorge vers le haut, abattaient la croupe, creusaient le ventre. Germaine Gallois, inflexible beauté bastionnée, n’acceptait pas de rôle « assis ». Gainée d’un corset qui commençait sous l’aisselle et finissait près des genoux, deux ressorts de fer plats dans le dos, deux autres au long des hanches, une « tirette » d’entre-jambes (j’emploie les mots de l’époque) maintenant l’édifice dont le laçage en outre exigeait un lacet de six mètres, elle restait debout, entr’actes compris, de huit heures trente à minuit.
Il est juste d’ajouter que, la crémaillère pendue, l’usage amendait, façonnait les demeures. Les petits chiens jappeurs y entraient en même temps que le singe, que les vases offerts au jour de l’an, les plantes vertes, les portraits par Ferdinand Humbert, Prinet, Roybet, Antonio de la Gandara… Coussins de chaise longue, châle de Manille drapé sur l’épaule du piano demi-queue, statuettes, sujet de cheminée, boîtes de chocolats et de fondants, chinoiseries et peaux de lion… Parfois un goût personnel et violent, indomptable, s’y faisait sa place, comme à la dynamite. Ce n’était point le cas chez Madame Otero, mais il me suffisait, pour que tout à mes yeux fût parfait, que la maîtresse du logis y savourât l’avant-dîner, en bas de soie et mules fatiguées, en chemise de jour et jupon sous son tea-gown, qu’elle remplaçait à l’occasion par un peignoir de bain. Cent quatre-vingt-douze cartes et les « marques » en palissandre devant elle, un cendrier à sa droite, un verre d’anisette à sa gauche, elle régnait.
Le jeu et le mutisme retiraient à son visage toute expression, mais il s’en passait bien. Pendant de longues années, il a comme dédaigné de vieillir. Madame Otero, qui se vantait, vraisemblablement, d’un sang hellène, avait le cou bien attaché, le profil buté de mainte statue grecque, et montrait des mains, des pieds, dénués de la voltigeante petitesse espagnole. Entre les grappes de ses cheveux vigoureux, son petit front de brebis demeurait pur. Le nez et la bouche de « Lina », les photographies de Reutlinger vous le diront cent fois, étaient des modèles de construction simple, de sérénité orientale. Des paupières bombées au menton gourmand, du bout du nez velouté à la joue célèbre et doucement remplie, j’oserai écrire que le visage de Madame Otero était un chef-d’œuvre de convexité.
— Achieds-toi, me disait-elle. Coupe. Maria, donne-loui un verre d’anigette.
Sa dame de compagnie, Maria Mendoza, Espagnole pauvre et de bonne maison qui ressemblait à un alezan anglais tout en os, obéissait avec une hâte un peu épouvantée, et le bésigue, ennemi de la conversation, commençait. Sous leur paupière à peine meurtrie, les regards de Lina surveillaient mes mains…
— Deux chent chinquante… Deux chent chinquante… À dire… À dire… Je les dis. Quinge chents…
Elle savait parfaitement prononcer les s. Mais elle réservait à la scène et aux relations de choix ce petit effort d’articulation.
Le jeu s’échauffait, elle laissait avec indifférence le peignoir de bain s’ouvrir, la chemise de jour glisser. Jusqu’au vallon d’ombre creusé entre deux seins d’une forme singulière, qui rappelaient le citron allongé, fermes et relevés du bout, descendait une parure agrafée comme au hasard, vraie aujourd’hui, fausse demain, sept rangs de perles radieux et rosés, ou une verroterie de théâtre, ou un lourd diamant. La faim impérieuse et l’odeur du puchero arrachaient seules Lina au bésigue. Debout, grande et cambrée, la taille encore mince au-dessus d’une croupe qui était son orgueil, elle bâillait haut, tapait du poing son estomac exigeant, et descendait entraînant les ombres de son festin, en chantant d’une voix métallique et juste :
Tengo dos lunares, Tengo dos lunares, Una junta la bocca, El otro donde tu sabe…
Point d’hommes à table, ni de rivale. L’amant en titre pansait quelque part son poignet tordu. Une ou deux amies vieillissantes, et moi qui n’étais pas vieille, mais terne, nous prenions place aux côtés de Lina.
La vraie fête de gueule, ce n’est jamais le dîner à hors-d’œuvre, entrée et rôtis. Là-dessus nous étions bien d’accord, Madame Otero et moi. Un puchero, son bœuf, son jambonneau et son lard gras, sa poule bouillie, ses longanizas, ses chorizos, tous les légumes du pot-au-feu, une colline de garbanzos et d’épis de maïs, voilà un plat pour ceux qui aiment manger… J’ai toujours aimé manger, mais qu’était mon appétit au prix de celui de Lina ? Sa majesté fondait, remplacée par une expression de volupté douce et d’innocence. L’éclat des dents, des yeux, de la bouche lustrée était d’une jeune fille. Rares sont les beautés qui peuvent bâfrer sans déchoir ! Quand Lina repoussait enfin son assiette, c’est qu’elle l’avait vidée quatre, cinq fois… Un peu de sorbet à la fraise, une tasse de café et elle sautait debout, serrant à ses pouces la paire de castagnettes.
— Au piano, Maria ! Vous autres, foutez-moi chette table dans le coin !
Dix heures sonnaient à peine. Jusqu’à deux heures du matin Caroline Otero dansait et chantait pour son plaisir, peu soucieuse du nôtre. De belle quadragénaire, elle passait jouvencelle. Le peignoir jeté, elle dansait en jupon de « broché » à grand volant de cinq mètres de tour, le seul vêtement indispensable à la danse espagnole, et la sueur collait à ses reins sa chemise en linon. Elle répandait, moite, une odeur délicate, brune, à dominante de santal,