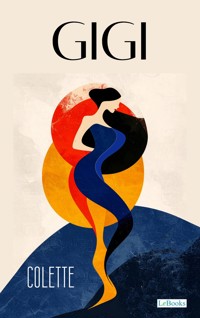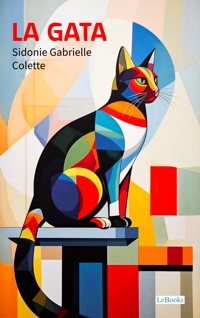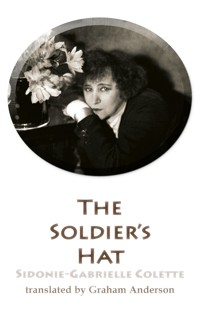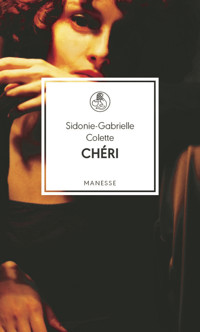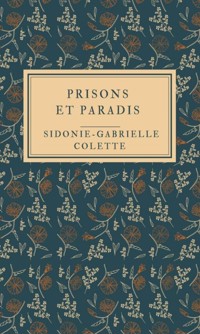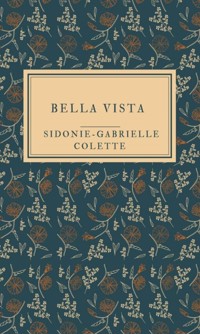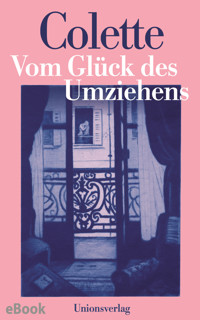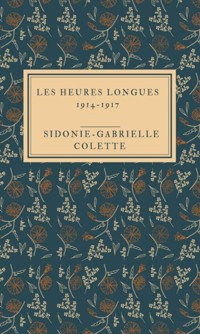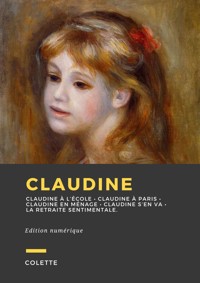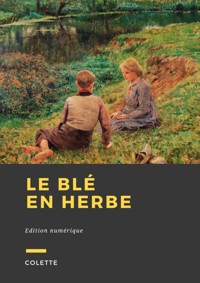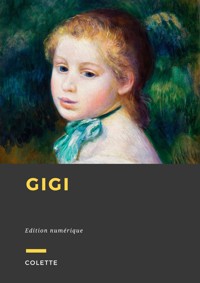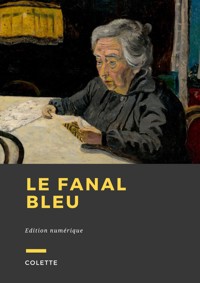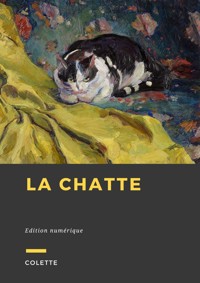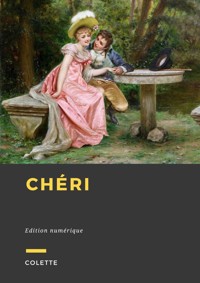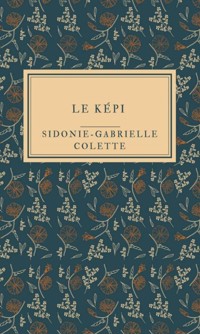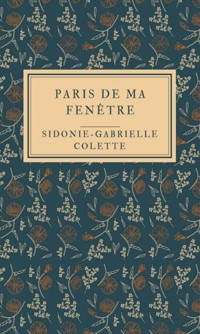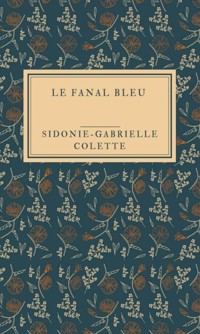
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Que nos précieux sens s'émoussent par l'effet de l'âge, il ne faut pas nous en effrayer plus que de raison. J'écris « nous » mais c'est moi que je prêche. Je voudrais surtout qu'un état nouveau, lentement acquis, ne m'abusât point sur sa nature. Il porte un nom, il me forme à une vigilance, une incertitude et des acceptations nouvelles. Ce n'est pas que je m'en réjouisse, mais je n'ai pas le choix.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Fanal bleu
(1949)
Colette
TABLE DES MATIÈRES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Que nos précieux sens s’émoussent par l’effet de l’âge, il ne faut pas nous en effrayer plus que de raison. J’écris « nous » mais c’est moi que je prêche. Je voudrais surtout qu’un état nouveau, lentement acquis, ne m’abusât point sur sa nature. Il porte un nom, il me forme à une vigilance, une incertitude et des acceptations nouvelles. Ce n’est pas que je m’en réjouisse, mais je n’ai pas le choix.
Une fois, deux fois, trois fois, me détournant du livre ou du papier bleuté vers le préau magnifique dont la vue m’est consentie, j’ai pensé : « Les enfants du Jardin cette année sont moins criards », peu après j’accusais d’extinction progressive la sonnette de l’entrée, celle du téléphone, et tous les timbres orchestraux de la radio. Quant à la lampe de porcelaine — pas le fanal bleu de jour et de nuit, non, la jolie lampe peinte de bouquets et d’ornements — je n’eus pour elle que grommellement et injustice : « Qu’est-ce qu’elle a pu manger, celle-là, pour être si lourde ? » Ô découvertes, et toujours découvertes ! Il n’y a qu’à attendre pour que tout s’éclaire. Au lieu d’aborder des îles, je vogue donc vers ce large où ne parvient que le bruit solitaire du cœur, pareil à celui du ressac ? Rien ne dépérit, c’est moi qui m’éloigne, rassurons-nous. Le large, mais non le désert. Découvrir qu’il n’y a pas de désert : c’est assez pour que je triomphe de ce qui m’assiège.
Quatre ans ont passé depuis que j’ai publié L’Étoile Vesper. Ce furent des années rapides, comme sont les années qui ont des matinées identiques, des soirées en vases clos, avec un petit centre imprévu, comme un noyau. L’Étoile Vesper, je l’appelais honnêtement mon dernier livre. Je me suis aperçue qu’il est aussi difficile de finir que malaisé de continuer. Sous mon fanal bleu mon amarre est de plus en plus courte, mon tourment physique de plus en plus fidèle. Mais que de déplacements — sauf la marche — me sont encore permis ! Uriage en 46, Genève et le Beaujolais en 47, la Provence — quoique interdite — en 48… Les pays, les ondes, les rivages retrouvés, je les recensais du haut d’une automobile ou d’une chaise roulante, avec orgueil : « En somme, je puis encore visiter tout cela… » Visiter ? C’est manière de dire, surtout de sentir. Anna de Noailles, durant la dernière impotence de sa vie, a vu plus que moi de cités, de mers et de monts, sur l’envers de son store toujours baissé.
Je voulais que ce livre fût un journal. Mais je ne sais pas écrire un vrai journal, c’est-à-dire former grain à grain, jour après jour, un de ces chapelets auxquels la précision de l’écrivain, la considération qu’il a de soi et de son époque, suffisent à donner du prix, une couleur de joyau. Choisir, noter ce qui fut marquant, garder l’insolite, éliminer le banal, ce n’est pas mon affaire, puisque, la plupart du temps, c’est l’ordinaire qui me pique et me vivifie. À me promettre de ne plus rien écrire après L’Étoile Vesper, voilà que je couvre deux cents pages, ni mémoires, ni journal. Que mon lecteur s’y résigne : lampe de jour et de nuit, bleue entre deux rideaux rouges, étroitement collée contre la fenêtre comme un des papillons qui s’y endorment le matin, en été, mon fanal n’éclaire pas d’événements de taille à l’étonner.
Il y a vingt ans, ou un peu plus, que l’amie de la musique et des musiciens, la princesse Edmond de Polignac, condamna d’un regard et d’un mot le pupitre-table à quatre petites pattes qui, de Paris à Saint-Tropez et retour, me suivait, faisait halte sur mon lit, aux auberges. Je tenais à ce meuble, improvisé pour moi par Luc-Albert Moreau, peintre, graveur et maître bricoleur, pour que j’y puisse écrire hors de la posture assise, à pieds pendants, qui toujours fut nuisible à mon bien-être et à mon travail.
— J’ai, me dit la princesse de Polignac, un petit meuble anglais, qui, agrandi, vous conviendrait tout à fait.
Elle ne se trompait pas. Épaissi, consolidé, haussé, ayant perdu la plupart de ses grâces du xviiie siècle anglais, il enjambe mon lit-divan et contente en effet depuis un quart de siècle mon repos et mon métier. Un pupitre à crémaillère s’encastre dans sa solide table d’acajou et supporte le poids de téléphone, de fruits, de coffret-radio et de gros tomes illustrés qui me délassent de ma propre écriture… L’édifice circule aisément de mon chevet à mes pieds. En y comptant le couteau à tout faire et sa queue de scorpion, le bouquet de stylos, et des bibelots sans utilité précise, je groupe sur son dos quelques bons et agréables serviteurs.
Grand désordre de papiers autour de moi ; mais désordre de trompeuse apparence, compliqué tantôt de châtaignes bouillies, d’une pomme mordue, et depuis un mois, d’une graine — exotique ? — dont les capsules détiennent puis expulsent, avec une sorte de violence, une semence d’argent fin, lestée d’un granule, plus léger encore que n’est la semence des chardons. Une à une ses houppes se libèrent, gagnent sous mon plafond l’air échauffé, y voyagent longuement, redescendent, et si l’appel d’air du feu en happe quelqu’une elle se prête au rapt, s’élance résolument dans l’âtre et s’y suicide. J’ignore le nom de la plante qui disperse ainsi ses volantes âmes, mais elle n’a pas besoin d’un état civil pour prendre sa place dans mon musée d’ignorante.
Ceux que je voulais durables, bien accrochés à leur vie et à la mienne, où sont-ils ? Jamais l’idée me fût-elle venue que Marguerite Moreno me quitterait ? La fatigue sur elle se faisait bénigne, elle riait de dédain quand je lui vantais l’oisiveté et le demi-somme de la sieste… Mais Marguerite prend un refroidissement, succombe en huit jours. Mais Luc-Albert Moreau rencontre un ami, s’écrie joyeusement : « Ah ! mon vieux, je suis content de te voir ! » et meurt sur la place, trahi par son cœur. Et avant eux, Léon-Paul Fargue… Tout près de mourir il murmurait contre le bleu de ses draps qu’il avait fait teindre : « Beaucoup trop bleu… inadmissible… » Et d’autres qu’il me faut renoncer à nommer, sinon à compter… En moi-même, je leur reproche leur fin, je les appelle imprudents, négligents… Me priver d’eux, si brusquement, me faire ça, à moi… Aussi ai-je repoussé, hors de ma vue et de mon souvenir, leur image de gisants, leur posture de quiétude définitive. Fargue soudain sculpté ? Je n’en veux pas. Mon Fargue à moi porte encore ses souliers poudreux de piéton, il parle, il gratte la tête noire du chat, il me téléphone, il va de Lipp à Ménilmontant, il commande à la houle trop bleue de sa couche… Les pieds de Marguerite Moreno, chaussés d’or immobile ? Oh ! non. Mon souvenir me les garde nonchalants, mobiles, vulnérables et jamais las.
Mes cadets, mes bien vivants, dirigent parfois vers moi un regard sévère ; ils se méfient. Ils ramènent sur mon épaule un pan de châle : « Vous ne sentez pas trop d’air ? » Non, je ne sens pas trop d’air, je ne sens pas cet air-là, auquel vous pensez. Je n’ai pas assez de suite dans les idées pour le sentir. J’ai tant d’occasions de me détourner de ce que vous nommez pudiquement « le mauvais air ». Surtout j’ai la douleur, cette douleur toujours jeune, active, inspiratrice d’étonnement, de colère, de rythme, de défi, la douleur qui espère la trêve mais ne prévoit pas la fin de la vie, heureusement j’ai la douleur. Oh ! Je reconnais qu’à employer l’adverbe « heureusement », je lui trouve une affectation de coquetterie, une minauderie d’infirme. Très peu d’infirmes gardent intact leur naturel, mais je ne voudrais pas laisser croire que je puise dans l’infirmité un coupable orgueil, l’habitude des égards, ou bien le complexe d’infériorité, qui est un principe d’aigreur. Je ne parle pas des simulateurs de la douleur qui n’offrent aucun intérêt et constituent d’ailleurs une infime minorité, je ne fais pas d’allusion à une catégorie de souffrants qui ne détestent pas être surpris, ou rencontrés, en flagrant délit de souffrance. Mon frère, le médecin, jugeait la délectation de ceux-ci en peu de mots. « C’est comme une extase, disait-il. C’est comme de se gratter le fond de l’oreille avec une allumette. C’est un peu vénérien. »
Je tiens, d’un grand homme politique qui était boiteux, un aveu que je n’ai pas trouvé obscur, quoique en ce temps-là je ne fusse qu’agréablement valide. L’homme politique aimait me hausser jusqu’à des idées générales, du moins il y tâchait. Je m’y efforçais aussi, pas longtemps. Je crois qu’il m’eût trouvée médiocre en beaucoup de choses, s’il n’eût aimé autant un de mes livres, La Naissance du jour — et qu’il eût souhaité élargir (moi je disais : borner) ma vie à quelque grande idée qui m’eût servi quasi de religion, de dignité (sic), d’inspiration. Je lui demandai un jour, par malice et représailles, s’il imaginait ce que peut être une existence dévastée par une pensée unique, et je fus étonnée de la réponse qu’il me fit :
— Très bien, répliqua-t-il promptement, puisque toute ma vie, tous les jours, et presque à chaque heure, je me suis rappelé que j’étais boiteux.
Il supporta avec un très grand courage, avant de mourir trop tôt, accidents et opérations, puis nous laissa une œuvre littéraire de poids, tout entière tournée, comme fut sa vie, vers la politique — tout entière sauf une nouvelle assez longue, une manière de chef-d’œuvre, une seule nouvelle, dont le héros est infirme.
J’ai donc, par chance, la douleur, que j’accorde avec l’esprit de gageure, te super-féminin esprit de gageure, de jeu si vous préférez : la Chatte Dernière, qui se mourait, indiquait, d’un geste de la patte, d’un sourire de son visage, qu’une ficelle traînante était encore objet de jeu, aliment de la pensée et de l’illusion féline. Chez moi, on ne me laissera pas manquer de bouts de ficelle.
Genève, 1946.
Je reviens de Genève, qui vit active à petit bruit. La singulière existence du malade en traitement au centre d’une cité étrangère, je ne lui trouvai d’abord que peu de ressemblance avec ma vie, adaptée depuis longtemps et de si bonne volonté à un mal, à ses plaisirs et à ses peines, à une ville aimée où je n’avais presque pas besoin de la douleur pour agencer une imitation de thébaïde, toute de solitude arbitraire et de capricieuse sociabilité.
La capitale suisse, je ne la sentais ni ne l’entendais autour de moi, en bas de ma case d’hôtel. Il est vrai que son pavé actuel est lisse, et son trafic dépend de voitures silencieuses. Une charrette à bras ramasse le matin les feuilles et les brindilles du petit square. Et les papiers ? Non. Il n’y a pas de papiers par terre à Genève. La petite charrette à bras roule sur deux gros boas pneumatiques. Je ne vois de ma fenêtre, sur un lé de quai, à un angle de rue, que des automobiles miroitantes comme des pianos neufs.
Les premières semaines d’un long traitement comportent ensemble l’accalmie et l’exaspération, si je compte l’accablement pour calme. Il me suffisait de me rappeler des séjours, brefs, vieux de trente ans, à Genève, dans une pension de famille où des artistes de théâtre et de music-hall, comme moi modestement fournis de pécune, hantaient une table d’hôte. Un Genève tout rayé de pluie. Mes poches s’emplissaient d’altruistes cigarettes (je ne fume pas), de petites montres en acier noir et en nickel, qui coûtaient bien dix francs pièce, dans le temps où le franc suisse équivalait au franc de France…
Revenue à Genève en 1946, j’y attendis, pendant qu’avril hésitant approchait, le retour d’une partie de mes forces, plutôt celui de mon optimisme — c’est la même chose — sinon l’extinction de la douleur, et aussi qu’une appréhension, presque exclusivement physique, cessât de s’opposer à la perception de la ville et de la nation. Étais-je donc si réduite, qu’au début le mont d’argent dur, par-delà le Léman, ne m’apparut que comme une réplique des cartes postales ? Il le faut croire, puisque le grand jet d’eau, issu du lac et qui brandi, roidi, constamment y retourne, je ne le regardais que comme un jouet majestueux, un épi, une semence éployée au vent, rebelle au vent. Il le faut croire, puisqu’il ne fut pas question, dans le commencement, de triompher d’un état de dépendance et d’humilité devant le thérapeute qui entreprenait de me défendre.
J’apprenais, premièrement, le comportement du patient en traitement, auquel mes médecins amis ne m’avaient pas dressée. J’apprenais la ponctualité, l’accoutumance, et quelles heures amenaient l’entrée d’un étranger puissant, bien intentionné et inexorable… L’heure de craindre, tout en l’appelant, un certain homme, un homme nouveau. Par chance, cette heure-là se chargeait d’une tenace coquetterie, réclamait la combinaison rose, la chemise de nuit nouée d’un ruban frais, la robe de chambre lissée d’un coup de fer. L’instant qui précède l’entrée d’un tel homme plein de pouvoir est plus émouvant que ne sont ses sévices en piqûres, pétrissages, profondes délégations électriques, auxquels sa présence réelle est un adoucissement. Après le cri involontaire ou le grommellement, je me permettais le rire plus décent que le sanglot, le blasphème cordial, une grosse plaisanterie que le médecin excusait. Puis je bénéficiais d’un moment de conversation extrêmement agréable, affectueux, allégé, délivré de moi, et… « cher docteur, à demain ».
J’avais bien oublié mon Genève d’autrefois, puisque aux premières sorties en voiture, à la nuit d’avril tombante, je m’étonnai si fort que la ville fût ce lâcher de piétons, de cycles, de silencieuses voitures américaines, cette affluence sans vacarme, cette activité sans chocs, cette hâte sans confusion. Et surtout, quelle fête d’électricité, pour le plus grand étonnement de mes six années de réclusion parisienne au sein du bleu de cave, du noir de guerre, du rouge de lumignon. Un bain de lumière rose prodiguée changeait en viviers frémissants les cases, débordantes et ordonnées, des magasins agencés pour la victuaille, la dentelle, la chaussure et les parfums. Je ne cessais de m’étonner. Quoi, le chocolat à portée de la main, et les gâteaux, dans les pâtisseries qu’on dépouille et n’épuise point ? À portée de ma main, de ma bouche sevrée, le lait, le lait, pur, révéré, vendu à toute porte, le lait que la condition des « V », à Paris, dispense goutte à goutte et bleuâtre ? Tout un chacun, moi comprise, peut ici s’asseoir dans un restaurant-jardin, ou chez le confiseur-glacier, et demander une tasse, deux, trois tasses de lait et les obtenir ? Loisible à tous de le boire dans une coupe rouge à pois blancs, ou bleue comme la pervenche ? Le boire invisible et sapide dans un grand gobelet de galalithe aussi blanc que lui ? Le mander à n’importe quelle heure, dans ma chambre d’hôtel, glacé et privé d’expression, ou tiède et évocateur du pis satiné, le teinter de café, le varier, mousseux, échauffé de vanille, de sucre et de rhum ? Je ne pourrai de longtemps me rassasier de voir le lait courir la ville aux mains des enfants dans une boîte bien fourbie, de le contempler jalonnant ma promenade sur roues, confié sans défense au portillon entrebâillé des chalets, balancé à une branche basse parmi les cerises vertes, déposé solitaire sur le petit mur de clôture et veillé par le chat !
À qui ne peut flâner sur un trottoir, se fier à des chances et des caprices de piéton, il n’est que des vues superficielles, de fuyantes cités, des édifices enrichis de séduisantes erreurs optiques. Non seulement je suis, d’ores et déjà, décidée à me contenter de celles-ci et celles-là, mais je m’y encourage. Qu’ai-je à perdre ? Plus rien. Au contraire. Les illusions accourent. Mais non, ceci n’est pas une tondeuse à haies, c’est le nouvel ustensile qui fait le café tout seul. Et ce joli objet d’une courbe si suave, non, ce n’est pas le support idéal pour polygonum grimpant, c’est un presse-pantalons. Car ici l’invention pratique fait merveilles. Certains magasins, qui s’intitulent modestement « quincaillerie », jusqu’à quand me seront-ils inaccessibles ? Je voudrais du moins coller mon nez contre leurs vitres, m’enivrer de bois verni, de hêtre rosé, de fer émaillé et d’aluminium, tant l’ingéniosité suisse éveille, à leur vue, l’idée d’art et d’harmonie. Par contre, les magasins consacrés aux bibelots artistiques…
Mais personne ne m’a priée de critiquer l’art, de dénombrer le paysage peint, le nu rosé, la nature morte, et quel besoin puis-je avoir d’un sous-main en cuir gravé, d’une cristallerie ornementale ? Laissons l’art en repos, il me le rend bien quand je frôle, au train ralenti de ma voiture, les magasins où toute denrée semble frais pondue. L’art, ici, c’est l’état d’innocence, le soin jaloux, la vendeuse intacte ; l’art, le luxe, c’est le papier, papier gaufré, dentelé, plissé, doré, le papier prodigué, blanc comme la neige, bleu comme le glacier. Comparé à lui, à son hygiénique abondance, le linge de notre France pauvre, contrainte à la parcimonie, exploité coin de serviette après coin de serviette, nous dégoûtera un peu.
Des bananes, des pommes d’arrière-saison encore juteuses, des fraises de primeur, des oranges, des œufs, de la crème fouettée ou non… Par contraste, point de fromage sinon au gramme, ni de riz, ni de beurre, sauf par ruse et combine. Et de nous esclaffer : « Pas de gruyère en Suisse ? Elle est bien bonne ! » Nous prenons ça pour une brimade humoristique, jusqu’à ce que nous reprenions notre sérieux devant la gravité et le naturel des autochtones : « Non, il n’y en a pas en ce moment », dit la charmante jeune femme genevoise. Elle porte des robes de couturier, des joyaux. Mais elle n’a pas de gruyère, ni de beurre. Elle est entraînée au respect des restrictions, et ne triche pas. Peut-être qu’ils n’ont pas de diable en Suisse…
Et gavés d’autre sorte, nous nous consolons en mangeant le pain tout seul, le pain-gâteau, le pain-brioche, le pain-gourmandise. Il est si bon que par timidité nous restons sur notre envie, et nous n’osons pas, à table, redemander du pain plus de deux fois.
Je n’ai avancé que par petits bonds, si j’ose écrire, dans la connaissance des facilités genevoises. La saison hésitait, et d’une couche où l’on souffre on ne prend, de la vie des êtres valides, qu’une vue courte. Huit heures du soir voyaient la fin de mes forces, l’arrivée d’un plateau chargé — crudités, viande grillée, légumes verts, fruits, qui ne sait par cœur le menu dit de régime ? —, puis venait ma récréation lumineuse. Par la fenêtre ouverte, emplie d’un bleu qui devient peu à peu nocturne, je vois un lé de lac, qui reflète un pont, des quais, et jusque passé minuit les enseignes multicolores, les phares, les perles électriques délimitent le lac. Demain, le brouillard matinal me rendra, irisée et quasi mouvante, la cathédrale hissée au-dessus des toits, et les étranges coques de vitres qui couvent les cours intérieures. Demain j’aurai la paisible aurore brumeuse et le tournoi d’hirondelles. Le soir, j’ai les drapeaux de lumière multicolore, qui baignent et s’étirent dans l’eau. Un certain azur publicitaire glorifie l’horlogerie nationale, heurte un vert d’absinthe dont la friction l’exalte, tandis qu’un écarlate se propage jusqu’au ventre en nacelle de trois cygnes, balancés sur leur propre reflet.
C’est un plaisir, certes, que de recevoir en plein visage un spectacle, lumières et ombres, sans se soulever sur un coude, sans tourner le cou, sans s’asseoir sur la couche, de ne le quitter qu’au moment où les paupières le séparent de nous. Ce qui se fait facile est un plaisir, même lorsqu’une goutte amère s’y dissout : si je n’avais pas — là et là, et là encore — cette… enfin ce mal, je n’aurais jamais eu l’idée de mettre mon lit dans l’angle, calculé au plus juste, où son occupante peut sans bouger exploiter trois horizons. L’agile, le dispos n’ont que faire de tant de commodité.
« J’irai moi-même, me dit une amie qui passe quelques jours à Genève, acheter dans les magasins ce qui vous tenterait ici. Confiez-moi une liste. »
C’est aussitôt fait que dit. J’avais depuis longtemps l’envie d’un moulin à poivre de bonne fabrication, un moulin, comme on dit dans mon quartier de Paris, « qui moule » et non pas ce mauvais petit rouage, prompt à s’émousser, qui hante nos bazars. Je voulais une tresse de fil et une tresse de soie, composées d’aiguillées égales et multicolores à l’ancienne manière, nouées à chaque bout comme les cervelas. Je les ai. Un peu maigres, mais un joli travail de natte à la main, une vraie passementerie. Je voulais des boutons pour la lingerie, en nacre, à quatre trous. En nacre, je ne m’en dédis pas. Oui, en nacre, folie et dilapidation ! Et des aiguilles, donc, des aiguilles « anglaises » (quand j’étais petite, leur enveloppe vernissée était déjà imprimée en allemand), des aiguilles que nous appelons, nous autres techniciennes du cousu main, « à chas diminué ». Et de la laine à repriser, en cartes. Et de l’élastique pour coulisser les ceintures des culottes en maille. Et des bobines de fil vieux style, du « fil poissé » pour coudre dans du cuir. Ai-je cousu, couds-je, coudrai-je dans du cuir ? Là n’est pas la question. Et du cordonnet de soie en vraie soie, pour refaire les boutonnières fatiguées des vêtements d’homme… Un étrange bien-être se peut donc puiser dans l’aspect, le contact de certaines « fournitures » que n’a jamais régies, ni modifiées, aucun souci d’esthétique ou de modernité ? Bien sûr. Mais c’est parce que je suis encore riche, je n’utilise pas à la manière ordinaire. Dans un sens magique de contemplation et d’évocation, je m’enrubanne de mercerie. Vous ne vous figuriez tout de même pas qu’elle a su, ma main droite un peu pelotonnée par l’habitude d’écrire, enfanter ce chef-d’œuvre de régularité, de discret relief, de solidité : une boutonnière de vêtement masculin ? J’entends la boutonnière au point de feston, naturellement. L’autre, la boutonnière dite passepoilée, n’offre aucune poésie.
Pour ce qui est des aiguilles à tapisser, la recherche est décevante. En France, néant. En Suisse, le désert. Il y a longtemps que dans les grands magasins français on me répond : « Nous ne connaissons pas ça. Oui, autrefois, je ne dis pas… » avec la tête penchée de côté, vous savez, un peu comme le chien à qui on offre un verre vide, et on me propose, compensatrices, des aiguilles à repriser ! Je projette, quand mon meilleur ami reprendra le volant et sa patience, de m’arrêter à toutes les petites merceries de village, les vraies, celles qui ont encore un portillon et une sonnette, celles qui mettent les boutons dans la boîte à laine, la laine dans le tiroir aux lacets, les lacets dans le compartiment aux fermetures Éclair, celles qui embaument le hareng saur, celles, enfin, où une fillette se tourne vers la sombre arrière-boutique en criant : « Maman, je les trouve pas, ces aiguilles que la dame me parle ! »
*