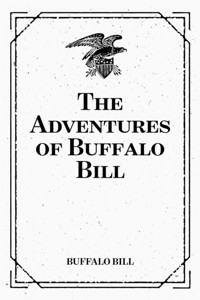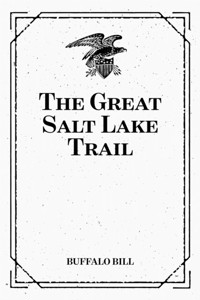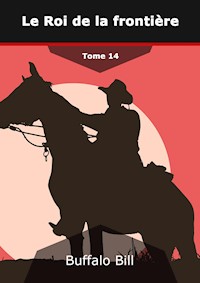2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Qui parmi vous, Camarades, risquera sa vie pour le salut de tous ?... Les volontaires, en avant ! Raide et muet, le régiment avait écouté le discours du Général. Mais à ce moment un frémissement le parcourut, semblable au frisson qui, à l'approche de l'orage, passe sur les tiges d'un champ de blé. En quelques secondes, cédant à cette ardeur exaltée qui nargue la mort, la moitié des hommes fut hors des rangs. Un sourire d'orgueil éclaira la physionomie martiale du Général. -Merci, Camarades ! reprit-il; je n'attendais pas autre chose de vous. Mais j'ai besoin d'un homme qui connaisse assez le pays et qui soit assez familier avec les pratiques des Indiens, pour pouvoir glisser au milieu d'eux sans être pris. S'il en est un parmi vous qui ait l'oeil du faucon et dont la carabine ne manque jamais son coup, que celui-là s'avance !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La course à la mort à travers les campements ennemis.
Pages de titreUn jeune héros.L’enlèvement de la Fiancée.À la vie, à la mort !Au Poteau du Supplice.Pour l’Honneur et la Vie.Bill Cody arrive à ses fins.Page de copyrightBUFFALO BILL
La course à la mort à travers les campements ennemis
Fascicule n° 1
1906-08
Un jeune héros.
C’était dans l’Amérique du Nord, au commencement de la guerre civile.
La garnison du fort Hayes, dans le Kansas, était sous les armes.
Le Général Custer, un des plus fameux chefs des États-Unis, se tenait devant le front du vaillant septième régiment du Kansas, qui formait la garnison du fort. Il promenait son regard scrutateur et perçant sur ces longues files d’hommes dans leur simple uniforme de drap bleu.
Il prit la parole : — Jennison-Jayhawkers ! dit-il en les appelant du surnom célèbre dont le régiment était glorieux. Depuis huit jours j’attends en vain d’importantes dépêches du Général Smith qui commande au fort Leawenworth. Elles ne me parviennent pas. Toutes nos communications sont coupées. Nos vivres peuvent durer encore une demi-semaine, tout au plus. D’ici au fort Larned, le plus proche, où est le Général Sturgis, il y a soixante milles environ, et de là à Leawenworth à peu près autant. Celui qui tenterait de faire ce chemin irait droit à la mort. Je ne donnerais pas un sou de ses chances de vie. Eh bien ! il n’en faut pas moins nous débloquer. Il nous faut des vivres. Contre les forces supérieures de l’ennemi, à peine pouvons-nous tenir encore quelques jours. Qui parmi vous, Camarades, risquera sa vie pour le salut de tous ?… Les volontaires, en avant !
Raide et muet, le régiment avait écouté le discours du Général.
Mais à ce moment un frémissement le parcourut, semblable au frisson qui, à l’approche de l’orage, passe sur les tiges d’un champ de blé.
En quelques secondes, cédant à cette ardeur exaltée qui nargue la mort, la moitié des hommes fut hors des rangs.
Un sourire d’orgueil éclaira la physionomie martiale du Général.
— Merci, Camarades ! reprit-il ; je n’attendais pas autre chose de vous. Mais j’ai besoin d’un homme qui connaisse assez le pays et qui soit assez familier avec les pratiques des Indiens, pour pouvoir glisser au milieu d’eux sans être pris. S’il en est un parmi vous qui ait l’œil du faucon et dont la carabine ne manque jamais son coup, que celui-là s’avance !
Silence partout !
Déconcertés, les soldats l’un après l’autre rentrèrent dans le rang. Aucun ne se sentait à la hauteur des exigences du chef.
À la fin, il ne resta plus devant le Général qu’un tout jeune homme. À peine sorti de l’enfance, il était grand, robuste et bien proportionné, les épaules larges, la poitrine puissamment développée. Son visage était beau, avec des yeux d’un brun clair, une bouche énergique et d’un dessin pur, un nez d’aigle, et des cheveux blonds qui tombaient jusque sur les épaules.
Très surpris, le Général dévisagea le jouvenceau.
Celui-ci soutint sans sourciller ce regard qui lui pénétrait jusqu’à l’âme.
— William Cody, qu’est-ce qui vous prend ? dit enfin le Général. Croyez-vous pouvoir escamoter de cette manière la permission que j’ai dû vous refuser l’autre semaine, après l’arrivée du dernier courrier ? Certes, je suis touché de votre ardeur filiale à vous rendre auprès de votre mère mourante, sans souci des ennemis féroces dont le pays est infesté. Mais aujourd’hui comme l’autre jour, j’ai le devoir de résister à votre prière. Ce que je réclame, c’est un homme fait, habile et réfléchi, non pas un jouvenceau, plein de feu, mais sans expérience.
À ces rudes paroles, le visage du jeune homme se teignit de pourpre. Mais ses traits restèrent immobiles, comme sculptés dans l’airain. À peine ses yeux eurent-ils un éclair trahissant la passion contenue.
— Je suis encore jeune, Général. Mais j’ai grandi dans ce pays. À cent milles à la ronde il n’est pas large comme mon pied de terrain que je ne connaisse. À peine âgé de neuf ans, je dus, pour défendre ma vie, descendre mon premier Peau-Rouge. Depuis combien en ai-je envoyé dans les territoires de chasse des bienheureux !
Ses paroles résonnaient, pleines et profondes. Ses lèvres frémissaient d’orgueil.
Hésitant encore, le Général continuait de regarder le hardi garçon.
Il ne lui avait pas encore répondu, lorsque survint un homme de haute stature, extraordinairement taillé en force et qui, des pieds à la tête, était vêtu de cuir.
Ses cheveux d’un roux sombre pendaient en boucles sur son cou. Il portait toute sa barbe. Ses yeux clairs et lumineux lançaient des regards perçants. Mais il avait un bras en écharpe ; il traînait la jambe gauche et une bande de linge sanglante lui entourait le front.
D’un geste paternel il posa sa main saine sur l’épaule du jeune homme, près de qui il s’était arrêté.
— Je réponds de lui ! dit-il d’une voix profonde. Si ma dernière sortie aux renseignements n’avait pas fait de moi un estropié, je n’aurais laissé à personne l’honneur de faire la nique aux Peaux-Rouges. Mais ma carabine est trop lourde pour moi. Quant à lui, un enfant par les années, mais un héros par l’audace et la vaillance ! Plus malin que le plus rusé Peau-Rouge ! Sa carabine ne manque jamais le but. Si quelqu’un peut s’en tirer, c’est Bill Cody !
Le jeune homme, ainsi loué, rougit encore une fois, mais de plaisir.
D’ailleurs il se tenait toujours droit et fixe devant le Général. Celui-ci le considérait maintenant sous un tout autre jour.
— Votre recommandation est d’un grand poids, California Joe, dit Custer en s’adressant au nouveau-venu, qui était déjà un des éclaireurs les plus fameux des États-Unis et qui devait par la suite acquérir encore plus de renom. Vous répondez du jeune homme, réellement ?
— Comme de moi-même ! répondit le colosse avec un énergique signe de tête. Son père était un brave ; il tenait pour le Nord. Aussi les guérillas l’ont tué. J’étais là quand ce jeune homme a juré de venger ce meurtre dans le sang.
— Et je tiendrai mon serment ! interrompit Bill tandis que son visage devenait sombre et qu’une douleur poignante contractait ses traits. Ce Charles Dunn et son capitaine, ce gueux de Jesse James, peuvent se garder ! L’heure du règlement de compte approche.
— Parles-tu du redouté bandit qu’on appelle Jesse James ? fit le Général. Le Ciel t’évite une rencontre avec lui ! C’est California Joe qui m’en a informé, il rôde avec une forte bande autour de Leawenworth, promenant partout le ravage et les plus hideux forfaits.
— Ah ! si je l’avais en face ! – Cette exclamation toute chaude de haine généreuse, échappa aux lèvres du jeune homme. Il reprit : — Dois-je monter à cheval, Général ?
— Oui, mon jeune ami, tu vas monter à cheval ! répondit Custer. Que le Ciel te protège !
— Je vous remercie, Général, dit le jeune garçon simplement. Avec votre permission, j’irai aussi voir ma mère. Je serai de retour dans trois jours au plus tard.
— Tenez bien votre chapeau, jeune homme, fit le Général, levant un doigt en un geste d’avertissement. Il y va de votre scalpe, cheveux et peau !
— Bah ! Ce serait dommage de le voir orner la ceinture d’un Peau-Rouge, déclara William Cody en riant d’un air d’insouciante bonne humeur. Je ne crains pas ces diables-là. Et puis les malices des guérillas, ça me connaît. Donnez-moi seulement la meilleure mule du fort. Une fois sur son dos, ces démons ne m’en descendront pas.
Une demi-heure après, notre jeune ami était déjà en route dans le silence de la forêt vierge.
À des centaines de milles tout autour de lui s’étendaient les bois et la prairie.
Se rapetissant sur sa selle pour mieux passer parmi les lianes et les branches, Bill dirigeait avec confiance sa mule gris souris, au harnachement sombre, qu’aucun point brillant ne trahissait de loin, à travers le désert infrayé. Une route seule traversait le pays à cette époque ; mais il ne voulait pas s’y risquer.
Avant de partir, il avait changé son uniforme contre des vêtements de cuir. Il portait, cousues dans le collet de sa veste, d’importantes dépêches que le Général lui avait confiées. Dans sa ceinture étaient passés un bowie-knife et un revolver. Une carabine à double canon reposait toute chargée devant lui, en travers de sa selle.
Il allait, sans s’inquiéter de la route. Mais son œil de faucon planait sur tout, et sa fine oreille percevait tous les bruits, même les plus légers.
Le jour était tombé depuis longtemps ; les lueurs rouges du soleil couchant s’éteignaient ; la lune dans son plein se balançait au ciel, et sa pâle lumière étendait dans la forêt une crépusculaire clarté.
Des rochers à pic se dressaient des deux côtés du ravin de plus en plus resserré, où s’était engagé Bill Cody. Il marchait maintenant dans le lit desséché d’un torrent. Au-dessus de lui pendait la chevelure broussailleuse des sapins, dont les branches, avec des gestes de fantôme, frôlaient le cavalier.
Il y avait des heures que Bill chevauchait.
À son estime, il avait déjà fait une quarantaine de milles.
Si la chance lui restait fidèle, il atteindrait bientôt le fort Larned.
Tous ses sens étaient tendus, épiant la moindre possibilité de danger. Mais tout son cœur était là-bas, chez lui.
Sa mère vivait-elle encore ? sa mère, tout ce qu’il possédait de cher en ce monde !
Quelle affreuse semaine il avait passé, depuis le dernier courrier qui était parvenu au fort, maintenant isolé du monde, et qui lui avait apporté une lettre où sa sœur l’informait de la grave maladie de leur mère et de son désir de le voir encore une fois !
Holà ! trêve aux pensées !… Qu’est-ce que c’est que ça ?…
Depuis un moment déjà Bill considérait avec méfiance la masse abrupte d’un rocher qui se dressait directement devant lui dans le fond du ravin.
Tout à coup un point noir se montra sur la crête du roc, pour disparaître aussitôt.
Les Indiens !
Aussitôt le jeune homme distingua un filet de fumée, fin comme un cheveu, qui raya, l’espace d’un clin d’œil, le disque argenté de la lune, et qui venait de derrière les roches.
Bill comprit qu’il était tombé dans un piège. Il y avait derrière lui des Peaux-Rouges aux aguets, et leurs éclaireurs d’avant-garde venaient, avec cette fumée, de leur donner le signal convenu.
Il continua de s’avancer avec le même air d’insouciance, comme s’il n’avait surpris aucun indice de danger.
Mais dès qu’il fut arrivé à une portée de fusil des rochers, il enfonça brusquement ses éperons dans les flancs de sa mule, et la jetant violemment de côté, il la lança à toute bride droit devant lui.
Il put voir alors sur le rocher deux Indiens en grand costume de guerre. En même temps retentissait derrière Bill passant comme une tempête, le cri de guerre des Sioux. Les coquins avaient tendu là une embuscade, pour couper le chemin à tout messager qui irait au fort, ou qui en viendrait.
En moins d’une seconde, Bill avait jugé la situation.
Les deux Peaux-Rouges en avant de lui sur le rocher n’étaient pas montés. Il n’avait pas à les redouter. Mais quel danger n’était-ce point d’avoir dans le dos une bande d’Indiens accourant sur des chevaux rapides ! Leur chef particulièrement, comme le reconnut Bill en tournant la tête, montait un cheval vite comme une flèche.
Au moment où il enlevait vigoureusement sa mule, une véritable flèche lui siffla aux oreilles. Il s’en fallut de l’épaisseur d’un cheveu qu’elle lui frappât la tête. Si cet Indien parvenait à en lancer une seconde, c’en était fait de Bill, car il était bon tireur.
Bill tourna encore une fois la tête, et il vit l’Indien, si près qu’il touchait presque la queue de sa mule, tendant de nouveau son arc.
Prompt comme le vent, Bill leva sa carabine. La détonation retentit dans l’instant même où la flèche allait partir.
Elle retomba, inerte. Le Sioux chancela sur sa selle ; ses bras battirent l’air, et presque aussitôt le cheval sans cavalier, continuant sa course, passa près de Bill Cody.
Au vol, une poigne de fer saisit la bride et arrêta la bête en plein galop.
Elle se cabre et rue furieusement ; mais le moment d’après, avec une souplesse de serpent, Bill a sauté sur le dos du noble coursier, et il lui met les éperons au ventre. Il file comme un vent d’orage, sort du ravin et galope dans la vaste plaine.
Une heure après, Bill avait atteint sans autre encombre le fort Larned, où son arrivée fit sensation.
Officiers et soldats se groupèrent en cercle autour de lui. N’en croyant pas leurs yeux, ils considéraient ce jeune garçon qui, avec l’audace d’un risque-tout, venait de réussir dans une tentative qui, ces derniers jours, avait causé la mort de plusieurs hommes de cœur.
Mais la stupéfaction se changea en effroi lorsque Bill demanda un cheval frais.
Il voulait repartir immédiatement.
— Cela ne se peut absolument pas, déclara le Général Sturgis, devant qui l’on avait conduit le jeune homme. Tenter une telle aventure, c’est courir au devant d’une mort certaine. Des centaines de Sioux tiennent toute la route d’ici à Leawenworth. Jesse James et sa horde y promènent leurs sanglantes horreurs. Toutes les fermes isolées ont été brûlées, les hommes tués, les femmes et les filles violées et emmenées en esclavage.
— Cependant il faut que je passe, reprit Bill avec simplicité. C’est l’ordre du Général Custer. J’exécuterai l’ordre, ou j’y trouverai la mort ; mais rien ne m’arrêtera !
— Pas même ma défense ? demanda le Général, le regard sévère.
— Pas même votre ordre, mon Général, répliqua Bill sans hésiter. J’obéis à une loi non écrite, qui est au-dessus de tous les règlements des hommes : ma mère m’appelle et désire me voir ! J’irai à elle, devrais-je traverser tous les épouvantements de l’Enfer !
Les traits fatigués du Général eurent un tressaillement d’émotion, vite réprimée.
— Eh bien ! va donc, tête folle ! dit-il en grommelant. Tu es jeune et de sang chaud ; garde-toi bien, mon brave !
Dix minutes après, Bill Cody était de nouveau en selle et reprenait sa route.
Au fort Larned, on l’avait averti du danger de traverser le gué qu’il trouverait à quelques milles de là. Quelques jours auparavant un éclaireur, qui s’y était aventuré, s’était noyé.
Bill connaissait parfaitement cette rivière impétueuse. Mais il n’y avait pas, sur un parcours de plusieurs milles, d’autre endroit où l’on pût la franchir. Il connaissait même, dans le voisinage du gué, une caverne cachée parmi des rochers, qui communiquait par un passage souterrain naturel avec la rive du Missouri.
Bien peu de gens savaient l’existence de cette caverne. Personne, peut-être ! Bill avait découvert ce secret par hasard, un jour qu’il poursuivait un ours.
Il pensa qu’au pis aller il s’y réfugierait, s’il avait encore des ennemis sur ses talons de ce côté-ci du gué.
Autour de lui, c’était la nuit opaque et profonde. Pas un bruit, pas une lueur ; la lune même avait disparue du ciel ; seule, l’eau murmurait en suivant son cours.
Bill se risqua ; il fit entrer son cheval dans la rivière.
Les sabots de l’animal s’enfoncèrent dans l’eau invisible. Clapotant doucement, elle monta peu à peu jusqu’au-dessus de sa croupe. Bill finit par en avoir jusqu’à la poitrine.
Le cheval ronflait sourdement, comme oppressé par une angoisse.
Enfin les sabots ferrés sonnèrent de nouveau contre les pierres. Le niveau de l’eau baissa. Le courant ne se fit plus sentir. On avait atteint l’autre rive.
Bill retint son cheval de la bride, pour écouter dans la nuit.
Mais au même moment il sentit quelque chose de glacé qui lui touchait le front, et une voix rude et menaçante, quoique étouffée, gronda :
— Les mains en l’air !
Même à cette distance, Bill ne voyait rien. Mais il comprit qu’on lui appliquait sur la tempe le canon d’un revolver. Puis il distingua confusément une face sauvage et barbue dont le possesseur était juché sur un mulet, et il ne put retenir ce cri :
— Charles Dunn !
En même temps un frisson lui courait partout. Il venait de reconnaître l’homme au pouvoir de qui il était si inopinément tombé. Ce Charles Dunn était l’assassin de son père.
Encore enfant, Bill avait dû être le témoin impuissant de la façon dont, sur l’ordre du féroce Jesse James, suivi d’une bande de canailles en furie, Charles Dunn avait abattu d’une balle son père bien aimé.
C’est alors que le faible enfant avait juré de venger la mort de ce père chéri sur l’ignoble meurtrier et sur son capitaine. Hélas ! voilà qu’il se trouvait lui-même au pouvoir du coquin !
L’homme barbu fut étonné d’entendre son nom sortir des lèvres de son prisonnier.
— Messager du fort, sans doute… porteur de dépêches, hein ? fit-il en ricanant. Et il se mit en devoir d’enlever à Bill ses armes ; il lui arracha des hanches sa ceinture, avec le coutelas et le revolver qu’elle portait.
Bill tenait toujours les mains en l’air, au-dessus de sa tête ; mais avec d’infinies précautions, il avait retiré ses pieds de leurs étriers de cuir.