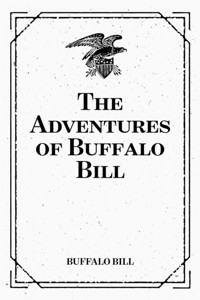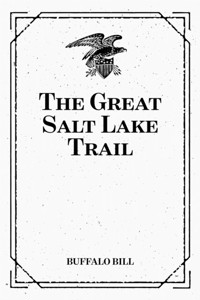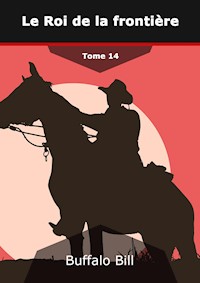2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Quatre cavaliers, dont un anglais, sont poursuivis par les Indiens, lorsque Buffalo Bill arrive à leur rescousse. Lord Elston explique à Buffalo Bill la raison de ce voyage en Amérique. Il souhaite avoir la preuve de la mort de son frère, lequel est censé avoir été tué par des indiens. Mais Buffalo Bill doute que les indiens soient coupables. Ils se rendent dans le camp du chef Indien le Coeur Rouge pour avoir le coeur net...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
La Piste de la vengeance
Pages de titreCourez ! Il y va de la vie.Une étrange rencontre.Les deux frères.Un complot.Une femme de la frontière.Les révélations d’une tombe.La caverne cachée.Un duel étrange.Un médaillon compromettant.Œil Étoilé.Une vengeresse sur la piste.Pris au piège.Dans le repaire des outlaws.Un lâche exploit.Wild Nell reçoit des visites.Démasqué.La fin d’un bandit.Page de copyrightBUFFALO BILL
LA PISTE DE LA VENGEANCE
ou Le Secret d’une Tombe
Fascicule n° 8
1906-1908
Courez ! Il y va de la vie.
Quatre cavaliers couraient en dévorant l’espace à travers une prairie de l’Ouest, poussant leurs chevaux au maximum de leur vitesse, pour échapper aux ennemis impitoyables qui les poursuivaient.
C’était une bande d’une cinquantaine d’Indiens, s’échelonnant sur une longue ligne, suivant la rapidité plus ou moins grande de leurs poneys.
Les quatre fugitifs étaient bien montés, mais ils conduisaient plusieurs bêtes de bât qui les retardaient et qu’évidemment ils ne se décideraient à abandonner qu’à la dernière extrémité.
Deux d’entre eux étaient des hommes de la plaine, personne ne pouvait s’y méprendre, cavaliers rudes et sans peur, battus des intempéries, durs au combat, en un mot de parfaits bordermen, bien montés, bien armés, vêtus de peau de daim avec de grands sombreros ombrageant leurs sévères figures, prêts à faire feu et à mourir là simplement, s’ils étaient appelés à le faire.
Les deux autres étaient d’un type différent, anglais sans aucun doute.
L’un était un homme de trente ans, sévère de figure, fortement bronzé, beau de traits, bien bâti, ayant l’air d’un soldat qui aurait passé par un dur service et qui serait loyal comme l’acier.
Bien habillé dans son costume de chasse, armé d’une carabine et de revolvers du dernier modèle, montant un cheval splendide, il paraissait juste ce qu’il était, un gentleman anglais venu en Amérique avec un but qu’il avait la volonté bien arrêtée d’atteindre, s’il était au pouvoir de l’homme de le faire.
Le quatrième cavalier était le serviteur et à la fois le compagnon de l’autre, anglais également.
Tous quatre pressaient désespérément leur monture, pour atteindre une élévation de terrain à plusieurs milles devant eux, où se trouvaient un épais bouquet d’arbres et des rochers disséminés.
Une fois là, ils auraient, du moins, un abri pour eux et leurs chevaux, et une chance d’obvier à l’infériorité si marquée de leur nombre.
— Ça nous ferait un homme de moins dans le tas – qui n’est pas gros, – mais je pense monsieur, qu’il serait mieux de prendre, Barney ou moi, la meilleure bête et de continuer tout droit jusqu’au fort pour avoir du secours ; car une fois que nous serons tous cernés dans ces arbres, il faudra nous en tirer tout seuls, sans aucun espoir d’une aide quelconque.
Ainsi disait, tout en galopant, un des bordermen en s’adressant à l’Anglais qui paraissait le chef.
— Vous savez ce qu’il en est mieux que nous, guide. Faites donc suivant votre jugement. Nous atteindrons les arbres sans doute, mais ce sera bien juste, et l’avance sera mince. Peut-être mon cheval serait-il le meilleur pour fournir cette course. À quelle distance est-ce ?
Il n’y avait aucune inquiétude dans le ton ou dans la physionomie de l’Anglais, qui se retourna pour jeter froidement un regard rapide sur les Indiens.
— Trente milles sûrement, monsieur. C’est Barney qui est le plus léger et qui, par conséquent devrait y aller. Seulement nous garderions ses armes, dont nous pouvons avoir besoin, à l’exception de son fusil qu’il emporterait pour se défendre contre un danger imprévu.
— J’irai, dit alors Barney, quoique je ne désire pas vous abandonner ; mais pour moi, c’est comme s’il n’y avait pas d’espoir pour ceux qui restent, ce qui ne m’empêchera pas de faire de mon mieux pour avoir le secours du fort.
Ce n’était pas encourageant, mais c’était dit à des hommes qui savaient regarder carrément la mort en face.
— C’est une circonstance étrange, dit l’Anglais, que j’ai eu un frère de tué dans ces plaines américaines, il y a près de deux ans, et par des Indiens. Carrol, mon homme de confiance, ici présent, l’accompagnait. Au cours d’une expédition de chasse contre la grosse bête, comme le buffle et l’ours, s’étant écarté seul du campement, il fut surpris et massacré. Du moins c’est l’histoire qu’on m’a racontée. On retrouva son corps, scalpé et percé de balles. Carrol le fit enterrer et revint en Angleterre. Moi, si je suis ici maintenant, c’est pour visiter la tombe où sont ses restes.
— C’était bien son corps, il n’y avait pas de doute, monsieur ; bien qu’il fût difficile à reconnaître, j’en conviens, car on ne le retrouva qu’au bout de quelques jours.
— Sans doute c’était lui, mais il faut que j’en aie la preuve.
Et regardant de nouveau derrière lui, l’Anglais ajouta :
— Les premiers gagnent sur nous régulièrement.
— Oui, ces bêtes de bât ne peuvent pas aller de la même allure qu’un cheval de selle. Mais accrochons-nous avec la ténacité farouche de la mort à nos vivres et à nos effets, voilà mon conseil, dit le guide Barney.
— Oh ! oui, si nous devons nous arrêter et combattre. Mais je crois que nous pourrons encore faire bonne figure, une fois que nous serons dans les arbres, fit remarquer l’Anglais.
— Si ce n’est nous, ce sera les Indiens, dit un des bordermen sans sourciller.
Ils approchaient alors de ces arbres qui croissaient serrés sur une élévation de terrain considérable, bordée de petites éminences et de blocs de rocher polis, qui offriraient un bon abri à la défense.
— Barney, dit Bruce Bond, l’un des guides, à son camarade, soyez tout prêt à repartir dès que nous aurons touché les arbres. Et vous ferez bien de prendre le cheval du gentleman, c’est le plus capable de faire l’ouvrage. Il vous faut quatre heures pour aller au fort, une heure pour faire préparer les soldats, et pas moins de cinq heures pour revenir, soit dix heures en tout, et ne leur laissez pas ignorer que nous défendons notre vie dans des circonstances où toutes les chances sont contre nous, en face d’ennemis qui ont une terrible envie de cueillir nos scalpes.
— Mes chevaux ne se sentiront pas tranquilles tant que je n’aurai pas sauvé les vôtres, camarades. Donc, comptez que le secours viendra aussi vite qu’il est possible de l’amener, et qu’il coulera du sang indien si nous vous trouvons anéantis.
Les Indiens, cependant, gagnaient du terrain, et à la façon dont ils s’efforçaient d’accélérer leur allure, il était clair qu’ils voulaient tomber sur les Visages Pâles avant que ceux-ci eussent le loisir de prendre aucune disposition pour soutenir l’attaque.
Les fugitifs néanmoins, approchaient de plus en plus des arbres ; un instant après ils étaient dans leur ombre, avec une douzaine de cavaliers rouges tout près derrière eux, et trois fois autant qui se hâtaient à différentes distances, mais à moins d’un mille dans la plaine.
Bruce Bond avait choisi de l’œil le point où ils entreraient sous les arbres, et les guidait de ce côté, lorsque soudain, un cavalier sortit du fourré droit dans leur direction, épaula vivement sa carabine et pressa la détente.
Avec la détonation, un chef indien qui courait en tête tomba à la renverse de son poney, un guerrier qui le suivait culbuta de sa selle la tête la première au second coup de feu, et un puissant et farouche cri de guerre sortit des lèvres du cavalier, que les deux guides et les Indiens reconnurent immédiatement.
— La longue Chevelure, Pae-has-ka, La longue Chevelure ! criaient les Indiens sur des tons divers de surprise, de colère et d’effroi.
— Buffalo Bill ! s’exclama Bruce Bond, le guide chef, d’une voix vibrante de joie.
Une étrange rencontre.
— Abritez les chevaux derrière, tous… puis demi-tour et tir à volonté. Il faut repousser ces rouges… Allons.
Ainsi parla d’une voix de commandement que les Indiens eux-mêmes entendirent, le cavalier qui, seul, était venu au secours de l’Anglais et de ses gens.
— Faut-il que j’aille au fort chercher du secours, chef Bill ? cria le guide Brad Barney.
— Non, j’ai du secours à portée d’entendre nos carabines. Tenez-vous prêts, tous !
En même temps qu’il donnait cet ordre, le cavalier qui s’était hâté de conduire son cheval sous l’abri des arbres, accourut faire face à la charge des Indiens.
L’Anglais et son serviteur se placèrent vivement à côté de lui, regardant avec admiration l’air magnifique de cet homme qui avait risqué sa vie pour les aider.
De l’autre côté étaient les deux guides.
Tous étaient prêts à l’action.
Les Indiens avaient hésité sous le feu meurtrier du cavalier si soudainement apparu, mais c’était seulement pour donner le temps à d’autres d’arriver et charger avec des forces supérieures ceux dont ils avaient cru tout à l’heure faire facilement leur proie.
— Les voilà !… Pas de poudre aux moineaux !… Feu ! ordonna le hardi et généreux organisateur de la résistance.
Et les cinq carabines crépitèrent en même temps.
— Feu à volonté !… et visez bien ! ordonna-t-il encore.
Sous cette fusillade froidement méthodique et déterminée, dont tous les coups portaient la mort parmi eux, les Peaux-Rouges fluctuèrent, et après avoir tiré quelques coups de fusil et envoyé une averse de flèches dans les arbres, ils s’enfuirent hors de portée.
Ils n’osèrent plus avancer tant que toutes leurs forces ne furent pas réunies.
Mais alors, étant dix contre un, ils allaient se précipiter dans un assaut irrésistible et massacrer les blancs écrasés sous le nombre, dût la moitié de leurs guerriers tomber dans la lutte, lorsqu’éclatèrent des sons de clairon, et les cinq Visages Pâles poussèrent une acclamation joyeuse et triomphale.
— Ah ! le capitaine Dangerfield a entendu notre feu, il soupçonne que je suis en péril et c’est sa manière de me dire qu’il arrive.
— Oui, et les rouges l’entendent aussi… Regardez-les s’en aller ! s’écria Brad Barney.
— Ça y est, c’est un fait ! Mais nous vous devons la vie, Chef Bill, car ils nous seraient tombés dessus, sûr et certain, et nous auraient écrasés dans une de leurs charges enragées, si vous n’aviez pas été là, dit Bruce Bond.
— Ça se serait passé peut-être comme ça, peut-être autrement, répliqua-t-il modestement, et il se tourna vers l’Anglais, qui avait une flèche plantée dans la manche de son habit.
— Vous êtes blessé, je le crains, monsieur, dit-il.
— Ce n’est rien… une égratignure, et je suis charmé que ce ne soit pas pire. Et vous mon brave ami ?
— Ça va très bien, merci, monsieur, et les autres ne semblent pas plus mal que moi, ajouta-t-il en jetant un regard au domestique Carrol et aux deux guides.
— Nous allons très bien, camarade Cody, grâce à vous, dit Bruce Bond.
Brad Barney approuva en disant :
— Oui, camarade, et vous êtes toujours l’homme qui survient pour aider celui qui est en péril. C’est de la chance que vous ayez été si près.
— Je suis en reconnaissance avec le capitaine Dangerfield et sa troupe. Les voilà qui viennent ; mais les Indiens se sauvent, vous voyez.
Il désignait du doigt une lointaine ondulation de la prairie où un détachement de cavalerie se faisait rapidement visible, tandis que les Peaux-Rouges se dispersaient en toute hâte.
— Mon ami, lui dit l’Anglais, je vous dois la vie ; de fait, nous vous la devons tous, et je vous assure que votre courageuse action, je ne l’oublierai jamais. Laissez-moi me présenter à vous. Je suis Lord Victor Elstone d’Angleterre, venu en Amérique pour une affaire importante, accompagné de mon bon serviteur Carrol, ici présent, sous la conduite de ces deux hommes de la frontière qui devaient me guider jusqu’au fort.
— Je suis heureux de vous rencontrer monsieur. Mon nom est William F. Cody et l’on m’appelle dans ces plaines Buffalo Bill.
— Ah ! j’ai entendu parler de vous. Vous êtes justement l’homme que je voulais voir en venant en Amérique, monsieur.
Et ils se serrèrent chaleureusement la main, le noble Anglais grandement impressionné par le beau et hardi visage de cet homme de la frontière et par son aspect général, si singulièrement remarquable et attirant.
— En vérité monsieur, vous êtes venu pour me voir ? demanda le chef des éclaireurs d’un air surpris.
— Oui, certainement, monsieur.
— Elstone, c’est votre nom, avez-vous dit, monsieur ?
— Oui, Victor Elstone, officier de l’armée britannique.
— J’ai connu un officier anglais de ce nom… ou plutôt… c’était le major Walter Elstone.
— Mon frère, monsieur, dont la mort ici, dans ces plaines américaines, m’a fait l’héritier de ses titres et de ses biens, le pauvre garçon !
— Je suis vraiment heureux de vous connaître monsieur. J’ai enterré votre malheureux frère il y a plus d’un an, car il a été tué ici.
— Alors, monsieur, vous êtes entre tous, l’homme qui peut me donner les renseignements que je cherche, dit Lord Elstone, montrant sur son visage le sentiment profond de regret que lui laissait son frère disparu, mêlé au plaisir d’avoir rencontré le fameux éclaireur Buffalo Bill dans des circonstances si imprévues et si tragiques à la fois.
Les deux frères.
Buffalo Bill et l’Anglais se trouvaient à l’écart des autres. Le domestique Carrol et les deux guides étaient allés sur la lisière même du petit bois pour regarder l’arrivée de la cavalerie et la fuite des Indiens. Ceux-ci s’étaient arrêtés et ralliés et paraissaient opérer un retour offensif contre les soldats.
— Ne tirez pas sur eux les hommes ! cria Buffalo Bill. Ils veulent simplement ramasser leurs morts et leurs blessés. S’ils font mine d’attaquer, le capitaine Dangerfield les traitera de la bonne manière. Quant à moi, je ne tue jamais un Peau-Rouge qu’il ne m’y force.
Ces paroles furent une surprise pour l’officier anglais. Cependant les Indiens montrèrent tout de suite que l’éclaireur avait dit vrai. Ils arrivèrent au grand galop tout près des arbres, ramassèrent précipitamment leurs morts et leurs blessés et se retirèrent aussi vite qu’ils étaient venus, avant que la cavalerie fût à portée.
Mais les cavaliers interrompirent leur marche vers le bouquet d’arbres et donnèrent la chasse aux Peaux-Rouges qui s’enfuyaient.
Quand Lord Elstone vit ce mouvement, il profita du temps qu’il restait encore seul avec Buffalo Bill pour lui exprimer de nouveau sa reconnaissance, et lui répéter qu’il était d’autant plus heureux de l’avoir rencontré que c’était pour le voir qu’il était venu en Amérique.
— En vérité, monsieur ! lui répondit Buffalo Bill d’un ton mal convaincu. J’imagine que c’est pour m’avoir comme guide dans une chasse à la grosse bête.
— Point ! C’est parce que j’ai besoin de vos précieux services dans une mission plutôt triste, et laissez-moi vous dire que je suis extrêmement désireux de vous engager tout de suite, au prix qu’il vous plaira de fixer vous-même.
— Je suis un officier du Gouvernement, monsieur, en ma qualité de Chef des Scouts de l’Armée, au fort McPherson. Par conséquent je ne peux accepter d’être payé par vous. Mais si je peux vous servir et que le Général veuille m’en accorder la permission, commandez-moi je vous prie.
— Vous êtes vraiment on ne peut plus aimable, et je vais vous dire tout de suite de quoi il s’agit.
— Je serai heureux de l’apprendre, monsieur.
— Vous avez dit, il y a quelques minutes, que vous aviez enterré le corps de mon pauvre frère Walter ?
— Oui, monsieur.
— Il avait été massacré par les Indiens, telle fut la nouvelle qui nous parvint en Angleterre.
— C’est ce qu’on a dit ici, monsieur.
— Alors vous pouvez garantir le fait ?
— Je peux garantir le fait qu’il a été massacré, monsieur, et que je l’ai enterré.
— Alors il n’y a aucun doute de sa mort, monsieur ?
— Aucun, s’il était Lord Walter Elstone et votre frère ; vous avez d’ailleurs avec lui une ressemblance frappante.
— Il s’est élevé, dans l’esprit de plusieurs personnes en Angleterre, un doute contre la certitude de la mort de mon frère, quoique le titre et les biens de la famille m’aient été transmis sans aucune difficulté. À cette époque, j’étais dans l’Inde avec mon régiment de cavalerie ; j’avais servi longtemps à l’étranger, en Afrique, en Australie, mais cette mort me rappela en Angleterre. Ce n’est que tout récemment que la jeune personne qui lui était fiancée m’exprima un doute sur sa mort, en suggérant que ce pouvait être quelqu’un autre que Walter. Naturellement cette idée me troubla et résolus de venir m’assurer de la vérité moi-même. Je me suis fait accompagner de Carrol, le domestique de mon frère, et je remarque que, bien qu’il affirme que personne ne doutait alors que le corps trouvé mort, de mort violente et qu’ils enterrèrent ne fût celui de Lord Walter Elstone, ce corps était dans un état tel qu’il put y avoir erreur. On peut supposer, et c’est ce que me disait la personne dont je viens de parler, que Walter a été pris par les Indiens et est encore prisonnier. Je viens pour découvrir la vérité, recueillir toutes les preuves ; or, comme mon frère a eu le pouce de la main gauche enlevé d’un coup de sabre dans un combat, et la jambe du même côté cassée au-dessus et au-dessous du genou, ces marques doivent se retrouver sur le corps.
— Il n’y a pas de doute, monsieur.
— Et vous pouvez me conduire à la tombe du corps que vous avez enterré comme celui de Lord Walter ?
— Oh, oui, monsieur. J’ai souvent, depuis campé auprès, dans le bois, et chaque fois j’éprouvais de la peine pour ce jeune Anglais, dont le sort fut si triste, et que tous ceux qui avaient été en relations avec lui aimaient.
— Eh bien ! nous irons à cette tombe, et le secret qu’elle contient se révélera.
— Oui, monsieur. Mais puis-je hasarder un conseil ?
— Autant que vous le voudrez.
— Vos deux guides savent-ils pourquoi vous venez ici ?
— Non, si ce n’est que je désire voir la tombe.
— J’en suis bien aise.
— Je les ai engagés purement et simplement pour m’escorter et me guider jusqu’au fort.
— Votre domestique sait ?…
— C’est une chose étrange que je ne lui ai jamais rien dit, si ce n’est que je désirais être certain que c’était bien le corps de mon frère qu’il avait reconnu ou cru reconnaître.
— Parfait, monsieur ! Mon conseil est que vous ne disiez à personne ici, sauf au commandant du fort, la raison exacte de votre venue, et que vous laissiez supposer que vous êtes ici pour faire des chasses, et aussi pour transporter les restes de votre frère en Angleterre.
— Je ferai comme vous le désirez, monsieur.
— J’ai, monsieur, un motif que je ne peux pas expliquer maintenant si ce n’est en disant que je ne crois pas que votre frère ait été tué par les Indiens.