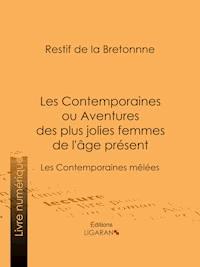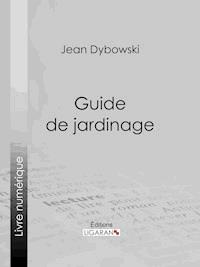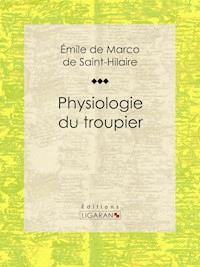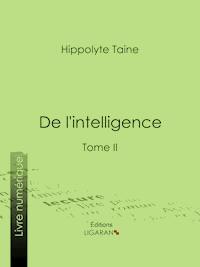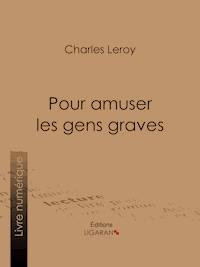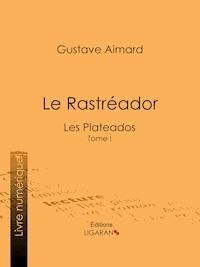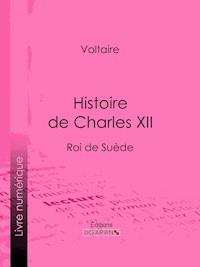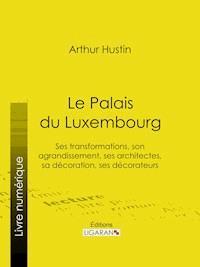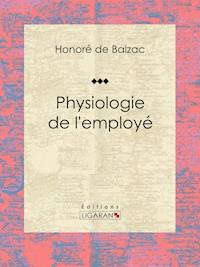Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "Ceci n'est pas un livre, au sens ordinaire du mot. Il n'y faut point chercher une aventure d'amour. Estelle n'épouse pas Némorin au dernier chapitre et nul Bartholo n'y cherche inutilement à protéger Rosine contre les entreprises de Lindor. Et cependant c'est un roman : le roman de la Femme, écrit d'après les chroniques et les légendes. C'est l'histoire de ses grandeurs et de ses décadences successives".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À
SON ALTESSE ROYALE
L’INFANTE EULALIE D’ESPAGNE
Ces douze conférences-causeries ont été faites à Paris chez Mme S. Poirson
EN 1899 ET 1900
EN PRÉSENCE DE :
S.A.R. L’INFANTE EULALIE D’ESPAGNE.
Ceci n’est pas un livre, au sens ordinaire du mot.
Il n’y faut point chercher une aventure d’amour. Estelle n’y épouse pas Némorin au dernier chapitre et nul Bartholo n’y cherche inutilement à protéger Rosine contre les entreprises de Lindor.
Et cependant c’est un roman : le roman de la Femme, écrit d’après les chroniques et les légendes. C’est l’histoire de ses grandeurs et de ses décadences successives ; celle de l’influence occulte ou visible qu’elle exerce de tout temps sur les mœurs.
En douze causeries, destinées, en principe, à être prononcées devant une assistance féminine restreinte, et que, pour répondre à de flatteuses sollicitations, il a réunies en volume en leur conservant fidèlement leur forme d’origine, l’auteur s’est volontairement borné à recueillir dans les ouvrages des historiens, des philosophes, des conteurs et même des compilateurs un assez grand nombre d’anecdotes amusantes, pittoresques et caractéristiques et à les relier entre elles par des commentaires utiles à sa démonstration, – car il s’agissait de démontrer quelque chose, ou sinon à quoi bon écrire ?
Ce quelque chose, le voici :
La grandeur et la prospérité des sociétés correspondent toujours à un équilibre parfait entre les deux forces, masculine et féminine.
La rupture de cet équilibre au bénéfice de l’une ou de l’autre se traduit inévitablement par un état morbide. Si c’est l’Homme qui l’emporte, les sociétés inclinent vers la brutalité et l’obscurantisme barbare. Si c’est la Femme qui domine, son autorité sans mesure se change en despotisme licencieux, et alors… c’est le cataclysme !
Cette vérité peut paraître arbitraire, mais ne saurait être méconnue. Il suffit d’ouvrir l’Histoire et de tirer des évènements la philosophie qu’ils comportent.
C’est à quoi tend cette étude.
À notre époque de féminisme à outrance, il n’était peut-être pas sans intérêt d’étudier la grande loi de l’harmonie des sexes, qui n’assure pas seulement la pérennité des races par une collaboration physique, mais qui affirme surtout leur santé morale et leur glorieux développement par la communion des esprits et des cœurs.
Les pages qu’on va lire n’ont d’autre ambition que de distraire un instant et se défendent de toute solennité pédantesque. Que si, parfois, quelques réflexions se mêlent au récit, c’est à la manière des « moralités » qui terminent les fables. L’auteur se tiendra pour amplement satisfait si l’on veut bien reconnaître qu’il a réussi à prouver, par des exemples irréfutables, la sagesse de Petrucchio relevant la méchante mise à la raison agenouillée devant lui et lui disant avec tendresse :
– Non ! pas ainsi, Catharina. Ni trop haut, ni trop bas. Pose ta tête sur ma poitrine : à la place du cœur !
M. L.
ALTESSE,
MESDAMES,
Au moment de prendre la parole, j’éprouve une certaine gêne et une grande confusion. La présence d’une AUDITRICE auguste ne serait pas pour calmer mon émoi légitime, si je n’y voyais avec joie la preuve que, à l’esprit des grands, de certains, du moins, en qui le cœur est aussi haut placé que le nom, les plaisirs littéraires, les préoccupations artistiques offrent un irrésistible attrait. Mais la tâche qui m’est imposée, tâche que votre bienveillance me donnait seule le droit d’entreprendre, présente de telles difficultés que je n’ai d’autre ressource, pour m’en tirer à mon honneur, que de m’en remettre complètement à vous…
Soyez-moi donc, comme toujours, accueillantes, et, s’il m’est permis,
ALTESSE,
de transgresser les lois rigoureuses de l’étiquette en m’adressant directement à Vous-même, je dirai : Donnez-moi l’espoir que, quoi qu’il puisse advenir de ces entretiens intimes, leur sort est en bonnes mains puisqu’il se trouve entre les VÔTRES. Malgré tous leurs efforts, la voix des poètes ne peut parvenir à l’oreille des grands que s’ils daignent se pencher un peu pour l’entendre… Que VOTRE ALTESSE daigne se pencher beaucoup, car ma voix est faible et je suis loin d’avoir l’autorité suffisante pour traiter un pareil sujet devant un tel auditoire…
Et vous aussi, Mesdames, faites les premiers pas, rompez vous-mêmes la glace. Il y va du plaisir spécial que vous êtes venues chercher en ces causeries et que vous ne trouverez sûrement que si, par votre bonne volonté, par votre indulgente attention, vous consentez à l’apporter vous-mêmes.
Je viens de dire que j’étais embarrassé de parler ici. C’est qu’en effet la difficulté du sujet en lui-même est doublée par le fait des conditions exceptionnelles dans lesquelles nous devons le traiter…
Parler des femmes est toujours fort difficile, mais en parler devant un auditoire d’où l’élément masculin a été systématiquement exclu, et pour cause, cela est encore plus grave, vous en conviendrez. Vous parler de vous à vous-mêmes, vous dire le rôle que vos grandes aïeules ont joué dans l’histoire du monde ; vous montrer l’influence toujours considérable, souvent heureuse et parfois néfaste qu’elles ont exercée sur leur temps ; vous les faire voir puissantes et redoutables en dépit de cette faiblesse apparente qui est leur véritable force ; les surprendre partout, dans les arts, dans la politique, dans la vie sociale, exerçant, comme en un jeu diabolique, leur action directe ou indirecte ; faire défiler devant vous ce magnifique cortège de conductrices de peuples, traînant à leur suite, dans les plis de leurs robes, les conquérants invincibles ou, du moins, invaincus ; vous montrer, dans un kaléidoscope, Adam aux genoux d’Ève, la première tentatrice ; Hercule tournant le fuseau d’Omphale ; Cléopâtre, balançant pendant une heure la fortune des Césars ; Aspasie inspirant à Périclès ces discours qui enflammaient la Grèce d’une ardente piété pour les dieux immortels ; Sappho, la lyre en mains, chantant l’hymne radieux de l’invincible amour ; « Archipiada ne Thaïs qui fut sa cousine germaine » ; comme, aussi, vous dire « qu’elle fut la reine qui commanda que Buridan fût jeté dans un sac en Seine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu’Anglais brûlèrent à Rouen, Haremburge qui tint le Maine et toutes les neiges d’antan » ; faire, pour un instant, revivre dans cette cour d’esprit la grâce adorable des belles « cours d’amour » ; vous rappeler les rois esclaves de vilaines et les vilains, pendant leur sommeil, baisés aux lèvres par des reines éprises de doux langage ; vous promener dans cet hôtel de Rambouillet où d’admirables femmes d’esprit, qui furent aussi des femmes de grand cœur créèrent cette belle langue française, si pure, si claire, si noble, qui, sur vos lèvres de Parisiennes du XIXe siècle, étincelle et flamboie en éblouissantes causeries ; vous parler de Marion de Lorme et de Ninon, d’Odette et de Diane, de Montespan et de Fontange, de la Vallière et de Maintenon ; vous conter Pompadour, de Mailly, des Tournelles ; plaider pour du Barry ; expliquer Barras par Lange, Napoléon par Joséphine ; excuser Tallien ; dénimber Récamier ; soulever le masque de Pauline Borghèse ; discuter Longueville ; prôner George Sand ; sans omettre Laure, Béatrice, la Fornarina et ces admirables Égéries qui furent au Sanzio comme à Buonarotti, à André del Sarto aussi bien qu’à Cellini, ce que le soleil est à la fleur, ce que le génie est à l’artiste, ce que l’inspiration et la Muse sont au poète !… vous conviendrez, si vaste est le programme ! qu’il y a quelque témérité en cette entreprise…
C’est l’Histoire universelle, tout simplement, et Bossuet lui-même eût hésité devant un pareil discours.
Je ne suis pas Bossuet… C’est précisément ce qui me permet d’aborder ce sujet : les inconscients, seuls, ont certaines audaces, et puis j’entends rester sur le terrain de la familiarité et ne point vous fatiguer par le sot étalage d’une insupportable érudition. Je ne veux que vous conter des fables, déterrer, pour votre plaisir, d’amusantes et pittoresques anecdotes, et vous laisser tirer vous-mêmes, des faits évoqués, la morale et parfois aussi l’immoralité de l’Histoire.
C’est une revue sans prétention que nous allons passer ensemble, une revue de vos forces et aussi de vos faiblesses.
Au moment où s’achève ce XIXe siècle en lequel vous jouâtes un rôle si brillant, au moment où s’ouvre le siècle nouveau qui vous devra, comme les autres, son éclat et sa gloire, l’instant est bien choisi d’établir le bilan de vos bonnes et de vos mauvaises fortunes, de dresser la liste de vos victoires et de faire la critique des savantes manœuvres qui, de tout temps, assurèrent vos triomphes…
Vous comprenez, maintenant, pourquoi les hommes ont été justement écartés de ces réunions ! Ce sont eux les vaincus dans la lutte des sexes. Il était inutile de leur rappeler par quelles fautes, éternellement les mêmes, ils ont constamment perdu toutes les batailles. C’eût été, de ma part, trahir votre cause que j’ai, au contraire, le ferme propos de pouvoir longtemps servir…
Si vous le voulez bien, maintenant que la connaissance est faite et que je vous ai loyalement exposé ma profession de foi, nous allons commencer l’excursion et suivre l’éternel féminin dans sa route capricieuse à travers l’histoire. Bien des surprises vous sont réservées au cours de ce voyage que nous accomplirons en six petites journées.
Six étapes, ce serait beaucoup pour des cerveaux oisifs, mais c’est peu pour les vôtres, avides de connaître ou désireux de se ressouvenir et c’est à peine suffisant pour ne voir, même que superficiellement, les choses essentielles, c’est assez cependant pour juger de l’ensemble… Nous sommes ici dans un salon où les regards se posent agréablement sur les diverses manifestations d’un art gracieux et aimable et dont les murs ne rappellent en rien l’austérité de Port-Royal ou du Collège de France, et notre charmante hôtesse m’en voudrait si j’affectais des allures didactiques.
Oh ! ce n’est pas que je ne puisse, hélas ! trop facilement, être aussi ennuyeux qu’un autre, mais je m’efforcerai, au contraire, de vous distraire de mon mieux.
Alfred de Musset a dit en quelque endroit :
Je dirai après lui : c’est ma manière, à moi, d’amuser mes auditoires. On retient mieux les choses écoutées en souriant. Depuis dix ans, cette méthode m’a toujours réussi : je la crois bonne et je m’y tiens.
ASPASIE.– PHRYNÉ. – LAÏS.– LÉŒNA.– PLANGON
La route s’ouvre devant vous toute fleurie et ne présente que des aspects séduisants dans des paysages peuplés de dieux de marbre, sous le radieux soleil de la Grèce antique, dans cette Ionie chantée par les poètes, dans cette Attique immortelle qui fut le berceau de notre France moderne et à laquelle tant de secrètes affinités nous rattachent…
Figurez-vous ce pays bienheureux « où quatre mille dieux n’avaient pas un athée », où les joies et les peines elles-mêmes étaient pour un peuple plein de foi la révélation d’une volonté céleste, où le pâtre conversait sous les ombrages sacrés avec les nymphes rieuses et clémentes, où, penché sur son urne de marbre, le vieil Ilissos assistait, débonnaire, aux ébats joyeux des faunes lascifs, où l’air attiédi, sous un ciel d’une pureté sans seconde, caressait voluptueusement la chaste nudité des corps, inspirant les pensées sereines et mettant dans les cœurs le respectueux amour des choses créées en un jour de joie par des dieux épris de beauté.
Dans les villes, tout sourit aux regards : palais et demeures plus modestes semblent issus du sol à l’appel d’une lyre divine, les temples déploient leurs blanches colonnades de marbre de Paros, et, sur les places publiques, des orateurs à la parole de miel haranguent un peuple souriant et vif, prompt aux enthousiasmes, se grisant de mots, capable de grandes choses, pourvu qu’on les lui présente sous un jour attrayant, amoureux de spectacles et toujours prêt à suivre, – dussent-ils le conduire aux pires abîmes, comme dans la vieille légende allemande, – un beau parleur ou quelque habile joueur de flûte.
Toute cette élégance, tout ce raffinement d’art, comme aussi cette frivolité, qui révèlent si clairement notre atavisme, sont l’œuvre incontestable des femmes. C’est leur influence qui ensoleilla la République athénienne et lui fit cette auréole de gloire souriante dont, après quatre mille ans, le monde est encore ébloui et charmé… C’est leur commerce quotidien qui poliça les rudes mœurs des Hellènes et créa cette atmosphère spéciale, capiteuse, troublante, qu’on appela l’atticisme et qui se nomme aujourd’hui le parisianisme.
Deux hommes ont régi la vieille Grèce que des mœurs différentes divisèrent en deux camps opposés : Lycurgue, qui fit du Péloponèse une caserne, et Solon, l’un des sept sages, qui fit de l’Attique la patrie élue des arts et des belles-lettres. Lycurgue proscrivit de sa République, armée jusqu’aux dents, tout ce qui lui semblait devoir amollir les cœurs et briser les énergies et n’admit près de ses guerriers que des viragos à demi masculines, êtres farouches et prolifiques, capables, sans plus, de fonder des familles nombreuses et robustes. Solon, au contraire, para la sienne de toutes les séductions, de toutes les grâces féminines. Or, qu’est-il advenu ? Les siècles ont passé : les remparts de Sparte se sont écroulés, tandis que l’Acropole et le Parthénon dominent encore l’éternelle Athènes et lui mettent au front une double couronne de gloire. Mais, plus encore que les temples, ce qui nous reste vivant de la cité bénie, ce sont les poèmes immortels, les chants enflammés, les livres sacrés des poètes et des philosophes qui sont des évangiles et des bibles de Beauté.
Tout cela, je le répète, est l’œuvre de la Femme. C’est son action irrésistible qui créa ces merveilles, qui fit jaillir ces sources intarissables où l’humanité n’a cessé d’étancher sa soif inextinguible d’idéal.
Hélas ! la vérité me force à convenir que, dans ce gigantesque labeur, la vertu austère n’entra que pour une bien petite part et que si, dans Athènes, vouée à Minerve, déesse de la sagesse, le temple de Pallas était l’objet du respect et de l’adoration du peuple, ceux, infiniment nombreux, de Vénus la Blonde étaient de beaucoup les plus fréquentés. C’est son culte qu’on y révère, c’est elle qui gouverne, ce sont ses lois qu’on observe, ce sont ses mystères qu’on célèbre dévotement sous le regard bienveillant de Phœbé, astre des nuits voluptueuses…
Si l’on étudie la société athénienne au point de vue purement féminin, on y remarque trois catégories de femmes : les épouses, les courtisanes et les pallaques.
Le grand orateur Démosthène le dit en termes explicites dans un plaidoyer célèbre prononcé par Apollodore :
« Nous avons des amies (hétaïres) pour la volupté de l’âme, des filles (pallaques) pour la satisfaction des sens, des femmes légitimes pour nous donner des enfants de notre sang et garder nos maisons. »
Je laisse de côté les deux premières catégories, j’y reviendrai tout à l’heure en détail ; il s’agit à présent des épouses, des matrones, comme on les appela à Rome quelques siècles plus tard.
Au vrai, c’étaient des sortes d’esclaves, des espèces de gouvernantes, des intendantes, pour être rigoureusement exact.
Dans un petit livre intitulé : Les Courtisanes grecques, rempli de doctes et précieux renseignements sur cette époque si curieuse et qui porte la signature de M. Émile Deschanel, je trouve le passage que voici :
« La femme légitime était élevée dans une ignorance complète ; elle vivait à l’écart dans le gynécée. Filer la laine, faire des vêtements, distribuer leur tâche aux servantes, servante elle-même ou peu s’en faut, intendante, pour ne rien outrer, telles étaient ses occupations. »
Il était recommandé dans les traités d’éducation d’alors de tenir la jeune fille ignorante de tout ce qui constitue la vie intellectuelle, la vie mondaine comme nous dirions aujourd’hui. Pas d’arts d’agrément, pas de culture de l’esprit, pas de sciences réputées frivoles et inutiles… Elle sortait du couvent… c’est-à-dire de la maison paternelle (je vous demande pardon de ce lapsus, je croyais parler de certaines éducations d’aujourd’hui), elle sortait, dis-je, de la maison paternelle pour entrer chez son époux. Ce n’était, en somme, que changer de prison. Le transfert, si j’ose ainsi m’exprimer, ne s’opérait pas sans un cérémonial assez pittoresque qui, chez ce peuple à l’imagination vive et poétique, prenait un aspect de symbole.
« La fiancée montait sur un char entre le fiancé et le garçon d’honneur ; on portait à l’entour des flambeaux d’hyménée et, lorsqu’on était arrivé à la maison que devaient habiter les époux, avec ces flambeaux on brûlait devant la porte l’essieu du char. Cela signifiait que la jeune épouse entrait dans la maison pour n’en plus sortir . »
Délicieuse perspective !… Je sais bien que tout est dans l’accoutumance et que cette pauvre recluse qui nous ferait pitié aujourd’hui s’accommodait de son triste sort et y trouvait peut-être même des joies dont l’attrait nous échappe. (Le gynécée est en quelque sorte le harem oriental, avec cette différence toutefois qu’en Grèce la sultane-validé reste seule enfermée dans le sérail, tandis que les favorites ont le droit de circuler librement et sans voile)… D’ailleurs, on lui répétait à chaque instant que son sort devait être tel, qu’il était beau, qu’il était noble : la pauvrette finissait par le croire.
Dans une oraison funèbre que Thucydide nous a transmise, Périclès, s’adressant aux veuves des guerriers morts, leur dit : « Filles, épouses et mères de famille, toute la gloire des femmes doit se réduire à faire parler d’elles le moins possible, soit en mal, soit en bien. »
Du moment que Périclès le disait, elles n’avaient plus qu’à s’incliner… Il est vrai que Périclès était marié, qu’il était malheureux en ménage et qu’il allait volontiers se consoler près de la courtisane Aspasie de ses déceptions conjugales…
Quoi qu’il en soit, il faut plaindre la condition de ces malheureuses, victimes de l’esprit oriental vraiment inhumain et profondément matérialiste.
Voici ce qu’un poète, Simonide d’Amorgos, écrit au sujet des femmes. Je vous lirais bien le texte original, mais, comme la douce Henriette des Femmes savantes au pédant Vadius qui la voulait, d’autre manière, endoctriner, vous me répondriez : « Excusez-moi, Monsieur, je n’entends pas le grec ! » Je vous dirai donc en français, tout simplement, ce que Simonide pensait des femmes :
« Il y a dix espèces de femmes : la première tient du sanglier ; la seconde, du renard ; la troisième, de la chienne hargneuse ; la quatrième, de la terre brute ; la cinquième, de la mer capricieuse ; la sixième, de l’âne entêté ; la septième, de la belette maigre et voleuse ; la huitième, du cheval à la belle crinière ; la neuvième, du singe, et la dixième, enfin, de l’industrieuse abeille. »
Simonide ne devait pas non plus être heureux en ménage.
D’ailleurs la vie de famille, chez les Grecs, était fertile en scènes tragiques. Hélène, Clytemnestre, Phèdre en sont la preuve et, sans pénétrer dans le palais des rois, chez les philosophes eux-mêmes, les ménagères n’étaient pas tous les jours d’humeur accommodante. Leurs maris, s’il faut en croire Théodore de Banville, s’en consolaient en faisant des mots. Le bon Socrate était harcelé par cette horrible mégère qu’il avait pour femme : Xantippe, puisqu’il faut l’appeler par son nom. Un jour que, en proie aux remords, elle faisait amende honorable et lui demandait, en s’accusant elle-même d’irascibilité et de jalousie aveugle :
– À quoi suis-je bonne sur cette terre ?
– À faire un philosophe, lui répondit le sage en souriant avec indulgence.
C’est probable et, sans les bourrasques continuelles que déchaînait sur lui sa terrible épouse, Socrate n’eût été peut-être qu’un bourgeois ordinaire.
Socrate n’est plus !… mais Xantippe vit encore.
Revenons aux bonnes intendantes.
Xénophon, dans son traité sur l’Économie domestique, fait dire à Ischomaque, en parlant de son épouse :
« N’était-ce pas assez de trouver en elle une femme qui sût filer de la laine pour faire des vêtements et surveiller le travail des servantes ? »
Cette éducation rudimentaire explique la résignation de Pénélope brodant de la tapisserie pendant l’absence d’Ulysse, et, à quelques siècles de distance, la patience des châtelaines coiffées de hennins, filant la quenouille tandis que les maris guerroyaient en Terre sainte… Il est vrai que les mœurs du Moyen Âge différaient un peu de celles qui nous occupent actuellement et que les belles dames du temps jadis, dans leurs sombres tours, avaient, pour charmer les ennuis d’une si longue attente, de gentils pages et de galants trouvères…
Mais ceci fera l’objet d’un entretien ultérieur.
J’insiste sur la condition des femmes légitimes et sur l’état de servilité ignorante dans lequel on les tenait, par cette citation d’Euripide qui fait dire à Hippolyte :
« Je hais une savante ; loin de moi et de ma maison celle qui élève son esprit plus haut qu’il ne convient à une femme ! »
Ne croirait-on pas entendre le bonhomme Chrysale dire à sa sœur, la pédante Bélise :
On comprend qu’élevées ainsi dans un état de sujétion absolu, qui les claquemurait dans leur maison, ne leur laissant en somme aucune communication avec le dehors, avec la vie ambiante qui grouillait sur l’agora, sur le Pnix, la place publique où s’élevait la tribune destinée aux palabres des orateurs populaires, les femmes, les épouses n’eussent sur leurs maris aucune influence ; c’étaient de bonnes poulinières, bien saines, bien robustes, qui mettaient au monde, sans relâche, de superbes gaillards, et voilà tout !…
Quelles étaient donc celles qui furent les artisans de la gloire athénienne ? Celles de la seconde catégorie : les courtisanes.
Le mot, qui pourrait choquer des esprits moins ouverts que les vôtres aux choses d’art, exige une explication.
Il n’avait pas dans l’antiquité le sens qu’on y attache à présent. Il signifiait, à peu près, « femmes de cour », « femmes du dehors », en opposition avec l’épouse, « femme d’intérieur ». Le mot même d’« hétaïre » signifiait expressément « compagne, amie », comme le disait Démosthène dans le passage que j’ai cité plus haut, « camarade », comme nous dirions aujourd’hui.
C’étaient en effet de belles-amies, des camarades, qui vivaient libres et non pas seulement licencieuses… Elles étaient parées de toutes les grâces et de toutes les séductions que donne une éducation artistique. Musiciennes, poétesses, philosophes, d’aucunes fort érudites, mais sans pédantisme, elles attiraient chez elles les beaux esprits, comme le firent, avec plus de vertu sans doute, mais avec non moins de charme, les Précieuses du grand siècle ; elles recevaient des hommes d’État, des financiers, des orateurs et des artistes, décrétaient des modes et exerçaient sur l’opinion et sur les affaires une influence prépondérante. C’était chez elles que les fils de famille allaient dépenser en banquets et en fêtes tout l’argent qu’ils ne mettaient pas à des chevaux, à des chiens ou à des combats de coqs. Elles faisaient les réputations, décidaient sur les tragédies, les comédies, les romans. En un mot, elles donnaient le ton et elles seules pouvaient le donner, car les épouses n’avaient qu’une existence latente, une existence de recluses, tandis qu’elles seules avaient une existence visible et effective.
À quelques nuances près, qui dénotent, du reste, un grand progrès dans la voie de l’affranchissement féministe, le tableau est à peu près le même aujourd’hui qu’autrefois.
J’ai prononcé, tout à l’heure, le mot « éducation » ; il ne doit pas surprendre. Les femmes « libres » recevaient, en effet, une éducation et une instruction très soignées. La morale païenne ne ressemblait que fort peu à notre morale chrétienne, et le Beau, sous quelque aspect qu’il se révélât, était la suprême loi. La Vertu n’était qu’une des formes secondaires de la Beauté.
De toutes les colonies grecques les plus fameuses, Milet, patrie d’Aspasie, et Lesbos, qui donna le jour à Sappho, furent les plus réputées pour la beauté et la pureté des traits, sinon des mœurs, de leurs filles. Ce sont ces deux villes qui partageaient le privilège de fournir à toute la Grèce des courtisanes admirables.
Milet était la pépinière des danseuses et des joueuses de flûte, et Lesbos fournissait plus spécialement des femmes de lettres et des philosophes.
Dès le bas âge, on les dressait à cette profession qui s’élevait jusqu’à un art véritable.
Dans des lycées spéciaux, dans des couvents païens, pour ainsi parler, d’où elles ne sortaient qu’après avoir parachevé de très solides études, on leur donnait une éducation complète qui se divisait en deux branches : la gymnastique et la musique.
La gymnastique comprenait tout ce qui regarde le corps, la musique tout ce qui regarde l’esprit.
On soignait la plastique, dont on dégageait la beauté suivant des rythmes naturels qui, faisant saillir les formes avec proportions, assouplissaient les membres en les fortifiant. À cet art se rattachait la danse, qui n’était pas, comme aujourd’hui, une simple distraction, une occasion de flirt, un prétexte à causerie, mais qui avait un caractère presque sacré et qui donnait à la démarche, au maintien, aux attitudes cette élégance, cette majesté que nous admirons dans les musées où les antiques reproduisent en marbres vénérés les Vénus, les Minerve auxquelles les courtisanes, en posant devant les artistes, servirent d’intermédiaires entre l’Olympe et la Terre, et dont les délicates statuettes de Tanagra ont reproduit, à côté des sublimités des déesses les coquetteries des simples mortelles.
Et voyez jusqu’où les Grecs poussaient le scrupule de la beauté parfaite : de même qu’on disait aux jeunes filles la merveilleuse histoire de l’amour, on leur en enseignait aussi les gestes harmonieux. On leur faisait comprendre que la façon de donner vaut mieux, souvent, que ce qu’on donne, et que la griserie de l’attitude, l’élégance d’une taille cambrée dans un robuste enlacement, l’arc harmonieux d’un beau bras enserrant une tête chérie, l’inclinaison gracieuse d’un front rougissant, l’offre câline d’une lèvre affamée de baisers sont les piments savoureux indispensables de l’éternel festin de la chair.
C’était le cours de musique.
On leur apprenait les chansons qui couraient les villes et les campagnes, les belles légendes qui se transmettaient de bouche en bouche et dont la collection la plus complète forme deux livres immortels, l’Iliade et l’Odyssée… On leur enseignait en même temps à jouer de la flûte et du psaltérion. L’histoire des dieux et les chroniques de l’Olympe ornaient leur esprit en défrayant leur conversation.
Dans l’ancienne Égypte, les almées, et dans l’Inde actuelle, les bayadères élevées dans les temples, étaient et sont encore à peu près l’équivalent des courtisanes éduquées dans les monastères de Lesbos et de Milet.
La gloire de Solon est d’avoir compris tout le parti que, pour le plus grand bien de la vie publique, il y avait à tirer de semblables auxiliaires et, alors que Lycurgue, le guerrier, leur fermait les portes de sa ville, Solon, le moraliste, leur ouvrit toutes grandes les portes de sa cité !
Tout fut changé alors. À ce contact, les mœurs s’adoucirent, les hommes acquirent en la société des femmes de la finesse et du goût et, comme l’histoire n’est qu’un éternel recommencement, nous verrons plus tard, quand nous en serons à étudier les coutumes de la société sous Louis XIII, que les hommes les plus célèbres d’alors, comme Saint-Evremont ou Condé, venaient, eux aussi, chez la belle Ninon de Lenclos, dont les mœurs rappelaient celles des courtisanes grecques, comme à une école de bonne tenue et de suprême distinction. Chez ces femmes, en effet, dans leur conversation enjouée, spirituelle, élégante, il y avait profit intellectuel, sinon moral, pour les uns comme pour les autres.
« Les hommes, dit encore excellemment M. Deschanel, donnaient aux femmes de la solidité et de l’élévation dans le jugement ; les femmes donnaient aux hommes cette souplesse d’esprit, cette pénétration, cette connaissance de la nature humaine qui est leur science instinctive. »
C’étaient donc, pour nous résumer, dans cette société d’où la vie familiale était pour ainsi dire exclue, les courtisanes qui, vertu à part, bien entendu, – mais nous avons vu que le mot vertu n’avait pas chez les Grecs le même sens que chez nous – c’étaient, dis-je, les courtisanes qui jouaient le rôle de femmes du monde.
Comme les femmes du monde d’aujourd’hui, en effet, elles tenaient salon, donnaient à causer, à chanter, à philosopher et savaient réunir autour d’elles les plus nobles esprits de leur temps.
C’est au Céramique qu’elles se réunissaient principalement, tandis que les « pallaques », la troisième catégorie des femmes grecques, qui n’étaient que des filles dont nous n’avons pas à nous occuper, habitaient le Pirée, sur le port, parmi les matelots grossiers et vulgaires.
Le Céramique, qui peut se comparer aux galeries de bois du Palais-Royal sous la Restauration, était situé dans un faubourg d’Athènes, près des jardins du philosophe Académos. Là se trouvaient aussi, le long d’une promenade publique, les sépultures des citoyens morts les armes à la main. On se promenait, on se rencontrait sous les portiques ornés de statues, dont les murs étaient revêtus d’inscriptions galantes, reproduisant les noms des belles Corinthiennes, noms parfumés de saveur printanière, qui ont survécu dans la mémoire des hommes et que l’on pourrait traduire ainsi : Branche de Myrte, Feston de Vigne, Fleurette, Petite Abeille, etc. ; ce n’étaient là que des noms de guerre, mais l’histoire, silencieuse sur le compte des épouses, nous a conservé les noms véritables d’un certain nombre de courtisanes célèbres : Phryné, Laïs, Hipparchic, Léœna, Plangon, Glycère, et les deux plus célèbres, Aspasie et Sappho.
J’ai choisi à votre intention, dans l’histoire de la vie et des mœurs de ces femmes, quelques anecdotes les plus piquantes… et les plus racontables.
Et, pour commencer, je veux vous conter les débuts et vous dire la gloire d’Aspasie, de la femme qui tint sous sa loi des génies immortels comme Socrate et Platon et de grands citoyens comme Périclès.
Un jour, au Pirée, aborde une petite barque de cabotage qui faisait le service des transports entre la côte du Péloponèse, l’Archipel et l’Attique. Au nombre des passagers se trouvait une jeune femme qui, comme tant d’autres, venait à Athènes pour y chercher fortune. C’était une fille de Milet, réputée comme l’est aujourd’hui notre ville d’Arles pour la beauté de ses habitantes. À peine débarquée, elle s’éloigne rapidement du port. Elle longe les murailles et s’arrête un instant sur le Pnyx. Malgré l’heure matinale, la place est couverte de citoyens. Sur la tribune aux harangues, un orateur parle au peuple. Il célèbre la gloire des dieux et la grandeur de l’Attique, et les premières paroles qui frappent l’oreille d’Aspasie et s’impriment dans son esprit sont un hymne en l’honneur de tous les sentiments nobles qui élèvent l’âme.
La jeune fille s’arrête un instant, elle contemple à la fois cette foule attentive, amoureuse de beau langage et de beaux gestes, et cet orateur de noble allure et de visage altier… et elle se dit que celles-là sont heureuses qui peuvent être distinguées par de tels hommes !… Puis, avec un soupir, elle reprend sa route.
La voici près de la porte Dipyle, qui donne accès dans le quartier du Céramique. Là, sous de frais ombrages, parmi les sépultures, symbolique union de la vie turbulente et de la mort reposée, se promènent, quêtant aventures, les jeunes hommes en robes de pourpre flottantes. Sous les blancs portiques, les filles de Milet, de Corinthe et de Lesbos, drapées en des soies de Tyr et de Sidon, marchent deux par deux, nonchalantes, jetant aux passants l’aumône de leur beauté. Les murs des portiques sont déjà couverts de galantes inscriptions, indiscrètes messagères des amants qui viennent graver sur le marbre, en l’accompagnant de commentaires passionnés, le nom de la bien chérie : « Glycère aux yeux de gazelle » ; « Eucolia aux chevilles frêles comme le roseau » ; « Daphné, dont les lèvres de pourpre ont fait pâlir les roses et dont la voix est plus douce que les accords du psaltérion »… L’inconnue contemple ce mur où demain son nom aussi sera gravé sans doute, et, revoyant en pensée le bel orateur de tantôt, elle se dit que peut-être elle était marquée pour d’autres destins…
Cependant l’émoi est grand parmi les promeneurs. Une Milésienne ! Comme plat du jour, c’est une rare aubaine ! Des groupes se forment ; on entoure, on admire la nouvelle venue.
Tout à coup, les yeux d’Aspasie se fixent sur un des jeunes gens qui la contemplent. C’est lui, c’est bien lui, l’homme qui, tout à l’heure, au Pnyx, haranguait la foule avec tant d’éloquence… Flatté d’être ainsi distingué entre tous, le jeune Athénien se détache du groupe, s’incline devant la beauté de l’inconnue et lui sourit. Mais un trouble étrange le saisit à son tour. Tous deux restent immobiles, incapables de prononcer une parole ; du moins leurs yeux se parlent-ils si leur bouche est muette, et le silence éloquent de ce long regard unit pour toujours l’un à l’autre la plus belle des femmes et le plus illustre des Grecs : Aspasie et Périclès !
Quelques années plus tard, la voyageuse, devenue reine de la République, avait su attirer et retenir près d’elle, par sa grâce et par son esprit, tout ce qu’Athènes comptait de philosophes, de savants, de poètes, d’artistes : elle les inspirait, les conseillait, et, comme nous dirions aujourd’hui, elle les lançait. Platon l’appelle en ses entretiens la « divine Aspasie », et Périclès lui doit les plus éloquents de ses discours.
Elle avait un salon !
Ah ! quel salon que celui-là !
Pour plafond, la voûte lointaine où s’immobilise l’éternité du bleu ; pour lustre, le soleil, le soleil de l’Hellade dont les Grecs avaient fait le plus triomphant des dieux ; les murs, c’est la barre de l’Hymette, ce sont les flancs de marbre du Pentélique ; par la porte grande ouverte, la perspective lointaine d’une mer frissonnante vers Munychie ; quelques bibelots épars : la crête enflammée d’Egine ; et, sur les murs, de magnifiques tableaux : le Parthénon qu’on vient d’achever et qui rutile comme une tiare sur le front chauve de l’Acropole. Point de fauteuils étroits et mesquins : de larges bancs de marbre ; sous les pieds, un moelleux tapis de sable ; des écrans de lentisques et d’arbousiers pour garantir les têtes contre le soleil, et, pour reposer les yeux de tant de merveilles, des asphodèles poussant leurs fleurs timides parmi les touffes d’or des genêts.
Voilà le salon d’Aspasie : un jardin, le jardin d’Académos.
La mise en scène est faite ; peuplons-la de personnages.
Vous allez voir que les hommes de tous les temps se ressemblent ; il n’y a que les noms de changés.
Voici les « intellectuels » de ce temps-là.
Vous avez connu ce salon parisien, le salon de Mme Aubernon, où Renan présidait jadis béatement, comme un chanoine désabusé, aux ébats et aux débats littéraires d’une élite quintessenciée, sous l’œil bienveillamment sévère et la légendaire sonnette de la docte maîtresse du logis. Chez Aspasie, ce n’est point notre Renan qui préside, mais un doux philosophe, dévotement impie, lui aussi : Socrate ! Un mage épris de l’« au-delà », un sondeur de mystères, de qui se réclament nos occultistes, évocateurs d’esprits, qui font tourner les tables en bourriques, le philosophe Pythagore y prélude à notre Sàr Péladan… Gérôme et Falguière s’y appellent Phidias et Praxitèle, M. Ferdinand Brunetière s’y nomme Anaxagore. Au loin, prenant des notes et de sa voix railleuse soulignant ses satires d’une phrase mordante, ce revuiste de génie, Aristophane, y tient la place qu’occupe chez nous ce gamin de Paris petit-neveu de ce gamin d’Athènes : M. Jean Louis Forain. On y rencontre encore un enfant gâté et charmant, Alcibiade : un « brav’-général », Xénophon ; un Detaille, Zeuxis ; et même, faveur insigne, un chef d’État, un président de République qui, dans ce temps, s’appelait Périclès.
Et l’on cause de tout, de philosophie, de morale, de politique et d’amour.
Périclès raconte la dernière séance du conseil des Archontes ; Socrate gronde Alcibiade à propos de ses mœurs de noctambule ; et, dans un coin, cette bonne vieille chlamyde de peau, Xénophon, dévoile à Anaxagore les secrets de l’état-major et lui inflige, pour la centième fois, le récit de son glorieux fait d’armes, la retraite des Dix mille… Parfois on fait de la musique, ce sont les jours où Platon se mêle au groupe et daigne laisser tomber de ses lèvres ces fleurs d’éloquence où les abeilles de l’Hymette viennent butiner leur miel… Et, voluptueusement belle, déesse parmi ces demi-dieux, Aspasie réunit toutes ces voix éparses, dont chacune exprimait un peu de la beauté antique, et en fait l’incomparable concert qui ravit encore le monde.
Cet enthousiasme, croyez-le bien, n’a rien d’exagéré. Quand on pense que le temps où vécut cette femme fut le plus brillant de la Grèce et qu’on l’appelle le siècle de Périclès, on ne peut s’empêcher de penser qu’il eût été tout aussi juste de l’appeler le siècle d’Aspasie.
Voulez-vous, pour en finir avec son histoire, un dernier trait qui la fait presque notre contemporaine ?
Périclès était mort depuis quelques années. Aspasie, dont l’âge avait pu éteindre la beauté, mais qui lui avait laissé tout son charme, exerçait toujours sur les hommes de son temps une influence considérable. Parmi ses fidèles, se trouvait un certain Lysiclès, riche marchand sans éducation, vulgaire et balourd. Cet homme eut un jour l’idée saugrenue d’occuper auprès d’Aspasie la place demeurée vacante depuis la mort de Périclès. C’était fou ! Cela fut cependant ! Mais, comme si elle eût tenu une gageure, la « divine » entreprit de dégrossir ce lourdaud. Elle fit tant et tant par ses conseils et par ses relations que Lysiclès devint une véritable puissance politique !…
Le cas n’est-il pas de nos jours et n’avons-nous pas vu, dans Paris, mainte femme d’esprit faire d’un sot un personnage important et notoire ?
Phryné n’avait pas, à beaucoup près, la valeur intellectuelle d’Aspasie (d’ailleurs elle était Béotienne, et la Béotie n’était pas réputée pour l’esprit de ses habitants) mais elle était miraculeusement belle, ce qui n’est déjà pas si bête, ce qui, surtout, était une vertu édifiante chez ce peuple épris de la forme, pour lequel, suivant l’expression de Flaubert, « l’action la plus religieuse était d’exposer des formes pures ».
Si Phryné n’eut pas d’esprit, elle eut, du moins, un beau geste.
Vous le connaissez.
Dans un procès qu’elle soutenait devant le Sénat, transformé en haute cour de justice, son avocat, le célèbre orateur Hypéride, voyant la cause de sa cliente compromise, eut une inspiration de génie. Il saisit Phryné par la main, la fit s’avancer devant ses juges et, tout d’un coup, lui arrachant brusquement sa tunique, il la montra nue aux yeux du Sénat ébloui !
La cause était entendue et gagnée.
C’est une forme d’éloquence spéciale qu’il est inutile, je crois, de recommander aux avocats du Luxembourg.
Cette beauté, célèbre dans toute la Grèce, avait considérablement enrichi la courtisane. Pour faire de cette richesse un noble usage, elle proposa de rebâtir à ses frais les murs de Thèbes détruits par la guerre, à la seule condition qu’on y graverait cette inscription : « Alexandre l’a détruite, Phryné l’a rebâtie. » La proposition ne fut pas acceptée.
De nos jours, on serait moins scrupuleux, j’imagine, et souvent le diable, devenu vieux et s’étant fait ermite, a relevé de ses deniers les murs de l’ermitage sans qu’on ait le moins du monde songé à s’indigner…
N’est-ce pas aussi la fille du roi d’Égypte Chéops qui, ayant exigé de chacun de ses amants une pierre de taille, en construisit la plus grande des trois pyramides, s’il faut en croire cette mauvaise langue d’Hérodote ?
Phryné n’était pas aussi « accueillante » que cette reine égyptienne, et son geste dans le prétoire fut une exception. Elle n’allait jamais aux bains publics, portait d’ordinaire une longue tunique qui enveloppait tout le corps. Mais un jour, qu’on célébrait à Eleusis, une fête de Neptune, une grande foule se pressant sur le rivage, Phryné, avec cette impudeur triomphante que nous lui connaissons, laissa tomber ses vêtements à la vue de tous les Grecs, entra dans la mer, puis en sortit, tordant ses cheveux humides. Le peintre Apelle et le sculpteur Praxitèle se trouvaient dans la foule. Ils gravèrent sur leurs tablettes cette scène inoubliable et en firent, l’un sa Vénus Anadyomède, l’autre une statue d’or qui fut placée dans le temple de Delphes sur une colonne de marbre pentélique.
Et voilà comment une courtisane, de beauté divine, enrichit l’art de deux chefs-d’œuvre incomparables.
Ce qui suit est également à la gloire des Grecs et démontre leur culte de la beauté, qu’ils poussèrent à l’extrême, jusqu’à ne point permettre à un modèle de déformer sa taille.
Les formes pures faisaient partie du trésor national, un beau corps était propriété publique, que nul n’avait le droit de détruire ni même d’endommager.
Écoutez ce passage suggestif d’Hérodote :
« Une courtisane, célèbre par la beauté de sa taille, est enceinte. Voilà un beau modèle perdu ; le peuple est dans la désolation. On appelle Hippocrate pour la faire avorter. Le célèbre médecin y consent au nom de l’art. Athènes est dans la joie. Le modèle de Vénus est sauvé ! »
Il est probable que, si le sacrilège, auteur du crime de lèse-beauté, ne fut pas puni sévèrement, c’est qu’il fut impossible à la jeune femme de le désigner, avec certitude, parmi ses nombreux amants.
Laïs aussi était belle, si belle que Démosthène lui-même, le vertueux, l’austère Démosthène, la supplia de le recevoir et, en une seule nuit, dépensa pour elle le gain de toute une année. Il n’en rougit pas, et le peuple l’en félicita…
Je crois qu’aujourd’hui, si quelque austère légiste se passait une telle fantaisie et qu’il y consacrât ses émoluments d’une année de sénateur, les choses suivraient un autre cours ; il n’y aurait pas assez de quolibets pour la lui reprocher… Nous sommes bien dégénérés !
Laïs survécut à sa beauté et, comme la religion païenne s’accommodait aisément d’une morale spéciale, la courtisane suspendit dans le temple de Vénus son miroir devenu inutile, sous lequel Platon fit graver une inscription que Voltaire a traduite en ces quatre vers :
Quelques-unes de ces femmes montrèrent du courage et même de l’héroïsme en maintes circonstances ; c’est ainsi que Léœna, qui avait poussé son amant Harmodios au meurtre du tyran Hipparque, fut mise à la torture sans que la douleur lui arrachât ni un cri ni une délation. La politique athénienne ayant des revirements presque aussi subits que la nôtre, le peuple éleva plus tard une colonne commémorative en l’honneur de celle qu’il avait laissé mettre à mort quelques années auparavant.
Voici maintenant un double exemple de désintéressement bien rare dont M. Pierre Louys s’est servi, en le transformant, pour son livre d’Aphrodite.
L’histoire vraie est celle-ci :
Plangon était belle, si belle qu’un jeune homme de Colophon conçut pour elle une violente passion, bien qu’il eût déjà pour maîtresse la belle Bacchis à laquelle il avait fait don d’un collier merveilleux. Plangon ne consentit à lui céder que s’il lui apportait le collier de Bacchis. C’était une fin de non-recevoir… Le moyen de croire que l’amante en titre consentirait à se séparer d’un joyau pareil, en faveur d’une rivale surtout !… C’est ce qui arriva cependant. Le jouvenceau alla trouver sa maîtresse, lui dépeignit en termes si éloquents l’amour qui le dévorait, que Bacchis, dont le cœur était sensible, lui rendit son collier… pour ne point voir son amant expirer à ses pieds. À la vue du bijou, Plangon tint parole, mais, touchée de la générosité de Bacchis, elle le lui renvoya le lendemain… Cet échange de bons procédés unit les deux femmes d’une étroite amitié et le jeune amoureux eut ainsi deux belles amies au lieu d’une.
L’antiquité est remplie d’exemples édifiants.
Démétrios, le preneur de villes, maître de tant de nations, finit, après une longue résistance, par s’emparer d’Athènes. Sa première visite fut pour la courtisane Lamia, sa maîtresse.
Il frappa les Athéniens d’un impôt de guerre de 250 talents d’or, près d’un million et demi de notre monnaie. Il le fit lever en hâte, avec une extrême rigueur, comme s’il avait eu de cette somme un besoin immédiat. Lorsqu’elle fut réunie à grand-peine :
– Qu’on porte cet argent à Lamia, dit-il avec raillerie, pour s’acheter du savon !
La boutade avait uniquement pour but d’humilier les Athéniens ; mais ceux-ci s’en consolèrent en faisant des mots. Ils s’étonnèrent simplement que Lamia fût assez sale pour avoir besoin de tant de savon.
Cette façon de prendre les choses en riant, c’est encore bien parisien !
C’est sur cette anecdote que je termine, sans vous avoir parlé de la grande artiste, de la poétesse géniale que fut Sappho ; ce sera pour la prochaine fois. Nous nous promènerons en même temps, avec Théodora, dans les bouges, les cirques et les faubourgs de Byzance, pour franchir ensuite les siècles et arriver en France, au Moyen Âge, où nous assisterons aux gentes cours d’amour.
Que si, dans cet examen rapide des courtisanes grecques, quelqu’une s’étonne que la débauche ait eu jadis tant de pouvoir, je répondrai que ce qui nous paraît aujourd’hui un vice était jadis un mérite. Il ne faut pas juger les anciens d’après nous.
Hercule, cependant, mis un jour en présence du Vice et de la Vertu qui l’invitaient à les suivre, hésita quelques instants, puis, séduit par la noblesse de Minerve :
Tout le monde, hélas ! n’est pas Hercule, et la femme de tous les temps a compris que son arme principale – la faute n’en doit pas, j’en conviens, retomber entièrement sur elle – était la séduction et que, pour tenir sous sa loi l’homme indocile et frivole, le sourire est un charme tout-puissant.
Et voilà comment, puisque, avec moins d’abandon peut-être, mais avec une grâce semblable, la Parisienne observe les lois que lui ont transmises ses grandes aïeules du jardin d’Académos, elle fut et sera toujours la magicienne à qui le peuple attique, que nous avons la prétention d’être encore, doit d’avoir conservé ce qui lui reste d’esprit, d’élégance et aussi de noblesse.
SAPPHO.– THÉODORA
Si, au début de notre premier entretien, je sentais quelque embarras à traiter le sujet que j’avais choisi, que dirai-je alors de celui qui s’impose aujourd’hui ?
Il ne s’agissait, lundi dernier, que de vous faire sentir en quelques traits forcément rapides l’influence heureuse de la Femme antique dans les arts. Il fallait vous faire admirer la radieuse beauté de la forme et vous la montrer ingénument orgueilleuse de sa splendeur sculpturale.
La tâche était relativement aisée, je n’avais qu’à fixer votre attention, à la retenir un instant par quelques images attrayantes pour que ce peuple de statues s’animât et vécût sous vos yeux.
Mais, aujourd’hui, combien plus délicate la mission qui m’incombe et combien, surtout, téméraire !
Il me faut, en effet, vous décrire la Femme dans l’accomplissement de la fonction pour laquelle elle fut créée : l’Amour.
Ce n’est plus la splendeur de sa chair, l’harmonie de ses gestes, la grâce noble de sa démarche qui doivent nous occuper exclusivement. Il nous faut aller plus avant… Ce livre merveilleux dont nous n’avons fait, en somme, qu’admirer la reliure, nous devons l’ouvrir à présent. C’est le cœur qu’il nous faut feuilleter, c’est le poème éternel dont nous allons lire ensemble quelques strophes sereines, enflammées, subtiles…
Lire couramment dans le cœur des femmes !… Qui pourrait se vanter de l’avoir jamais fait ?… Qui oserait s’enorgueillir d’avoir jamais déchiffré l’indéchiffrable énigme ? Qui ? Si ce n’est la femme elle-même… Sur un pareil problème, l’humanité masculine s’est toujours inutilement penchée, et, dans cette science obscure, la plus candide des Agnès en pourrait remontrer au plus érudit des docteurs…
L’Amour !… C’est la chanson aux mille couplets tour à tour gais ou tristes, désespérés ou triomphants ; des cris de colère y passent, des révoltes parfois y tressaillent. Bonheur et misère : l’Amour est fait de tout cela.
Que de dissertations n’a-t-il pas inspirées ! Que de sottises n’a-t-il pas fait dire après toutes celles qu’il a fait commettre !
Vous connaissez la réponse d’Ésope à son maître qui lui demandait quelle était la meilleure et la pire des choses ! Si on l’avait interrogé sur la question de savoir qu’elle était la plus inutile il eût certainement répondu que c’était les dictionnaires, en admettant qu’ils existassent déjà de son temps.
J’ai eu la vaine curiosité, avant d’établir le plan de cette seconde causerie, d’ouvrir notre Larousse national et obligatoire, ce grenier d’abondance où les récoltes de l’esprit sèchent comme moissons en grange…
Ah ! faites-moi la grâce de croire que ce n’était pas pour y dénicher une définition de l’amour. Chercher l’amour dans un dictionnaire, c’est comme si l’on voulait retrouver le parfum et la couleur des roses entre les pages d’un herbier. Non ! Je voulais simplement me rendre compte des réflexions inutiles qu’un pareil sujet avait bien pu inspirer à ces botanistes du cœur qu’on nomme les psychologues.
Eh bien, voici ce que j’ai vu :
Derrière ce substantif coquet, comme de lourds escadrons derrière un fringant colonel, j’ai vu s’aligner 44 colonnes de texte serré. À 121 lignes environ par colonne et à 40 lettres par ligne, cela donne un total de 5 324 lignes et de 212 960 lettres !
Pour vous épargner l’ennui de le faire, j’ai lu consciencieusement tout cela et quand j’ai eu fini d’épurer, de passer au crible la longue suite des anecdotes, des exemples, des notes encyclopédiques, historiques, philosophiques, etc., etc., j’en suis arrivé à cette conclusion imprévue que la meilleure définition de l’amour est encore celle que nous donne du premier coup la grammaire :
AMOUR : substantif masculin au singulier, féminin au pluriel.
Cette vérité provoque, je le sais, de nombreuses plaisanteries et semble vouloir proclamer l’inconstance de votre sexe et la fidélité du nôtre ; affirmations également erronées. Souffrez que je ne m’y arrête pas… Si je la proclame cette vérité, c’est qu’elle a un sens caché. Il en est des définitions de la grammaire comme des arrêts de la Sibylle, il ne suffit pas d’en connaître la lettre, il faut encore en pénétrer l’esprit. Celle-ci peut, il me semble, se commenter ainsi : En amour, ce que l’homme préfère, c’est la femme qui en est l’objet. Tandis que ce que la femme aime surtout dans l’amour, c’est l’amour lui-même, c’est l’action d’aimer.
Chez les Grecs, l’amour était représenté comme un dieu tout-puissant qui ne pouvait, sans déchoir, être emprisonné dans les étroites limites d’un cœur, quelque vaste qu’il pût être. Ils admettaient volontiers que prétendre être uniquement aimé était une conception ridiculement orgueilleuse : « L’amour a des ailes, disaient-ils, il plane sur l’univers, il parcourt le monde, et son empire s’étend par-delà les systèmes, au-dessus des préjugés et des conventions. »
Ainsi parlaient les femmes d’autrefois ; ainsi pensent encore, d’ailleurs, quelques-unes d’entre celles d’aujourd’hui qui sont restées fidèles aux antiques traditions.
La morale païenne, vous le voyez, diffère essentiellement de la nôtre, et c’est à son point de vue très particulier que nous devons nous placer pour juger sainement, puisque aussi bien, c’est encore d’une courtisane que nous allons nous occuper pendant quelques instants.
Je veux parler aujourd’hui de cette femme dont la gloire a franchi les siècles, de ce chantre inspiré de l’amour, de Sappho enfin, qui fut avec Homère et Pindare l’un des trois plus grands poètes de la Grèce antique.
Et, vraiment, doit-on, à propos de cet immortel génie, prononcer le mot de courtisane, même en y attachant le sens qu’on lui attribuait jadis ?… Non. La sublime poétesse s’est tellement élevée au-dessus de son temps ; elle est si universellement humaine que ce serait la rabaisser que de la confondre avec les simples mortelles dont nous avons esquissé l’histoire… Sappho n’est pas seulement un poète, c’est la poésie même… C’est de ses chants inspirés que sont nés tous les chants d’amour qui, depuis trois mille ans, ont bercé la tendresse humaine… La passion trouve en elle son Verbe et ce Verbe, lui aussi, est Dieu !… À sa voix les âmes frémissent d’enthousiasme ou hurlent de douleur. Il n’est pas un écho qu’elle n’éveille et la caresse de ses doigts sur sa lyre immortelle emplit le monde de l’accord puissant qui vibre et vibrera toujours dans l’infini des cœurs.
Pour la bien chanter, cette divine, il faudrait être presque un dieu ! Mais que dis-je ! ne le fut-elle pas un jour ? Oui, certes, et miraculeusement ! Il était réservé à notre siècle, à notre pays de traduire excellemment cet esprit grandiose. Interpréter le génie, un génie seul en était capable, et ce génie, notre France peut s’enorgueillir de l’avoir créé, c’est le maître dont le souvenir plane sur nous, celui dont l’image est parmi nous présente, celui auquel beaucoup succèdent, mais que pas un n’a remplacé : c’est Gounod, dont je salue ici la compagne vénérée…
Souvenez-vous de ces pages radieuses de Sapho… Souvenez-vous de ces chants qui frémissent d’enthousiasme et débordent de passion ! C’est l’âme de Sappho qui s’éveille en eux. Elle-même les a dictés. Et si Gounod a si bien traduit la pensée de celle qui fut tout l’amour, c’est qu’il fut, lui, toute la musique…
Souvenez-vous des stances qui terminent cette œuvre magistrale en qui s’évoque si brillamment l’âme grecque ! Est-ce qu’une inspiration si haute n’honore pas à tout jamais celle qui en fut l’objet ?
Ce grand artiste nous a montré de Sappho l’âme héroïque et puissante, mais ce qu’il n’a pu nous peindre complètement parce que le théâtre ne pouvait complètement le dire, c’est la Sappho amoureuse, non point seulement esclave de ses passions, ce qui serait la diminuer, mais victime de la passion.
C’est de Sappho, poétesse d’amour, que nous allons nous entretenir.
Jusqu’au jour où l’île de Lesbos tressaillit comme un luth à ses chants, la terre confondait le Bonheur avec le Plaisir, la Volupté avec l’Amour et, dans cette Grèce si matériellement psychique, pour ainsi dire, la possession était tout. C’est Sappho qui, en quelque sorte, lui révéla l’Amour en chantant ses ivresses et ses tortures. C’est elle qui donna, la première, un langage à la passion. Ce qui la caractérise, c’est que l’art d’aimer qui, chez elle, atteint les cimes de l’expression qui ne fut jamais dépassée, n’est pas un simple exercice littéraire, la traduction plus ou moins heureuse de sentiments plus ou moins éprouvés !… Non. C’est le cri arraché par la douleur ou par l’ivresse. Tout ce qu’elle dit a un accent de vérité sur lequel il est impossible de se méprendre. Toutes les joies, elle les a goûtées ; toutes les tortures, elle les a subies.
À elle, bien plus encore qu’à Phèdre, s’applique le vers de Racine :
Il semble que la déesse ait élu le cœur de Sappho pour y exercer sa puissance despotique. Elle y règne en maîtresse absolue. Tels ces oiseleurs sans pitié qui crèvent les yeux des rossignols ou qui cisaillent les cygnes pour leur faire exprimer leurs chants les plus beaux, tel l’Amour étreignit l’âme de Sappho jusqu’à ce qu’elle exhalât des plaintes surhumaines qu’Apollon recueillait et notait sur sa lyre… Ses vers sont de la quintessence d’amour. Un seul hémistiche suffit pour engendrer des chefs-d’œuvre. Le Cantique des Cantiques de Salomon semble une paraphrase et la Phèdre de Racine est tout entière contenue dans une de ses strophes.
Oui, elle fut l’Amour, l’Amour qui chante et qui pleure, qui rugit et qui sanglote, l’Amour triomphant, torturé, radieux, filial, maternel. Elle en a exprimé toutes les formes, toutes les nuances. Elle en a parcouru toute la gamme. Elle en fut le plus prodigieux instrument. J’ai dit qu’Apollon tenait la lyre, ce n’est pas assez : la lyre d’Apollon, c’est Sappho ! Ce sont des lambeaux de son cœur qu’elle arrache, de ce cœur formidablement puissant qui, suivant l’expression de Longin, « ne fut pas seulement la proie d’une passion, mais le rendez-vous de toutes les passions ! »
Devant tant de douleur, devant tant de beauté, ne discutons plus… Imitons les Grecs : adorons !…
À quoi bon s’étendre et commenter ?
« En vérité, disait Plutarque en parlant d’elle, ce que cette femme chante est mêlé de feu » !
Le feu ? Oui, c’est bien là l’image du cœur de Sappho, c’est le buisson ardent que rien ne consume. Le feu ne s’explique pas, il brûle et tout est aliment pour sa vigueur sans cesse renaissante…
Et quelle diversité ! Quelle palette extraordinaire !
Voici la tendresse maternelle, la gronderie amicale et souriante :
« J’ai à moi une jolie enfant dont la beauté estsemblable à celle des chrysanthèmes, Cléis, ma Cléis bien-aimée, que je ne donnerais pas pour toute la Lydie. »
Cette Cléis, aussi aimée par sa mère que le fut Mme de Grignan par Mme de Sévigné, est l’objet d’une réprimande. Admirez la grâce de la gronderie :
« Il ne convient pas d’entendre pleurer dans une maison qu’habitent les Muses. »
La voulez-vous entendre, jeune fille effleurée pour la première fois par le souffle de l’Amour ? Écoutez la réponse qu’elle fait à sa mère qui la presse d’achever sa tâche et lui reproche de rêver :
« Ma bonne mère, je ne puis du tout travailler à ma tâche tant la tendre Vénus m’accable du regret de ce bel adolescent. »
N’est-ce pas Marguerite à son rouet, laissant tomber son fuseau en pensant au beau gentilhomme inconnu qui vient de la saluer à la kermesse ?
La voulez-vous voir, amante passionnée ? Écoutez encore. On dirait la Pythonisse sur son trépied, d’abord frissonnante à l’approche du dieu, puis convulsée, secouée d’un spasme sacré et retombant brisée, possédée tout entière :
Celui-là me paraît l’égal des dieux qui, assis en face de toi, écoute de près ton doux parler et ton aimable rire.
Ils font tressaillir tout mon cœur dans mon sein ; la voix n’arrive plus à mes lèvres ; ma langue se brise ; un feu subtil court rapidement sous ma chair ; mes yeux ne voient plus rien ; mes oreilles bourdonnent.
Une sueur glacée m’inonde, un tremblement me saisit tout entière. Je deviens plus verte que l’herbe. Il me semble que je vais mourir…
La voici encore, pleine de dignité, faisant à Alcée une noble réponse.
Le grand poète lyrique, son rival en gloire, l’aimait profondément, mais n’osait lui avouer son amour :
Je voudrais parler, disait-il, mais la honte me retient.
Sappho répond :
« Si ta pensée était pure et si ta bouche n’allait pas s’ouvrir pour le mal, la honte ne serait pas sur ton visage et tu ne craindrais pas de parler selon l’honneur. »
Ne croirait-on pas entendre quelque héroïne de Dumas fils ?
La voici maintenant, amante délaissée, tournant ses yeux vers la déesse et tendant vers elle des mains suppliantes.
Lisez l’ode à Vénus, c’est la plus belle page d’amour qui soit au monde, c’est elle qui inspire depuis tant de siècles peintres, poètes, sculpteurs, musiciens, tous les fervents, tous les desservants de l’art :
ODE À VÉNUS
Aphrodite immortelle, au trône brillant, fille de Jupiter savant en artifices, je viens à toi en suppliante ; n’accable pas mon âme d’amertume et d’ennuis.
Ô Déesse, viens à moi !
En d’autres temps, écoutant mes instantes prières, tu les exauças et, quittant à mon appel la demeure de ton père, tu accourais sur ton char doré, attelé de beaux moineaux agiles, qui, faisant tourbillonner autour de la terre brune leurs ailes rapides, le traînaient du haut du ciel à travers les airs.
En un instant ils arrivaient.
Et toi, ô bienheureuse, ayant souri de ton visage immortel, tu me demandas ce qui causait ma peine, pourquoi je t’appelais et quels étaient les vœux ardents de mon âme en délire.
Tu me dis :
« Qui veux-tu de nouveau que j’amène et que j’enlace dans ton amour, ô Sappho ?