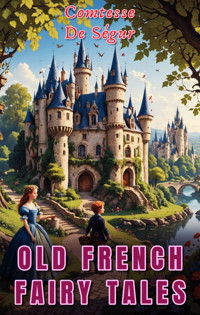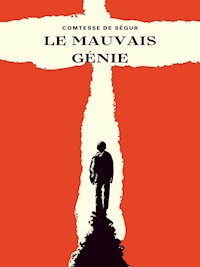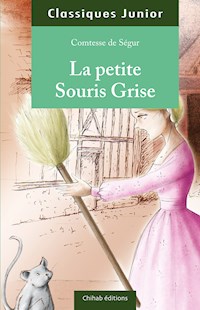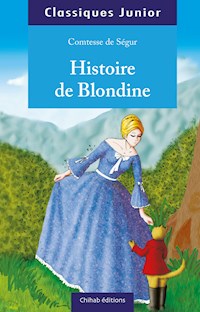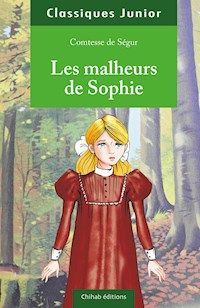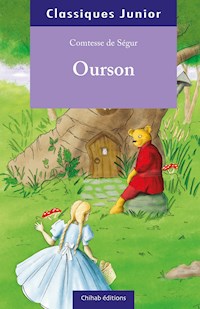Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Extrait : "GASPARD : Mais, avance donc ! Tu vas comme une tortue ; nous n'arriverons pas à temps. LUCAS : Eh bien ! le grand mal ! C'est si ennuyeux, l'école ! GASPARD : Comment le sais-tu ? Tu n'y as jamais été. LUCAS : Ce n'est pas difficile à deviner. Rester trois heures enfermé dans une chambre, apprendre des choses qu'on ne sait pas, être grondé, recevoir des coups d'un maître ennuyé, tu trouves ça agréable ? GASPARD : D'abord, la chambre est très grande."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335095418
©Ligaran 2015
Mais, avance donc ! Tu vas comme une tortue ; nous n’arriverons pas à temps.
Eh bien ! le grand mal ! C’est si ennuyeux, l’école !
Comment le sais-tu ? Tu n’y as jamais été.
Ce n’est pas difficile à deviner. Rester trois heures enfermé dans une chambre, apprendre des choses qu’on ne sait pas, être grondé, recevoir des coups d’un maître ennuyé, tu trouves ça agréable ?
D’abord, la chambre est très grande…
Oui, mais étouffante.
Pas du tout… Ensuite, on n’apprend jamais que les choses qu’on ne sait pas ; et c’est très amusant d’apprendre.
Oui, quand c’est pour travailler au dehors, mais pas pour se casser la tête à…
Pas du tout… Ensuite on n’est grondé que lorsqu’on est paresseux.
Oui, si c’est un brave maître, mais un maître d’école !
Pas du tout… Ensuite, on ne reçoit de claques que pour de grosses méchancetés.
Mais puisqu’ils disent que parler ou bouger c’est une grosse sottise.
Parce que ça fait du bruit pour les autres.
Et le grand mal quand on ferait un peu de bruit ? Ça fait rire, au moins.
Si tu ris, tu te feras battre.
Tu vois bien, tu le dis toi-même. Et je dis, moi, que si mon père ne me forçait pas d’aller à l’école, je n’irais jamais.
Et tu serais ignorant comme un âne.
Qu’est-ce que ça me fait ?
Tout le monde se moquerait de toi.
Ça m’est bien égal. Je n’en serai pas plus malheureux.
Et quand il t’arriverait des lettres, tu ne pourrais pas seulement les lire.
Je n’en reçois jamais.
Mais quand tu seras grand ?
Tu me les liras, puisque tu veux être un savant.
Non, je ne te les lirai pas. Je ne resterai pas avec toi.
Pourquoi ça ?
Parce que tu m’ennuierais trop ; tu ne sauras seulement pas lire ni écrire.
J’en saurai plus que toi, va. Et des choses plus utiles que toi. Je saurai labourer, herser, piocher, bêcher, faucher, faire des fagots, mener des chevaux.
Ça te fera une belle affaire, tout ça. Tu resteras toujours un pauvre paysan, bête, malpropre et ignorant.
Pas si bête, puisque je serai comme mon père, qui est joliment futé et qui sait, tout comme un autre, faire un bon marché ! Pas si malpropre, puisque j’ai le puits et la mare pour me nettoyer en revenant du travail ; et toi, avec ton encre plein les doigts et le nez, tu ne peux seulement pas la faire partir. Pas si ignorant, puisque je saurai gagner mon pain quand je serai grand, et faire comme mon père, qui place de l’argent. Tu n’en feras pas autant, toi.
C’est ce que tu verras ; je deviendrai savant ; je ferai des machines, des livres, je gagnerai beaucoup d’argent, j’aurai des ouvriers, je vivrai comme un prince.
Ah ! ah ! ah le beau prince ! Prince, vraiment ! En sabots et en blouse ! Ah ! ah ! ah ! Nous voici arrivés. Place à M. le prince !
Lucas ouvre la porte de l’école en riant aux éclats, et fait entrer Gaspard en répétant :
« Place à M. le Prince ! »
Tout le monde se retourne ; le maître d’école descend de l’estrade, saisit Lucas par l’oreille, lui donne une tape et le pousse sur le quatrième banc. Gaspard s’esquive et va s’asseoir tout honteux pour son frère, à sa place accoutumée.
Quand je te disais ! Tu vois bien que j’avais raison.
Tais-toi ! On ne parle pas ici. Ton frère est le modèle de la classe. Fais comme lui. Pas un mot… Qu’est-ce que tu sais ?
Je sais bêcher, pio…
Tais-toi ; ce n’est pas ça que je te demande ! Sais-tu lire, écrire ?
Pour ça non, m’sieur. Dieu m’en garde !
Si tu réponds encore un mot impertinent, je te mets à genoux sur des bûches.
Mais, m’sieur, il faut bien que je réponde, puisque vous me parlez.
Il faut me répondre poliment.
Je ne sais comment faire ! Quelle scie que cette école !
Le maître d’école s’était éloigné ; il remonta sur son estrade.
Le quatrième banc au premier tableau.
Les enfants du quatrième banc vont se placer debout devant ce premier tableau ; Lucas reste assis.
Le maître d’école donne une tape sur la tête de Lucas avec une longue gaule placée près de lui, et répète d’une voix forte :
« Le quatrième banc au premier tableau ! »
Lucas comprend et va rejoindre les autres.
Petit Matthieu du second banc, va montrer les lettres aux ignorants.
Petit Matthieu se lève et commence la leçon.
A, Répétez tous : A.
Les huit petits répètent :
A, A, A, A.
Assez, assez. O. Répétez tous : O.
O, O, O, O
Assez. Qu’est-ce que c’est, ça ? Il montre un A.
O, O, O, O, O.
Pas du tout. Ce n’est pas O. Voilà O ; c’est A.
A, A, A, A, A.
Assez, Qu’est-ce que c’est, ça ? Il montre O.
A, A, A, A, A.
Pas du tout ; c’est O. Vous êtes des nigauds. Il leur montre A. Qu’est-ce que c’est ?
O, O, O, O, O.
Vous faites donc exprès ? Dites ce que c’est ; tout de suite.
Ah bah ! tu nous ennuies. Est-ce que nous savons ?
Tu vas te faire calotter, toi. C’est pour te faire savoir que je te montre.
Tu n’es pas le maître d’école ; ce n’est pas à toi à montrer.
Tu dois m’obéir ; c’est moi qui suis le remplaçant.
Ah ! ah ! ah ! Plus souvent que je t’obéirai.
M’sieur, Lucas dit qu’il ne veut pas m’obéir. Puis-je le taper ?
Non, mets-lui le bonnet d’âne.
Petit Matthieu veut mettre le bonnet d’âne à Lucas qui se débat ; les autres le maintiennent de force ; il veut arracher le bonnet de dessus sa tête ; on lui saisit les mains.
M’sieur, il ne veut pas, il nous donne des gifles ; il veut arracher le bonnet.
Attache-lui les mains avec la courroie.
Donne-moi la courroie, Julien ; là, sur le tas de cahiers… Bien, apporte-la ; dépêche-toi, il nous échappe.
Tous les huit se mettent après Lucas ; les uns attachent la courroie, d’autres lui tiennent les jambes, les épaules, les bras.
C’est fait ; à présent, tu vas rester tranquille.
Lucas est en colère ; il pleure et finit par se résigner ; les autres continuent la leçon et Unissent par connaître A, O, I, U, E. La leçon finie, on détache Lucas ; il retourne sur son banc avec les autres ; il boude, mais il ne bouge plus.
On lui donne un livre, et on lui montre la page où il doit étudier A, O, I, U, E. Il commence par ne rien faire ; il ferme le livre, il pousse ses camarades qui le poussent à leur tour.
Le maître d’école lève les yeux, tape avec sa gaule Lucas et les autres qui se bousculent.
« Silence ! » dit-il.
Les enfants se frottent la tête et les épaules ; Lucas veut parler ; ses camarades l’en empêchent et lui disent tout bas :
« Tais-toi ; tu vas nous faire tous punir. »
Lucas s’ennuie, bâille, tousse, se mouche.
« Silence ! » crie le maître d’école en posant sa gaule sur l’épaule de Lucas.
Il l’avait posée fort, sans doute, car Lucas pleure et se frotte l’épaule.
« Silence donc ! » crie le maître d’école d’une voix irritée, en posant la gaule plus lourdement encore sur l’épaule de Lucas.
Pour le coup, Lucas est dompté, on ne l’entend plus ; il s’ennuie tellement, qu’il ouvre son livre et cherche à reconnaître les lettres qu’on lui a montrées ; ses camarades l’aident un peu, et il finit par les savoir très bien. Quand le maître d’école fait revenir les petits au premier tableau, Lucas ne se trompe pas une fois ; il est triomphant.
Ah ! ah ! il paraît que la gaule t’a ouvert l’esprit, mon garçon. Allons, c’est bien, c’est très bien ! nous recommencerons à la première occasion. La gaule a fait merveille pour bien d’autres encore. Il n’y a que Gaspard qu’elle n’a jamais touche… L’école est finie ; allez tous dîner et jouer jusqu’à deux heures.
Il était midi ; les enfants se précipitent dans la cour ; les uns se dépêchent d’aller dîner chez leurs parents ; d’autres, comme Gaspard et Lucas, qui demeuraient trop loin, s’assoient dans un coin, ouvrent leurs paniers et en tirent leurs provisions.
Qu’est-ce que nous avons pour dîner ?
Un œuf dur chacun et du fromage blanc. Tiens, voilà ton œuf, ton pain ; voici ma part ; le fromage et le cidre entre nous deux.
Et toi, Henri, qu’est-ce que tu as ?
Quoi que j’ai ? Pas grand-chose ; du pain et du fromage passé.
As-tu du cidre ?
Ma foi non ; quand j’ai soif, je vas au puits ou à la rivière. Maman est seule, tu sais, pour gagner sa vie ; elle n’a pas de cidre à me donner.
Lucas ne dit plus rien ; les enfants mangent tous ; quand Gaspard a fini, il regarde la bouteille de cidre.
Tiens, il y a encore près de la moitié ; j’en ai pourtant bu mes trois verres comme d’habitude.
C’est moi qui n’ai pas encore bu ; laisse-moi la bouteille, je vais boire tout à l’heure.
Dépêche-toi, que nous ayons le temps de jouer.
Les enfants se lèvent ; Lucas fait signe à Henri de rester. Quand les autres sont partis, Lucas verse un verre de cidre et le donne à Henri.
Tiens, mon Henri, bois ça ; cela te remontera l’estomac.
Merci bien, Lucas ; tu as bon cœur, tout de même, quoique tu aies été bien en colère quand tu as reçu la gaule sur la tête et le dos. C’est qu’il ne plaisante pas le maître d’école.
Pour ça non ; quand il tape, ce n’est pas pour rire. Il est méchant tout de même !
Écoute donc ! C’est qu’aussi tu l’asticotais et tu lui répondais. Il n’aime pas ça.
C’est ennuyeux de ne pas pouvoir parler et raisonner un tant soit peu !
Mais, pense donc. Si chacun se mettait à riposter et à dire des raisons, c’est que ça ferait un train à ne plus s’entendre. Nous sommes soixante-trois, vois-tu.
L’école serait bien moins ennuyeuse.
Oui, mais on n’y apprendrait rien. Tu vois bien toi-même, tu n’as su tes lettres que parce que tu t’ennuyais.
Et à quoi ça me servira de savoir cinq lettres ?
Un autre jour tu en apprendras cinq autres, et toujours comme ça ; et puis tu sauras lire.
À quoi que ça me servira de savoir lire ?
Ça te servira à bien apprendre ton catéchisme, à avoir des prix, à apprendre à écrire.
Et à quoi ça me servira d’écrire ?
À écrire des lettres, à faire des comptes. Ça sert bien, va ; je vois ça chez notre maître ; il ne savait jamais le compte de rien, ni loin, ni paille, ni orge, ni avoine. Quoi qu’il arrivait ? On le volait que c’était une pitié. Sa ferme marchait mal ; le blé avait beau rendre, il n’en vendait pas ce qu’il avait espéré. Le foin s’en allait, et tout partait sans lui donner de bénéfices.
Ce n’est pas parce qu’il ne savait pas écrire !
Si fait ; car depuis que je sais écrire et compter, il m’emploie tous les dimanches à faire ses comptes, à écrire ses marchés ; il sait ce qu’il a, ce qu’il vend, et il est à l’aise au lieu d’être gêne.
Tiens, tiens ! c’est vrai, ça !… Allons, un dernier verre que nous partagerons, et puis allons jouer.
Ils burent chacun leur demi-verre et partirent, contents tous deux : Lucas, d’avoir partagé son cidre avec Henri, qui était un brave et honnête garçon, fils d’une pauvre veuve, et Henri d’avoir pu donner un bon conseil à Lucas, qui avait été charitable pour lui. Ils se mêlèrent aux joueurs, et Lucas commença à trouver l’école moins ennuyeuse et moins inutile qu’il ne le pensait.
Grâce à sa bonne action, Lucas était en ce moment plus heureux que le studieux, le sage Gaspard.
À deux heures, la cloche sonna pour reprendre l’école ; les enfants cessèrent leurs jeux et coururent se placer près de la porte ; quand le maître ouvrit, la tête de l’école se mit à entrer en bon ordre, deux par deux ; chacun alla prendre sa place. La queue se bousculait, se poussait ; c’était Lucas qui causait ce désordre par son empressement à rentrer en classe. Il en avait poussé un second, lequel poussait un troisième. Un coup de coude amena un coup d’épaule, qui fut payé d’un coup de pied. La moitié n’était pas entrée, qu’on criait et qu’on se battait à la queue.
Le maître d’école avait fait des chut et des silence sans pouvoir se faire obéir ; il eut alors recours à son argument accoutumé, la gaule ; elle retomba vivement et fortement sur le groupe en désordre ; Lucas en reçut plus que les autres, car il se faisait remarquer par des cris et des mouvements plus prononcés ; au lieu de reculer il avançait toujours, si bien qu’il se trouva seul en avant, seul en vue et seul en face du maître d’école irrité.
Mauvais gamin ! La gaule ne te suffit pas ! Il te faut mieux que ça ! Voilà, mon garçon, tu vas être servi à souhait.
Pan ! pan ! v’lan ! et v’lan ! Lucas reçut en une minute plus de coups qu’il n’en pouvait compter ; il eut les cheveux et les oreilles tirés et il arriva sur son banc par l’effet d’un coup de pied qui le lança comme une balle.
La surprise le rendit muet ; il était reste la bouche ouverte et les yeux écarquillés, quand ses camarades le rejoignirent, les uns riant de sa mésaventure, les autres se frottant les membres, froissés par la gaule.
Le calme était rétabli, le maître d’école se retrouvait sur son estrade ; chacun ouvrait son livre et tirait ses cahiers ; la distribution du travail fut promptement faite ; les petits retournèrent à leur tableau ; la leçon se passa à merveille. Lucas, encore troublé de tout ce qu’il avait reçu, fut docile, sérieux et appliqué ; aussi eut-il des compliments en place des coups du matin. Quand il sortit de l’école avec son frère, Henri les suivit.
« Je vais faire route avec vous, dit-il, puisque nous demeurons dans le même hameau.
Oui, viens avec nous, Henri, nous cueillerons des merises tout en marchant.
Pas moi ; j’aime mieux cueillir des fleurs de MILLEPERTUIS ; c’est la saison.
Pour quoi faire ? Ce n’est pas très joli.
Si fait ! Je trouve très jolies ces grappes de petites fleurs jaunes. Mais ce n’est pas pour cela que je les cueille, c’est pour les mettre dans de l’huile.
Pourquoi faire, dans l’huile ? C’est la gaspiller.
Pour ça, non, ça ne la perd pas ; quand les fleurs ont bien trempé au soleil pendant un mois, l’huile devient toute rouge ; on en met sur des coupures, des brûlures, des plaies, et ça guérit de suite.
Tiens, comment sais-tu ça, toi ?
Je l’ai lu dans un journal que m’a prêté le maître d’école.
Comment s’appelle-t-il, ce journal ?
La Revue de la Presse. Il est amusant tout plein ; il y a un tas d’histoires, et puis des remèdes comme cette huile de MILLEPERTUIS.
Je demanderai au maître d’école qu’il me le prête.
Ce sera amusant ! Si tu vas te mettre à lire maintenant en dehors de l’école, je serai seul pour travailler et m’amuser.
Tu n’as qu’à lire aussi ; tu ne t’ennuieras pas alors.
Si fait, je m’ennuierai ; c’est assommant, de lire ; j’aime bien mieux faner ou bêcher le jardin, ou clore les brèches, ou garder les vaches. Et toi, si tu passes ton temps à lire, mon père te frottera les oreilles, tu verras ça.
Non, parce que mon père sait que je veux devenir savant pour faire mon chemin.
Quel chemin vas-tu faire ?
Je te l’ai déjà dit, je veux faire comme le petit Maigre, M. Féréor, qui était garçon cloutier, et qui a des millions, et des usines partout, et des terres partout, et des châteaux, et qui commande à des milliers d’ouvriers, et qui est heureux comme il n’est pas possible davantage.
Heureux ! C’est donc pour ça qu’il crie toujours ; qu’il est après ses ouvriers comme un dogue après les bestiaux ; qu’il court sans arrêter, comme le Juif-Errant ; qu’il ne se donne de repos ni fêtes ni dimanches.
Je ne dis pas, mais il a tout de même des millions, et la croix d’honneur, et des châteaux, et des terres à ne savoir qu’en faire ; et tout le monde le salue et le craint.
Oui, on le craint, comme tu dis, mais on ne l’aime pas ; on le salue et on rit de lui ; et toi, tout le premier, tu l’appelles vieux parchemin, vieil avare, sac à argent, et je ne sais quoi encore.
Parce qu’il est pas bon, et qu’il ne donne pas aux pauvres, et qu’il est dur pour les ouvriers ; mais je ne ferai pas comme lui, tu verras ça.
Je ne verrai rien du tout, parce que tu resteras ce que tu es ; ouvrier, aidant mon père à faire aller la ferme.
Non, je ne veux pas travaillera la terre ; je te l’ai déjà dit, je n’y travaillerai pas.
Eh ! vous autres, arrivez donc ! On a besoin de vous pour ramasser le trèfle ?
Gaspard et Lucas aperçurent leur père qui les attendait sur le chemin, et qui paraissait mécontent de leur longue absence.
Lucas courut au-devant de lui.
« Nous voici, mon père : nous avons été un peu lents à venir, parce que nous nous disputions Gaspard et moi.
Pourquoi vous disputiez-vous au lieu d’avancer ? Vous savez bien que je ramasse mon trèfle, et qu’on n’a pas trop de tout son monde.
Oui, mon père ; j’y vais tout de suite. C’est que Gaspard veut devenir un monsieur, et que je me moquais de lui.
Ah ! tu veux devenir un monsieur ! Tu n’as pas encore l’âge, mon garçon. Va vite au trèfle ; je vais chercher des liens et je vous rejoins. »
Le père rentra dans la cour de la ferme ; Lucas courut au champ de trèfle ; Gaspard marcha plus lentement encore, en répétant :
« Le trèfle, le trèfle. Je me moque pas mal du trèfle. C’est tantôt une chose, tantôt une autre ; on n’a jamais fini dans cette vilaine ferme. C’est éreintant ; c’est ennuyeux !… Et ce nigaud de Lucas qui pousse à ce travail ennuyeux et fatigant ! Il ne comprend rien ; il est bête comme tout.
Ah ça ! tu as donc la paralysie dans les jambes, que tu n’avances pas plus qu’un lièvre blessé. Tiens, vois ton frère ; le voilà là-bas, là-bas prêt à se mettre à l’ouvrage.
C’est que… j’ai des devoirs à faire.
Quels devoirs ? Pour qui ?
Pour le maître d’école.
Je me moque de ton maître d’école et de ses devoirs quand mes trèfles sont dehors et bons à rentrer. Ton devoir est d’aider au travail de la ferme ; je n’en connais pas d’autre pour le moment. Allons marche, et lestement. Dépêchons-nous. »
Le père poussa rudement Gaspard qui était de très mauvaise humeur, mais qui fut obligé de hâter le pas comme son père. Quand ils furent arrivés au champ de trèfle, Lucas y travaillait avec ardeur ; il avait déjà retourné une demi-rangée de trèfle.
« Tiens, Gaspard, voilà la fourche au pied de l’arbre, » cria-t-il à son frère qui paraissait chercher quelque chose.
Le père était à l’ouvrage avec tout son monde, avant que Gaspard eût ramassé sa fourche.
« Prends garde, lui dit Lucas à demi-voix, mon père te regarde ; il n’a pas l’air trop content. »
Laisse-moi tranquille ; s’il n’est pas content, je ne suis pas content non plus. Vous m’ennuyez tous.
Le père regardait toujours, et voyant la mauvaise volonté évidente de Gaspard, il s’approcha et lui tapa sur le dos avec sa fourche.
« C’est pour te donner du cœur à l’ouvrage, paresseux, fainéant ! Commence, ou je te ferai marcher un peu plus rudement que tu ne le voudrais. »
Gaspard savait que son père ne plaisantait pas quand il s’agissait de travail, et il fut bien obligé de se mettre sérieusement à l’ouvrage ; mais il y mettait de l’humeur, de la mauvaise volonté ; au lieu de retourner le trèfle avec sa fourche, il le poussait et il en laissait la moitié sans y toucher. Le père l’observait sans faire semblant de rien.
On travailla ainsi pendant deux heures environ ; il faisait chaud ; on avait soif. Le champ était fini ; avant de passer à celui à côté, le père appela ses ouvriers.
« Il fait chaud, dit-il ; buvons quelques verres de cidre et mangeons une croûte de pain ; nous allons recevoir ainsi la récompense de notre travail. »
Les ouvriers, joyeux de ce quart d’heure de repos, se groupèrent sous un gros pommier bien touffu qui les abritait du soleil. Lucas accourait rouge et en nage. Gaspard allait aussi prendre sa place, mais le père le repoussa rudement.
Tu n’as pas gagné ta place au milieu de nous, grand paresseux ; va retourner le trèfle que tu n’as fait que pousser, et quand tu auras fini, tu viendras te rafraîchir ; pas avant.
Gaspard, consterné, n’osa pas répliquer, et resta debout, immobile, prêt à pleurer. Quoiqu’il n’eût travaillé ni bien ni beaucoup, la sueur coulait de son front, et il avait évidemment grande envie d’un verre de cidre. Il fit pitié à Lucas.
« Mon père, dit-il, pardonnez-lui ; il était fatigué de l’école, il avait déjà chaud ; c’est pourquoi il a travaillé mollement. »
Et toi donc, n’as-tu pas été à l’école comme lui ? N’avais-tu pas chaud comme lui ?
Oui, mon père ; mais, moi, ce n’est pas la même chose ; je travaille à l’école moins fort que Gaspard, et je supporte mieux la chaleur et le travail des champs.
Parce que tu as du courage et du cœur pour ce qui est du vrai travail, et lui n’est qu’une poule mouillée ; il mérite d’être puni. Il n’en mourra pas, et il fera mieux son devoir à l’avenir… Allons, continua-t-il en s’adressant à Gaspard, va au trèfle, retourne tes rangées, et dépêche-toi.
Le ton du père Thomas ne permettait pas de résistance ; Gaspard reprit sa fourche et commença tristement son travail. Lucas se leva et le rejoignit avant que le père eût pu le retenir.
Ne te chagrine pas, Gaspard, je vais t’aider ; nous allons avoir bientôt fini à nous deux, et tu arriveras encore à temps pour manger un morceau et boire un coup.
Et toi donc ? Tu dois être fatigué.
Pas trop encore ; d’ailleurs, quand je le serais, je trouverais encore la force de te venir en aide.
Merci, Lucas… Tu vois ce que c’est que le travail d’une ferme ! Et tu veux que je passe ma vie à suer, à m’éreinter, à m’ennuyer pour gagner à peine de quoi vivre ? Pas si bête ! Je puis faire mieux que ça, et je ferai à mon idée quand je serai plus grand.
Écoute, Gaspard ; il n’y a déjà pas tant de différence entre la fatigue du fermier et la fatigue de l’école. Seulement, mon travail m’est bon pour la santé ; il me donne de la force, de l’appétit et du sommeil ; et toi, avec tes livres, tu te fatigues la tête, tu deviens malingre, tu dors mal, tu rêvasses un tas de choses qu’on n’y comprend rien ; et, en somme, tu es fatigué plus que moi, tu es sérieux comme un âne et paresseux comme un loir.
Tout en causant et en discutant, ils avaient fini leur ouvrage. Lucas s’était entendu appeler plusieurs fois par son père, mais il n’avait pas fait semblant d’entendre, pour débarrasser plus vite son frère de sa tâche.
« À présent, dit Lucas en riant, mes oreilles se sont ouvertes, et j’entends mon père qui m’appelle tant qu’il a de la voix… Voilà, voilà ! cria-t-il. J’arrive ; nous avons fini. »
Ils eurent bientôt rejoint les autres près du pommier, et tous deux demandèrent à boire et à manger. Le père s’empressa de donner à Lucas une bonne tranche de pain et un grand verre de cidre. Il servit moins abondamment Gaspard.
Tu n’aimes donc pas à tourner le trèfle, mon garçon ?
Je n’aime pas ce qui fatigue et ce qui fait chaud.
Ah ! ah ! ah ! tu es délicat, toi ? Et comment veux-tu que les choses marchent si personne ne veut se fatiguer, ni suer, ni travailler ?
Je veux bien travailler, mais dans des livres et des écritures.
Ah ! tu veux devenir un gratte-papier ! Joli amusement ! J’aime mieux devenir rouge comme un radis en travaillant la terre, que pâle comme un navet en piochant dans les livres.
Je ne serai pas du tout pâle. Est-ce que le vieux M. Féréor est pâle ?
Pour ça non ; je dois dire qu’il est violet tirant sur le noir, à force de se brûler le sang à courir les grandes routes jour et nuit et à expérimenter ses fourneaux. Et tu trouves, toi, que c’est une jolie couleur pour un chrétien ?
Ce n’est pas à la couleur de M. Féréor que je veux arriver, c’est à sa position.
Et tu crois, nigaud, que tu arriveras comme lui aux millions qu’il a gagnés ?
Pourquoi pas ? Puisqu’il les a gagnés, je peux bien les gagner aussi.
Oh ! oh ! monsieur a de l’ambition !
Imbécile ! à quoi te serviront tes millions quand tu seras mort ?
Ils me serviront autant que vous servent vos trèfles et vos blés.
Pour ça, tu as raison, après la mort ; mais pendant la vie, c’est meilleur.
Comment cela ?
Parce que je vis comme un brave fermier que je suis ; que je ne me creuse pas la cervelle à étudier dans les livres ; que je me contente de ce que m’envoie le bon Dieu, et que je ne me ronge pas le cœur à désirer des millions que le bon Dieu n’a pas voulu me donner, puisqu’il m’a fait naître paysan.
Gaspard n’osa pas répondre, car il n’avait rien de bon à dire. On finissait la demi-heure de repos, et chacun se leva.
À présent, mes garçons, rentrons le trèfle qui a été bottelé ce matin. Toi, Guillaume, va chercher la grande charrette. Toi, Lucas, va aider à atteler. Toi, Gaspard, ramasse les râteaux et les fourches et va les porter près des bottes de trèfle. Et vous autres, femmes et garçons, allez faire des liens là-bas sous le pommier, et ramassez le trèfle sec pour être lié.
Chacun alla à son ouvrage, riant, chantant et se dépêchant. Gaspard soupirait, rageait et pestait contre les travaux des champs.
Il fallait bien qu’il travaillât, pourtant, et, comme disait son père, qu’il gagnât son pain.
« Demain, se dit-il, je m’arrangerai autrement, et j’aurai une bonne heure de repos, pendant que ce nigaud de Lucas s’échinera à travailler aux champs. »
Le lendemain, de grand matin, le fermier appela tout son monde ; le temps était superbe.
Allons, les gars, arrivez tous ; à l’ouvrage ; les femmes resteront à la ferme pour soigner les bestiaux et faire des liens ; il faut tout rentrer aujourd’hui. Toi, Lucas, tu vas venir avec nous ; et toi, Gaspard, tu vas aider ta mère, et à huit heures tu nous apporteras notre déjeuner dans les champs.
Et j’irai à l’école ensuite.
Pas d’école aujourd’hui, mon garçon ; l’ouvrage est trop pressé.
Mais, mon père, le maître d’école ne va pas être content.
Laisse-moi tranquille avec ton maître d’école. J’ai besoin de toi, et tu resteras.
Le fermier alla rejoindre les autres, et Gaspard resta immobile et consterné.
« Pas d’école, pas d’école ! répétait-il. Il faut pourtant que j’y aille ; j’ai à parler à M. Tappefort. »
Il réfléchit quelques instants. Son visage s’éclaircit.
« C’est ça ! » s’écria-t-il.
Et il courut à la ferme, prit un livre, et alla trouver sa mère qui battait le beurre.
Maman, mon père m’a dit de rester à la ferme ; je vais aller reporter au maître d’école un livre qu’il m’avait prêté, et je reviens.
Va, mon garçon ; va. Mais ne sois pas longtemps ; j’ai besoin de toi pour m’aider à battre le beurre ; j’ai le bras fatigué, et je n’ai personne pour me remplacer. Ils sont tous au trèfle.
Gaspard hésita un instant. La pauvre mère suait à faire pitié ; il voyait qu’elle avait réellement besoin de quelques instants de repos ; qu’il la trompait en prétextant le livre du maître d’école, et qu’il ferait bien d’y renoncer pour ce jour-là ; mais l’amour de l’étude l’emporta, et il partit en courant.
« Le pauvre garçon ! pensa la mère. Comme il court pour être plus vite revenu… Suis-je fatiguée, mon Dieu ! J’en ai les bras engourdis. »
Elle continuait pourtant à battre son beurre qui ne voulait pas prendre.
C’est singulier ! il y a plus d’une heure que je bats ! Et le beurre ne prend pas… Gaspard ne va pas tarder à revenir ; il n’y a pas loin de chez nous à l’école.
Mais Gaspard ne revenait pas, et les bras de sa mère se fatiguaient de plus en plus. Pendant qu’elle s’éreintait, Gaspard, tranquillement assis dans sa classe, écrivait, lisait, calculait. La classe n’était pas encore ouverte, mais il avait demandé la permission de s’y installer.
« Parce que, m’sieur, dit-il au maître d’école, plus tard je ne pourrai pas ; on a besoin de moi à la ferme ; mon père veut m’envoyer au trèfle, et je ne veux pas rester en arrière des autres écoliers. »
Mais ton père va gronder quand il te saura ici puisque tu as affaire à la ferme.
Oh ! m’sieur, si je l’écoutais, je ne viendrais jamais à la classe. Il dit que ce sont des bêtises, et que je n’ai pas besoin de pâlir sur des livres, que j’en sais bien assez.
Pais comme tu voudras… On apprend bien des choses dans les livres.
Je le sais bien, m’sieur ; et c’est pourquoi je veux devenir savant comme M. Féréor. En voilà un qui a bien fait son chemin !
Prends garde, mon ami, d’en vouloir trop savoir ! Et surtout, ne désobéis pas à ton père. N’oublie pas qu’avant la science vient le respect pour ses parents.
Oh ! m’sieur, je ne manque pas de respect, allez.
Le maître d’école sortit, laissant Gaspard continuer son travail, et lui répétant de ne pas désobéir à son père, et de ne venir à l’école que lorsqu’il en aurait la permission.
Gaspard étudia avec tant d’assiduité, qu’il oublia l’heure, qu’il continua de travailler avec les autres quand ils arrivèrent à huit heures et demie ; neuf heures étaient sonnées quand la porte de l’école s’ouvrit et Lucas entra précipitamment.
Gaspard, Gaspard, mon père m’envoie te chercher. Viens vite, il est en colère tout plein, et il dit que si tu n’obéis pas, il viendra lui-même te chercher, et qu’il te ramènera à grands coups de fouet.
Toute la classe s’agita ; le maître d’école dit à Lucas de sortir, qu’il troublait la classe.
Mais, m’sieur, il faut que j’emmène mon frère. Mon père m’a dit de l’amener, et même il m’a dit que si vous le gardiez malgré lui, il porterait plainte à M. l’inspecteur.
Allons, Gaspard, allons, mon pauvre garçon, il faut obéir à ton père ; pars vite avec Lucas.
Mais, m’sieur…
Il n’y a pas de mais, mon ami ; il faut obéir à son père, tu sais. Tu es bon garçon, bien studieux, bien intelligent, bien habile. Tu feras ton chemin, je te le promets. Mais plus tard, quand ton père te laissera faire.
Gaspard se leva en soupirant et suivit lentement Lucas, qui trépignait d’impatience à la porte.
Quand ils furent sortis du village, Lucas se mit à courir.
« Viens vite, Gaspard, dépêche-toi. Si tu savais comme mon père est en colère ! Nous attendions le déjeuner qui était en retard ! il a été voir pourquoi tu ne l’apportais pas, et il n’était pas déjà trop content. Mais quand il a vu que tu n’avais pas aidé maman à battre son beurre et que tu étais parti pour l’école, et que pauvre maman était si fatiguée qu’elle ne pouvait plus tourner la baratte, et que le beurre n’avait pas pris, il a été d’une colère à nous faire tous trembler. Bien sûr, il va le battre. Il a été couper une gaule dans le bois ; je crains que ce ne soit pour toi. »
Gaspard hâta le pas et se mit à pleurer.
« Mon Dieu ! mon Dieu ! que vais-je devenir ? Quand il est en colère, il n’écoute rien, il tape comme sur une gerbe de blé. »
Il courait, pourtant ; Lucas courait plus vite encore, espérant adoucir son père avant que Gaspard l’eut rejoint. Mais Gaspard avait perdu du temps à se décider à quitter la classe ; il avait marché lentement jusqu’après la sortie du village. La colère du père avait augmenté au lieu de diminuer. Quand il les aperçut, il alla au-devant d’eux et sans écouter les supplications de Lucas, sans avoir égard à la terreur de Gaspard, sans dire une parole, il saisit Gaspard par les cheveux, et, avec la gaule qu’il tenait à la main, il lui administra une si rude correction, que Gaspard commença par crier grâce et pardon, puis par pousser des cris lamentables qui firent accourir la mère et les gens de la ferme.
La mère se jeta sur le bras de son mari et lui arracha la gaule qu’il avait si rudement employée.
Tu as tapé trop fort, Thomas. Quand tu es en colère, tu ne sais plus ce que tu fais.
Oui, j’ai tapé pour qu’il le sente, et, s’il recommence, je taperai plus fort encore.
Gaspard pleurait, Lucas pleurait, la mère Thomas était mécontente, le père Thomas n’était pas content, et les garçons et les filles de ferme se groupèrent autour de Gaspard et de Lucas pour les consoler.
Ne pleure pas, mon Lucas ; tu ne seras pas battu, toi.
Ah ! pour ça, non ; ce n’est pas toi qui te sauverais à l’école de peur de l’ouvrage.
Voyons, Gaspard, faut pas pleurer, mon garçon. Ce qui est fini est fini et ne recommencera pas.
Tu n’es pas le seul qui ait été battu ; je l’ai bien été, moi aussi, et je ne m’en porte pas plus mal.
Sans compter que tu n’avais pas raison de courir à l’école et de nous laisser tous jeûner.
Et de laisser ta mère s’échiner après la beurre sans seulement lui donner un coup de main.
Aurez-vous bientôt fini, vous autres ? L’ouvrage est en retard à cause de ce grand paresseux. Allons ! que chacun prenne sa fourche et son râteau, et aux champs ! Marche en avant, toi, savant ; je finirai bien par t’apprendre ce que tu me sembles ne pas savoir encore, qu’il n’est pas bon de me mettre en colère.
Gaspard marchait trop doucement au gré de son père ; un coup de pied lui fit hâter le pas. Lucas s’approcha du père Thomas :
« Mon père, ne battez plus Gaspard ; vous l’avez déjà tant battu. »
Je l’ai battu, et je le battrai encore, s’il me plaît de le battre. Et toi, tu n’as rien à dire : cela ne le regarde pas.
Cela me regarde, car Gaspard est mon frère, et j’ai du chagrin de le voir souffrir.
Laisse-moi donc tranquille ! S’il souffre, c’est bien sa faute.
Ce n’est pas sa faute s’il aime l’école et s’il veut être savant.
Savant ! Joli état que celui de savant ! Ce n’est pas les livres qui vous mettent de l’argent dans la poche et du pain dans la huche.
Pas les livres, mais ce qu’ils apprennent.
Ah çà ! vas-tu aussi tourner au savant, toi ?
Ma foi non, je n’en ai guère envie ; mais puisque ça plaît tant à Gaspard, pourquoi l’empêchez-vous d’aller à l’école ?
Parce que j’ai de l’ouvrage pressé ; parce que j’ai besoin de lui, et qu’il faut qu’il travaille comme les autres. Tais-toi ; en voilà assez.