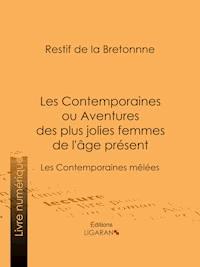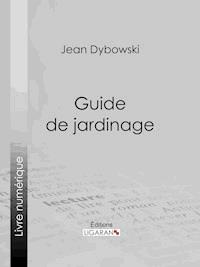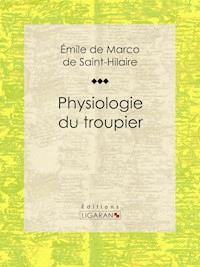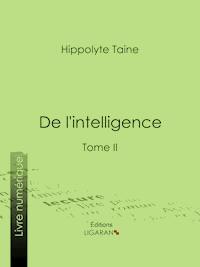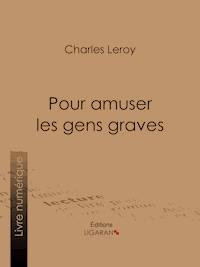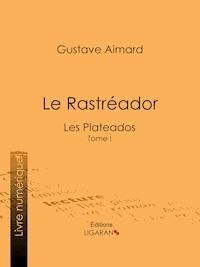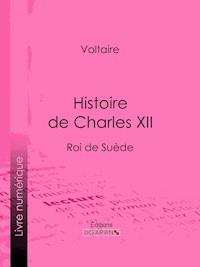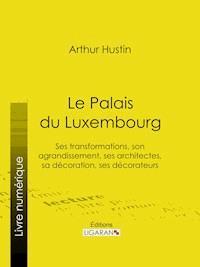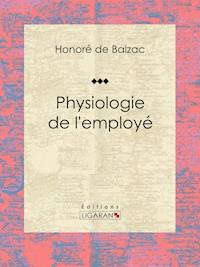Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "L'Europe compte cinq puissances continentales : trois d'entre elles ont formé une alliance qui ne saurait viser que les 2 autres. À l'alliance des trois, les deux puissances tenues à l'écart doivent-elles opposer une alliance à deux ?..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’Europe compte cinq puissances continentales : trois d’entre elles ont formé une alliance qui ne saurait viser que les deux autres. À l’alliance des trois, les deux puissances tenues à l’écart doivent-elles opposer une alliance à deux ?
C’est là tout le problème de la politique du jour. Il n’y en a jamais eu de plus simple, au moins en apparence. La solution semble énoncée dans la donnée ; elle est cependant moins aisée qu’elle n’en a l’air. Pour ne point faire fausse route, il faut chercher la valeur et la relation des deux termes du problème, le facteur russe et le facteur français. Ce dernier peut sembler suffisamment connu en France ; mais c’est là une erreur, car ce qui importe ici, c’est moins l’opinion qu’a la France d’elle-même que l’opinion qu’en ont les autres.
La France vue du dehors. – Le personnel gouvernemental. – Le manque de direction et d’esprit de suite. – Du rôle de la présidence. – Le parti révolutionnaire et la dernière élection présidentielle.
Quel spectacle offre-t-elle à l’étranger, cette France qui a si longtemps gardé le privilège d’attirer l’attention du monde ? Ce qui frappe avant tout, il faut le dire, c’est la petite taille et la petite voix des personnages qui se meuvent sur cette scène retentissante. Quelque opinion qu’on ait de la pièce, les premiers rôles semblent tenus par des doublures. On est surpris de voir à quels minces résultats aboutit cet immense appareil électoral qui semblerait devoir porter à leur suprême puissance toutes les forces de la nation.
Est-ce, comme le disent ses détracteurs d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie, comme le répètent à Paris même tant de désenchantés ou de pessimistes, que cette vieille terre de France est un sol épuisé ? À qui le faire croire, alors que, dans toutes les branches de l’art et de la science, la France donne tant de marques de vitalité ? Depuis 1870, il y a, chez elle, un renouveau dans tous les domaines, et notamment dans les sciences morales, économiques, historiques, dans les sciences qui touchent à la politique. Pourquoi la politique fait-elle exception ? Cela semble tenir au régime. Le propre des démocraties serait-il de remettre le gouvernement aux mains de la médiocrité ? À ce point de vue, l’expérience de la France républicaine est affligeante ; et ceux qu’elle inquiète le plus, en Europe, sont les démocrates, qui avaient salué avec le plus de confiance l’aurore de la troisième République.
On dirait que le suffrage universel, tel qu’il se pratique en France, a pour objet une sélection à rebours. Une assemblée étonnante à cet égard, c’est le quatrième pouvoir de l’État, celui qui commence à intimider les trois autres, le conseil municipal de Paris. L’étranger y cherche en vain un nom connu du dehors. C’est comme si l’on s’était ingénié à exclure toutes les illustrations de la grande ville ; cela ressemble à une gageure.
Au Parlement, au Sénat en particulier, le niveau intellectuel est sans doute plus élevé, grâce surtout aux ruraux ; mais là même que de brasseurs d’affaires ou de tribuns d’estaminet pour un homme public ! Les hommes les plus en vue dans les diverses spécialités de la politique, législation, finances, affaires étrangères, semblent frappés d’ostracisme. On se défie des gens qui savent. La porte des Chambres leur est fermée, ou, s’ils viennent à la forcer, c’est pour jouer, devant l’incrédulité d’un parterre gouailleur, le rôle ingrat de Cassandre.
Et cet abaissement du personnel gouvernemental n’est pas propre au monde parlementaire. Administration, diplomatie, magistrature, tous les services publics ont été ravalés et énervés par des épurations successives qui, sous prétexte de loyalisme républicain, ont presque partout remplacé les hommes capables par des hommes agréables.
Il restait l’armée, la force et l’honneur de la France. Jusqu’à ces derniers temps, elle était demeurée indemne du virus politique ; mais voici que le radicalisme s’ingénie à le lui inoculer. Pour être acclamé grand homme de guerre, il suffit de se faire le courtisan des radicaux. Près d’eux, l’expulsion d’un prince vaut Arcole et Rivoli. Pour la popularité d’un général français, des chansons de cafés-concerts font autant que des batailles. Un chef de corps entre-t-il en lutte avec le Parlement, le suffrage universel s’empresse de le porter sur le pavois. Pour aspirer à la dictature, il n’est plus besoin des victoires d’un Bonaparte ; il semble qu’il suffise d’une belle barbe et d’un beau cheval.
Tel est l’attristant spectacle que présente à l’Europe la France des dernières années. On dirait qu’elle s’est appliquée à justifier les cyniques prédictions du prince de Bismarck lors du procès d’Arnim. Ce procès, qui s’en souvient ? Jamais la brutale franchise du chancelier ne s’était si crûment donné cours. M. de Bismarck n’avait pas craint de prévenir les Français que le meilleur gouvernement pour les intérêts allemands, c’était la république. Il ne leur avait pas caché qu’il comptait sur elle pour isoler la France au-dehors et la débiliter au-dedans : Les Français étaient avertis. Il dépendait d’eux de faire mentir les prophéties de l’oracle de Varan. Les républicains n’avaient guère, pour cela, qu’à suivre les traditions de M. Thiers. Leur premier souci devait être de rassurer les intérêts conservateurs au-dedans, aussi bien qu’au-dehors. Pour ne pas remplir les espérances mises sur elle par le prince de Bismarck, il fallait que la République montrât à l’Europe une France unie, économe, inspirant confiance à l’étranger comme à ses enfants. Est-ce là le programme qu’ont adopté les républicains au pouvoir ? Cette seule question semble une ironie.
Voilà une dizaine d’années que la République travaille à une tout autre besogne, comme si elle avait pris à tâche d’offrir à l’Europe une France désunie, appauvrie, déconsidérée. Le pays ne lui paraissant pas assez divisé par la politique, elle s’est précipitée dans les querelles religieuses, et elle s’obstine à n’en point sortir. Elle a fait de l’école un engin de guerre, et, comme si la foi en Dieu affaiblissait les peuples, elle cherche hypocritement à déchristianiser les masses. L’exemple de M. de Bismarck, revenu du Kulturkampf, est perdu pour les ministres de la troisième République ; le chancelier est libre d’aller à Canossa, les démocrates français sont de trop grands politiques pour l’y suivre. Alors que l’empire d’Allemagne prend soin de faire sa paix avec le saint-siège, ils veulent retirer du Vatican l’ambassadeur de France.
Au point de vue matériel, le parti dominant n’a guère été plus sage. Comme si la France était trop riche, ou comme si elle n’avait pas à songer aux éventualités de l’avenir, la République a éclipsé toutes les monarchies par l’énormité et l’imprévoyance de ses dépenses. Nous ne parlons pas ici de la politique coloniale. Les hommes qui croient le rôle de la France à jamais fini peuvent seuls s’étonner que ses regards osent encore s’étendre au-delà des mers. Ce qu’il est difficile de ne pas remarquer, c’est le décousu de la plupart de ses entreprises coloniales, l’insuffisance des moyens, l’incohérence des procédés, le vague des solutions. On retrouve là le manque de direction et d’esprit de suite qui caractérise toute la politique française.
Quoi qu’il en soit, si l’Europe ne doit pas lui cacher le globe, la France ne saurait se désintéresser de l’Europe. Elle a des voisins qui la condamnent à un perpétuel qui-vive. Mieux que l’Allemagne de M. de Bismarck, c’est elle qui peut dire que « les brochets l’empêchent de devenir une carpe ». Elle a beau souhaiter la paix, il est naturel qu’elle se réserve de mettre à profit les crises qui peuvent se produire, les alliances qui peuvent s’offrir, les conflits que l’avenir ne saurait manquer de provoquer. Mais comment s’y prépare-t-elle ? A-t-elle seulement une politique ? Peut-elle même en avoir une ?
Pour être en mesure de négocier et de traiter avec d’autres États, il faut, dans un gouvernement, un organe permanent, un pouvoir sur lequel on puisse compter en tout temps, au moins une tradition respectée de tous. Où, dans la France actuelle, trouver rien de semblable ?
Est-ce à la Chambre des députés ? Les majorités y varient à chaque trimestre, et pas un député sur dix n’a quelque notion de l’Europe ; cela semble inutile à un législateur français.
Est-ce au Sénat ? les hommes compétents y sont moins rares, mais les affaires étrangères ne sont pas dévolues au Sénat français comme, à Washington, au Sénat américain.
Est-ce au quai d’Orsay ? Combien de ministres l’ont traversé depuis dix ans ? Les huissiers n’ont pu en retenir les noms. La direction des affaires extérieures était hier aux mains d’un homme de sens et de sang-froid ; combien de temps l’a-t-il gardée ? quatorze ou quinze mois, et cela a paru un long règne ministériel. À M. Flourens a succédé M. Goblet. Quel député présidera, dans six mois, à la diplomatie française ? Pour les affaires étrangères, toute compétence semble oiseuse. À M. de Bismarck, la République opposa le premier avocat venu. On dirait que le suffrage universel ou le scrutin de la Chambre confère à ses élus une grâce d’en haut qui les rend aptes à tout. Les ministres des divers cabinets peuvent prétendre à tous les portefeuilles ; pour se mettre d’accord, il semble qu’ils tirent entre eux les ministères au sort.
Les défiances politiques excluent du quai d’Orsay les hommes qui ont pratiqué les cabinets ou les cours de l’Europe. Connaître une cour serait seul un motif de suspicion. Ce qu’il y a de plus grave, c’est que cela est encore moins la faute des hommes que la faute du régime. C’est la conséquence d’un système où tous les intérêts du pays sont abandonnés aux caprices d’une Chambre ignorante et aux hasards de majorités qui n’admettent qu’une règle : les considérations électorales.
Du vivant de M. Gambetta, il y avait au moins, à la commission du budget ou à la présidence de la Chambre, une influence dominante. Pour être peu constitutionnelle, la dictature occulte du tribun de Cahors n’en avait pas moins l’avantage de donner une sorte de continuité aux cabinets renversés par les jeux du Parlement. Les envoyés des puissances pouvaient encore trouver à qui parler. Aujourd’hui, rien de pareil.
Il y a bien la présidence de la République. On aurait pu croire qu’au milieu de cette incessante mobilité, l’Élysée représenterait l’esprit de suite, indispensable aux relations entre gouvernements. C’était là, semble-t-il, la mission de la présidence. Chacun sait que ce n’est pas ainsi qu’elle a été entendue. S’il est une chose dont, durant son règne de neuf ans, M. Grévy s’est abstenu, c’est la politique étrangère. Pour lui, le monde semblait finir aux montagnes du Jura. M. Grévy a été remplacé ; peut-on dire que la situation ait changé avec le changement de président ?
Parmi les candidats à la suprême magistrature, il y avait un homme capable peut-être de donner à la politique française une impulsion personnelle ; on l’a écarté. On tenait à ce qu’aucune direction ne pût venir de l’Élysée. Si la présidence de la République est encore quelque chose, on paraît ne pas vouloir que le président soit quelqu’un. Au chef de l’État, il est interdit d’avoir une politique.
L’espèce de révolution parlementaire de décembre 1887 est peu faite pour rassurer les amis de la France. Certes, c’est une belle chose qu’une élection présidentielle en une après-midi. Le mérite, il est vrai, en revient à Versailles et à la constitution de 1875, qui a imaginé de faire nommer le président, sans délai, par les Chambres réunies, non au palais Bourbon, mais hors de Paris. Si courte qu’elle ait été, il était temps que la crise finit. Paris et la France sont, durant quelques jours, demeurés sans gouvernement : vingt-quatre heures, quarante-huit heures de plus et tout devenait possible. Pour facile qu’ait été la transmission des pouvoirs, elle n’en a pas moins laissé apercevoir le défaut du mécanisme gouvernemental. L’Europe croyait le président élu pour sept ans, placé au-dessus du mauvais vouloir des Chambres, et voilà que, pour le renverser, il a suffi d’une mise en demeure du Parlement. En visant l’homme, les Chambres ont inconsciemment touché l’institution. Le Luxembourg et le Palais-Bourbon ont appris aux factions comment on se débarrasse d’un Président. Croit-on M. Carnot sûr d’achever ses sept ans ?
Ce n’est pas tout ; cette crise a découvert à l’étranger deux plaies dont il se figurait la République indemne ou guérie ; la corruption administrative et l’agitation révolutionnaire.
Jusqu’ici, à travers toutes ses révolutions, la France avait gardé la réputation d’un pays intègre, trop administré peut-être, mais administré honnêtement. C’était sa force, en même temps que sa gloire. Aujourd’hui, la vieille renommée de l’administration française est atteinte ; elle n’a pas résisté aux faiblesses de l’Élysée, aux complaisances ou aux complicités de la Chambre. Tandis qu’à Paris le scandale était tel, depuis des années, que, dans les ministères, plus rien n’étonnait ; au-dehors, comme en province, le soupçon n’eût osé monter jusqu’au gendre du chef de l’État. On se demande aujourd’hui si c’est bien le même homme que la Chambre s’obstinait à nommer président de la commission du budget et rapporteur général du budget. Pour l’étranger, c’est comme un charme de rompu. Cette longue indifférence des pouvoirs publics pour les questions d’honorabilité paraît un symptôme grave. On y a vu une marque d’affaissement du sens moral. « L’âge de la bégueulerie est passé », s’écriait M. Gambetta, parlant des femmes de ses ministres. L’âge de la respectabilité est passé, feraient dire nombre de politiciens de la troisième République.
Grâce à Dieu, il reste encore en France des hommes probes, à commencer par M. le président de la République ; mais le fait seul de nommer un président pour sa réputation d’intégrité n’a-t-il pas quelque chose d’inquiétant ? Le Seigneur disait à Abraham qu’il épargnerait Sodome, s’il y trouvait dix justes. On dirait que le Congrès de Versailles a cru tout sauver parce qu’il en a trouvé un. La commission d’enquête nommée par la Chambre ne semble pas avoir fait grande besogne. Police et magistrature paraissent avoir moins de souci de découvrir les coupables que de dégager les personnages compromis. À travers les voiles timidement soulevés par la justice, pour les laisser discrètement retomber, on entrevoit une corruption qui gagne de proche en proche. Cela n’est pas une force pour un pays.
Ce mal rongeur, qui dévore lentement les chairs d’un peuple, n’est pas le seul dont la France se montre atteinte. Les derniers évènements en ont dévoilé un autre, sinon plus dangereux, du moins plus rapide ; nous voulons parler de l’agitation révolutionnaire. Aucun État n’en est aujourd’hui indemne : la monarchie n’en préserve pas plus que la république. Ce qui est particulier à la France, ce qu’a révélé la crise présidentielle, c’est « l’action des éléments révolutionnaires sur le gouvernement. On a vu entrer en scène un nouveau pouvoir qui, pour n’être pas occulte, n’en est pas plus constitutionnel. La rue a reconquis une place dans la politique française. Elle n’avait pu maintenir son favori au ministère de la guerre ; elle a pris sa revanche avec l’élection du président. Si elle n’a pas imposé de candidat, elle a imposé son veto.
Le comité central révolutionnaire s’est reformé. Pendant trois jours, il a couvert Paris de ses affiches rouges, sans que la police osât y porter la main. Elle est moins timide avec les manifestes des exilés. Le conseil municipal a pu impunément annoncer une insurrection, si le nouveau président n’était pas de son goût. La nuit qui a précédé l’élection, la Commune de 1871, le hideux revenant, a fait une apparition à l’Hôtel-de-Ville. Pour avoir raison de la représentation nationale, il a suffi du spectre de l’émeute : devant lui s’est évanouie la candidature antipathique à l’Intransigeant et à la Lanterne.
Ce qu’il a pu faire pour une élection à la présidence, le parti révolutionnaire peut se le permettre pour une crise ministérielle. La Chambre saurait-elle mieux résister lorsque, ne pouvant se réfugier à Versailles, elle entendrait, du palais Bourbon, le grondement du flot populaire sur les quais ou la place de la Concorde ? Quand, un jour de congrès, en pleine paix, le gouvernement étant sur ses gardes et les troupes sous les armes, les manifestations de la rue ont un tel ascendant, l’étranger se demande ce qu’il adviendrait en temps de guerre, alors que Paris serait dégarni de troupes, ou que tout le peuple serait armé. Faudrait-il, à la première rumeur de défaite, voir le drapeau rouge hissé sur Notre-Dame et la France en guerre civile ?
L’étranger se méprend, nous dira-t-on ; il n’a pas compris les évènements de décembre. Ce que de loin il prend pour une marque de faiblesse est un signe de force. Ce n’est pas la crainte de l’émeute, c’est le besoin d’union qui a inspiré l’élection de M. Carnot. Elle est sortie d’un élan spontané, comme en suscite notre patriotisme en toutes les grandes occasions. L’attitude des Chambres, lors de la démission de M. Grévy, montre que les Français savent au besoin faire abstraction de leurs querelles. Ils sauraient bien, en cas de guerre, le faire voir à l’ennemi.
Soit ; le caractère français a de ces brusques mouvements qui déconcertent les étrangers. Sa générosité native offre autant de ressources que de périls. M. Carnot a dû son élection à une heure d’enthousiasme et au besoin d’union. Cela a été un beau coup de théâtre ; mais cela a duré aussi peu. La concentration faite sur le nom du président n’a pu se faire sur celui de ses ministres. Réussirait-elle à s’accomplir autour de M. Floquet ou de M. Clemenceau, qu’on peut se demander si l’autorité de la France au-dehors en serait accrue.
Qu’est-ce, en effet, que cette concentration tant prônée, sinon l’union d’une moitié de la nation contre l’autre ? Car, au-dessous de la France républicaine et libre penseuse, il reste une France conservatrice, une France religieuse, et cette autre France, nous ne sachons pas que la politique de concentration songe à lui faire une place. Loin de là, c’est pour lui courir sus qu’on invite les républicains à s’entendre. Le premier article de tout traité d’alliance des groupes de gauche, c’est, comme l’a déclaré M. Clemenceau, la reprise des hostilités contre l’ennemi commun. Sous un nom de paix se dissimule une politique belliqueuse. Des deux Frances qui se disputent, en les déroutant trop souvent, les sympathies de l’Europe, l’une doit traquer l’autre sans lui accorder de quartier. Une guerre civile, patente ou latente, voilà le dernier mot de la concentration. Après cela, comment s’étonner que le pays se détache du parlementarisme et que le suffrage universel fasse bon visage aux candidats à la dictature ?
La politique de concentration. – Doit-elle tourner à l’accroissement des forces de la France ? – À qui doit profiter la concentration républicaine ? – Le radicalisme et la politique extérieure. – Le radicalisme et les finances de la France. – Le radicalisme et l’armée française.
L’union de tous les groupes républicains tournerait-elle au moins à l’accroissement des forces matérielles de la France ? L’étranger se permet d’en douter.
Sur quoi se fera la concentration, alors qu’elle ne pourra plus se faire uniquement sur les personnes et les amours-propres ? Sur quoi s’est-elle déjà parfois opérée, grâce aux compromissions de ministères hybrides ? Sur de prétendues réformes, sur ce qu’on appelle pompeusement les grandes réformes démocratiques. Et que sont ces réformes, qui doivent enfin donner à la France « la vraie République » ? Autant de coups portés à l’organisme social, financier, administratif, militaire de la France. Au lieu de consolider la machine gouvernementale, elles auraient pour premier effet d’en détendre les ressorts, d’en relâcher les rouages. Tandis que les jacobins de 1793 avaient au moins le mérite de ramasser dans leurs mains toutes les forces du pays, pour les lancer contre la coalition, les radicaux de 1888 semblent n’avoir d’autre souci que d’énerver la puissance publique et de démanteler l’État. N’est-ce pas là le sens de l’autonomie parisienne ?
Or, c’est bien au radicalisme que doit profiter toute concentration ; aussi ne cesse-t-il de la réclamer. C’est le pavillon sous lequel il compte faire passer sa marchandise. L’avènement des radicaux et de la vraie République amènera un nouveau personnel gouvernemental et une nouvelle politique.
Pour le personnel, c’est le pouvoir remis à des mains de moins en moins compétentes et de plus en plus besoigneuses, passant « des nouvelles couches » aux couches en formation. Pour la politique, c’est la France traitée comme une grenouille ou un lapin de laboratoire, abandonnée, entre les mains d’opérateurs inhabiles, aux recettes des empiriques et aux expériences des utopistes.
Quelle politique extérieure pourrait avoir un pareil gouvernement ? Quelle impression ferait-il en Europe ? Certains politiciens semblent s’imaginer qu’un pays peut tout se permettre chez lui, sans que sa position au-dehors en soit affectée. C’est là une erreur enfantine. Un État ne peut ébranler ses institutions, ruiner ses ressources, affaiblir son gouvernement, sans se discréditer à l’étranger. Les conquêtes du radicalisme ne froissent pas seulement les susceptibilités de douairière de la vieille Europe, elles inquiètent les cabinets et enlèvent la confiance des hommes d’État.
« Nous autres souverains, disait un jour le roi Victor-Emmanuel à un des ambassadeurs de la République, nous sommes monarchistes. » C’est là, soit dit en passant, un des motifs de l’alliance de l’Italie avec les empires voisins. Ce qui est vrai du Quirinal l’est encore davantage de la Hofburg et du palais d’Hiver. À plus forte raison est-on enclin au conservatisme dans les cours étrangères. Tout l’esprit des Français ne saurait empêcher que, princes et ministres, les hommes qui dirigent les affaires européennes aient généralement des préjugés conservateurs ; qu’ils aient peu de confiance dans l’extrême démocratie ; qu’à leurs yeux, les idées révolutionnaires soient un débilitant et le radicalisme un dissolvant.
On paraît croire en France que, si les gouvernements étrangers ne font pas bon visage au radicalisme, c’est uniquement parce qu’ils en craignent la propagande. Quand nous aurions une politique radicale, disent nombre de Français, ce serait pour l’intérieur ; nous n’aurions garde d’en faire un article d’exportation. Nous serions, à Paris, les protégés des révolutionnaires et les instruments des socialistes, sans être au-dehors les fauteurs du républicanisme ni les patrons du nihilisme. Notre dynamite, nous saurions la mettre sous clef ; quand elle ferait explosion, les voisins n’auraient pas à en redouter les éclats : nous sauterions tout seuls.
Les Français qui raisonnent ainsi ne songent qu’aux ennemis de la France ou aux indifférents. Ils oublient les peuples ou les gouvernements qui portent encore intérêt à la puissance française. Si les étrangers appréhendent l’avènement du radicalisme, ce n’est pas uniquement qu’ils aient peur des théories radicales, c’est aussi qu’ils n’y croient pas. De ce qu’on craint l’infection de la fièvre révolutionnaire, il ne suit point qu’on la regarde comme bénigne pour le malade qui risque de l’apporter aux autres. Parce qu’elle est contagieuse, elle n’en semble pas moins dangereuse. Si l’on se flattait de s’en isoler entièrement, c’est un mal que, avec M. de Bismarck, l’on verrait sans peine à ses ennemis. Personne n’aurait l’idée de le souhaiter à ses amis.
Le radicalisme, il est vrai, n’est pas encore le maître incontesté de la France. Ce n’est que le dauphin de la République. Il n’est pas défendu d’espérer que, au lieu de s’abandonner à lui, le pays, par un mouvement brusque, se dérobe à son étreinte. La situation actuelle, avec ses ambiguïtés et ses incertitudes, avec ses compromissions et ses contradictions, peut se prolonger quelques années ; et, dans notre Europe en armes, c’est beaucoup de gagner deux ou trois ans. Le malheur est que, pour énerver le pays, le radicalisme n’a pas besoin de régner en souverain absolu.
Grâce à la complicité de faux modérés, la politique de glissade, en honneur depuis dix ans, à déjà permis bien des destructions ou des mutilations. Les ressources d’un État, au point de vue de sa puissance, consistent en deux choses surtout, les finances et l’armée. C’est grâce à une ancienne supériorité, à ce double égard, que la France a joué un tel rôle dans le monde. Or l’armée et les finances, voilà précisément ce qui est le plus menacé, ou mieux, le plus entamé par le radicalisme.
Pour les finances, le mal est déjà grand. Les ressources de la France étaient considérables. On le savait partout ; cela seul lui valait, dans le monde, la considération, qui s’attache à la richesse. L’aisance avec laquelle M. Thiers a payé à M. de Bismarck ses cinq milliards a émerveillé l’Europe, mais elle a ébloui la République. Ce pays si riche, ses gouvernants semblent avoir pris à tâche de le ruiner. À l’étranger, où l’intérêt électoral ne trouble pas l’arithmétique, chacun sait ce que leurs représentants s’efforcent encore de dissimuler aux Français : la France, depuis une dizaine d’années, s’est habituée à dépenser, en outre de ses ressources ordinaires, au moins 500 millions par an, de façon que, en pleine paix, l’administration des vrais républicains lui a coûté aussi cher que l’indemnité prussienne.
La présidence de l’économe M. Grévy a été une ère d’imprévoyantes prodigalités. On a gouverné comme si la France était une île au milieu de l’Océan, sans voisins à surveiller, sans guerres à redouter. Tandis que Berlin avait soin de grossir son trésor de guerre, tandis que le prince de Bismarck n’épargnait rien pour fortifier les finances du nouvel empire, la République engageait de toute façon l’avenir, accumulant les emprunts publics et déguisés, gaspillant inconsciemment les ressources de ses conversions de rente, s’appropriant les fonds des caisses d’épargne, recourant à tous les expédients des fils de famille en détresse. Il lui faut aujourd’hui créer des taxes nouvelles, et déjà la France a le plus lourd budget du globe.
C’est là, pour elle, dans les compétitions de la paix ou de la guerre, une évidente faiblesse. On songe à ces courses où les chevaux qui ont gagné des prix sont astreints à porter une surcharge. Il en est ainsi de la France vis-à-vis de ses concurrents. Avant que le signal du départ n’ait été donné, elle a eu la présomption de se mettre elle-même dans des conditions d’infériorité. Les ressources qu’il lui fallait épargner pour les jours de péril, ses gouvernants les ont prodiguées en places inutiles et en chemins de fer électoraux.
On reconnaît le mal aujourd’hui ; on sent qu’il est urgent de refaire les finances de la France ; mais qui s’en chargera ? Est-ce le radicalisme, qui fait profession de promettre la diminution des impôts ? On sait, hélas ! ce que valent en finances les théories radicales ! Pour elles, le capital est un gibier à traquer, un animal nuisible à pourchasser en toute saison, au risque de le détruire ou de le faire émigrer. Un gouvernement radical est forcément un gouvernement cher. Il est cher, pour ainsi dire, par définition. La vocation du radical, c’est de faire du neuf ; il se plaît à démolir pour reconstruire sur un plan nouveau ; et, en politique, tout comme ailleurs, rien de plus dispendieux que la manie de la truelle.
En est-il de l’armée comme des finances ? Pas encore, heureusement ; mais le jour approche où l’armée française va être soumise, elle aussi, aux expériences démocratiques. Le radicalisme a déjà remporté en elle une victoire. Sous prétexte d’égalité, il a fait adopter une bonne partie de son programme.
La France a aujourd’hui une armée nombreuse, exercée, bien équipée, des officiers pleins d’entrain, des soldats qui, en dépit des mœurs politiques, semblent avoir conservé la discipline. Cette armée, le pays a le droit d’en être fier. À l’Allemagne, les Français n’ont peut-être à envier que son état-major et sa tradition. La loi militaire votée par l’Assemblée nationale a, dans son ensemble, donné des résultats excellents. Et voici que cette loi, au lieu d’en corriger les défectuosités de détail, on la sacrifie à la réclame électorale. Est-ce ainsi que procède le Reichstag de Berlin ? C’est peut-être la première fois qu’on a vu discuter une loi militaire, en mettant au second plan les considérations militaires. Cette armée, dont elle peut avoir besoin avant trois mois, la République la refait et la défait, comme un enfant ses bataillons de soldats de plomb.