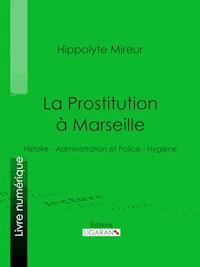
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "On ne saurait indiquer avec de sérieuses garanties de certitude quel fut l'état de la prostitution à Marseille dans les premiers siècles qui suivirent sa fondation. Les plus anciennes traditions ne nous fournissent à cet égard aucun renseignement précis, et parmi les nombreux auteurs qui ont écrit notre histoire locale, il n'en est pas un seul qui semble s'être préoccupé de ce sujet."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De toutes les villes de France, aucune peut-être, sans même excepter la capitale, n’a une plus mauvaise réputation que Marseille au double point de vue de la profusion des maladies vénériennes et du développement de la prostitution. Cette sorte d’accusation est-elle vraiment fondée ?… C’est ce que nous nous proposons de rechercher dans le cours de cette étude.
Il est vrai que la situation particulière de Marseille, la prospérité de ses industries si multiples, ses relations commerciales avec toutes les parties du monde, en font pour ainsi dire une cité à part. Ouvriers, marins, étrangers y affluent en plus grand nombre que partout ailleurs, la plupart ardents au plaisir et avides de jouissances faciles. De là, chez cette partie au moins de notre population, des mœurs, des habitudes et des exigences très diverses.
À l’une de ces exigences, et sans contredit la plus impérieuse, répond la prostitution. Or, comme il est démontré que dans tout pays la proportion des maladies vénériennes est en raison directe du degré de la dépravation morale, il ne serait pas surprenant de voir plus loin justifiée cette fâcheuse réputation qui a été de tout temps attribuée à notre ville.
Mais n’anticipons pas sur nos conclusions ; mieux vaut laisser aux chiffres seuls, ces éléments irréfutables de discussion, le soin d’établir la vérité et de répondre aux diverses questions que nous avons en vue.
Nous étudierons dans ce travail la prostitution à Marseille sous les trois aspects suivants : son histoire, l’administration qui la régit, ses rapports avec l’hygiène.
1° Au point de vue historique, nous suivrons pas à pas sa marche envahissante ; nous dirons les phases les plus saillantes qui ont marqué son extension et les diverses péripéties qu’elle a eues à subir aux différents âges de notre histoire locale. Nous passerons aussi en revue les principaux arrêtés et règlements que nos anciens magistrats ont successivement formulés contre les prostituées et contre leurs excitateurs ou complices. Si, d’une part, la corporation des filles publiques paraît à certaines époques légalement établie et reconnue, on ne tardera pas à voir un peu plus loin ces mêmes filles folles de leur corps poursuivies avec une rigueur presque barbare et leur odieux commerce prohibé sous les peines les plus sévères.
Dans l’ensemble de ces dispositions municipales si variées, qui pourraient être considérées à bon droit, comme la jurisprudence du passé sur la matière, nous aurons de précieux enseignements à puiser pour le présent comme pour l’avenir.
Il ressortira peut-être de cet exposé, contrairement à l’opinion générale, que les temps anciens n’eurent pas beaucoup plus de moralité que l’époque actuelle. S’il en est ainsi, c’est-à-dire si la prostitution nous apparaît déjà développée dans l’antiquité, encore florissante au moyen Âge et résistant jusqu’à nos jours à l’œuvre modificatrice des siècles, nous en déduirons cette triste conclusion, qu’elle est un vice inhérent à l’espèce humaine, un mal incurable que rien ne peut détruire, mais contre lequel la société a le devoir de se mettre en garde.
2° Au point de vue administratif, nous exposerons, sans y trop insister, les dispositions actuelles qui régissent la prostitution, renvoyant pour de plus amples détails à notre ouvrage : « LA SYPHILIS ET LA PROSTITUTION DANS LEURS RAPPORTS AVEC L’HYGIÈNE, LA MORALE ET LA LOI. » Notre conscience seule nous guidera pour dire avec franchise le bien ou le mal que nous pensons des règlements qui sont aujourd’hui en vigueur ; c’est affirmer hautement que la plus parfaite sincérité doit inspirer chacune de nos appréciations.
Nos fonctions de médecin-inspecteur du dispensaire de salubrité publique nous ont mis à même, depuis plusieurs années, de voir de près les avantages et les inconvénients du régime administratif auquel les prostituées sont soumises dans notre ville. Nous considérons comme un devoir de mettre à profit l’expérience que nous avons acquise pour signaler à la municipalité ainsi qu’à l’administration supérieure les abus qu’il faut détruire et les modifications qui sont nécessaires ou même opportunes.
La préfecture de police de Paris a naguère remis à l’étude l’importante question de la prostitution ; elle a donc compris que parmi les règlements existants, il en est plusieurs qui ne sont plus en rapport avec les exigences modernes. Rendons hommage à ceux qui ont provoqué cette révision salutaire comme à ceux qui l’ont accomplie ; mais en même temps profitons de leur exemple. Il ne faut pas que les questions qui touchent à l’intérêt public aient en France deux solutions différentes. L’unité dans la législation du pays est non seulement une garantie, mais une nécessité sociale de premier ordre : à ce titre, Paris et la province doivent être soumis à un régime administratif identique.
3° Au point de vue de l’hygiène, nous ferons connaître les diverses mesures qui concernent la prostitution dans ses rapports avec la santé publique. Le fonctionnement du service médical chargé de l’inspection, l’organisation des visites sanitaires, le traitement hospitalier des prostituées atteintes de maladies vénériennes, tels seront les points principaux sur lesquels nous aurons à insister dans ce chapitre. Quant aux résultats obtenus, nous ne les établirons que pièces en mains, et autant que possible sur des chiffres et des statistiques. En comparant ces chiffres à ceux fournis par les dispensaires des autres grands centres de population, nous verrons jusqu’à quel point notre ville doit figurer au premier rang des cités les plus corrompues au physique et au moral.
Un auteur anglais, sir John Stuart Mill, a dit : « On ne peut ni prévenir, ni guérir les maux de la société tout comme les maladies du corps, à moins d’en parler ouvertement. » Nous inspirant de cette pensée, et après avoir déjà écrit en 1875 un volume sur la prostitution, nous ne craignons pas d’aborder pour la seconde fois l’étude de ce même sujet, c’est-à-dire de ce fléau qui, par sa propagation incessante, devient une menace réelle pour la société.
L’heure est d’ailleurs venue où il n’est plus permis de se faire illusion et de garder des scrupules. La question de la prostitution et par suite de la police des mœurs, dont on n’osait parler autrefois qu’à mots couverts, compte aujourd’hui parmi les questions sociales les plus discutées. En France comme à l’étranger, elle est à l’ordre du jour. Ne s’en est-on pas occupé librement, il y a quelques mois à peine, dans les congrès, dans les réunions publiques, dans les journaux ? Le Parlement d’Angleterre et le Conseil municipal de Paris n’ont-ils pas consacré à son étude plusieurs de leurs séances ? Et enfin, pour ne rien cacher de la vérité, certaines dames étrangères, animées d’une énergie et d’une hardiesse peu communes à leur sexe, n’ont-elles pas créé une ligue internationale contre l’organisation actuelle de la prostitution inscrite ?
En présence de ce mouvement général de l’opinion publique, il devient nécessaire que nos législateurs, quelles que soient leurs répugnances et la délicatesse du sujet, n’hésitent pas plus longtemps à se saisir à leur tour de la question. Moins scrupuleux que leurs prédécesseurs du Conseil des Cinq-cents, qu’ils ne laissent donc plus aux municipalités ni le soin ni le droit d’établir des mesures variables et souvent arbitraires ; qu’ils promulguent enfin une loi destinée à régir définitivement la matière et à donner à toute la France une législation uniforme. Le jour où, à l’exemple du Parlement anglais, notre Chambre législative aura proclamé ce grand acte, nous rendrons à nos députés ce témoignage mérité qu’ils ont une fois de plus rempli fidèlement leur mandat, en prenant en main la défense de la liberté individuelle menacée, de la santé et de la morale publiques compromises. Ce sont là, il faut en convenir, des intérêts assez graves pour mériter l’attention du Gouvernement et la sollicitude du législateur !
Avant de terminer ce préambule, il nous reste un devoir à remplir, une dette à acquitter.
L’œuvre que nous avons entreprise était au-dessus de nos forces. Si nous avons osé l’aborder, c’est que des hommes, dont le savoir égale l’obligeance, ont généreusement mis à notre disposition de précieux matériaux qu’ils avaient accumulés de longue date. Il est tout naturel, ayant bénéficié de leurs études, que nous inscrivions au moins leurs noms en tête de cet ouvrage.
Qu’on nous permette donc de rendre ici un public hommage de reconnaissance à M. le docteur Sauvet, qui n’a pas hésité à nous confier tous les documents que, depuis une vingtaine d’années et à titre de médecin en chef du service des mœurs, il avait collectionnés avec tant de soins ; à M. Maurice Dunan, ce jeune professeur d’histoire du Lycée Louis-le-Grand, dont les connaissances spéciales et les conseils nous ont été si utiles ; à notre excellent ami Joseph Mathieu, ce bibliophile infatigable, qui, si bien initié à tous les secrets de l’histoire de Provence, nous a fait profiter, sans réserve, du fruit de ses travaux ; à M. J. Eiglier, qui, pendant son trop court passage à nos archives municipales, a prêté à nos recherches le secours de sa vaste érudition ; à M. F. Pelizza, qui participa à la rédaction de plusieurs de nos chapitres, et, enfin, à M. C***, que sa position officielle nous défend de nommer, mais ne nous empêche pas de remercier.
Vous tous, Messieurs, qui fûtes presque mes collaborateurs, recevez l’expression très sincère de ma gratitude. Comme je suis de ceux qui aiment à se souvenir, c’est à vous, n’en doutez pas, si ce livre obtient quelque succès, que j’en attribuerai le premier mérite.
En ce temps de pornographomanie, quelques-uns croiront peut-être que cet ouvrage a été écrit en vue de satisfaire des curiosités malsaines. Que ceux-là se détrompent ! Nous n’eussions jamais touché à un tel sujet, si d’avance nous n’avions eu la certitude de pouvoir imprimer à notre œuvre un caractère à la fois scientifique et moral.
Bien pénétré, au contraire, de ce sentiment que notre étude répond à un but supérieur d’utilité sociale, nous la soumettons avec confiance à l’appréciation de l’autorité compétente et au jugement du public.
MARSEILLE, le 25 juillet 1882.
On ne saurait indiquer avec de sérieuses garanties de certitude quel fut l’état de la prostitution à Marseille dans les premiers siècles qui suivirent sa fondation. Les plus anciennes traditions ne nous fournissent à cet égard aucun renseignement précis, et parmi les nombreux auteurs qui ont écrit notre histoire locale, il n’en est pas un seul qui semble s’être préoccupé de ce sujet.
Malgré cette pénurie de documents, qui eussent été si précieux à notre étude, essayons de rechercher quelles furent ou mieux quelles durent être les mœurs de nos premiers ancêtres.
Il est permis de supposer que les fondateurs de l’antique Massilia, en venant créer cette colonie lointaine, y apportèrent les coutumes, les lois, le langage, la religion, les mœurs de leur pays d’origine. Or, par une coïncidence bizarre, la même époque qui est généralement assignée à la fondation de Marseille, est aussi celle ou Solon, ce sage réformateur des lois de la Grèce, créait pour ainsi dire la prostitution légale, en imposant aux courtisanes d’Athènes de sévères règlements et en autorisant la libre institution des établissements publics de débauche. Sans vouloir prétendre que les mœurs furent dès lors aussi dissolues dans la nouvelle cité phocéenne qu’elles l’étaient dans les principales villes grecques, il est cependant probable que Marseille suivit bientôt l’exemple de la mère-patrie, et ne tarda pas à avoir comme elle ses dicterions et ses hétaïres, ses Laïs et ses Phryné. Si le nom d’aucune de ces héroïnes de la galanterie des premiers âges n’a survécu dans nos annales, c’est sans doute parce que, moins heureuses que leurs sœurs de Corinthe et d’Athènes, elles ne rencontrèrent, pour immortaliser leur beauté, ni l’éloquence d’Hypéride ni le ciseau de Praxitèles.
À défaut de preuves plus certaines de cette similitude des mœurs grecques et phocéennes, le titre flatteur de nouvelle Athènes que reçut Marseille peu de temps après sa fondation, semble du moins indiquer que notre ville eut plusieurs points de ressemblance avec la célèbre et voluptueuse cité de l’Attique. Et, certes, il est loin d’être démontré que cette ressemblance ne s’étendit pas aux mœurs tout en s’adressant de préférence à la culture des lettres, des sciences et des beaux-arts. Cette appréciation semble même d’autant plus plausible que le seul auteur ancien qui ait défini les mœurs marseillaises, Plaute, dont les écrits, on le sait, remontent à deux siècles environ avant notre ère, affirme qu’elles étaient, comme en Grèce, délicates, molles et dissolues.
L’histoire, à son tour, nous apprend que la première religion en usage à Massilia, fut le paganisme grec. Or, s’il faut encore ajouter foi à la tradition, parmi les divinités dont le culte était particulièrement sacré dans les vingt principales villes de la Grèce, la Vénus Pandémos, déesse de la prostitution, occupait le premier rang. Tous les mois, se célébraient en l’honneur de cette divinité érotique des fêtes pompeuses, qui s’accompagnaient le plus souvent d’étranges excès de zèle religieux. Les courtisanes de toutes classes, dictériades, aulétrides et hétaïres, en étaient les fidèles prêtresses. À certains jours même, n’accordant leurs faveurs qu’au profit de la déesse protectrice, elles venaient, le lendemain, lui consacrer pieusement en offrande le fruit des débauches accomplies sous ses auspices. Peut-être le culte de Pandémos n’entraîna-t-il jamais dans notre ville naissante de semblables excès ; mais il est du moins vraisemblable que cette Vénus impudique, ne fût-ce que par imitation, y eut aussi son temple et ses autels à côté de l’Apollon de Delphes et de la Diane d’Éphèse.
Sous la domination romaine, les Massiliotes comme les Gaulois ne tardèrent pas à subir l’influence étrangère. Avec les armes des vainqueurs, leurs lois avaient franchi les Alpes, et avec leurs lois les mœurs et la dépravation de Rome. À cette époque, en effet, l’empire romain, au lieu de donner aux peuples soumis à sa puissance l’exemple des vertus civiques comme au temps de sa splendeur, ne pouvait plus leur offrir que le triste spectacle de la corruption qui déjà préparait sa chute.
Initiée tout à coup aux délices d’une civilisation malsaine notre Gaule ne conserva pas longtemps intacte son ancienne austérité. Marseille ne résista pas davantage, et même la démoralisation y fit de tels progrès que bientôt, suivant Athénée, on vint jusqu’à dire en proverbe : Embarquez-vous pour Marseille, quand on voulait exprimer : Allez vivre dans la débauche. D’ailleurs, n’est-ce pas Marseille qui donna le jour à Pétrone, cet auteur satirique que Tacite a appelé le plus habile voluptueux de son époque et qui fut l’intendant raffiné des plaisirs ou plutôt des orgies de Néron ?… « Un homme dont les mœurs sont si hautement dépravées, – a dit avec juste raison, il y a près d’un siècle, un écrivain de notre ville, – n’est pas le seul de son espèce dans sa patrie. »
À Rome, des lois très sévères étaient établies contre la prostitution. Est-il à présumer que ces mêmes lois furent jamais en usage à Massilia ?… Faute de documents assez précis, nous ne pouvons nous livrer à ce sujet qu’à de vagues suppositions.
Pour le même motif aussi, nous nous abstiendrons de préciser quelle fut sur les mœurs marseillaises l’influence du christianisme, et, un peu plus tard, celle que dut amener l’invasion de la race franque. Toutefois, si cette double influence, comme c’est vraisemblable, fut la même dans notre cité que dans toutes les autres parties des Gaules, elle exerça, momentanément du moins, une action des plus salutaires : le christianisme, en apportant une nouvelle et très puissante force moralisatrice ; l’invasion de la race franque, en opposant à la dépravation gallo-romaine la fière et sauvage individualité d’une race forte.
Mais une fois cette heureuse influence éteinte, qu’advint-il de l’état des mœurs à Marseille durant cette série de siècles pendant lesquels notre ville, en butte à des guerres continuelles, perdit et recouvra tour à tour son indépendance ?… Par analogie, la réponse est tout indiquée.
C’est, en effet, dans cet intervalle qu’on vit partout en France la prostitution revêtir un caractère légal et établir ainsi son existence sur des bases nouvelles, mais définitives. Dès lors, devenue dans l’état social une profession reconnue et autorisée, elle fut soumise à certaines prescriptions particulières ; mais elle cessa d’emporter note d’infamie. Grâce à la licence du système féodal, elle forma bientôt une corporation régulière, et elle eut, chose inouïe ! comme tous les autres corps de métiers, ses règlements, ses coutumes, voire même ses privilèges. Ne citons pour preuve que ces processions solennelles (et c’est là un fait absolument historique), qui, dans un très grand nombre de villes, étaient accomplies chaque année par les filles publiques en l’honneur de sainte Magdeleine, leur patronne.
La prostitution ayant ainsi établi officiellement ses droits, il serait peu logique de supposer que Marseille fît exception à la loi commune, et qu’il ne se produisît pas chez nous ce qui s’était produit partout ailleurs.
En vain Charlemagne, par deux capitulaires devenus célèbres dans les annales de la législation française contre la débauche publique, avait-il tenté d’améliorer l’état social et de réformer les mœurs. Les ordonnances de ce prince restèrent sans effet et le nombre de femmes de mauvaise vie augmenta sous ses successeurs dans d’étonnantes proportions.
Au commencement du treizième siècle, elles étaient devenues si nombreuses que Sauvai ne craint pas d’affirmer « que jamais il n’y en avait eu tant dans le royaume. »
À l’avènement de Saint-Louis, en 1236, la débauche publique était plus grande encore. Le premier soin du jeune roi fut de s’appliquer à la combattre par les moyens les mieux en rapport avec son caractère, la religion et la charité. Mais ce régime de douceur n’ayant produit aucun résultat, le saint roi voulut détruire la prostitution, en la prohibant sans exception ni réserve par tout son royaume, dans les provinces du Nord comme dans celles du Midi.
Dans ce but, il publia, au mois de décembre 1254, une ordonnance mémorable dont l’article 27 était ainsi conçu : « Item, soient boutées hors communes ribaudes tant de champs comme de villes, faites les monitions ou deffenses, leurs biens soient pris par les juges des lieus ou par leur autorité, et si soient dépouillées jusqu’à la cote ou au pelicon ; et qui louera maison à ribaude, ou recevra ribauderie en sa maison, il soit tenu de payer au bailli du lieu ou au prévost ou au juge autant comme la pension vaut en un an. »
En même temps que Saint-Louis promulguait cette ordonnance, son frère, Charles d’Anjou, comte de Provence, confirmait les statuts et coutumes de cette province en ordonnant : « Que tous ceux qui se mêlaient de corrompre et prostituer les femmes ou filles, omnes lenones, seraient chassés de ses comtés de Provence et des terres voisines qui dépendaient de ses États. Que, si dix jours après la publication de cette ordonnance, il se trouvait encore quelqu’un assez misérable pour exercer cet art impie en quelque lieu que ce fût, étant sous sa domination, il voulait qu’il en fût informé, et qu’après la vérité connue, le coupable fût puni selon la sévérité des lois et que l’on y ajoutât la confiscation de tous ses biens. Il fait enfin deffense à tous ses officiers de donner retraite en leurs maisons à aucunes femmes prostituées ou de mauvaise vie, à peine de privation de leurs offices et de cent livres couronnées d’amende, attendu le scandale que ce mauvais commerce causait. »
Cette ordonnance du Comte de Provence, inspirée sans doute par celle de Saint-Louis, est le premier document authentique que nous possédions sur la législation de la débauche publique dans notre région. Elle prouve au moins, comme nous le disions plus haut, que la prostitution suivait dans notre pays, et principalement à Marseille, la même marche envahissante que dans le reste de la France.
L’acte prohibitif de Charles d’Anjou fut exécuté avec toute la rigueur que comportait la police de l’époque. Les filles folles de leurs corps, comme on les appelait alors, furent contraintes de s’éloigner de Marseille. Beaucoup d’entre elles se réfugièrent dans les campagnes voisines et dans les villages des environs où elles portèrent la corruption. Celles qui restèrent dans la ville durent se cacher ou affecter une conduite décente. Mais cet état de choses donna bientôt lieu à de fâcheuses aventures et les femmes d’honneur furent exposées à de trop fréquentes méprises. On acquit donc cette triste expérience qu’il est impossible d’abolir totalement le vice de la prostitution sans tomber dans d’autres désordres plus dangereux encore.
En présence de tous ces inconvénients, le Conseil de Ville de Marseille s’empressa de revenir sur l’ordonnance de Charles d’Anjou. Bien convaincu que dans l’intérêt même des bonnes mœurs, il valait mieux, au lieu de tenter l’abolition impossible de la prostitution, chercher à en modérer les excès, ce Conseil décida de reléguer les courtisanes dans certains quartiers et de leur interdire de porter les mêmes parures que les femmes honnêtes. C’était agir avec d’autant plus de sagesse qu’on allait pouvoir par ces moyens se livrer à une surveillance plus active des lieux de débauche et mieux assurer la décence et la tranquillité publique.
L’ordonnance (De Meretricibus) que nous trouvons dans les archives de nos Statuts municipaux, Livre V, Chap. XII, et qui remonte à la seconde moitié du treizième siècle, est un témoignage irrécusable de la sagacité des magistrats de l’époque. Voici la traduction exacte de cette ordonnance curieuse à plusieurs titres : « Des Courtisanes. – Par le présent Statut, nous interdisons à toutes les filles publiques de porter des vêtements écarlates, des fourrures soit de petit-gris, soit d’hermine et tout manteau autre qu’en étoffe rayée avec cordons de la même étoffe ; il leur est pourtant loisible de porter l’écharpe écarlate. Toute courtisane qui aura eu la témérité de contrevenir aux précédentes dispositions, sera passible envers la Cour d’une amende de soixante sous royaux couronnés, et ce toutes les fois que pareille infraction sera constatée. Au cas où elle ne pourrait satisfaire à ladite amende, elle subira le fouet sur la place publique. Il est, en effet, de toute rigueur de pouvoir distinguer les femmes dont les désordres sont de notoriété publique d’avec les femmes honnêtes. Par courtisanes publiques, on doit entendre celles qui sont connues pour vivre dans un lupanar ou maison de débauche, celles qui se prostituent ouvertement en vue d’en retirer un profit, celles qui reçoivent dans leurs demeures, de jour ou de nuit, deux ou plusieurs hommes dont l’intention, en se rendant chez elles, est bien arrêtée de s’y livrer à la débauche et à l’orgie.
Nous décidons également que nulle courtisane ne pourra désormais établir sa demeure, si modeste qu’elle soit, aux environs du monastère de Saint-Sauveur, c’est-à-dire de la rue de la Vieille-Monnaie à la rue de Bernard de Beaulieu et de cette dernière rue au four de Guillaume Hugues. Leur sont aussi interdits : les alentours de l’église des Accoules depuis les hauteurs des Moulins et le mazeau des Tours jusqu’à la maison de Bernard Bonnafoux, l’île de Durand de Villeneuve et celle de Guiraud de Syronne et de Raimbaud le chandelier. Dans le délai d’un mois, à partir de la publication du présent statut, toutes les courtisanes seront rigoureusement expulsées des quartiers ci-dessus désignés, et cela sur les plaintes des honnêtes gens, leurs voisins, à qui sera laissé le soin de vérifier l’exactitude de l’accusation en vertu de laquelle lesdites femmes doivent être expulsées.
Nous décidons aussi que la Cour Marseillaise sera, de son côté, tenue de prononcer l’expulsion des femmes qui habitent au milieu d’honnêtes gens, sur la requête et les plaintes de ces derniers.
Il est également interdit à toute courtisane d’habiter auprès des autres églises de la ville. Tout citoyen qui aura enfreint cette disposition, soit en louant à des filles publiques une ou plusieurs maisons, soit en les recevant ou en leur permettant de séjourner chez lui, sera puni d’une amende équivalant au montant du loyer annuel des maisons ou de la maison où les dites femmes auront demeuré ; cette amende sera exigible chaque fois que l’infraction prévue ci-dessus sera constatée. »
Non contents de ces dispositions protectrices, les édiles marseillais, pour éviter aux femmes honnêtes le désagrément de se rencontrer avec les prostituées dans les établissements publics, édictèrent un nouvel arrêté qui avait pour but de défendre aux courtisanes l’accès des maisons de bains à certains jours de la semaine. Chose bizarre dans cette ordonnance, les juifs y subissent la même flétrissure que les filles publiques. « Nous interdisons formellement à tout propriétaire de bains et étuves de recevoir dans son établissement des juifs et des juives, excepté le vendredi de chaque semaine ; la même défense est faite en ce qui concerne les courtisanes publiques et leurs servantes, à l’exception du lundi de chaque semaine. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie d’une amende de soixante sous au minimum et laissée à l’appréciation du Recteur.
La présente interdiction est signifiée directement aux Juifs et aux Juives ainsi qu’aux courtisanes, et il leur est enjoint de s’y conformer sous peine d’une condamnation qui sera prononcée par le Recteur ou les Consuls. »
Pour bien se rendre compte de toute la portée de ce statut, il est indispensable de savoir que, dans les temps anciens, les étuves étaient souvent les lieux choisis pour les rendez-vous galants. Comme les faits de débauche s’y accomplissaient nombreux et presque toujours sans beaucoup de discrétion, il était urgent d’épargner à la pudeur publique ces pernicieux exemples. Après cet arrêté, il devenait loisible à chacun, mais alors sous sa seule responsabilité, d’aller, au jour voulu, jouir du spectacle de l’immoralité en action.
Pendant un siècle environ, les filles publiques restèrent dans les limites que l’ordonnance De meretricibus, leur avait assignées. Mais bientôt elles s’établirent en si grand nombre dans certaines rues et y causèrent de tels scandales, que les habitants de la rue Bellande adressèrent une pétition au Conseil pour obtenir leur expulsion ou au moins pour les obliger à transporter leurs pénates et leur honteux trafic dans la rue Ingarienne, où de temps immémorial existait un prostibulum, c’est-à-dire une maison publique.
Après une délibération en date du 16 mars 1339, le Conseil de Ville, faisant droit à cette démarche, nomma quatre délégués auprès du Séneschal : « Est ad evitanda futura scandala propter ea quæ commissa sunt et comituntur in carreriâ Bellande, ob stagia inhibidem meretricum ; ut idem dominus Senescallus dignetur expresse dare in mandatis domino Judici Turrium ut idem dominus Judex expellat a totâ dictâ carrierâ omnes dictas meretrices, in dictâ carrierâ moram facientes mantiones earum, si voluerint, in carrierâ Guarriani trahentes, ubi antiquo tempore teneri prostibulum est consuetum. »
La fin du quatorzième siècle fut marquée par deux autres délibérations municipales. L’une conçue dans un but essentiellement moralisateur, était relative à la création d’une maison de refuge où se retireraient les femmes débauchées qui, revenues à de meilleurs sentiments, auraient été touchées de la grâce pendant la semaine sainte, qui était, paraît-il, la semaine des conversions. « Ut mulieres faillitæ quæ in tempore septimanœ sanctœ, divinâ aspirante gratiâ, sunt per penitentiam ad honestatem vitæ reductæ, earum corpora valeant in honestate et castitate in Domino conservare, carentque habitatione pro nunc in quâ valeant Dei servitio famulari, placuit dicto consilio refformare quod domus quæ fuit Martini de Mosteriis sita juxta hospitale Beatæ Mariœ Annunciatœ, ematur per sindicos, pretio quo poterit meliori, de pecunia hospitalium hujus civitatis, illis solutionibus quibus melioribus potuerit ; in quâ dictæ mulieres se valeant reducere, et in illâ earum corpora in omni honestate in Domino conservare ».
L’autre délibération, datée du 8 mai 1383, renouvelle et confirme l’ordonnance De meretricibus, qui était probablement déjà tombée en désuétude. Elle a, en effet, pour but de faire appliquer rigoureusement l’article des Statuts qui interdit aux courtisanes de porter des vêtements semblables à ceux des femmes honnêtes. On y émet aussi le vœu que les prostituées ne puissent avoir d’autre demeure que le prostibulum. « Attento quod meretrices inter bonas et honestas mulieres non noscuntur portu inordinato vestimentorum et arnesiorum causante, placuit dicto consilio reformare et refformando dictum domum locumtenentemrequiere quod statutum super hoc edictum, positum in quinto libro statutorum numero CCII, sub rubricâ de meretricibus quod ad meretrices in prostibulo publico commorantes plenarie observare faciat, eumque per dictam civitatem et loca ipsius consueta faciat voce preconia publice divulgari ; et quod nulla meretrix publica de prostibulo audeat commorari, seu stagiam facere aut nullus eam tenere nisi in prostibulo, sub penâ formidabili imperio dicti domini vicarii imponenda ».
Mais, contradiction singulière ! pendant qu’on édictait ces diverses ordonnances prohibitives, les Comtes de Provence percevaient un droit sur la prostitution. Ce droit consistait en quelques deniers que devait payer toute femme de mauvaise vie qui pénétrait dans leurs domaines avec l’intention d’y vivre de la débauche.
Un peu plus tard, à l’exemple de Toulouse, dont les Capitouls faisaient construire des maisons destinées aux filles de joie et qui en tiraient ensuite un revenu consacré aux réparations de la ville et à l’entretien des hôpitaux, Marseille transforma la débauche publique en une sorte d’institution municipale régie et exploitée comme toute autre branche de l’administration. L’impôt communal prélevé sur elle, comme autrefois l’or lustral à Rome, portait dans notre ville une dénomination spéciale ; on l’appelait : redditus curanus pelosi ou simplement curant peloux. Le produit de cette taxe honteuse, qui, après quelques interruptions, s’est malheureusement perpétuée jusqu’à nous, était, comme il l’est encore aujourd’hui, versé sans le moindre scrupule dans la caisse municipale. C’est là un fait odieux, sur lequel nous nous réservons de revenir en temps opportun.
Pour veiller à la perception régulière de cet impôt, le Conseil de Ville de Marseille nommait chaque année, sous le titre assez impudique de subrestans du curant peloux, des commissaires qui étaient en même temps chargés de la surveillance des prostituées. C’était la police des mœurs de l’époque ; et Dieu sait quel dut être à ces temps à demi barbares le mode de fonctionnement de cette police !… Quoi qu’il en soit, l’institution des subrestans du curant peloux subsista pendant de longues années, et il faut même arriver jusqu’à la fin du dix-septième siècle pour voir cette charge tomber dans le ridicule et enfin abolie.
Pendant que la prostitution était ainsi régie à Marseille, les autres principales villes de Provence avaient aussi leurs lois et leurs coutumes particulières. À titre de complément de l’étude que nous poursuivons, il nous convient d’en dire au moins quelques mots.
À Arles, en 1256, sur la demande du Corps de Ville, les commissaires députés décidèrent que le témoignage des courtisanes ne serait plus reçu en justice. À cette même époque, s’il faut en croire le savant historien Anibert, « rien n’était si multiplié à Arles que les lieux publics de prostitution. On en trouvait non seulement dans la ville, mais encore dans toute la campagne ».
Dans la seconde moitié du treizième siècle, un nommé Robin de Cis, qui s’était arrogé, on ne sait trop à quel titre, la qualité de Roi des Ribauds, levait une espèce de tribut sur les femmes de mauvaise vie. Il exigeait six deniers de chacune de celles qui habitaient dans l’enceinte de la ville et trois deniers seulement de celles de la campagne. Mais le Parlement, informé de cet abus, fit sur le champ chasser le ribaud et restituer tout ce qui avait été payé.
Divers règlements, consignés dans les annales de la ville, obligeaient les courtisanes d’Arles à n’établir leur demeure que dans certaines rues qui leur étaient assignées. Si quelqu’une s’avisait de venir loger dans les quartiers réservés à la population honnête, il était permis aux voisins de les expulser de leur propre autorité.
« Au quinzième siècle, continue Anibert, on trouve établi dans Arles un usage qui venait sans doute de plus loin, et que je ne crains pas de faire remonter au temps de la République. Le Corps de Ville fournissait et entretenait les maisons où les courtisanes exerçaient leur profession.
En 1489, ces femmes n’étant point assez commodément logées à leur fantaisie, vinrent habiter des maisons voisines du couvent des R.P. Carmes, au quartier du Marché neuf. Ces bons religieux, auxquels un pareil voisinage offrait sans doute de fréquents et cruels objets de distraction, supplièrent le Conseil de Ville de vouloir bien les en délivrer et de faire transporter ailleurs le lieu de débauche. En conséquence, on délibéra le 15 avril d’acheter un nouveau local pour y transplanter cet étrange bercail et l’on nomma six commissaires pour y procéder conjointement avec les Consuls, le Prieur des Carmes et le Ministre des Pères Trinitaires.
Malgré ces belles espérances, les Pères Carmes essuyèrent encore pendant huit ans complets tout le chagrin et le danger de ce spectacle. Ce ne fut que dans le Conseil tenu le 10 avril 1497, que l’on fixa enfin la demeure des femmes déshonnêtes près de l’égout de l’hôpital Saint-Esprit du Bourg, dans la maison que la communauté y avait fait construire et à laquelle on donnait le nom de Soclavarié ou Sobvigarié, parce, qu’il y avait un appartement d’où le Sous-clavaire ou Sous-viguier veillait à ce qu’il ne se passât rien en ces lieux de contraire à la tranquillité publique et à la sûreté de ceux qui y fréquentaient ».
Ajoutons, pour terminer ce rapide exposé de l’état de la prostitution à Arles pendant le moyen Âge, un très curieux passage des archives de cette ville en date de 1598 : « De toute ancienneté, disent ces annales, les Consuls et Conseils de la Maison Commune avaient coustume aux festes de la Penthecoste, ensemblement avec la course et sault des hommes, de faire courir les femmes de joie dont celle qui gagnait la course, gaignait un pair de bas de drap et un pair de soulier, dont le Sous-Clavaire a toujours l’intendance. Mais il arriva qu’un bon père Jésuite preschant à Saint-Trophime quelques jours avant les dictes festes et exagérant l’infamie de telles courses de femmes, les Consuls trouvèrent bon de les supprimer. De façon que le Sous-Clavaire, qui, quelques jours avant, s’était saisi desdictes femmes et en tenait plusieurs enfermées, les lascha aussitôt. Ainsi ceste sale coustume fut abolie. Desquelles courses ce proverbe, vous n’aurez pas les chausses, est tiré, quand on le dict au second qui apporte quelque nouvelle dont le prix doit être donné au premier, comme les chausses estaient données à la première de ces femmes qui gagnait le prix de la course. »
Une course à peu près semblable avait lieu chaque année à Beaucaire, la veille du jour de l’ouverture de la célèbre foire qui se tenait dans cette ville. Toutefois le prix n’était plus un pair de chausses comme à Arles, mais unpaquet d’aiguillettes. De là encore est sans doute venu cet ancien dicton qu’une femme court l’aiguillette quand elle se livre à la prostitution.
À Manosque, il existait, comme dans les autres villes, des prescriptions relatives au costume des prostituées. Il leur était défendu de porter les joyaux dont les femmes honnêtes avaient seules le droit de se parer. Mais ces dispositions étant difficiles à faire observer, le Conseil, par une délibération en date du 8 octobre 1433, se décida à acheter vers Notre-Dame-de-Bon-Repos une maison destinée à y loger les femmes légères, mulieres leves, disent les annales.
Des désordres graves, dont les sous-viguiers eux-mêmes furent les principaux auteurs, se produisirent dans cet établissement peu de temps après sa fondation. À la suite d’une rixe sanglante, les consuls, pour éviter le retour des scènes de ce genre, se trouvèrent dans la nécessité de prendre un arrêté qui interdisait aux ruffians et autres gens malfamés de porter des armes, soit le jour, soit la nuit.
À Salon, à Draguignan, à Toulon, des règlements tous conçus dans le même esprit, confinaient la prostitution dans des quartiers déterminés. L’administration de ces diverses villes alla même plus loin : elle affecta au logement des courtisanes réunies en communauté des établissements placés sous sa dépendance et dont le régime fut mis au rang des services publics.
À Aix, les prostituées habitaient de préférence la Bonne rue ou Bouena carriera. Dénomination ironique qui correspondait à la rue Chaude d’un grand nombre de cités.
À Sisteron, les femmes de mauvaise vie, suivant une délibération du 20 février 1343, étaient particulièrement tenues de ne pas séjourner dans les cabarets. Toutefois, en opposition aux usages d’Arles, leur serment était accepté en justice.
S’il faut en croire Laplane, les filles publiques furent à diverses reprises l’objet de la sollicitude du Conseil de cette ville. « Car si d’une part, dit cet auteur, on devait les séquestrer de la société, de l’autre il fallait veiller à ce que rien ne manquât à leur entretien ; mais ce qui était indispensable, c’est que l’établissement fut toujours assez bien peuplé pour offrir une garantie aux honnêtes femmes de la ville ».
Une coutume très bizarre dans ce pays était le péage de cinq sols que les femmes de joye, comprises dans le même tarif que les bêtes de somme, devaient payer au passage du pont de Peipin sur la Durance.
Les charges et les droits de la basse galanterie étaient ainsi établis à Marseille et dans les principales villes de la Provence, lorsqu’eut lieu, vers la fin du quinzième siècle, l’invasion de la syphilis en Europe. Cette cruelle maladie, inhérente désormais à la débauche publique, devait naturellement faire entrer l’histoire de la prostitution dans une phase nouvelle.
La syphilis, cette lèpre moderne qu’apportèrent d’Amérique les compagnons de Christophe Colomb, se répandit sur l’ancien continent avec une promptitude et une violence inouïes. La France entière ne tarda pas à payer un large tribut à cet affreux mal, dont l’apparition frappait le monde de terreur.
Tous les auteurs contemporains de l’épidémie nous en ont laissé de navrantes descriptions. Citons parmi eux : Nicolas Léonicène, 1497 ; Gaspard Torella, 1500 ; Jacques Catanée, 1505 ; Jean Alménar, 1510, etc., etc.
Mais, pour donner une idée exacte de l’intensité qu’avait à cette époque le virus syphilitique, exposons ici le tableau que Jérôme Fracastor, en 1530, comme dans un résumé synthétique de tout ce qui avait été écrit avant lui, a tracé de la vérole : « Étudions maintenant, dit le poète-médecin, étudions les symptômes de ce fléau que l’influx céleste vient de reproduire après de longs siècles d’oubli.
Ce mal n’affecte ni les muets habitants de l’onde, ni les bêtes fauves des forêts, ni les oiseaux du ciel, ni les chevaux, ni les bœufs, ni le menu bétail. Il n’en veut qu’à l’homme : l’homme seul est sa proie.
Dans le corps humain, c’est le sang qu’il attaque tout d’abord, et ne s’alimentant que d’humeurs crasses et visqueuses, c’est aux parties épaisses et corrompues de ce fluide qu’il s’attache de préférence.
Ici surtout, ô muse, je réclame ton secours pour tracer le tableau de cette peste exécrable. Daigne aussi m’inspirer, Apollon, Dieu du jour, Dieu de la poésie, et fais que mon œuvre puisse, grâce à toi, traverser les siècles à venir. Un jour viendra peut-être où nos arrière-neveux auront plaisir à consulter la description d’un mal oublié. Oublié, oui, car nul doute que dans un temps donné ce mal ne rentre dans les ténèbres du néant. Et nul doute aussi qu’après une autre série de siècles, il ne revienne à la lumière pour affliger de nouveau le monde et répandre encore une fois la terreur parmi les peuples d’un autre âge.
Un premier fait des plus surprenants, c’est qu’après avoir contracté le germe de la contagion, la victime touchée par le fléau ne présente souvent aucune lésion bien manifeste avant que la lune n’ait accompli quatre fois sa carrière. Le mal, en effet, ne se révèle pas immédiatement par des symptômes accusateurs dès l’instant où il pénètre dans l’organisme. Pendant un certain temps il couve en silence, comme s’il recueillait des forces pour une explosion plus terrible. Dans cette période, toutefois, une langueur insolite s’empare du malade et déprime tout son être ; l’esprit semble alourdi, les membres mous et défaillants se refusent au travail, l’œil perd son éclat et le visage assombri se couvre de pâleur.
C’est aux organes de la génération que se porte le virus tout d’abord, pour s’irradier de là sur les parties voisines et sur les régions de l’aine. Bientôt après, se manifestent des symptômes plus tranchés. Lorsque s’éteint la lumière du jour pour faire place aux ombres de la nuit, à l’heure où la chaleur innée des corps vivants abandonne les parties périphériques pour se concentrer sur les viscères, soudain d’atroces douleurs éclatent dans les membres chargés d’humeurs viciées et torturent les articulations, les bras, les épaules, les mollets. C’est qu’à ce moment, en effet, la nature vigilante, ennemie de toute impureté, travaille à réagir contre les ferments putrides que le mal a introduits dans les veines et dont il a pénétré toutes les humeurs, tous les sucs nourriciers de l’organisme. Elle s’efforce de les chasser, elle lutte énergiquement contre eux. Mais ceux-ci résistent ; épais, visqueux, ne se déplaçant qu’avec lenteur, ils se fixent aux chairs, ils s’attachent à la trame exsangue des tissus et provoquent partout où ils adhèrent d’effroyables souffrances.
Les plus subtiles de ces humeurs morbides, celles qui se laissent le plus facilement évacuer, se réfugient soit vers la peau, soit aux extrémités des membres. Elles produisent alors sur ces points de hideux exanthèmes qui se répandent bientôt sur tout le corps et couvrent le visage d’un masque repoussant.
Inconnus jusqu’à nos jours, ces exanthèmes consistent en des boutons pustuleux et coniques, qui, gorgés de liquides corrompus, ne tardent pas à s’ouvrir pour donner issue à une sanie muqueuse et virulente. Quelquefois même des boutons semblables se développent dans la profondeur des organes et corrodent sourdement les tissus. On voit ainsi d’horribles ulcères dépouiller les membres, dénuder les os, ronger les lèvres et pénétrer jusque dans la gorge, d’où ne s’échappe plus qu’une voix sourde et plaintive.
D’autres fois encore, il s’exhale de la peau des humeurs épaisses qui se concrètent en croûtes immondes à la surface des téguments. Tels on voit les sucs visqueux qui suintent du cerisier ou de l’amandier se condenser en calus gommeux sur l’écorce de ces arbres.
Ah ! que de malades, tristes victimes de ce fléau, contemplant avec horreur leur visage et leur corps couverts de hideuses souillures, déplorant leur jeunesse flétrie en sa fleur, n’ont pas maudit les Dieux et menacé le ciel ! Infortunés ! La nuit qui verse un doux repos sur toute la nature, n’a plus de charmes pour eux, car le sommeil fuit leurs paupières. Pour eux, de même, l’aurore se lève sans attraits, car le jour comme la nuit rappelle leurs douleurs. Plaisirs de la table, festins joyeux, dons enivrants de Bacchus, fêtes de la ville, délices de la campagne, rien ne leur sourit plus. Vainement ils vont chercher quelque allégement à leurs souffrances sur les rives verdoyantes qu’égaie le murmure des eaux, sous les ombrages des vallons, dans les solitudes des montagnes. Désespérés, éperdus, ils reviennent adresser aux Dieux d’ardentes prières, brûler dans les temples l’encens expiateur, charger les autels de riches présents. Peines inutiles ! Les Dieux restent sourds à leur voix et dédaignent leurs offrandes ».
Voilà décrite dans toute son horreur, bien que sous une forme poétique, cette cruelle maladie du quinzième siècle, dont la syphilis de notre époque n’est plus heureusement que la faible reproduction !
La France, avons-nous dit, fut peut-être de toutes les nations celle qui eut le plus à souffrir du terrible fléau. De même notre province, par suite de ses relations incessantes avec l’Espagne et l’Italie, ces deux points de départ de la dispersion syphilitique, fut aussi celle qui subit les premières atteintes. Une autre cause du reste, à défaut de cette influence de voisinage, pourrait encore expliquer l’importation du virus plus rapide dans nos parages que partout ailleurs. Ce fut, en effet, par la Provence que les troupes de Charles VIII, à leur retour d’Italie, rentrèrent en France en 1495. Or, cette armée revenant du pays où l’infection vénérienne avait éclaté et déjà fait tant de victimes, ne devait-elle pas semer sur son passage le germe fatal et y laisser des traces indestructibles du mal de Naples ?
Si les archives de Marseille sont muettes à cet égard, nous trouvons du moins, dans les annales de Manosque, une délibération en date du 17 avril 1496, qui mentionne le premier cas de syphilis incontestable en France. Cette délibération reproduite à titre de curiosité et avec plus ou moins d’exactitude par tous les historiographes de la vérole, nous apprend que le Conseil de Ville de Manosque, cette année-là même (1496), donna mission à Honoré Saffalin, syndic, d’ordonner à Elzéard Buès, fermier des fours banaux de la cité, de défendre l’entrée de ces fours à Peyrache, son fils ; et cela, parce qu’il était atteint de la maladie dite de las boyas, d’après la dénomination espagnole, maladie jusque-là inconnue en Provence et que des soldats au service du roi et du duc d’Orléans avaient rapportée d’Italie l’année précédente.
Une fois importé, le germe de la syphilis se propagea dans des proportions effroyables. Les moindres hameaux de notre région, comme la plupart des villes, furent tout à coup infestés. Partout l’épidémie devint à ce point meurtrière, qu’on vit succomber presque tous les malheureux que la hideuse maladie avait atteints. Pour comble de malheur, la science, en face de ce mal jusqu’alors inconnu, restait impuissante, ne sachant encore quel remède lui opposer. C’est assez dire combien l’alarme devint générale et à quelle consternation furent en proie toutes les populations de nos contrées.
Jusqu’à cette époque, l’autorité n’avait eu à poursuivre dans la promulgation de ses ordonnances contre les filles publiques, que le seul but de défendre la morale et de protéger l’ordre public. L’apparition de la syphilis et sa rapide propagation en France auraient dû imprimer un caractère nouveau à ce genre de législation et faire adjoindre au côté administratif des règlements certaines mesures sanitaires imposées par les circonstances. Il n’en fut malheureusement pas ainsi ! Nous aurons même à parcourir plus de deux siècles encore pour arriver à l’établissement de ces heureuses institutions prophylactiques, qui maintenues jusqu’à nos jours, font le plus grand honneur au régime administratif sous lequel elles ont pris naissance.
Mais revenons à notre cité.
À Marseille donc, la prostitution soumise à une taxe officielle était, par ce fait même, régulièrement établie et reconnue.
Pendant les XVIe et XVIIe siècles, cette situation changea peu, et le nombre des filles publiques suivit une progression constante.
Les abords de la rue Ingarienne, où, par ordre administratif, avait été autrefois relégué le personnel de la débauche, devinrent le théâtre de si affreux scandales, que les habitants de ce quartier, par deux pétitions successives en date des 11 janvier et 15 juin 1495, demandèrent à l’autorité supérieure de confiner ailleurs le honteux trafic dont ils étaient chaque jour témoins. Mais aucun titre de nos archives ne prouve que ces réclamations aient été entendues.
Cependant, comme les filles de joie, grâce à l’impunité dont elles jouissaient, se multipliaient d’année en année et envahissaient, outre la rue Ingarienne, la plupart des quartiers de la ville, le Parlement de Provence, dans le but d’obvier à cette diffusion de la débauche, prononça un arrêt qui ordonnait l’établissement d’un bourdeau à Marseille. En exécution de cet arrêt, le Conseil municipal de la Ville mit l’affaire en délibération le 10 février 1543, et s’en occupa encore le 15 mai et le 28 octobre de la même année, le 6 avril et le 28 octobre 1544 et enfin le 24 février 1545.
Pour procéder à la création de cet établissement, la ville acheta le terrain d’un nommé Claret, sur la hauteur des Moulins, dans le voisinage de l’Hôtel-Dieu. Mais comme ce terrain était servile au Chapitre de la Major qui voulut le retenir par droit de prélation, le Conseil se vit obligé d’abandonner l’entreprise.
Quelques années s’étaient à peine écoulées que de nouveau le projet d’une maison publique pour y loger les femmes de mauvaise vie fut repris par la ville de Marseille. En effet, le 3 novembre 1555, le Conseil municipal chargeait les Consuls de la création d’un local « pour y faire retirer les filles faillies et vivant indeignement et pour obvier aux inconvénients que journellement advenaient à faulte de ladicte maison ».
Malgré ces indications si précises, les Consuls ne donnèrent aucune suite à leur mandat, et cette fois encore le projet d’un établissement public de débauche resta sans exécution. Est-ce à dire que la négligence des Consuls fut la seule cause de ce nouvel insuccès ?… Nous avons d’autant moins de raison de le penser que nous touchons ici à une époque vraiment mémorable dans l’histoire de la prostitution publique, époque qui eut sans doute son influence sur les suites de la décision de notre Conseil de Ville.
C’était en 1560 ; les États d’Orléans solennellement assemblés décrétèrent l’abolition de la prostitution et la fermeture immédiate de toutes les maisons de débauche. L’article 101 de la grande ordonnance datée de cette ville et enregistrée en Parlement le 13 septembre 1561 était ainsi conçu : « Défendons à toutes personnes de loger et recevoir en leurs maisons, plus d’une nuict, gens sans adveu et incogneus. Et leur enjoignons les dénoncer à justice, à peine de prison et d’amende arbitraire. Défendons aussi tous bordeaux, berlans, jeux de quilles et de dez, que voulons estre punis extraordinairement, sans dissimulation ou connivence des juges, à peine de privation de leurs offices. »
Cette ordonnance venait à peine d’être promulguée que l’administration de l’époque se prévalut de l’article que nous venons de citer et se mit en devoir de le faire exécuter. Dès lors, tous les établissements publics du royaume reçurent l’ordre de se fermer, et les femmes de mauvaise vie, qui avaient jusque-là exercé paisiblement leur scandaleuse industrie sous la protection des lois et des magistrats, furent chassées de l’enceinte des villes. Arrêtées, emprisonnées chaque fois qu’elles voulurent faire résistance, elles étaient, en cas de récidive, condamnées au fouet, à la prison et à la marque.
Dans les campagnes, qui devinrent leur dernier refuge, elles ne se trouvaient pas mieux en sûreté, Traquées souvent comme des bêtes fauves, elles furent contraintes de se cacher dans la profondeur des bois pour échapper à la persécution générale.
À ce propos, remarquons ici cette bizarrerie inexplicable qui, dans la marche des évènements, préside quelquefois à la réalisation de certains faits. Penser, en effet, que ce fut au milieu de cette horrible dépravation et de ces débordements inouïs du XVIe siècle, en face de cette Cour si corrompue et si éhontée des derniers Valois, que fut proclamée l’abolition définitive de la prostitution légale ; penser surtout que ces ordonnances prohibitives, passées à l’état de lettres-mortes sous le règne de Saint-Louis, s’exécutèrent fidèlement sous le règne impur de Charles IX, c’est presque avoir le droit de révoquer en doute les enseignements de l’histoire !
Quoi qu’il en soit, l’abolition des bordeaux avait été accueillie avec une telle satisfaction dans tout le royaume, que Charles IX et son chancelier, Michel de l’Hospital, voulurent pousser plus loin l’œuvre commencée et continuer par des édits successifs la réforme des mœurs. Après l’expulsion des prostituées de l’enceinte des villes et après la fermeture des maisons de débauche, il fallut naturellement songer à balayer la cour et l’armée de toute cette bande parasite de mauvais sujets, vagabonds et femmes perdues, qui, depuis les temps les plus reculés, se faisaient traîner à la remorque. Le roi, de concert avec son vertueux ministre, par une nouvelle ordonnance du 6 août 1570, ordonna « que tous vagabonds, sans maistres ni adveu, ayent dans les vingt-quatre heures à vuider sa dicte cour sur peine d’estre pendus et étranglés sans espérance d’aucune grâce ny rémission ; que toutes filles de joye et femmes publiques deslogent aussi de la dite cour dans le dit temps sous peine du fouet et de la marque. »
Divers autres édits non moins explicites promulgués vers la même époque contre les prostituées et les goujats qui suivaient l’armée, provoquèrent quelquefois d’horribles excès de cruauté. Témoin le fait de ce farouche maréchal Philippe Strozzi qui, dans un moment d’humeur, s’il faut en croire le témoignage de Varillas, ordonna « qu’on jetât dans la rivière de Loire, huit cents filles de joye qui suivaient son camp ».
Pendant que de telles rigueurs s’accomplissaient dans le reste du royaume, quel était le sort de la prostitution à Marseille ? – À n’en pas douter, l’ordonnance prohibitive d’Orléans eut son retentissement jusque dans notre ville et y exerça la même influence que dans toutes les autres grandes cités du pays. Les maisons de débauche se fermèrent et les filles de joie, qui avaient peu à peu envahi les quartiers les plus populeux, furent contraintes de se cacher pour se soustraire à la vengeance publique.
Le peuple, en effet, avait accueilli avec une telle faveur l’arrêt prohibitif, qu’il crut parfois devoir s’en instituer le défenseur et en exiger la rigoureuse exécution. Devenu pour la circonstance et par exception l’auxiliaire de la police, il se plaisait souvent à désigner à l’autorité, mais à la condition d’une prompte justice, les repaires secrets des femmes perdues et des vagabonds. Dans ces cas, du reste, les formalités n’entraînaient jamais de lenteur, et les sévères décisions des échevins ne se faisaient pas attendre.
Ainsi traquée et poursuivie, la prostitution à Marseille eut à se dissimuler pendant près d’un siècle. Mais, en vérité, si durant cette période nous perdons sa trace dans les archives de la ville, les délibérations du Conseil et les arrêts du Parlement, ce n’est certes pas qu’elle eût cessé complètement d’exister. Il suffit même pour se convaincre du contraire de consulter nos annales sanitaires et on y apprendra qu’en Provence une terrible recrudescence du mal vénérien marqua la fin du XVIe et le commencement du XVIIe siècle. Où trouver la source de cette nouvelle épidémie, si ce n’est dans ces repaires hideux, derniers retranchements du vice, qui, établis dans les recoins les plus obscurs, parvenaient à déjouer la vigilance de la police, et n’en devenaient ainsi que plus dangereux ?
Toutefois, le système de prohibition absolue ne pouvait pas être observé indéfiniment avec la même rigueur. C’était là un fait inévitable ; il est de ces dispositions administratives qui sont d’avance vouées à un sort fatal, celles surtout qui ont pour but de s’opposer à certaines conséquences de l’imperfection humaine. Insensiblement, l’édit d’Orléans cessa d’être interprété suivant son véritable sens ; les légistes comprirent que pour éviter le mal on était tombé dans le pire ; les magistrats, de leur côté, se départirent peu à peu de leur inflexible sévérité. Il n’en fallait pas davantage pour voir la prostitution, cette plaie vivace de la société, prendre de nouvelles forces dans ses anciennes racines. N’est-il pas établi que l’organisme social porte en lui certains germes pernicieux qu’aucune force légale ne pourra jamais détruire ?
Cependant les maisons de débauche n’avaient pas encore osé se reconstituer au grand jour ; mais une foule d’autres cachées dans l’ombre ou déguisées sous les apparences les moins suspectes, s’étaient formées secrètement aux dépens des vieux fiefs de la prostitution. Il y avait bien encore de temps à autre quelques filles de joie fouettées, marquées, rasées et bannies à perpétuité ; quelques maquerelles condamnées à l’amende ou à l’écriteau ignominieux, promenées à rebours sur un âne et mises au pilori ; quelques ruffians et berlandiers fustigés, emprisonnés et envoyés aux galères, mais c’était là l’exception ; on marchait visiblement vers un nouveau régime, celui de la prostitution tolérée, de la prostitution légale.
Déjà, dans la première moitié du dix-septième siècle, la débauche publique à Marseille avait à ce point reconquis ses droits que, sur une population qui était alors de quatre-vingt mille âmes à peine, on ne comptait pas moins de quatre cents filles perdues qui vivaient sans crainte de Dieu et qui se prostituaient vilainement. Encore est-il bien probable que cette évaluation était de beaucoup inférieure à la réalité, puisqu’elle ne concernait que la classe la plus vile du personnel de la débauche, c’est-à-dire cette infâme catégorie qui de nos jours constitue le rebut de la prostitution inscrite. Or, s’il est vrai, que dans tous les temps, le vice, comme la vertu, a eu ses degrés, au-dessus de ces quatre cents filles perdues, devait tout naturellement s’épanouir ce monde de la galanterie que les chroniques nous dépeignent si florissant à cette époque.
À n’en pas douter, le temps des délations faites par le peuple et la bourgeoisie contre les filles de mœurs légères était déjà passé. À cette hostilité éphémère avait succédé une sorte de commune harmonie qu’entretenait la corruption générale. Ne citons pour preuve de cette démoralisation de toutes les classes, que ces désordres scandaleux dont le clergé lui-même, tant séculier que régulier, se rendit alors coupable.





























