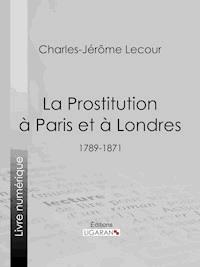
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Il s'opère en France, depuis vingt ans, un travail de transformation sociale qui a modifié sensiblement les conditions dans lesquelles s'exerce l'action de l'autorité publique en matière de prostitution. Le sentiment religieux s'est affaibli, la tolérance pour la galanterie vénale et scandaleuse est entrée dans nos mœurs, les prostituées ont invoqué, ou plutôt on a invoqué, pour elles, les immunités civiques, la tradition basée sur l'expérience a été méconnue."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En commençant ce travail, je voulais simplement donner sur la prostitution à Paris quelques indications de chiffres et de détails pratiques, qui m’ont souvent été demandés par des hommes spéciaux de tous les pays ; mais j’ai été amené à élargir un peu mon cadre et parfois à conclure.
Sur ce dernier point, je dois faire une réserve : Si mes renseignements que l’Administration n’a d’ailleurs jamais refusés à personne, découlent de ma fonction, mes appréciations n’engagent absolument que mon opinion personnelle.
Paris, mars 1870 et février 1872.
Par des causes de natures diverses et qu’il n’est pas besoin d’indiquer, les écrits sur la prostitution éveillent la curiosité d’une façon exceptionnelle, et ils provoquent l’envoi d’observations et de critiques. Beaucoup de ces communications ne manquent pas d’intérêt ; il en est une que je crois devoir reproduire ici parce qu’elle émane de M. Alexandre Dumas fils, une haute notabilité littéraire qui est, en même temps, un esprit parisien des plus raffinés. J’y ai trouvé, au milieu de déductions, dont certaines sont, je crois, contestables, la confirmation d’une opinion qu’il m’a fallu exprimer dans sa vérité désolante : l’augmentation de la prostitution clandestine est un mal social qu’il faut bien reconnaître et que des mesures de police ne peuvent seules atteindre et détruire. M. A. Dumas fils développe cette thèse avec la hardiesse d’allure qu’elle comporte, et aussi avec la netteté ordinaire de son style. Voici sa lettre qui est datée de septembre 1874 :
« Je continue à croire qu’on n’arrêtera pas le mouvement de la prostitution, laquelle n’est plus aujourd’hui affaire de misère, d’ignorance, ni même absolument de paresse, mais de révolte et de théorie. La femme s’est lassée de l’indifférence parfaite de l’homme pour ses besoins, et elle ne veut plus ni travailler ni crever de faim. Elle veut s’amuser et bien vivre. Les exemples de grande fortune et de beaux mariages, donnés par certaines courtisanes dans ces derniers temps leur créent des ambitions comme, dans les autres, carrières, à tous ceux qui veulent arriver aux sommets. C’est à ce point de vue que la question demande surtout à être étudiée. Les statistiques ont du bon ; la morale, l’éducation, la religion, et Saint-Lazare brochant sur le tout, peuvent donner quelques bons résultats, mais l’infiltration a eu lieu. Ce qui n’était que dans les couches inférieures gagne les couches hautes, et vous êtes encore mieux placé que moi pour le constater. L’adultère vénal et purement voluptueux se pratique presque ouvertement. Antony serait un grotesque dans ce temps-ci. On ne fait plus la cour aux femmes mariées, on leur offre le plaisir de l’amour, et elles vous disent : oui ou non, comme pour une contredanse, sans que cela les choque autrement. Et elles répondent ordinairement oui, tout de suite, quand elles y ont un intérêt quelconque. Je parle naturellement de celles qui acceptent comme principe qu’on leur fasse la cour. Lesbos fait concurrence à Cythère, et je n’ai pas besoin de vous dire combien cette interprétation de l’amour a fait de progrès. Vous avez des renseignements sur le développement de cette église nouvelle. C’est encore dans les Catacombes ; dans vingt ans ce sera sur la place publique. Quant aux enfants naturels, infanticides, avortements, sans compter les adultérins, vous n’êtes pas sans en avoir constaté aussi la progression.
Le remède ? Il n’est pas facile. Il s’agirait, pour l’appliquer, d’avoir la connaissance de l’homme et de la femme, le génie, le pouvoir, la force et des milliards. Ce qui me porte à croire que les choses dureront ainsi jusqu’à ce que la prostitution de la femme et l’ignorance de l’homme aient si bien miné par-dessous le vieux monde qu’il s’écroule pour faire place à un autre.
Vos moyens de salubrité, de répression, de police enfin, sont excellents, mais ils sont excellents dans une ville comme était Paris il y a quarante ou cinquante ans, avant que les chemins de fer en eussent fait le trottoir universel et ne vous eussent amené tous les vices de la province et de l’étranger. À cette époque, la prostitution subissait l’administration, et l’administration pouvait la confiner dans quelques coins. On citait quelques femmes galantes, très peu, qui avaient voitures, et ces femmes avaient, presque toujours, été assez bien élevées. Cela ressemblait à un surnumérariat du mariage pour les jeunes gens, et à un véritable mariage pour les hommes mûrs. Il y avait entre ce monde très restreint et les autres mondes, aristocratie, bourgeoisie, peuple même, une démarcation très précise et très visible. Aujourd’hui, regardez ! »…
J’aurais pu ne citer de cette lettre que les passages qui cadraient étroitement avec mes idées sur la question. Je n’en ai pas retranché un mot. Le lecteur y aura gagné.
En terminant cette citation, et pour conclure, je me demande, avec la conviction que je ne suis pas seul à faire cette réflexion, si l’auteur, tant applaudi et tant imité, de drames émouvants où le personnel du demi-monde et même de moins que cela, bénéficie, non sans prestige, de trop de circonstances atténuantes, est bien sûr de n’avoir point, sans le vouloir assurément, contribué non pas à créer, mais à développer, dans une certaine mesure, le regrettable état de choses qu’il décrit si bien ?
On sait que, dans ces derniers temps, l’autorité de la police, en ce qui touche la répression et la surveillance de la prostitution, a été vivement attaquée.
Nonobstant la singulière diversité de ses adhérents et de ses motifs, cette campagne pour la liberté de la débauche vénale a eu pour principal organe l’honorable, mais excentrique, mistriss J. Butler. Se continuera-t-elle en France de la part de madame J. Butler, qui a dû reconnaître qu’elle s’était fourvoyée ? Cela est douteux.
D’où qu’elles viennent, si elles se poursuivaient, de pareilles manifestations auraient-elles pour effet, sinon de supprimer le mal, au moins de le diminuer, ou bien l’augmenteraient-elles en provoquant les audaces et les résistances des prostituées, en même temps qu’elles énerveraient, sans la décourager cependant, l’action de l’autorité ?
Sur ce point ma conviction attristée est faite.
Cette troisième édition contient un chapitre supplémentaire dans lequel se trouvent, avec de nouveaux renseignements, des indications statistiques aboutissant au 1er janvier 1877 et un appendice.
Février 1877.
SOMMAIRE.– État actuel. – Le Congrès médical international. Sa formation, sa composition, son programme et ses travaux. Analyse des propositions relatives aux mesures à prendre pour restreindre la propagation des maladies vénériennes. – Exigences de la science médicale. – Exigences sociales. – Difficultés pratiques et de toute nature. – Comment la police de Paris peut-elle, en matière de prostitution, atteindre son but au milieu d’exigences contradictoires ? – Caractère de ce travail
Il s’opère en France, depuis vingt ans, un travail de transformation sociale qui a modifié sensiblement les conditions dans lesquelles s’exerce l’action de l’autorité publique en matière de prostitution.
Le sentiment religieux s’est affaibli, la tolérance pour la galanterie vénale et scandaleuse est entrée dans nos mœurs, les prostituées ont invoqué, ou plutôt on a invoqué, pour elles, les immunités civiques, la tradition basée sur l’expérience a été méconnue, et la police, déjà déroutée par des étrangetés de costume communes aujourd’hui aux femmes de toutes les classes, se voyant journellement, pour des actes relatifs à la prostitution, aux prises avec des attaques injustes manifestement inspirées par la passion politique, a dû, dans beaucoup de cas, s’imposer une réserve qui a paralysé ses efforts.
Quoi qu’elle fasse pour réprimer et surveiller les prostituées, l’Administration, dont les devoirs à ce sujet sont plus complexes qu’on ne le soupçonne, ne peut satisfaire les exigences exclusives de la science médicale uniquement préoccupée du péril créé par la contagion syphilitique.
Ces exigences doivent être aussi anciennes que l’apparition du mal vénérien. Elles se sont accrues en raison de l’intensité du danger. Toutefois, elles se sont surtout révélées avec autorité depuis qu’une part plus large a été faite à l’hygiène dans les mesures de réglementation. Enfin, elles se sont manifestées sous une forme collective qui commandait l’attention, en 1867, au moment de l’Exposition universelle, lors de la réunion à Paris du Congrès médical international.
La formation de ce congrès, dont l’idée première appartient au congrès médical de Bordeaux de 1865, eut lieu par les soins de M. le professeur Bouillaud, qu’assistait une commission composée de :
MM.
BARTHEZ, médecin de l’hôpital Sainte-Eugénie,
BÉCLARD (J.), agrégé de la Faculté, secrétaire de l’Académie de médecine,
BÉHIER, professeur à la Faculté, médecin de l’hôpital de la Pitié,
BOUCHARDAT, professeur à la Faculté,
BROCA, professeur à la Faculté et chirurgien à l’hôpital Saint-Antoine,
DECHAMBRE, membre du comité des Sociétés savantes au ministère de l’Instruction publique,
DENONVILLIERS, inspecteur général de l’Université, professeur à la Faculté,
FOLLIN, agrégé de la Faculté, chirurgien de l’hôpital Cochin,
GAVARRET, professeur à la Faculté,
GOSSELIN, professeur à la Faculté et chirurgien de l’hôpital de la Pitié,
JACCOUD, agrégé de la Faculté, médecin de l’hôpital Saint-Antoine,
LASÈGUE, professeur à la Faculté, médecin de l’hôpital Necker,
LONGET, professeur à la Faculté,
ROBIN (Ch.), professeur à la Faculté, membre de l’Institut,
TARDIEU, professeur à la Faculté,
VERNEUIL, agrégé de la Faculté, chirurgien de l’hôpital Lariboisière,
VIDAL, médecin de l’hôpital Saint-Louis,
WURTZ, doyen de la Faculté.
Citer ces noms, c’est indiquer l’importance scientifique du Congrès médical international.
En même temps qu’il proclamait, comme acquis pour la science, ce fait que la surveillance de la prostitution est insuffisante au point de vue de la santé publique, le Congrès inscrivait dans le programme de ses travaux cette question :
Est-il possible de proposer aux divers gouvernements quelques mesures efficaces pour restreindre la propagation des maladies vénériennes ?
Un commentaire annexé au programme stipulait cette réserve que la solution du problème posé « ne serait pas cherchée dans une pénalité nouvelle applicable aux individus qui vivent sous la loi civile commune (sic). » Il expliquait que les renseignements recueillis par le Congrès pourraient être le point de départ de mesures administratives nouvelles.
En rédigeant ce commentaire, destiné, comme ils le disaient d’ailleurs, à limiter et à préciser les questions du programme, les membres du Comité voulaient empêcher les études du Congrès de s’engager sur un terrain autre que celui de l’observation et de la science.
C’était là un écueil plus facile à indiquer qu’à éviter. En dehors de la constatation des ravages causés par l’infection vénérienne et de déclarations sur les nécessités de visites sanitaires et de traitement, la question à résoudre avait un caractère absolument administratif, et, malgré les recommandations du commentaire, elle comportait des propositions de projets de lois ou de règlements qui ne pouvaient être utilement formulés qu’à la condition de prévoir une sanction pénale.
Quoi qu’il en soit, des travaux considérables et du plus haut intérêt, parmi lesquels il faut placer, en première ligne, ceux de MM. les docteurs Jeannel, médecin en chef du dispensaire de Bordeaux, et Garin, ancien médecin de l’Hôtel-Dieu de Lyon, furent soumis au Congrès qui leur consacra plusieurs séances. C’est ainsi que le Congrès entendit la lecture de mémoires déposés par MM. Crocq, de Bruxelles, délégué du gouvernement belge, parlant tant en son nom qu’en celui de M. le docteur Vleminckx, président de l’Académie royale de médecine de Belgique ; de Méric, chirurgien des hôpitaux de Londres ; J. Rollet, ex-chirurgien en chef de l’Antiquaille ; le docteur Mougeot, de l’Aube ; le docteur Boëns, de Charleroy ; le docteur Auzias-Turenne, le docteur Jaccoud, le docteur Léon Lefort, le professeur Seitz, délégué du gouvernement bavarois ; le docteur Cohen, de Hambourg ; le docteur Rey, médecin de la marine ; le docteur Adam Owre de Christiania ; le docteur Combes, de Paris ; le docteur Berchon, médecin principal de la marine militaire, directeur du service sanitaire de la Gironde ; le docteur Drysdale, de Londres, etc.
À côté d’observations et de renseignements d’une grande portée et qui pouvaient, dans une certaine mesure, réaliser la pensée du programme, se produisirent des projets et des propositions de réglementation légale ou administrative.
Plusieurs des moyens préconisés étaient déjà employés ; d’autres n’étaient pas réalisables ; quelques-uns témoignaient de l’absence de notions sur le terrain légal ou d’un complet oubli d’impossibilités pratiques tout à fait évidentes.
Il n’entre pas dans le cadre de ce livre d’y faire l’analyse détaillée des travaux du Congrès. Ces travaux ont d’ailleurs donné lieu à une publication spéciale très complète. Deux des médecins entendus, MM. les docteurs Auzias-Turenne et Cohen, exclusivement préoccupés de la prophylaxie vénérienne, au point de vue scientifique, proposèrent, le premier, la syphilisation, c’est-à-dire une sorte de vaccination par l’inoculation du virus syphilitique ; le second, la circoncision des nouveau-nés. Je n’ai pas à aborder l’examen de ces questions. En ce qui touche les travaux des autres membres du Congrès, on peut citer les propositions de M. le professeur Crocq comme dénotant une connaissance approfondie de la matière. Toutefois, plusieurs de ses propositions portent sur des points où il a été pourvu dans le même sens par la loi française. Le caractère international du Congrès devait entraîner cet inconvénient que chaque membre étranger, obéissant à des préoccupations nationales, signalait les améliorations à introduire dans la réglementation de son pays, sans tenir compte de ce qui se faisait dans les autres contrées.
Tous les médecins s’accordaient sur le point des obligations sanitaires d’ordre général, et qui sont imposées d’ailleurs dans beaucoup de pays.
M. le docteur Mougeot, de l’Aube, demandait la visite préalable des hommes par les maîtresses de maisons de tolérance. Il voulait qu’une sorte de musée Dupuytren, collection plastique figurant tous les ravages produits par les affections vénériennes, servît d’antichambre à ces maisons.
Frappé des dangers que la prostitution clandestine fait courir à la santé publique, M. le docteur Boëns estimait qu’il y avait lieu de la considérer comme un outrage ou un attentat aux mœurs, et de la placer sous l’application de l’article 334 du Code pénal, en ajoutant à cet article une disposition ainsi conçue :
« Quiconque, femme ou fille, sans autorisationde l’autorité locale, aura attenté aux mœurs en se livrant habituellement à la débauche, sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 50 à 500 francs. »
M. le docteur Léon Lefort exprimait l’avis qu’il fallait augmenter le nombre des maisons de tolérance afin de pouvoir atteindre et réprimer la prostitution clandestine.
On verra plus loin par des démonstrations de faits combien cette opinion est fondée.
M. le professeur Seitz faisait remarquer que les sévérités excessives contre la prostitution l’obligent à se cacher et la rendent plus nuisible pour la santé publique. C’était la démonstration de cette vérité proclamée par Delamarre dans son Traité de Police, « parce qu’on voulait que les filles publiques ne fussent nulle part, elles furent partout ».
À l’appui de sa remarque, M. le docteur Seitz invoquait des chiffres indiquant une notable augmentation des maladies vénériennes qui s’est produite en Bavière, en 1861, à la suite de la promulgation d’une loi en vertu de laquelle on frappait d’une pénalité d’un mois à deux ans de prison les prostituées et les individus qui les logeaient.
De même que M. le docteur Mougeot, M. Drysdale, de Londres, demandait qu’on soumît, mais par voie administrative, à une visite médicale les hommes qui se rendaient dans les maisons de prostitution !
Un étudiant en médecine, admis exceptionnellement à prendre part à la discussion, voulait que la communication de la maladie vénérienne pût, dans tous les cas, entraîner une condamnation au payement de dommages-intérêts.
Après un préambule dans lequel il exposait que « la majesté et l’inviolabilité de la loi répugnent également à l’autorisation formelle et à la prohibition absolue de la prostitution », M. le docteur Jeannel ajoutait :
« Mais la loi, qui ne peut ni reconnaître ni interdire la prostitution, peut, du moins, énoncer formellement les attributions de la police à ce sujet. »
Et, comme conséquence, il proposait, en l’empruntant, pour partie, à Parent-Duchâtelet, un projet de loi ainsi conçu :
ARTICLE 1er.
« La répression de la prostitution, soit avec provocation sur la voie publique, soit de toute autre manière, est confiée au chef de la police.
Un pouvoir discrétionnaire est confié à ce magistrat sur tous les individus qui s’adonnent à la prostitution publique.
ART.2.
La prostitution publique est constatée, soit par le témoignage de deux agents au moins, soit par notoriété, soit par enquête sur plainte et dénonciation.
ART.3.
Le chef de police pourra faire, à l’égard de ceux qui, par métier, favorisent la prostitution, ainsi qu’à l’égard des logeurs, des aubergistes, des propriétaires et principaux locataires, tous les règlements qu’il jugera convenables pour la répression de la prostitution.
ART.4.
Le chef de la police pourra faire les règlements qu’il jugera convenables pour les visites corporelles aux prostituées dans l’intérêt de la santé publique. »
Il n’y a pas lieu de commenter ce projet de loi. On verra plus loin tout ce qu’il a de commun avec la source légale des pouvoirs administratifs tels qu’ils s’exercent en France et notamment à Paris à l’égard des prostituées.
M. le docteur Jeannel ne l’ignorait pas, et il n’avait d’autre but que de soumettre aux gouvernements étrangers, sous une forme générale, un type de réglementation analogue à celle qui est en vigueur dans notre pays.
Tous les médecins entendus par le Congrès s’accordèrent à réclamer la plus large extension possible des visites sanitaires, visites des marins, des soldats, des ouvriers au service de l’État, et ils demandèrent surtout « l’hospitalisation des vénériens ».
M. le docteur Rollet, en appuyant sur ce dernier point, insistait pour que les villes qui n’avaient pas d’asiles spéciaux fussent invitées à recevoir désormais les vénériens dans les hôpitaux généraux au même titre que les malades ordinaires.
Il y eut à ce sujet une grande vigueur dans les opinions exprimées. Je craindrais, en me les appropriant pour les analyser, de leur enlever une partie de leur valeur. On les jugera mieux par des extraits.
« Il ne faut plus d’entraves à l’admission des syphilitiques dans les hôpitaux, plus de ces vaines formalités, longues et odieuses, qui, en retardant l’entrée des malades à l’hospice, aggravent leurs maux et en favorisent la reproduction. »
(M. le docteur GARIN.)
« Terminons en demandant avec les meilleurs esprits qui se sont occupés de la matière, qu’on multiplie pour les vénériens les secours de toute espèce ; qu’on leur facilite l’admission dans les hôpitaux, loin de les en chasser comme des parias, comme j’en suis témoin depuis 22 ans dans mon hôpital.
N’est-il pas déplorable, quand on a fait de Paris une ville de plaisirs, où toutes les classes de la société se précipitent de tous les pays, qu’on refuse l’entrée des hôpitaux spéciaux et autres à ceux qui sont tombés sur le champ de bataille de la luxure, avant qu’ils aient eu six mois de résidence dans la capitale ?
Qu’on ne nous objecte pas la modicité des ressources hospitalières. Si la ville n’y suffit point, l’État viendra à son aide ; l’essentiel est de tarir au plus vite cette source d’infection qui implore elle-même sa séquestration. »
(M. le docteur MOUGEOT.)
Il est difficile d’être plus énergique.
Toutes les opinions formulées sur ce point aboutirent à la même péroraison, à un tableau saisissant de l’action désastreuse des affections vénériennes sur la génération et sur la race.
La science médicale insista sur les formes multiples que prend la transmission de la contagion (syphilis des nourrices, du vaccin, des verriers). Tous les médecins s’accordèrent à représenter la syphilis « la peste syphilitique, cette lèpre, cette peste occulte des temps modernes, cette plaie sociale, le plus grand fléau de l’espèce humaine, cette cause de l’abâtardissement des populations » comme ayant sa source dans la prostitution clandestine qu’on signalait par suite à toute l’activité et à la rigueur de l’action administrative.
Pour ces hommes d’étude et de pratique, journellement aux prises avec les terribles effets du fléau vénérien, rien ne doit entraver ou affaiblir ce qui peut restreindre ou faire disparaître un pareil mal. À leurs yeux, l’état de choses actuel, en ce qui touche la prostitution, offre pour la santé publique un péril perpétuel et toujours grandissant. Leur mission professionnelle les rend sur ce terrain absolus et exclusifs. Toute considération étrangère à leur préoccupation les touche peu. Ils s’inquiètent et s’irritent. Un des membres du Congrès, dont j’ai eu occasion de citer les travaux (M. le docteur Mougeot), faisait cette déclaration caractéristique :
« C’est en vain qu’on nous opposerait le respect sacré de la liberté individuelle et de la vie privée… Qu’est-ce qu’une liberté individuelle qui menace et détruit la liberté individuelle de plusieurs ? Qu’est-ce qu’une vie privée où il y a une immixtion incessante d’étrangers, et qui va colporter ici et là, à domicile et partout, une contamination qui peut être terrible en ses effets ?
On expropriera pour cause d’utilité publique les plus belles années de la vie d’un homme, et l’on hésiterait à exproprier, pour cause de salubrité publique, quelques heures, quelques jours, quelques mois, s’il le faut, de la liberté d’une fille de mœurs suspectes ou misérables !… On sacrifiera des hommes considérables et les dévouements les meilleurs pour conjurer des fléaux transmissibles comme le choléra, la fièvre jaune, la peste bovine, etc. ; on imposera d’onéreuses quarantaines à d’honnêtes gens sur le simple soupçon d’être porteurs d’un air empesté… Et, pour éteindre le fléau, bien autrement redoutable, la syphilis, qui ne punit pas seulement le coupable, mais par celui-ci l’innocent, et qui pis est toute une descendance,… on s’arrêterait devant la liberté individuelle et la vie privée d’une débauchée ou d’une prostituée !
Cela ne peut pas être. La concurrence vitale est la loi de tout ce qui a vie dans la nature. Rien n’y échappe, pas plus les nations que les individus. La nation qui, par une coupable insouciance vis-à-vis d’une corruption physique et morale, aura laissé amoindrir le nombre de ses enfants et la force corporelle de chacun d’eux deviendra nécessairement la proie des nations qui se seront maintenues plus nombreuses et plus fortes. Le secret de l’avenir est là comme l’explication du passé.
Donc, au nom des intérêts les plus élevés, noustenons pour les plus grandes rigueurs dans les mesuresadministratives, non seulement pour les femmes publiques et soumises, mais vis-à-vis de tout ce qui touche plus ou moins à la prostitution clandestine. Toute cette catégorie appartient, selon nous, aux établissements insalubres et doit en subir la réglementation. Ici, nulle exception, dussent ces rigueurs s’étendre jusqu’à ces hétaïres qui, loin de faire de la prostitution clandestine, affichent, par tous les moyens possibles, ce qu’elles sont, et vont jusqu’à mettre à l’encan, dans les clubs, la clé de leur alcôve. »
Cette sortie indignée contre les « hétaïres » se complète par le passage suivant que j’extrais d’un ouvrage plein d’intérêt publié par un autre membre du Congrès, M. le docteur Garin, médecin de l’hôpital de Lyon :
« Pourquoi tant ménager cette classe de femmes, ostensiblement entretenues, dont la porte, presque ouverte à tout venant, a, pour ainsi dire, une clé banale en circulation ? Pourquoi ces filles de joie, qui ne sont, après tout, que la bohème plus ou moins fringante de la prostitution, ont-elles le droit de ruiner impunément, non seulement la santé, mais les mœurs et la fortune de la jeunesse dorée de notre temps ? Pourquoi ces Laïs et ces Phryné de notre âge, à qui leurs exploits font un nom et dont le scandale fait toute la gloire, peuvent-elles sans crainte étaler, sur les premiers bancs de nos spectacles et de nos fêtes, leurs extravagantes toilettes et leurs allures tapageuses comme un effronté défi au luxe décent de nos femmes, comme une provocation ouverte au libertinage de nos fils ? Est-ce que l’honnêteté aurait quelque chose à perdre à voir ces Lesbiennes de rencontre chassées de nos lieux de plaisirs ? Est-ce que la santé publique n’aurait rien à gagner à les savoir sévèrement astreintes aux mesures d’hygiène devant lesquelles se courbent les courtisanes, moins bien chaperonnées, il est vrai, mais non pas plus dangereuses ? Et pourrait-on gémir beaucoup sur l’honneur de quelques drôlesses soumises au joug, quand on applaudit à la capture de ces bandits émérites qui ne sont pas plus haut placés, dans les habiletés du crime, que ne le sont ces sirènes dans les raffinements du vice ? »
Ces citations étaient nécessaires pour montrer jusqu’à quel point, dans la question qui nous occupe, les aspirations et les exigences de la science médicale sont extrêmes et impérieuses.
À côté de ces exigences, qui ne se produisent qu’à certaines époques et dans des régions spéculatives, il y a celles plus nombreuses, mais non moins ardentes, que formule la société au point de vue de l’ordre, de la décence publique et de l’intérêt des familles.
Disons d’abord que la Préfecture de police reçoit journellement des plaintes, qu’abrite le plus souvent le voile de l’anonyme, et qui émanent des nombreuses victimes de la contagion syphilitique.
À ces plaintes, et sous toutes formes, lettres spéciales, réclamations collectives, articles de journaux, viennent se joindre celles auxquelles donnent lieu la prostitution publique, inscrite ou clandestine, le proxénétisme, la débauche scandaleuse et la galanterie vénale. Que de nuances dans cette fange !
Tous les plaignants s’étonnent aigrement de ce que les scandales qu’ils signalent aient pu se produire ; ils attendent une satisfaction immédiate, ils exigent de la police une intervention efficace dont l’exercice leur semble toujours facile.
Parle-t-on de la prostitution en général ? Tout le monde reconnaît qu’elle ne peut être empêchée ou supprimée. Il y a même une banale formule qui la désigne comme un mal nécessaire. Mal nécessaire, c’est entendu, mais personne n’en veut subir le spectacle ou le voisinage, et chacun le renvoie à son voisin.
À ces répugnances individuelles, fort légitimes et parfaitement fondées, viennent s’ajouter les exclusions d’ordre et de morale publique, qui éloignent les prostituées des églises, des asiles de charité, des lycées, des écoles, des musées et de certains établissements publics.
Faites la part des prohibitions spéciales qui se rattachent à la police sanitaire de l’armée, et des mesures à prendre en ce qui touche les théâtres, les jardins publics, les passages, etc., et, bien que tout cela constitue un ensemble de difficultés considérables, vous n’entrevoyez qu’une faible partie des exigences, souvent pleines de contradictions, que l’Administration a pour mission de satisfaire.
Ici les lumières des boutiques attirent les filles de débauche dont la présence éloigne les acheteurs honnêtes. Plus loin, c’est le contraire, la clientèle a de bonnes raisons pour craindre l’intervention des agents de police, intervention que le marchand critique et maudit.
La prostitution insoumise est légion ; elle se montre d’autant plus audacieuse qu’instinctivement elle se sent protégée contre la police. Elle sait combien est difficile sur la voie publique l’accomplissement d’une mesure de rigueur contre des femmes. Aussi s’affiche-t-elle bruyamment et attire-t-elle l’attention par ses allures, ses toilettes, ses paroles et ses scandales. Le public, qui ne peut faire de distinction entre les filles inscrites et les prostituées clandestines, et qui, en outre, ne se rend pas compte des difficultés très réelles qu’il crée lui-même le plus souvent, se plaint avec éclat. Il s’étonne de l’abandon apparent où se trouvent la décence publique, les mœurs, l’ordre, la morale sociale, et il demande à l’autorité une répression vigilante et énergique de ces désordres.
Avec les différences de détail qui résultent de la diversité des caractères et des habitudes, cette situation doit être commune à presque toutes les capitales de l’Europe.
Devant un tel état de choses, en présence de ces nécessités impérieuses, de ces exigences parfaitement justifiées, l’Administration doit absolument agir et pourvoir.
Le danger est évident, le mal extrême ; les plaintes, qui sont unanimes, s’appuient les unes sur la morale, les autres sur l’hygiène. Tout le monde semble devoir applaudir à l’exécution des mesures sollicitées, et celles-ci paraissent, dès lors, constituer une tâche facile. Cela ne se règle-t-il pas en deux lignes ? « Le chef de police a un pouvoir discrétionnaire. Il prendra les dispositions les plus rigoureuses à l’égard des femmes qui se livrent notoirement à la prostitution. »
Marchez maintenant. Impossible. Dès le premier pas, l’Administration voit se dresser devant elle des obstacles d’un ordre supérieur que la théorie n’aperçoit pas et qui, nul n’oserait le contester, si grand et si terrible que soit le danger vénérien, dominent de très haut par leur nature les exigences médicales.
Il faut compter avec l’intérêt, la pitié que commande la position des malheureuses tombées dans l’abîme de la prostitution, avec les chances de relèvement qu’elles peuvent avoir, faire la part des circonstances, apprécier ce qui est accidentel ou définitif, affronter des désespoirs qui menacent du suicide, compter encore avec l’affection, les espérances et les efforts des familles, parfois se substituer à elles et enfin et surtout, dans tous les cas où il s’agit de mineures, et c’est le plus grand nombre, s’incliner devant la responsabilité et les droits de l’autorité paternelle. On comprend que ce n’est que pour des espèces exceptionnellement graves que l’Administration peut se sentir autorisée à inscrire d’office, c’est-à-dire malgré sa famille, père, mère ou tuteur, une mineure sur le livre des prostituées.
N’oublions pas qu’avant d’aborder ces difficultés, il aura fallu traverser celles que j’ai indiquées et qui résultent de l’emploi de mesures de coercition, prises dans la rue, sur un boulevard, à l’égard de femmes contre lesquelles on ne peut relever d’inculpations délictueuses atteintes par la loi pénale, et dont l’arrestation ne manque jamais de provoquer des interventions et des critiques irréfléchies ou intéressées.
Ce n’est pas tout. Il n’y a pas que les récriminations individuelles à redouter ; il faut aussi prévoir une sorte de blâme général, dédaigneux, vague, qui, plus que les attaques acerbes, énerve et réduit au découragement et à l’impuissance les agents de l’autorité. Cela tient aux idées actuelles de tolérance en matière de morale. Le nombre est grand aujourd’hui de gens qui, ne voyant dans la débauche qu’une des formes du luxe, raillent et entravent, comme des sévérités puritaines attardées, les actes de police en fait de mœurs.
Que de tartufes qui s’ignorent, s’irritent en plein boulevard des mesures dont les prostituées sont l’objet, alors qu’une heure plus tôt, en famille, ils ont récriminé contre « l’incurie de la police qui permet aux courtisanes de souiller par leurs scandales les promenades et les établissements publics, et d’en interdire ainsi l’accès aux femmes honnêtes ! »
Ces inconséquences et ces injustices sont d’essence humaine. Chacun les connaît et les peut constater. Il convient surtout de les signaler lorsqu’on passe en revue les difficultés de la répression à l’égard des prostituées.
Pleine d’écueils partout, l’action de la police rencontre donc à Paris, dans cette agglomération d’hommes, au milieu de cette foule turbulente, des difficultés tout à fait exceptionnelles. Elle s’y exerce avec le prestige d’un pouvoir traditionnel et plus que séculaire, légalement consacré à diverses époques, avec des nuances d’exécution qui varient suivant les espèces.
Comment se meut-elle ? Comment peut-elle vivre, durer, atteindre son but au milieu d’exigences contradictoires et alors qu’elle est aux prises avec de perpétuelles attaques suscitées par l’intérêt privé, la passion politique, les arrière-pensées malsaines ?
Toutes les fois qu’une question relative à la prostitution vient à se poser n’importe où, à Saint-Pétersbourg ou à Londres, à Berlin ou à Vienne, c’est à Paris qu’on en cherche la solution.
Cela se conçoit. Tous les règlements municipaux des villes de province applicables à la prostitution sont calqués les uns sur les autres. Ici, ils ont en vue l’intérêt sanitaire d’une agglomération de soldats ou de marins ; là, dans un milieu industriel et populeux, il faut protéger la santé d’ouvriers et de journaliers ; partout il faut se préoccuper des hôtes de passage, des débauchés d’habitude. En pareils cas, les mesures à prendre sont uniformes, simples et sûres. À Paris, tout est immense, nuancé et complexe. Il y a, pour chaque mesure, une tradition perfectionnée par une longue pratique et toujours rajeunie. L’expérience a produit ses fruits. On sait ce que l’on fait et pourquoi on le fait. On connaît les forces et les imperfections de l’heure présente. On aperçoit les nécessités de l’avenir.
En 1867, dans un travail rapide, j’ai brièvement indiqué ce qu’est la prostitution publique à Paris et de quelles mesures elle est l’objet.
Je reprends aujourd’hui ce travail. Je le reproduis textuellement dans certaines de ses parties, mais j’y ajoute tous les développements qu’il comporte. J’ai à cœur de faire comprendre, par un exposé méthodique, détaillé et empreint d’un caractère actuel, les principes, les règles et la pratique de la police parisienne à l’égard de la prostitution.
SOMMAIRE.– De l’histoire de la prostitution. – Répression et moralisation. – Absence de mesures sanitaires. – Pouvoir traditionnel de la police parisienne à l’égard des prostituées. – Prévôts de Paris, lieutenants généraux de police. – Municipalités de 1789 et de 1790. – Comités institués par la Convention. – Commissions administratives. – Bureau central. – Conseil des Cinq-Cents. – Préfets de police. – Continuité de pouvoirs, tradition non interrompue. – Difficultés créées par le développement des maladies contagieuses. – Message du Directoire. – Impossibilité de formuler dans tous ses détails une loi sur la prostitution. – Sources légales. – Ordonnances anciennes. – Lois de 1789, 1790 et 1791. – Article 484 du Code pénal. – Arrêts de la Cour de cassation. – Opinion de M. le procureur général Dupin.
Lorsqu’on est amené à s’occuper de la prostitution, on se sent attiré vers un examen complet de cette grande plaie sociale. Sans l’avoir étudiée à toutes les sources, on sait ce qu’elle a été dans l’antiquité et au Moyen Âge ; on l’entrevoit dans tous les pays du globe, en Grèce, à Rome, en Égypte, en Asie ; on voudrait pouvoir suivre à travers les siècles les changements que la position de la femme a dû subir dans l’état social. C’est l’histoire des mœurs et de la civilisation, et l’on peut y rattacher les plus grands faits historiques : l’avènement du christianisme, les croisades, la découverte de l’Amérique, l’émancipation des esclaves, etc.
Un cadre ainsi élargi comporte d’immenses recherches ; il conduirait à d’utiles enseignements, mais il dépasse le but de ce travail.
Si l’on se restreint à un examen de la prostitution dans une contrée unique, les comparaisons partielles avec l’antiquité ou le Moyen Âge perdent de leur portée. Ce n’est plus en quelque sorte que de l’érudition. Mon point de vue très modeste et essentiellement pratique m’interdit d’entrer dans de pareils développements.
Bien longues et bien inutiles d’ailleurs seraient la nomenclature et l’analyse détaillée des actes publics, capitulaires, ordonnances royales, lettres patentes, arrêts de parlement, sentences prévôtales, ordonnances de police, auxquels la prostitution a donné lieu en France depuis l’an 800 jusqu’à 1789, et qui, presque tous, ont été cités et reproduits dans les travaux publiés sur cette question.
Ce qui caractérise les actes dont il s’agit, ce qu’il faut en retenir, c’est la rigueur des pénalités qui y sont édictées et parmi lesquelles l’essorillement, la prison, le fouet, le carcan, la marque, le bannissement, la confiscation des biens tiennent une large place.
À côté de ces sévérités, on pourrait dire de ces barbaries, on constate, il est vrai, dès le treizième siècle, des fondations pieuses et charitables ayant en vue la moralisation des prostituées et la protection de jeunes filles abandonnées.
Telles sont, pour en citer quelques-unes :
La réunion des filles converties dans un hôpital sous le nom de Maison des Filles-Dieu (1226) ;
Un asile de même nature créé par lettres patentes de Charles VIII sous le titre de Refuge des filles de Paris, et aussi des filles pénitentes (1496) ;
L’hôpital de la Miséricorde pour les jeunes filles pauvres (1623) ;
La fondation par madame de Miramion, dans le faubourg Saint-Antoine, d’une maison de détention pour les prostituées (1665) ;
L’affectation de la Salpêtrière à la détention, provoquée par leurs parents ou tuteurs, des filles de débauche (1684) ;
La maison des Filles de la Providence, refuge d’orphelines (1699).
On pourrait indiquer encore l’Œuvre du Bon Pasteur, et les établissements de Sainte-Valère et de Sainte-Pélagie.
Il n’y avait pas que ces asiles. Beaucoup de communautés religieuses recevaient, dans un but d’amendement, des filles perdues qui manifestaient l’intention de renoncer à la débauche. Dans les villes de guerre, il y avait des renfermeries, où l’on détenait les prostituées en les astreignant au travail.
Lorsqu’on passe en revue la réglementation ancienne, où les préoccupations religieuses et morales apparaissent aux prises avec la débauche et ses désordres, il est impossible de ne pas être frappé par deux faits considérables :
L’absence de mesures sanitaires. On expulse les « vérolés ». On ne les soigne pas ;
La démonstration d’un pouvoir traditionnel qui, pour la police parisienne, s’ajoute à sa puissance légale, en ce qui regarde les prostituées.
On trouve, en effet, dans ces documents la preuve de la perpétuation régulière dans les mains du préfet de police, sous les diverses qualifications données à ses prédécesseurs de fait, prévôts de Paris et lieutenants généraux de police, d’attributions autoritaires sur tout ce qui concerne les femmes de débauche. Il y a là une continuité de pouvoirs, une tradition non interrompue, même par la Commune de Paris, sous la période révolutionnaire, et qui a notablement fortifié l’action et l’autorité de la Préfecture de police en matière de mœurs.
À l’appui de cette remarque j’indiquerai :
1° L’ordonnance royale du 20 avril 1684, qui affecte la maison de la Salpêtrière à la réclusion des femmes de mauvaise vie, et qui transporte au lieutenant de police la juridiction précédemment exercée par le prévôt : « Sa Majesté voulant, dit cette ordonnance, que les sentences dudit lieutenant de police en ce fait particulier et dont Sa Majesté lui attribue, en tant que besoin est, toute juridiction et connaissance, soient exécutées comme de jugement en dernier ressort ; »
2° L’ordonnance royale du 26 juillet 1713, qui règle la procédure à suivre par le lieutenant de police ;
3° L’ordonnance royale d’août 1785, qui établit un hospice spécialement destiné au traitement de la maladie vénérienne.
Citons encore l’ordonnance du 6 novembre 1778, qui fixe les obligations imposées aux filles publiques et qui les astreint, entre autres mesures, à être enfermées à l’hôpital.
C’est en vertu de ces divers règlements que s’exerçait la juridiction de la police à l’égard des filles publiques, et que ces dernières, contrairement au droit commun, étaient soumises à un ensemble de mesures telles que :
L’inscription sur un registre spécial,
La visite sanitaire,
Et la réclusion, par voie administrative, soit à titre de mesure disciplinaire ou préventive, soit en vue d’un traitement médical.
Ces mesures, encore en vigueur aujourd’hui à Paris, furent appliquées par les municipalités de 1789 et de 1790, aussi bien que par les comités institués sous la Convention, la commission administrative nommée directement par cette assemblée à la suite du 9 thermidor et par le Bureau central créé par la Constitution de l’an III. Elles constituaient une réglementation, dont la pratique, plus que séculaire, démontrait la valeur et qui, ratifiée par le conseil des Cinq-Cents, en l’an IV, et par l’art 484 du Code pénal, fut suivie par les préfets de police institués par la législation de l’an VIII.
Ce point mérite l’attention particulière de quiconque voudrait et croirait pouvoir s’assimiler dans tous ses détails le mode d’action de la police de Paris à l’égard des prostituées. La tradition ne s’emprunte pas. On comprend qu’une réglementation nouvelle, si parfaite qu’elle soit, rencontre des critiques, des difficultés et peut échouer, alors qu’on voit ces mêmes règles, consacrées par le temps, acceptées par tous, entrées enfin dans les habitudes et dans les mœurs, s’appliquer avec succès. Il importe, en outre, de tenir compte du rang du fonctionnaire appelé à faire et à mettre en pratique de semblables règlements.
À ce point de vue, le préfet de police, par ses attributions multiples et considérables, et par sa position auprès du gouvernement, a une importance exceptionnelle qui relève et agrandit son autorité comme pouvoir municipal.
Quant à l’absence de prescriptions sanitaires qu’on remarque dans les anciens règlements, elle est caractéristique. À l’apparition du mal vénérien, l’action répressive se montra plus rigoureuse, mais elle ne s’accompagna d’aucune mesure propre à combattre et à restreindre le fléau. Il est évident qu’on regardait alors la maladie vénérienne comme le châtiment de la débauche, et, par suite, comme une cause salutaire de continence. Faut-il s’en étonner ? Cette manière d’envisager le mal syphilitique existe encore de nos jours, et elle est plus commune qu’on ne le croit. Cela s’explique, le danger provoque l’impitoyabilité vis-à-vis de l’auteur du péril. Il a fallu beaucoup de temps pour triompher de ces petitesses aveugles. Aujourd’hui, l’intérêt social a prévalu, et l’on est arrivé à comprendre que, bien que les débauchés d’habitude doivent en bénéficier, il faut tout faire pour préserver la race humaine de cette cause de dégénérescence et d’abâtardissement. L’Administration n’a-t-elle pas d’ailleurs un devoir de protection sanitaire à exercer à l’égard de la jeunesse, et, pour justifier son intervention, est-il besoin d’évoquer toutes les victimes innocentes de la contagion syphilitique ?
Disons en passant que les exhibitions à la manière du musée Dupuytren, préconisées comme un moyen d’avertissement efficace, sont bien un peu inspirées par l’idée qu’on se faisait généralement autrefois des affections vénériennes. On les regardait alors comme une punition. On les montre aujourd’hui comme un épouvantail. La différence n’est pas grande entre ces deux systèmes. Ce qu’il y a de gagné, c’est le traitement ; mais ce résultat, encore incomplet, ne s’est obtenu que bien lentement.
L’avènement des préoccupations d’hygiène et de salubrité, leur consécration sous toutes formes dans les lois et les règlements, datent d’hier. C’est un des caractères les plus saillants de l’époque actuelle. Il ne faut donc pas s’étonner de ce que l’intervention active de l’autorité au point de vue sanitaire n’apparaisse pas dans les diverses institutions relatives aux prostituées qui viennent d’être énumérées. Cette abstention systématique dura plusieurs siècles. Il en résulta qu’à l’époque où l’invasion syphilitique atteignit des proportions considérables, et réclama impérieusement l’assistance et le traitement, l’administration hospitalière se trouva prise au dépourvu.
En 1785, les vénériens assiégèrent l’Hôtel-Dieu, ainsi que Bicêtre et la Salpêtrière, transformés en hôpitaux spéciaux. Ils s’y entassèrent littéralement, et c’était encore le plus petit nombre. Le même lit servait à plusieurs malades qui se relayaient pour l’occuper, et qui couchaient sur le carreau en attendant leur tour. Il fallait acheter le traitement par des châtiments corporels. On s’y résignait, tant le fléau sévissait avec gravité. On comptait alors à Bicêtre 600 entrées par an pour correspondre à plus de 2 000 demandes d’admission.
L’administration fit des efforts. Le service hospitalier s’améliora. L’ancien couvent des Capucins transformé, en 1793, en asile de traitement sous le nom d’hôpital du Midi, remplaça la Salpêtrière, et versa une portion de ses malades dans l’hôpital de la Pitié devenu sa succursale. L’infirmerie de la prison dite la Petite-Force put recevoir 500 malades.
En 1811, l’hôpital des Vénériens soigna 4 744 malades, savoir :
La création de ce quartier était due à l’initiative de M. Lenoir, lieutenant de police. L’institution avait d’abord été essayée à Vaugirard, en 1780, sur le rapport de M. Faguer, chirurgien en chef de Bicêtre. On y recevait les nourrices vénériennes, à la condition qu’elles allaiteraient, avec leur enfant, un enfant trouvé affecté de syphilis. On les traitait, et le traitement atteignait les enfants. Après la nourriture, elles recevaient une gratification. Le petit hôpital de Vaugirard fut réuni à celui des Capucins (hôpital du Midi), le 1er janvier 1793.
La période de l’occupation étrangère (1814 et 1815) vit reparaître les difficultés des plus mauvais temps en ce qui touchait l’accroissement de la contagion syphilitique, et les impossibilités de soigner tous les malades. Les filles vénériennes des provinces, où les hôpitaux étaient encombrés de militaires, affluèrent à Paris. Les soldats étrangers y remplissaient les lits d’hôpitaux disponibles. Les Prussiens, notamment, avaient pris possession de l’hôpital des Vénériens ; ils y restaient sans nécessité, refusant de l’évacuer, et occupant des lits en quantité double de leur nombre. Il n’y avait plus de place dans aucun hôpital : Saint-Louis, l’infirmerie de la Petite-Force regorgeaient de vénériens. À l’hôpital de la Pitié, l’encombrement était excessif ; les malades attendaient au dehors dans des charrettes ou couchés sur de la paille. La contagion fit d’énormes progrès.
Cette crise traversée, et elle se fit sentir jusqu’en 1819, on revint à l’état normal que troublèrent seulement, mais dans une moindre proportion, les secousses de même nature produites par les évènements de 1830 et de 1848. L’ouverture forcée de la maison des Madelonnettes, le 29 juillet 1830, rejeta dans Paris 600 filles publiques dont plus de 100 étaient vénériennes ou galeuses. Trois mois avant ces évènements, le nombre des militaires vénériens entrés à l’hôpital du Val-de-Grâce s’élevait à 209. Trois mois après la révolution, il était de 449.
En 1848, on manqua de places à l’infirmerie de Saint-Lazare, et l’on dut diriger des filles vénériennes sur les hôpitaux.
Je me suis efforcé d’abréger cette allusion aux difficultés sanitaires. Elle était indispensable pour faire entrevoir, d’une manière générale, les nuances, les difficultés et les nécessités de l’action administrative. – Je reviendrai avec plus de détails sur cette question lorsque j’aborderai l’organisation et la statistique du Dispensaire de salubrité. J’ai hâte de compléter mon exposé de la source légale et du caractère des pouvoirs que la Préfecture de police exerce à l’égard des prostituées.
Le 17 nivôse an IV (7 janvier 1796), le Directoire exécutif envoyait au conseil des Cinq-Cents un message demandant qu’une loi fût rendue pour réprimer les désordres de la prostitution publique. Il exposait à cette occasion que les lois répressives contre les filles publiques consistaient en quelques ordonnances tombées en désuétude, ou en quelques règlements de police purement locaux et trop incohérents. Il faisait remarquer que la seule disposition intéressant les mœurs édictée par la loi des 19-22 juillet 1791 ne s’appliquait qu’au proxénétisme. Il insistait sur ce point que le Code pénal du 25 septembre 1791 et le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) étaient muets sur la prostitution.
Ce silence avait sa raison d’être que le Directoire ne pouvait ignorer. En dehors d’une affectation au pouvoir municipal, sous une forme générale, d’une attribution discrétionnaire sur les prostituées, ce qu’avait réglé la loi du 14 décembre 1789, comment formuler dans tous ses détails une loi sur la prostitution ? Quelles seront les sanctions pénales ? Comment les graduera-t-on ? Le législateur, qui a reculé devant l’inceste, qu’il n’a pas voulu prévoir, inscrira-t-il dans ses codes les pratiques et les désordres de la débauche ? Il ne l’a pas voulu faire en 1791 et en 1795 ; il ne l’a pas fait davantage dans le Code pénal de 1810, qui n’a pas de dispositions applicables à la prostitution, et qui n’en mentionne pas même le nom.
En 1818, alors que cette question, souvent agitée, se trouvait soulevée de nouveau, M. le comte Anglès s’exprimait ainsi à ce sujet :
« Une loi sur la prostitution me paraît fort difficile à proposer. Tout ce que l’on pourrait faire serait de placer les filles publiques sous la surveillance de la haute police tant qu’elles se livrent à la prostitution. »
Qui dit surveillance doit aboutir à la constatation de faits à réprimer. Quelle aurait été, dans l’espèce, la répression ? M. le comte Anglès ne s’expliquait pas à ce sujet.
Un jurisconsulte très estimé, M. Achille Morin, rédacteur d’un journal de droit criminel, examinant cette question, l’appréciait ainsi en 1860 : « Aucune mesure législative n’a pu être prise, ni alors (en l’an IV) ni depuis. En 1811 et en 1816, en 1819 et en 1822, des administrateurs éminents, s’entourant des conseils de jurisconsultes et secondés par les notabilités de leurs bureaux, ont essayé de formuler des projets spéciaux, appropriés autant que possible aux exigences de la morale : après examen approfondi, ils se sont vus contraints de reconnaître l’impossibilité de l’œuvre… aucune loi n’a été rendue et ne paraît devoir l’être sur un sujet aussi difficile. »
Le conseil des Cinq-Cents nomma, pour examiner le message du Directoire, une commission qui ne paraît pas avoir fait de rapports.
Sur ces entrefaites et dans la séance du 7 germinal an IV, un membre du conseil, le citoyen Bancal, proposa de créer une commission chargée de présenter une loi sur « les maisons de débauche qui, disait-il, attaquaient d’une manière si funeste la population, la santé, la pudeur, et propageaient les maladies les plus dangereuses pour l’espèce humaine. »
Cette proposition fut accueillie par des murmures. On demanda l’ordre du jour qui fut voté après une violente sortie du citoyen Dumolard dont voici les passages les plus saillants :
« Les intentions du préopinant sont louables… mais les vues qu’on nous propose sont petites, minutieuses, indignes, ce me semble, du Corps législatif. Ce n’est pas aux législateurs d’un grand peuple qu’on doit présenter des règlements de moines… Les abus dénoncés sont vrais… les désordres sont réels… mais peut-être sont-ils inséparables de l’existence d’une commune telle que celle que nous habitons… au surplus, il existe des règlements de police très précis… qu’on les exécute… Je demande l’ordre du jour. »
Nous voici bien loin des scrupules des législateurs dont je parlais tout à 1 heure.
Ce qu’il faut surtout retenir de cet incident, c’est la reconnaissance et la demande d’exécution des règlements de police sur les prostituées.
En effet, sans attacher à l’ordre du jour voté sur la proposition de Dumolard la portée d’une consécration légale absolue de la réglementation imposée aux filles publiques antérieurement à 1789, ce qui serait d’ailleurs très admissible, on ne peut s’empêcher d’y voir la ratification par le Corps législatif des règlements de police en vigueur, alors comme aujourd’hui, sur des faits que la loi du 14 décembre 1789 a classés dans les attributions du pouvoir municipal.
Il convient de remarquer d’ailleurs que l’article 484 du Code pénal a sanctionné, en principe, ces règlements. Lorsque fut édicté cet article, qui est ainsi conçu : « Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer, » l’orateur du gouvernement, en énumérant les matières non régies par le Code et dont les règlements spéciaux devaient toujours recevoir leur exécution, comprit la prostitution parmi ces matières au nombre desquelles il indiquait : « les maisons de débauche où s’exerce la prostitution. »
Ces règlements spéciaux et les lois du 14 décembre 1789, 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 forment toute la législation relative à la débauche publique.
La loi de 1789, qui a constitué les municipalités, n’a pas tenté une énumération impossible des attributions multiples du pouvoir municipal. Elle les a résumées par cette formule générale : « faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police. »
D’après la loi des 16-24 août 1790, cette formule comprend : « le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes, qui troublent le repos des citoyens…, le maintien du bon ordre dans les lieux publics, le soin de prévenir par les précautions convenables et celui de faire cesser les fléaux calamiteux, tels que les épidémies, etc. »
La loi des 19-22 juillet 1791 porte, art. 10 : « Les officiers de police pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. »
Un arrêté du 3 brumaire an IX (25 octobre 1800), qu’il y a lieu de mentionner ici, met les maisons publiques au nombre des matières placées sous l’action et l’autorité du préfet de police.
En présence de cet ensemble de dispositions légales, il ne saurait s’élever de doute sur ce point que la prostitution rentre dans les faits qui sont soumis à l’autorité et à la vigilance des municipalités, et que c’est à titre de magistrat municipal que le préfet de police la réglemente, la surveille et la réprime.
Au surplus, la Cour de cassation s’est, à diverses reprises, prononcée dans ce sens, notamment le 3 décembre 1847. Dans cet arrêt rendu par la Cour suprême et qui avait pour but d’établir que la prostitution est comprise dans les objets de police que les lois précitées confient au pouvoir municipal, on lit les considérations suivantes :
« Attendu que, sous chacun de ces rapports (la sécurité, l’ordre et la morale), cette matière rentre dans les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux ; qu’elle leur est exclusivement attribuée par les dispositions des lois de 1790 et 1791… ;
Attendu que la police sur les maisons de débauche, ainsi que sur les personnes qui s’abandonnent à la prostitution… exige, non seulement des dispositions toutes spéciales dans l’intérêt de la sécurité, de l’ordre et de la morale, mais encore des mesures particulières au point de vue de l’hygiène publique. »
Il est impossible d’être plus explicite sur la nécessité et la reconnaissance légale de mesures spéciales en matière de prostitution. On ne saurait contester qu’il y a dans le choix et l’exécution de ces mesures un côté discrétionnaire inévitable, imposé, d’une manière absolue, par la nature des choses et qu’aucun texte de loi ou de règlement ne pourrait, sans créer un véritable scandale, prévoir et régler dans ses détails. Ajoutons, ce qu’il importe de remarquer, que le véritable caractère des mesures en question, qu’il s’agisse de peines disciplinaires ou de visites sanitaires, est surtout préventif. C’est un acte administratif, un moyen de police qui, par sa nature et en vertu du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, échappe à l’action du contrôle judiciaire.
En 1859, un jurisconsulte, dont l’opinion est la plus imposante autorité, M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, appelé à formuler son avis sur ce point, s’exprimait ainsi :
« La prostitution est un état qui soumet les créatures qui l’exercent au pouvoir discrétionnaire délégué par la loi à la police, état qui a ses conditions et ses règles comme tous les autres, comme l’état militaire, toutes réserves faites sur la comparaison. Appliquer aux filles publiques des règlements spéciaux ou des mesures de police auxquels les astreint leur genre de vie, ce n’est pas plus commettre un attentat à la liberté individuelle qu’on ne le fait dans l’armée lorsqu’on applique aux militaires les règles de discipline en vertu desquelles ils peuvent être privés, discrétionnairement et sans formalités, de leur liberté. – L’incarcération des filles est moins grave que la visite, et cependant nul ne conteste la légalité de cette dernière mesure. Lorsque les employés des douanes et ceux de l’octroi fouillent les voyageurs et mettent la main sur eux, ils portent, en quelque manière, atteinte à leur liberté, à leur personne, et cependant de telles mesures sont légales parce qu’elles sont la conséquence forcée des choses… C’est exagérer le principe de la liberté individuelle que de le pousser jusqu’à entraver l’exercice légitime des autres garanties sociales.
En d’autres termes, au-dessous des peines proprement dites appliquées par les tribunaux de répression, il peut y avoir dans la matière dont il s’agit une série de mesures, comme l’incarcération et la visite des filles publiques, qui ne constituent que des moyens de police, et qui peuvent résulter légalement de l’exercice du pouvoir discrétionnaire abandonné à l’administration, pouvoir que la police exerce librement sous les garanties constitutionnelles. »
Cette citation clôt mon exposé. On vient de voir l’origine, la nature et la base légale des mesures de surveillance et de répression dont les filles publiques sont l’objet dans le département de la Seine.
Dans les autres départements, l’autorité municipale procède par voie d’arrêtés réglementaires édictés en vertu des lois de 1789, 1790 et 1791, et elle défère aux tribunaux de simple police les contraventions à ces règlements.
Peut-être y aurait-il lieu, dans une certaine mesure, et à la condition pour eux d’être pourvus d’un dispensaire et d’un établissement avec infirmerie spéciale analogue à la prison de Saint-Lazare, d’étendre le mode de procéder en vigueur à Paris aux grands centres de population, comme cela se fait déjà à Lyon, à Marseille et à Bordeaux, mais quel est l’homme de bonne foi qui, connaissant le nombre, l’audace et le danger des prostituées de la capitale, demanderait qu’on y abandonnât une pratique basée sur des règlements séculaires et qui, tout énergique qu’elle paraît, arrive parfois à être insuffisante, pour déférer au tribunal de police municipale, comme des contraventions ordinaires, et avec la publicité de l’audience, les désordres graves et les scandales de la prostitution parisienne ?





























