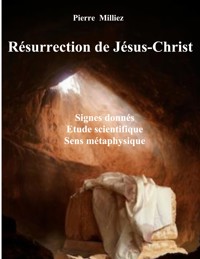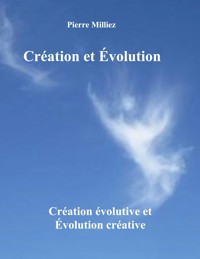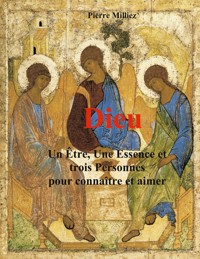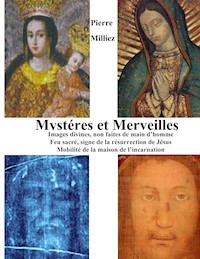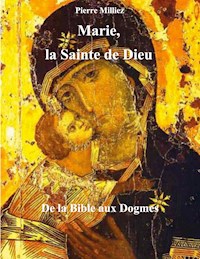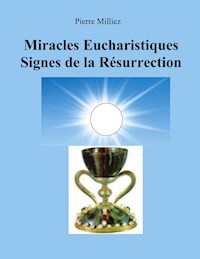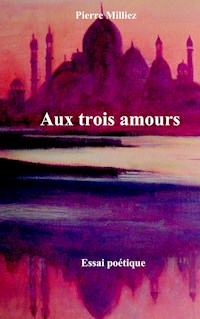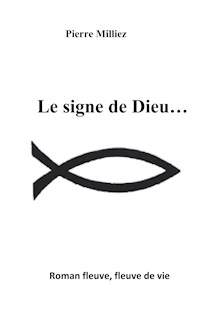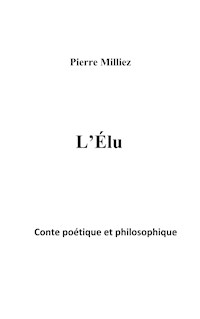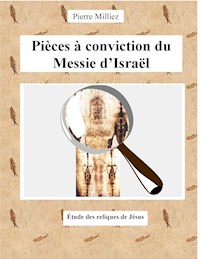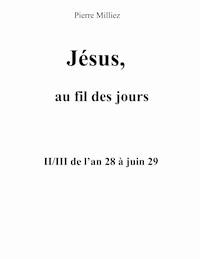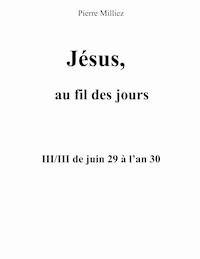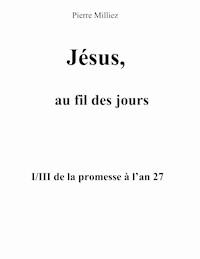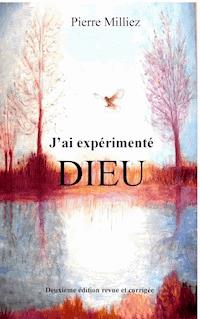Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L'existence de Jésus de Nazareth est reconnue par tous les historiens. Jésus donne aux scribes et aux pharisiens qu'il ne leur sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. "Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits." (Mt 12, 40). À sa Résurrection Jésus est revêtu des quatre dons mentionnés par Saint Paul (1Co 15, 42-44). Ces dons, visibles sur le Linceul et le Voile, libèrent Jésus des lois physiques et biologiques. Ils sont visibles aussi dans les miracles eucharistiques (voir du même auteur "Miracles eucharistiques, Signe de la Résurrection"). Si Jésus ressuscite dans un tel corps, libéré notamment de la mort, n'est-il pas ce qu'il prétend être : Le Fils de Dieu ? L'ouvrage explique scientifiquement : - la datation du Linceul par le carbone 14 et par les rayons X (2022), - la date de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, - le temps passé par le Christ dans le sépulcre, - les signes de retour à la vie sur le Linceul (2020), - les signes de mouvements sur le Linceul (2022), - la cause de l'impression du corps sur le Linceul et du visage sur le Voile, - l'état d'apesanteur du corps dans le Linceul, - la sortie du Linceul sans arrachement des fibres et des croûtes, - les caractéristiques physiques du corps ressuscité de Jésus, - le doute des disciples sur l'identification du ressuscité, - la déclaration de Jean en voyant les linges : " Il vit, et il crut".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je dédie ce livre à tous ceux qui sont :
-
en attente d’une réponse à la question fondamentale de l’être,
-
en recherche d’un sens à leur vie,
-
en quête d’une relation, même sans le savoir, avec celui qui Est.
Origine des extraits de la Bible, parole de Dieu :
Traduction d’après les textes originaux par le chanoine A. CRAMPON
Société de Saint Jean l’Evangéliste
Desclée et Co., Tournai 1939
Photos couverture :
Visage du Linceul de Turin (Photographie de Giuseppe Enrie en 1931 transformée en positif) et Voile de Manoppello,http://en.wikipedia.org
Du même auteur aux éditions Books on Demand (BOD.fr)
Témoignage ; J’ai expérimenté Dieu
Études
La Résurrection de Jésus Christ – Signes donnés, étude scientifique, sens métaphysique
La Résurrection au risque de la Science
Pièces à conviction du Messie d’Israël ou étude des reliques de Jésus
Les miracles eucharistiques, signes de la Résurrection
Marie, la sainte de Dieu, de la bible aux dogmes
Mystères et merveilles
Jésus au fil des jours I/III de la promesse à l’an 27
Jésus au fil des jours II/III de l’an 28 à juin 29
Jésus au fil des jours III/III de juin 29 à l’an 30
Révélations sur Jésus
Dieu, un Être, une Essence et trois personnes pour conjuguer connaître et aimer
Création et évolution, de la création évolutive à l’évolution créatrice
Conte poétique et philosophique
Le petit d’homme
L’élu
Roman : Le signe de Dieu
Recueil poétique :Aux trois amours
« Celui qui est vraiment pieux met surtout sa dévotion dans l'objet invisible que représentent les images. Il n'a pas besoin de beaucoup d'images ; très peu lui suffisent... Il y a plus : son cœur n'a aucune attache aux images dont il se sert. Vient-on les lui enlever, il ne s'en préoccupe pas beaucoup ; il cherche en effet, cette image vivante qu'il porte en lui-même, c'est-à-dire Jésus crucifié. Voilà pourquoi, par amour pour lui, il est plutôt heureux de ce qu'on lui enlève tout et de ce que tout lui manque, même les moyens qui semblaient les plus aptes à l'élever vers Dieu... Sans doute c'est une chose bonne que de se réjouir quand on a ces images ou ces moyens qui favorisent la dévotion ; aussi doit-on choisir toujours celles qui y portent le plus ; mais ce n'est pas une perfection que d'y être tellement attaché qu'on les possède avec un esprit de propriété... Ce moyen doit aider l'âme à prendre son vol vers Dieu, et il doit être aussitôt mis de côté. »
Jean de la Croix, La Montée du Carmel (Paris, édit. du Seuil, 1947)
Thérèse Martin entra au Carmel de Lisieux. Elle prit pour nom de religieuse, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face….
Paul Claudel s’exclama devant le Linceul de Turin : « Plus qu’une image, c’est une présence ».
« Le Suaire (Linceul de Turin) n'est pas une donnée de foi. Chacun est libre de se former une opinion. L'Église appelle à vénérer un signe, une image, une icône qui, justement parce qu'elle ravive en nous la Passion et la mort du Christ, conserve sa valeur comme objet de piété et mérite donc le respect. La vénération catholique envers le Suaire (Linceul de Turin) n'est pas du tout déterminée par le problème de l'authentification.
Cardinal Giovanni Saldarini, Archevêque de Turin, gardien pontifical du suaire (Linceul de Turin), entretien au journal La Croix du dimanche 12 avril 1998.
Le 13 avril 1980 Jean-Paul II en voyant directement le Linceul de Turin l’a qualifié de « plus éclatante relique de la passion et de la résurrection. »
Le 24 mai 1998, à Turin, le pape Jean-Paul II qualifie le Linceul de « provocation à l'intelligence ». Il invite les scientifiques à continuer leurs travaux. Il indique que ce qui compte avant tout pour le croyant est que le linceul est « miroir de l'Évangile ».
Le pape ajoute : « Le Saint Suaire (Linceul de Turin), cette Icône du Christ abandonné dans la condition dramatique et solennelle de la mort, qui est depuis des siècles l’objet de représentations significatives, (…) nous exhorte à aller au cœur du mystère de la vie et de la mort pour découvrir le grand et consolant message qu’il renferme. »
Début septembre 2006 le Saint-Père Benoît XVI s’est rendu à Manoppello. En arrivant à Manoppello, le pape a dit : « Nous cherchons le visage du Seigneur. C’est le sens de ma visite. »
Benoît XVI rappelle d’ailleurs que la bonne attitude face au suaire (Voile de Manoppello) est de ne pas s'arrêter à l'image gravée sur la toile, mais de remonter par l'esprit et par le cœur vers la Personne que l'image rappelle.
Le 2 juin 2008, le pape Benoît XVI a annoncé une nouvelle ostension en 2010. Benoît XVI a parlé d'une « occasion propice pour contempler ce mystérieux Visage (Linceul de Turin), qui parle silencieusement au cœur des hommes, en les invitant à y reconnaître le visage de Dieu »
Préface
Foi et science ne s’opposent pas, a-t-on coutume de dire à juste titre, car elles n’ont pas le même objet. La foi cherche à comprendre pourquoi et à dire pourquoi, la science cherche à comprendre comment. Ainsi lorsque l’on a voulu faire dire à la Bible comment s’était déroulée la Création, les croyants s’y sont perdus et les non croyants ont douté davantage, car la Genèse est un récit spirituel.
Avec les linges sacrés, et notamment avec le Saint Suaire, dit Linceul de Turin, la science est un cadeau fait à la foi, mais comme tout cadeau il n’est pas indispensable. Les découvertes scientifiques faites autour de cet objet, véritables révélations, sont un clin d’œil pour notre époque scientiste et agnostique. Le langage de la science parle à nos contemporains, et c’est un peu comme si l’Évangile trouvait au travers du Linceul des accents de vérité et une légitimité.
Les linges sacrés sont au nombre de cinq. À ma connaissance, l’ouvrage de Pierre Milliez est le premier à les étudier simultanément avec tant de détails, les trois derniers chapitres étant particulièrement originaux et passionnants.
- La Tunique d’Argenteuil est le vêtement sans couture qu’aurait porté le Christ au moment de sa passion, dont il se serait revêtu après la flagellation et qui fut ensuite tiré au sort par ses bourreaux au pied de la Croix.
- Le Suaire d’Oviedo (ou Soudarion) est ce linge qui aurait servi à couvrir le visage du Christ de la descente de la Croix à la mise au tombeau.
- La Coiffe de Cahors est une sorte de bonnet, appelé Pathil selon la tradition juive, qui aurait recouvert le Christ mort, laissant le visage découvert (permettant d’y déposer un voile).
- Le Linceul de Turin est cette large et longue bande de tissu en lin sur lequel le Christ mort aurait été déposé et dans lequel il aurait été enveloppé à l’intérieur du tombeau.
- Le Voile de Manoppello ou Sainte Face est ce voile très léger comportant sur les deux faces l’image d’un visage aux yeux ouverts, qui aurait servi à recouvrir le visage du Christ mort au tombeau.
Tous ces linges portent le nom de l’endroit où ils sont conservés. Le plus connu est de loin le Linceul de Turin. C’est d’ailleurs l’objet antique le plus étudié au monde. Il est saisissant de voir le nombre de chercheurs de différentes disciplines, de colloques, de livres, de revues ou de sociétés savantes qui se penchent sur son étude depuis 112 ans. Après la révélation du négatif de l’image, véritable positif du visage et du corps de l’Homme crucifié, par Secundo Pia en 1898, 70 livres et articles furent publiés entre 1898 et 1903 !
Aujourd’hui ce sont plusieurs milliers de travaux que lui consacrent des chimistes, des physiciens, des palynologues (étude des pollens), des archéologues, des historiens, des biologistes, des radiologues, des médecins et des chirurgiens…
Les techniques les plus sophistiquées de la science ont été, au fil des époques, mises en œuvre dans plusieurs buts :
- comprendre le parcours du Saint Suaire dans le temps et dans l’espace ;
- comprendre comment l’image a été formée ;
- établir son authenticité et démontrer que cela ne peut être un faux (et en quoi il se distingue des faux qui ont abondé à certaines époques).
La science peut, indépendamment de toute conviction spirituelle, mettre au service de la connaissance ses outils et sa méthode. La méthode scientifique n’est pas au service d’une thèse, elle doit chercher à démontrer l’hypothèse et à réfuter l’antithèse le plus objectivement possible par l’expérience et la mesure. Elle doit donc seulement établir les faits, puis les confronter, enfin les interpréter avec l’intelligence.
Toutes les données scientifiques disponibles convergent et sont concordantes dans leurs réponses aux trois questions initiales :
- c’est un linge qui date environ de l’an 30 de notre ère et provient de la région de Jérusalem ;
- l’image sur le linge n’a pas été faite de main d’homme ;
- la probabilité pour qu’il ait enveloppé le corps d’un homme ayant subi la passion décrite dans les Écritures est considérable.
Sur ce dernier point, il est évident qu’un faussaire du moyen âge (en supposant faux le second point !) ne pouvait avoir ni les connaissances physiologiques et anatomiques, ni les connaissances historiques pour reproduire l’ensemble des détails qui le composent.
Cette authenticité a pu être remise en cause par la fameuse datation au carbone 14. La méthode scientifique ne doit alors, lorsqu’un résultat n’est pas cohérent avec l’ensemble des autres résultats, ni l’occulter, ni lui donner plus de poids. La science doit se poser la question de la raison de cette discordance et en premier lieu éliminer les deux éventualités suivantes :
- soit le protocole n’a pas été respecté et n’a pas été rigoureux : c’est le cas ici car il y a eu vice de forme (poids des échantillons non convenable, endroits inadéquats de prélèvement sur la pièce, absence de mesure en double aveugle) ;
- soit la méthode n’est pas adaptée à l’objet ou à sa mesure : c’est aussi le cas ici (brûlures et incendies, contaminations liées au rapiéçage, vernis biogénique autour des fibres…).
Il faut donc poursuivre la recherche pour comprendre cette discordance et enrichir le faisceau d’arguments existants. Mais la recherche n’a pas pour but de convaincre, encore moins de convertir, elle a pour but d’éclairer notre esprit et de nourrir la foi du croyant.
En tant que médecin et chercheur, ce sont les constatations médicales, physiopathologiques et anatomiques qui me touchent le plus. Nombre de confrères ont mis au service de la Sindonologie (science du Linceul) leur compétence au point de nous faire revivre pas à pas chaque étape de la passion du Christ avec un réalisme bouleversant qui nous fait comprendre de façon éclatante à la fois sa souffrance et son amour pour nous. La coïncidence minutieuse entre les stigmates des supplices de Jésus imprimés sur le suaire et les pages des Évangiles a pu conduire à ce que le Linceul puisse être surnommé le cinquième évangile, véritable iconographie visible de la passion.
Pourtant, au même titre que les apparitions, les miracles ou les autres faits surnaturels de l’histoire spirituelle chrétienne, le Linceul de Turin n’appartient pas aux dogmes et n’est pas un élément constitutif de la foi. Au même titre que les icônes il peut être moyen de méditation ; de même que les reliques il peut être objet de vénération ; mais il ne peut être adoré. Cependant cette image est différente des autres représentations religieuses car ce n’est pas une reproduction mais le drap qui lui-même a peut-être accueilli le corps du Christ crucifié. Non seulement l’existence de ce linge et sa présence aujourd’hui est quasi miraculeuse mais la formation inexpliquée et énigmatique de l’image est peut-être le signe de la Résurrection… Face au mystère qui persiste l’acte de foi est alors posé.
De nombreuses recherches scientifiques complémentaires méritent d’être conduites autour des quatre autres linges sacrés. La superposition extraordinaire entre les données historiques, biologiques, polliniques… relatives aux quatre linges sont plus que troublantes, mais là encore la science ne fait que chercher, elle ne peut affirmer de façon infaillible, elle ne peut être la preuve. L’absence d’authenticité de ces linges ne retirerait rien à notre foi qui reste une liberté et un don. L’authenticité rendrait simplement encore plus proche sa présence réelle. La paix et la douceur qui émanent du visage de l’Homme du Linceul de Turin et du Voile de Manoppello, révélés au cours du siècle le plus déshumanisé des temps modernes, sont des signes qui interpellent.
Oui les linges sacrés, et en particulier le Linceul de Turin, sont des objets de recherche et ils doivent continuer à l’être pour tous, croyants et non croyants ; mais ce sont surtout des objets de contemplation qui nous montrent le Christ et peuvent nous conduire à Lui.
Docteur Jean-Michel Lecerf
Institut Pasteur de Lille
Introduction
Le titre de ce livre est la résurrection au risque de la science, car d’une part la résurrection résume la foi chrétienne, d’autre part la science est ce qui nous permet d’appréhender le monde qui nous entoure.
La résurrection résume la foi chrétienne car s’il y a résurrection, c’est qu’il y a eu mort avant. S’il y a eu mort avant c’est qu’il y a eu vie. Pour les Chrétiens la résurrection contient le mystère de la rédemption (commémoration lors de la fête de Pâques, première fête) et contient le mystère de l’incarnation (commémoration lors de la fête de Noël, deuxième fête).
La résurrection est spécifique à la foi chrétienne.
La spécificité de l’être humain est certes l’introspection, la capacité de se penser lui-même, de s’étudier lui-même ; mais aussi la capacité d’aller au-delà de lui-même, d’appréhender le monde qui l’entoure, d’étudier autre chose que lui-même. L’homme est un être pensant. Le « pensant » de l’homme atteint sa rigueur dans la science.
La résurrection passe-t-elle l’épreuve de la science ?
La science risque-t-elle de remettre en cause la foi ?
Le Dieu des Chrétiens est un Dieu d’amour.
Ce Dieu d’amour se manifeste dans le mystère trinitaire :
Trois personnes Père, Fils et Saint-Esprit en un seul Dieu.
Ce Dieu a créé l’homme et veut le rencontrer.
La Bible est le récit de la relation de Dieu avec les hommes.
Les évangiles nous racontent l’incarnation du Fils (qui est Dieu).
Le Verbe (qui est Dieu) s’est fait chair et il a habité parmi nous.
Les évangiles nous parlent de ce Jésus qui est pleinement Homme et pleinement Dieu.
Les évangiles nous relatent la passion, la mort et la résurrection de Jésus.
Quels sont les signes qui nous restent de cet évènement unique dans l’histoire de l’humanité ?
Cinq linges répartis en Italie, Espagne et France portent encore les traces de la passion, de la mort et de la résurrection du Jésus des évangiles. Ces linges abordés tour à tour dans cet ouvrage sont :
- la Tunique d’Argenteuil,
- le Suaire d’Oviedo,
- la Coiffe de Cahors,
- le Linceul de Turin,
- le Voile de Manoppello.
Nous verrons :
- la concordance des linges sacrés entre eux,
- la correspondance des icônes avec le Linceul de Turin et le Voile de Manoppello,
- la conformité des cinq linges avec le récit de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus dans la Bible.
SOMMAIRE
Préface
Introduction
1 Tunique d’Argenteuil
1.1 Présentation générale
1.2 Données historiques
1.3 Caractéristiques de la Tunique
1.4 Formation de l’image
1.5 Description de l’image
1.6 Études complémentaires
2 Suaire d’Oviedo
2.1 Présentation générale
2.2 Données historiques
2.3 Caractéristiques du Suaire
2.4 Formation de l’image
2.5 Description de l’image
2.6 Études complémentaires
3 Coiffe de Cahors
3.1 Présentation générale
3.2 Données historiques
3.3 Caractéristiques de la Coiffe
3.4 Formation de l’image
3.5 Description de l’image
3.6 Études complémentaires
4 Linceul de Turin
4.1 Présentation générale
4.2 Données historiques
4.2.1 De Jérusalem à Antioche
4.2.2 D’Antioche à Édesse
4.2.3 D’Édesse à Constantinople
4.2.4 De Constantinople à Lirey
4.2.5 De Lirey à Turin
4.2.6 Les autres linceuls
4.3 Caractéristiques du Linceul
4.3.1 Datation
4.3.2 Dimensions
4.3.3 Matière
4.3.4 Constitution du tissu
4.3.5 Tissu exceptionnel
4.4 Formation de l’image
4.4.1 Traces d’incendies
4.4.2 Caractéristiques de l’image sanguine
4.4.3 Caractéristiques de l’image Jaune sépia
4.4.4 Formation de l’image jaune sépia
4.5 Études complémentaires
4.5.1 Poussières
4.5.2 Pollens et fleurs
4.5.3 Monnaies
4.5.4 Objet ovale sur le cou
4.5.5 Inscriptions de lettres antiques
4.5.6 Poissons
4.5.7 Phylactère
4.5.8 Objets de la passion
4.6 Image d’un corps mort
4.6.1 Généralités
4.6.2 Visage et nuque
4.6.3 Membres supérieurs
4.6.4 Membres inférieurs
4.6.5 Tronc et dos
4.6.6 Corps d’un homme mort
4.7 Image d’un corps revenant à la vie
4.7.1 Étude chirurgien espagnol
4.7.2 Formation de l’image jaune Sepia
4.7.3 Corps en mouvement
5 Voile de Manoppello
5.1 Présentation générale
5.2 Données historiques
5.3 Caractéristiques du Voile
5.4 Formation de l’image
5.5 Description de l’image
5.6 Études complémentaires
6 Concordance des Linges entre eux
6.1 Tunique d’Argenteuil et Linceul de Turin
6.2 Suaire d’Oviedo et Linceul de Turin
6.3 Coiffe de Cahors et Linceul de Turin
6.4 Voile de Manoppello et Linceul de Turin
6.5 Conclusion des linges
7 Sainte face du Seigneur
7.1 Visage de Jésus dans la Bible
7.2 Visage de Jésus sur le Linceul et le Voile
7.3 Visage copié
8 Mort et ensevelissement de Jésus
8.1 Passion et mort de Jésus
8.1.1 Condamnation
8.1.2 Crucifiement
8.1.3 Mort
8.2 Mort et ensevelissement de Jésus
8.2.1 Lieu de la mort de Jésus
8.2.2 Date de la mort de Jésus
8.2.3 Préparation pour l’ensevelissement
8.3 Préparation à la Résurrection
8.3.1 Ré-animation ou Résurrection
8.3.2 Annonce de la résurrection de Jésus
8.3.3 Transfiguration
9 Résurrection de Jésus
9.1 Résurrection
9.1.1 Durée entre la mort et la Résurrection
9.1.2 Résurrection et effets sur les linges
9.1.3 Choix de l’agneau du sacrifice
9.1.4 Sens de la Résurrection de Jésus-Christ
9.2 Caractéristiques du corps ressuscité
9.2.1 Les quatre dons
9.2.2 Don de force ou d’agilité
9.2.3 Don du corps spirituel ou de subtilité
9.2.4 Don de gloire ou de clarté
9.2.5 Don d’incorruptibilité ou d’impassibilité
9.3 Témoignages
9.3.1 Témoignage de Jean
9.3.2 Crédibilité des témoins
9.3.3 Témoins de la résurrection
9.3.4 Reconnaissance de la divinité de Jésus
Épilogue
Écoute Israël
Annexe 1.1 : Tunique - Chronique Frédégaire
Annexe 1.2 : Tunique – Redécouverte
Annexe 1.3 : Tunique – Dévotions
Annexe 1.4 : Tunique – Datation carbone 14
Annexe 1.5 : Tunique – Donations
Annexe 2.1 : Suaire – Événements à Oviedo
Annexe 2.2 : Suaire – Professeur Villalain
Annexe 3.1 : Coiffe – Charlemagne
Annexe 3.2 : Coiffe – Vénération avant 1500
Annexe 3.3 : Coiffe – Prise de Cahors
Annexe 3.4 : Coiffe – Vénération après 1600
Annexe 3.5 : Coiffe - Études scientifiques
Annexe 3.6 : Coiffe - Description des taches
Annexe 4.1 : Linceul - Légende d'Abgar
Annexe 4.2 : Linceul - Épitaphe d'Abercius
Annexe 4.3 : Linceul - Hymne de la perle
Annexe 4.4 : Linceul - Période iconoclaste
Annexe 4.5 : Linceul – Constantinople
Annexe 4.6 Linceul - Lettre de Baudouin II
Annexe 4.7 : Linceul – Ostensions
Annexe 4.8 : Linceul - Maison de Savoie
Annexe 4.9 : Linceul de Compiègne
Annexe 4.10 : Linceul - Faux linceuls
Annexe 4.11 : Linceul - Fil de lin
Annexe 4.12 : Linceul - Images laser
Annexe 5 : Voile - Recherches d’un capucin
Annexe 8 : Anne-Catherine Emmerich
Bibliographie
1 Tunique d’Argenteuil
Tunique d’Argenteuil (http://analogie.free.fr - license CopyLeft)
1.1 Présentation générale
La Tunique d’Argenteuil est une chemise sans couture. Elle est portée par Jésus pendant le chemin de croix. Au moment de la crucifixion de Jésus, les soldats tirent au sort cette Tunique.
Sur le plan historique, la Tunique est restée à Jérusalem et ses environs. Elle est ensuite emmenée à Constantinople, capitale de l’empire chrétien d’Orient. Vers l’an 800, l’impératrice Irène remet la précieuse relique1 à Charlemagne. L’empereur la donne à sa fille, abbesse d’un prieuré à Argenteuil, près de Paris.
La caractéristique de cette Tunique est qu’elle est inconsutile2, c'est-à-dire sans couture, d’une seule pièce. Sa matière en laine est tissée selon la coutume du premier siècle, torsadée en « Z ».
La formation de l’image sur la Tunique correspond au contact d’un corps ensanglanté qui a laissé du sang sur le linge.
La description de l’image montre du sang sur le dos, et de façon plus marquante sur les épaules. Une autre tache importante se trouve à l’endroit où une ceinture ou un cordon a arrêté le sang qui coulait des différentes plaies. Le sang appartient au groupe AB.
Les études complémentaires du tissu permettent de trouver des poussières et pollens.
1.2 Données historiques
De Jérusalem à Argenteuil, via Constantinople
Jésus porte cette Tunique directement sur le corps. Jésus met en plus une Tunique de dessus3.
Jean 19, 23-24 : « 23Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, dont ils firent quatre parts, une pour chaque soldat, et aussi sa tunique. Or la tunique était sans couture, toute d’un seul tissu depuis le haut (jusqu’en bas). 24Ils se dirent donc les uns aux autres : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » (C’était) pour que s’accomplît cette parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. C’est ce que firent les soldats. »
Les vêtements sont partagés par les bourreaux. La Tunique est tirée au sort et ainsi s’accomplissent les Écritures. Psaume 22, 19 : « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. »
Saint Pierre4 est le probable dépositaire de la Tunique. Les persécutions le chassent de Jérusalem vers l’an 36. Il emmène avec lui la Tunique à Jaffa5. Il s’y réfugie chez Simon le corroyeur.
Trois historiens6 racontent la découverte de la Tunique (Annexe 1.1). Le juif Simon, fils de Jacob, révèle dans les années 590 l’endroit où le Vêtement est caché, dans un coffre de marbre blanc à Jaffa. De nombreux évêques7 portent à pied la Tunique jusqu’à la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem distante d’une cinquantaine de kilomètres.
En 614 Chosroès II, roi des Perses, envahit la Palestine. La Tunique est transportée à la basilique des Saints-Archanges à Galata, près de Constantinople..
En 798, l’impératrice d’Orient, Irène (752 - 802) noue des relations diplomatiques avec Charlemagne et en l’an 800 lui donne la Tunique8.
Lors de son retour en France avec la relique, Charlemagne s’arrête et séjourne quelque temps en Limousin. Dom Wyard9 y relate de nombreux miracles grâce à la vertu de cette relique. Un enfant mort revient à la vie. Des personnes affligées de maladies incurables recouvrent la santé. Douze démoniaques sont délivrés. Huit malades, quinze paralytiques, quatorze boiteux, trente muets, cinquante-deux contrefaits, soixante-cinq malades d’écrouelles sont guéris.
Argenteuil
Donation par Charlemagne
Le 12 août de l’an 800, à une heure de l’après-midi, Charlemagne apporte la Tunique du Christ à sa fille Théodrade10, abbesse de Notre-Dame de l’humilité d’Argenteuil. L’arrivée de la Tunique est saluée par les cloches qui sonnent à toute volée. En commémoration de la donation de la Tunique à Argenteuil, les cloches du prieuré sonneront chaque jour à 13h00 et ne s’arrêteront qu’avec la révolution.
Redécouverte de la Tunique
Sous le règne de Charles le Chauve11, lors de l’invasion normande, les religieuses cachent la précieuse relique dans un mur pour la préserver des impies. En l’an 850, les Normands pillent et saccagent le hameau d'Argenteuil et la basilique Saint-Denis. Le monastère reste en ruine durant un siècle et demi.
En l’an 1003 l’épouse12 d’Hugues Capet rétablit le monastère.
La Tunique semble perdue du IXe siècle jusqu’au milieu du XIIe siècle. Elle demeure cachée dans une muraille du monastère d’Argenteuil.
Les moines de Saint-Denis arrivent en 1129 à l’abbaye. En 1156, ils entreprennent des travaux dans l’église abbatiale. À cette occasion la Tunique est retrouvée (Annexe 1.2).
Funeste projet
Au XIIIe siècle13, Gaultier de Haute-Pierre, noble chevalier lorrain, vient au prieuré d’Argenteuil pour y admirer la Tunique. Il obtient l’autorisation du supérieur pour se recueillir devant la relique. Il veut alors dérober un morceau de la relique et charge un de ses pages de l’opération. Mais alors que ce dernier s’apprête à couper un morceau du vêtement, le chevalier devient enragé et il est pris de frénésie. Malade durant onze jours, il se confesse publiquement et avoue son funeste projet. Il succombe le onzième jour, le 26 septembre 1298. Il est inhumé dans l’église du prieuré selon son souhait.
Guerre de religion
En 1567 le prieuré d’Argenteuil est incendié par les huguenots et le bourg pillé. Le frère Jean Tessier, religieux et sacristain du prieuré, cache la Tunique. La châsse vide est dérobée par les émeutiers. Le curé, l’abbé Lucas, est pendu à sa fenêtre par les protestants. Par la suite, la Tunique est entreposée dans un reliquaire en bois. Après le pillage du monastère par les huguenots, Henri III rétablit l'église du monastère d’Argenteuil, et s'y rend lui-même, afin de se prosterner devant la Tunique.
Révolution
Sous la Révolution, le prieuré bénédictin est supprimé, et la relique remise à l'église paroissiale. Les bâtiments en partie ruinés sont vendus comme biens nationaux en 1792.
Le 18 novembre 1793, l’abbé Ozet (1749 - 1816), curé d’Argenteuil, enlève la Tunique de sa châsse. Il la coupe en plusieurs morceaux et les cache en partie dans son jardin et en partie chez des paroissiens fidèles. La châsse, offerte par la duchesse de Guise, est portée à la Monnaie pour y être fondue. L’abbé Ozet est incarcéré du 4 mars 1794 au 30 janvier 1795.
Dès sa libération, l’abbé exhume le précieux trésor caché dans son jardin et chez des paroissiens. Quelques morceaux sont malheureusement égarés, mais le vêtement est recousu.
Événements depuis la Révolution
L’ancienne église d’Argenteuil, trop vétuste, est démolie. La basilique Saint Denis est construite. Le 5 juin 1865, la Tunique est transportée dans cette basilique d’Argenteuil.
Mgr Goux détecte la présence de sang sur la Tunique dès 1882, et le consigne dans son procès-verbal du 17 Juillet. L'analyse des textiles est faite par les Gobelins et l'étude hématologique par l'école de Pharmacie de Paris.
Le samedi 12 décembre 1983 à 15h40, jour de la fête de la Sainte Jeanne de Chantal, un séminariste en stage à Argenteuil se rend à l’église afin d’y jouer de l’orgue. Pénétrant dans cet édifice par la porte de côté, il remarque que celle-ci est fracturée. Il se précipite à la chapelle de la Tunique et constate que la relique a disparu.
Le 1er février 1984 dans la soirée, le curé se trouve au presbytère et s’apprête à sortir. Une personne, qui lui fait promettre de ne jamais révéler son nom, lui restitue la Tunique, parfaitement conservée.
Aujourd'hui cette relique de la Tunique se trouve à la basilique Saint Denis d'Argenteuil.
Dévotion
Les pèlerinages, processions, miracles se succèdent au fil des siècles (Annexe 1.3).
Études scientifiques
En 1892 et 1893, des études scientifiques sont entreprises par les manufactures nationales des Gobelins14 et par des chimistes15.
En 1931, l’abbé Parcot, licencié es sciences entreprend également des études scientifiques.
En 1934 Gérard Cordonnier réalise des photos à l’infrarouge.
En 1998, le COSTA16 réunit à Argenteuil, le 14 novembre, une table ronde avec des représentants17 du CIELT18, du CSST, du TSCC (USA), de l’EDICESES. Des spécialistes participent à cette rencontre, Madame Flury-Lemberg, experte suisse des tissus anciens, l’abbé Le Quéré, auteur d’un premier livre sur la Sainte Tunique d’Argenteuil.
Madame Sophie Desrosiers, spécialiste des textiles anciens, étudie le tissu en 2003.
Datation au carbone 14 (Annexe 1.4)
En 2004, les analyses, menées au Laboratoire des Mesures du Carbone 14 à Saclay, datent le tissage de la Tunique des VIe et VIIe siècles de notre ère (entre les années 530 et 650 ap. JC).
Mme Claire van Oosterwijck montre l’incapacité de la méthode du Carbone 14 à dater des tissus pollués comme cette relique. Elle réfute aussi la datation au carbone 14 du Linceul de Turin réalisée en 1988.
Donation de fragments (Annexe 1.5)
1.3 Caractéristiques de la Tunique
Caractéristiques
Le vêtement est droit, avec une encolure pour passer la tête, deux manches courtes retombant sur les côtés.
La Tunique d’Argenteuil est une tunique de dessous. Elle mesurait environ 148 cm (actuellement 122 cm) de hauteur pour une largeur sous les bras de 90 cm. Elle est cousue sur une étoffe de soie blanche. La Tunique d'Argenteuil est incomplète avec beaucoup de trous (morceaux de tissu disparus lors de la Révolution). Il manque toute la bande inférieure, ainsi qu’une bande de 0,30 m sur 0, 70 m sur le devant.
Un examen de la Tunique indique qu'elle est bien à l’origine « inconsutile », c'est-à-dire sans couture, tissée d'un seul tenant, y compris les manches. Il s'agit d'un procédé de tissage particulier dont la technique ne s'est pas perdue en Orient.
L’étude réalisée19 montre que les fibres de la Tunique sont en laine avec des fils d’une grosseur très régulière. Il s’agit d’un tissu souple et léger. Le tissage est uniforme et réalisé sur un métier à tisser primitif. Le résultat est remarquable pour un travail entièrement manuel.
Le Professeur Lucotte confirme les anciennes analyses des Gobelins. Les nouvelles recherches de Mme Bédat indiquent une résistance du tissu due au mode de tissage très ancien d'un fil en laine torsadé « en Z ». L'épaisseur du fil est celle d'un vêtement de dessous.
La coloration de la Tunique est réalisée avec une teinture de garance très utilisée dans l'Orient des premiers siècles. Le pourpre est réservé à la classe aisée. Pour fixer la teinture, le mordançage s'est fait à l'alun, connu depuis les temps immémoriaux, à Babylone déjà.
La fabrication et le procédé de coloration datent la Tunique à l'époque du Christ et la situent en Palestine.
1.4 Formation de l’image
Évangile de saint Marc 15, 20 : « Après s’être moqués de lui, ils lui retirèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et le firent sortir pour qu’on le crucifiât. »
La Tunique est le vêtement que le Christ porte, après la flagellation, tout au long du chemin du Calvaire, lors du portement de croix. Le sang du Christ et sa sueur ont donc imprégné le tissu.
1.5 Description de l’image
Les taches de sang
Les nombreuses taches de sang sont observées dès 1882 par l'évêque de Versailles, en 1931 par le chanoine Parcot, puis plus par le chanoine Breton lors des photographies prises avec des projecteurs.
Des analyses chimiques prouvent qu'il s'agit bien de sang. On détecte des globules rouges inaltérés, des cristaux caractéristiques d'hémine obtenus à partir de l'hémoglobine du sang.
Sur les photos du dos de la Tunique, prises à l'infrarouge, on distingue une plaque de sang séché de 15 cm sur 15 cm, située à l'extrémité de l'omoplate gauche attribuée au portement de la croix.
Une série de cinq taches en chapelet correspond à la crête des vertèbres dorsales. Elle se prolonge en dessous de la ceinture par trois petites taches correspondant aux vertèbres lombaires et se termine par une grande tache à hauteur du sacrum.
Le professeur André Marion remarque que les taches de sang sur ce qu'on considère comme le dos de la Tunique, sont disposées en forme de croix. Elles correspondent par leur disposition au supplice du port de la croix qui précède la crucifixion.
Une autre tache importante de sang se trouve sur les reins de l'homme du Linceul. Il s’agit des flux de sang des plaies de la flagellation coagulés à l'endroit où une ceinture les a arrêtés.
En 1985, le Dr Saint Prix démontre que le sang de la Tunique est de groupe AB. Le groupe AB est rare dans les populations du monde, entre 1 et 10 % selon les régions.
Le professeur Lucotte, généticien, a fait un millier d'observations sur des hématies (globules rouges) parfaitement conservées sur la Tunique par du sel terrestre (NaCl) détecté sur la Tunique. Le diamètre moyen de ces hématies est de 6 microns environ, donc plus petit que la normale. Cette baisse de diamètre s'explique par une déshydratation au cours du temps, nouvelle preuve de l'ancienneté de la Tunique.
ADN
Le Professeur Lucotte indique que les hématies prélevées sur la Tunique n'ont pas de matériaux ADN.
En revanche, plusieurs cellules de peau, des cheveux, des pellicules, des globules blancs, prélevés sur la Tunique, contiennent de l'ADN humain. Le professeur a obtenu l'empreinte ADN (comme en médecine légale) de cet homme, d'après 15 marqueurs discriminants.
L'analyse chromosomique indique les certitudes suivantes :
- ADN humain,
- profils génétiques concernant un seul individu,
- marqueurs spécifiques avec présence du chromosome Y, marqueur de la masculinité,
- formules chromosomiques indiquant une correspondance avec un ADN sémite oriental non arabe (juif oriental).
Le professeur explique que l'homme a énormément souffert (analyse des hématies et spécialement des hématies déformées). L’homme était de sexe masculin et d'origine juive orientale.
1.6 Études complémentaires
Pollens
L’étude de la Tunique d'Argenteuil par le professeur Lucotte décèle la présence de 18 espèces de pollens, dont la plupart sont des plantes anciennes méridionales (palmier, de plante grasse). La présence notamment d'une espèce de Tamarix20 et de Pistachier21, plantes endémiques en Palestine, indique que cette Tunique y a séjournée.
Le professeur a trouvé des spores de rouille de graminée que l'on ne trouve en Palestine qu’en mars / avril, époque de la Pâque juive et de la Passion du Christ. La Tunique a donc séjourné en Palestine,
Poussières minérales
L’étude des poussières minérales par le Professeur Lucotte renseigne sur la région où la Tunique a été portée. Les minéraux identifiés indiquent un sol quasi désertique.
1 Reste du corps des saints ou objet leur ayant appartenu, et faisant l'objet d'un culte
2 « Sans couture », décalque du latin inconsutilis traduction du grec agraphos
3 Tunique ou Robe dite de Trèves
4 Selon Caesar Baronius4 (1538 – 1607), Pilate achète la Tunique au soldat romain qui l’a gagné au sort. Il revend ensuite la Tunique à des Chrétiens.
5 Jaffa appelée aussi Joppé, port de la partie sud de l’ancienne Tel Aviv
6 Grégoire de Tours (438-594) dans son « De gloria martyrum », Frédégaire, chroniqueur de l’époque mérovingienne en 660 dans sa « Chronologie », et Aimon dans son troisième livre de l’histoire de France
7 Antioche, Jérusalem, Constantinople…
8 Histoire de Navarre d’André Favin
9 Né en 1639 à Etaples, bénédictin de Saint Maur, mort le 23 mai 1714 au monastère de Sainte Valérie sur Mer
10 Fille issue de son mariage avec Fastrade sa troisième femme
11 Né en 823, roi de 843 à sa mort en 877
12 Adélaïde d’Aquitaine (mère de Dagobert II le Pieux)
13 D’après Dom Wyard (1638-1714) dans « Histoire de la Sainte Tunique d'Argenteuil »
14 MM Guignet et David
15 MM Lafon et Roussel
16 Comité pour la Sainte Tunique d’Argenteuil
17 Messieurs Alonso et Marion
18 Centre International d'Études sur le Linceul de Turin
19 Manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais
20 Tamarix hampeana
21 Pistacia palestina
2 Suaire d’Oviedo
Suaire d’Oviedo (http://anagogie.free.fr - license CopyLeft)
2.1 Présentation générale
Le Suaire d’Oviedo en Espagne est un linge de petite taille qui a servi à essuyer le visage de Jésus après sa mort.
Sur le plan historique, le Suaire est conservé à Jérusalem. Il quitte cette ville au début du VIIe siècle au moment où les Perses envahissent la Palestine. Après un périple par l’Afrique du Nord, le Suaire arrive en Espagne à Oviedo, devançant l’avancée des musulmans.
Le Suaire d’Oviedo mesure 83 sur 53 cm. Il est en lin, tissé selon la torsion dite « en Z »
La formation de l’image provient de l’utilisation de ce tissu pour essuyer le visage du Christ de la descente de croix à sa mise au tombeau. Il comporte de nombreuses traces de sang.
L’étude du linge permet de déterminer les souffrances de l’homme et l’origine de sa mort.
Les pollens étudiés sur le tissu attestent le parcours du Suaire entre Jérusalem et Oviedo.
2.2 Données historiques
De Jérusalem à Oviedo
Les reliques du Christ sont gardées par les apôtres dans un coffre de cèdre, appelé l' « Arca Santa » selon la tradition.
Vers 348, saint Cyrille de Jérusalem (315 - 387) affirme dans une homélie : « tout ce que le Seigneur a souffert dans sa Passion, nous pouvons le voir sur ses linges mortuaires que nous conservons dans cette église (le Saint Sépulcre) ».
Le roi des Perses, Chosroès II, envahit en 614 la Palestine. Avant la prise de Jérusalem, le coffre est emmené vers l’ouest22. Le prêtre Philippe est chargé de transporter l'Arca Santa à Alexandrie en Égypte. Mais en 616 les perses arrivent à Alexandrie. Philippe emporte alors l’arche à travers l'Afrique du Nord. Il traverse le détroit de Gibraltar.
A Carthagène en 616, « l’Arca Santa » est reçue par Fulgence, évêque d'Ecija. Saint Fulgence le remet à son frère saint Léandre, évêque de Séville dont le successeur sera son frère saint Isidore23.
Saint Ildefonse, disciple de saint Isidore, devient évêque de Tolède. Il emporte les reliques et leur coffret pour les mettre à l'abri dans la capitale du royaume hispano-wisigothique. La présence de l'Arca Santa est attestée dans cette ville au début du VIIe siècle. Tolède est alors le siège de la principale église d’Espagne. La présence du coffre à Tolède en 636 est attestée par le concile de Braga de 679. Un coffre est réalisé en chêne pour remplacer l’ancien en cèdre.
Vers 812 - 814, pour fuir l’avancée musulmane, « l’Arca Santa » est transportée vers le nord, dans les Asturies, à Oviedo (Annexe 2.1).
Aujourd'hui le Suaire est conservé à la sacristie de la cathédrale d'Oviedo. Il est exposé au public le Vendredi saint et durant l'octave de la fête de la Sainte-Croix (du 14 au 21 septembre).
Études scientifiques
En 1965, les premières études sont réalisées à la demande de Mgr Giulio qui remarque des analogies avec le Linceul de Turin.
En 1978, le célèbre criminologue suisse, Max Frei, étudie les pollens prélevés et les compare avec les pollens du Linceul de Turin et de la Tunique d’Argenteuil.
En 1985, le Centre romain de Sindonologie24 réalise une étude.
En 1989, le pape Jean-Paul II vient se recueillir sur le site.
En novembre 1989 et le 17 février 1990, le Centre espagnol de Sindonologie réalise des études.
En 1990, les laboratoires de Tucson et de Toronto réalisent une datation au carbone 14 qui donne une date entre 679 et 710 après Jésus-Christ (écart déjà constaté pour le Linceul de Turin et la Tunique d’Argenteuil mais cette datation n’est pas applicable à des linges pollués).
En 1991, les premières publications sont faites lors du congrès de Sindonologie de Cagliari.
En juin 1993, le Dr Carlo Goldini identifie le groupe sanguin AB identique à celui du Linceul et de la Tunique.
En octobre 1994 et Avril 2007, les deux premiers congrès scientifiques internationaux sont organisés sur le Suaire d’Oviedo.
2.3 Caractéristiques du Suaire
Le Suaire25 d'Oviedo est une toile de lin de 83 x 53 cm.
Les fils du Suaire ont la même composition que ceux du Linceul et la grosseur des fibres est identique. Elles sont filées à la main, dans les deux cas et selon la torsion dite « en Z ». Mais le tissage est différent. La trame est en arête de poisson pour le Linceul de Turin, et orthogonale pour le Suaire d’Oviedo.
Le Suaire d’Oviedo se présente aujourd'hui cousu sur une toile de fond blanche. Le tout est présenté dans un cadre d'argent.
Les bords, sur deux centimètres de large, présentent des petits trous. Le linge fut en effet longtemps cloué avec des clous d'argent sur un encadrement de bois pour l’exposer. Il est ensuite cousu sur la toile de fond.
2.4 Formation de l’image
A l'époque l'usage du Suaire varie. Le visage du supplicié est recouvert pendant qu'on le cloue, ou lorsqu'il est en croix, ou seulement après sa mort.
Le Suaire d’Oviedo a servi à couvrir le visage du Christ de la descente de croix à la mise au tombeau. Il présente d'importantes traces de sang.
Après la mort de Jésus, le visage ensanglanté nécessite un Suaire pour recueillir le sang. Chez les Juifs, le sang est le principe de vie. Tous les objets tachés de sang doivent être mis avec le corps dans la sépulture.
2.5 Description de l’image
Sur le Suaire une dizaine de taches sont décelables. Elles correspondent parfaitement à celles du visage du Linceul de Turin. Quatre taches de liquide traversent la toile de lin. Ces auréoles symétriques sont dues au pliage en deux du Suaire d’Oviedo. L’analyse montre une déchirure de 5,5 cm sur le bord de la partie horizontale supérieure, de petites perforations et une série de gouttes de cire.
Les membres du groupe « EDICES » en Espagne, assistés par des membres du STURP, ont étudié le Suaire d’Oviedo. L’étude scientifique réalisée est aussi rigoureuse que celle de 1978 sur le Linceul de Turin.
La composition des taches indique que l'homme dont le visage a été recouvert par le linge, est mort crucifié. Les liquides se sont en grande partie écoulés du nez et de la bouche lorsque le corps fut descendu de la croix.
La disposition des taches montre que le Suaire a été enlevé puis replacé sur le visage à cinq reprises. Cinq groupes de taches, en dégradé, retracent les différentes étapes de la mise au tombeau.
Des expériences menées montrent que l'homme, au moment de la mort, était en position verticale pendant environ une heure. Sa tête était penchée avec un angle de 70 degrés vers l'avant et de 20 degrés vers la droite, ce qui est compatible avec une crucifixion.
Le cadavre est alors descendu et posé à plat. La tête est toujours penchée de 20 degrés vers la droite et de 115 degrés en avant. Le front repose sur une surface dure et est resté dans cette position environ une heure.
Le corps est plus tard déplacé tandis qu'une main masculine tente de supprimer le flux d'un liquide s’écoulant du nez (le sang et le sérum). Le corps est finalement couché sur le dos, tandis que le Suaire est enlevé.
On distingue sur le linge, de petits trous provoqués sans doute par des épines. Du vinaigre est sans doute responsable des altérations superficielles de la surface du linge.
Le Suaire présente de nombreux plis identifiables à la lumière rasante. Ces plis correspondent à ceux que l'on obtient en plaçant une serviette autour d'une tête.
Le docteur Villalain26 identifie les taches comme du sang humain de groupe AB.
Le professeur a fait de nombreuses recherches en effectuant des simulations (Annexe 2.2).
2.6 Études complémentaires
Pollens
En 1979, Max Frei prélève des pollens sur le Suaire d’Oviedo. Il découvre les pollens de six plantes trouvés également sur le Linceul. Deux de ces pollens sont caractéristiques de la Palestine. D’autres pollens, qui ne se retrouvent pas sur le Linceul, correspondent à des plantes de l'Afrique du Nord. Aucun pollen de plantes propres à la Turquie où à l'Europe n’est trouvé sur le Suaire, alors qu'ils sont abondants sur le Linceul.
Les scientifiques espagnols Montero et Pintado répertorient trente types de pollens différents. Ces analyses attestent que le Suaire d’Oviedo provient bien du bassin méditerranéen.
L'analyse des pollens confirme le parcours historique du Suaire de Palestine en Espagne, via l'Afrique du Nord.
22 Récit de Pélage, évêque d’Oviedo au XIIe siècle
23 Grand érudit, né vers 560/570 et décédé en 636, auteur des Étymologies, importante encyclopédie sur le savoir antique
24 Domaine de la science qui a pour objet l’étude du Linceul de Turin
25 En grec soudarion
26 Professeur émérite de médecine légale à l'université de Valence en Espagne
3 Coiffe de Cahors
Coiffe de Cahors dans la chapelle Saint-Gausbert Dans son reliquaire actuel de la fin du XIXe siècle (Photographie de Pierre Milliez)
3.1 Présentation générale
La coiffe est un linge mortuaire utilisé par les Juifs pour couvrir la tête du mort au moment de la mise au tombeau. Ce linge sert aussi de mentonnière. Il est appelé Pathil chez les hébreux.
Durant les premiers siècles la Coiffe est conservée à Jérusalem. La Coiffe est offerte à Charlemagne par le Calife Haroum-al-Raschid. Charlemagne lui-même la donne ensuite à Aymatus évêque de Cahors.
La Coiffe est constituée de huit doubles (huit coiffes), de texture différente. Les huit épaisseurs sont appliqués l’une sur l’autre et cousues ensembles. Elle possède les caractéristiques des suaires des premiers siècles (matière, forme, coupe, galon la bordant, coutures).
Le tissu comporte des marques de sang. Les taches de sang permettent de déterminer ce qu’a subi l’homme mis au tombeau.
Dans les temps anciens la Coiffe de Cahors est appelé Saint Suaire. Pour éviter toute confusion avec le Suaire d’Oviedo ou le Linceul de Turin, nous préférons l’appellation plus précise de Coiffe de Cahors.
3.2 Données historiques
Histoire de l’an 30 à l’an 1119
La Coiffe est posée sur la tête de Jésus lors de sa sépulture. Les disciples conservent la Coiffe à Jérusalem.
Aux premiers siècles, Cahors est une grande cité épiscopale gallo-romaine. Elle compte plus de trente mille habitants.
Pour les carolingiens le Quercy est une province importante. Pépin le Bref, accompagné de son fils Charles, y vient en 763 pour guerroyer contre le duc d’Aquitaine Waïffre.
Au VIIIe siècle, les Arabes multiplient les incursions et pillages dans le Lot et occupent Cahors jusqu’en 778. Charlemagne à son retour d’Espagne reprend Cahors27.
Connaissant la piété et l’intérêt de Charlemagne pour les reliques, les monarques lui envoient de préférence des reliques. Le présent de la sainte Coiffe est fait à Charlemagne par le Calife Haroum-al-Raschid28.
Richard de Wassebourg écrit en citant saint Annon29 qu'en l'an 800, Aaron, roi et amiral de Perse, envoie des ambassadeurs à Charlemagne avec des reliques dont le suaire de Jésus (Annexe 3.1).
Les chroniques de Saint-Denis30 sur les Gestes de Charlemagne relatent qu'on lui a apporté de Jérusalem et de Constantinople, de saintes reliques dont le suaire (Annexe 3.1).
Marc-Antoine Dominicy31 relate que de son temps il y avait dans l’abbaye de Conques une vieille chronique commençant aux premières années du règne de Charlemagne et finissant en 1244. D’après ce manuscrit, Charlemagne aurait reçu de Constantinople plusieurs reliques, entre autres des épines de la couronne du Christ, un des clous du crucifiement, un fragment de la Croix et le Suaire de Notre-Seigneur. Un astérisque renvoyait vers la marge aux mots antiques latins en lettres majuscules suivants32 : « Qui fut donné ensuite à l’église de Cahors ».
« En possession de tant d’objets précieux, ce grand prince se plut à en faire don à diverses églises de son empire. Il est certain qu’il fut obligé de venir plusieurs fois dans l’Aquitaine pour faire la guerre aux Sarrasins d’Espagne et qu’il favorisa particulièrement le Quercy, qui avait beaucoup souffert de l’invasion de ces barbares…. »33
En 803, Charlemagne donne la Sainte Coiffe à Ayma évêque de Cahors de 790 à 804. Il confie à Saint Namphaise34 la donation de la Coiffe. C’est l’hypothèse retenue par la plupart des historiens. Un tableau de M. Calmon évoque l’évènement dans la chapelle du Saint Suaire de Cahors.
Histoire de 1119 à 1500
En 1119, le Pape Calixte II tient un concile à Toulouse. Il se rend ensuite à Cahors, dont Guillaume III de Caumont35 est évêque. Il y consacre l’autel de la Coiffe situé dans la chapelle Saint Pierre.
La Coiffe est vénérée lors des pèlerinages, dans les offices du Suaire de Cahors dans les missels. Dès 1360 l’ostension de la Coiffe durant les deux jours de Pentecôte du haut de l’ambon36 (Annexe 3.2).
Histoire de 1500 à 1600, Prise de Cahors par les protestants
Le 29 mai 1580, suite à une trahison, les protestants occupent Cahors et livrent la ville au pillage. La cathédrale est saccagée avec tout ce qu’elle contient d’autels, vases sacrés, statues, reliques.
Malheureusement les archives du chapitre de la cathédrale, avec les titres de la Coiffe, sont incendiées par les protestants. Le cartulaire est également brûlé à cette époque. Le cartulaire contenait les annales des prodiges fleurissant autour de la Coiffe. Dominicy connaissait son existence par le témoignage de plusieurs personnes respectables qui avaient vu le livre avant sa destruction.
La Coiffe échappe de justesse à la destruction (Annexe 3.3).
Meuble reliquaire qui contenait la châsse de la Coiffe jusqu’en 1580
Reliquaire en argent qui contenait la Coiffe à partir de 1585
Autel consacré en 1119 par le pape Calixte II (Photos de Pierre Milliez autorisation marquis Guy de Braquilanges)
Histoire postérieure à 1600
En 1653, la peste ravage le Quercy et quelques cas sont signalés dans le faubourg de Saint-Georges. L’évêque37 de Cahors, ordonne des jeûnes, des prières et une procession générale à travers places et rues, lors de laquelle on porte la Coiffe de Notre-Seigneur. Le fléau s’arrête.
En 1712, l’évêque de Cahors38 est gravement malade, en danger de mort. L’évêque de Montauban39, accourt alors. Les vœux et les prières réalisés à la chapelle de la Coiffe sauvent le malade….
En 1733, Monseigneur Henri de Briqueville de la Luzerne consacre un nouvel autel à la Coiffe. Les pèlerinages fervents durent jusqu’à la révolution française, tous les 8 février, jour anniversaire de l’expulsion des armées protestantes, les 30 juillet, en mémoire de la délivrance de la peste de 1653, et les 15 août car selon la tradition Marie a tissé elle-même cette Coiffe pour son fils.
En 1790 les archives périssent dans la tourmente révolutionnaire. En 1790 l’inventaire du chapitre cathédral mentionne la châsse en argent décorée de putti. Sur une boîte en bois sont cloutées des plaques d’argent repoussé et ciselé, avec des colonnes à chapiteaux corinthiens.
En 1793, M. Danglars, évêque constitutionnel du Lot, apprend qu’on doit brûler la Coiffe. Il la dérobe lui-même de sa châsse en argent datant de 1585, et ne la rend qu’au retour de la paix religieuse.
La Coiffe continue d’être honorée au fil des siècles (Annexe 3.4)
Vers 1960 la Coiffe cesse d’être présentée au public par l’évêque comme il était de tradition aux fêtes de Pentecôte.
La Coiffe est conservée ensuite dans la chapelle saint Gausbert. donnant sur le cloître de la cathédrale Saint Etienne de Cahors. Elle a été placée en haut de l’autel principal à partit de 2015
Études scientifiques historiques
Les taches de sang de la Coiffe sont examinées avec soin en 1839 avec la chimie de l'époque et font l'objet d'un procès-verbal déposé aux archives du Chapitre (Annexe 3.5).
3.3 Caractéristiques de la Coiffe
Forme
Une première enquête de 1640 compare la Coiffe avec d'anciennes médailles. Elle correspond parfaitement au « pathil » dont les Juifs couvrent la tête de leurs morts, avec ces deux mêmes bandes attachées sous le menton.
La Coiffe est unique dans sa confection. Sa singularité plaide en faveur de son authenticité, authenticité qui n'a d'ailleurs, jamais été contestée.
« La Sainte-Coiffe a la forme d’un serre-tête d’homme. Elle devait couvrir la tête de Notre-Seigneur, depuis le front jusqu’à la nuque, s’allonger sur les tempes et être attachée sous le menton »40.
La Coiffe couvre la tête du front à la nuque et ne laisse à découvert que le visage, depuis le milieu du front jusqu'au menton. Elle fait office de mentonnière.
La Coiffe comportait deux pans d'étoffe qui recouvraient de chaque côté les oreilles et les joues, mais en laissant la nuque dégagée. Chacun de ces pans se terminait par un arrondi.
On aperçoit encore à l'extrémité gauche le petit bouton auquel venait s'attacher, en dessous du menton, la boutonnière en ganse de l'extrémité droite. La boutonnière a disparu depuis le siècle dernier. Cette disposition aidait à maintenir fermée la bouche du mort.
Dimension
La Coiffe mesure 22 centimètres de haut. La Coiffe a de chaque côté des tempes sept pouces de large (18,9 cm), et, depuis le front jusqu’à l’extrémité des bouts qui s’allongent sous le menton dix pouces et demi de long (28,4 cm). Elle a onze pouces (29,8 cm) depuis le front jusqu’à la nuque, et huit (21,7 cm) depuis la nuque jusqu’à l’extrémité des bouts qui s’allongent sous le menton. Le contour de l’ouverture en son entier, en suivant les bords, est de trente-sept pouces (100,2 cm).
Un pouce équivaut à 2,707 cm.
Une ligne équivaut à 2,707/12, soit 2,256 mm.
Couleur
« La couleur de la Sainte-Coiffe se rapporte à celle d’une soie écrue, usée et fort maniée.»41
« Ce saint linge, a perdu avec le temps sa couleur naturelle ; il est maintenant d’un gris tirant sur le jaune, ou pour mieux dire de la couleur d’un linge enfumé… Les aromates, que l’on a mis sur la tête de Jésus-Christ, peuvent aussi avoir beaucoup contribué à lui faire changer de couleur. »42
« Pour nous, nous appellerons cette couleur d’un blanc sale, enfumé par le temps »43.
Composition44
« Ainsi la Sainte-Coiffe se compose de huit doubles ; ou, si l’on veut, de huit coiffes l’une sur l’autre, cousues ensemble avec un fil assez gros. Les doubles sont d’un seul morceau, en sorte qu’il n’y a que huit pièces.
La première pièce à l’extérieur et la huitième à l’intérieur sont en crêpe-lis, et d’une telle finesse qu’on peut les comparer à une toile d’araignée. Les autres pièces sont d’un tissu moins fin ; mais la deuxième et la septième sont plus fines que la troisième et la sixième, et celles-ci plus que la quatrième et la cinquième qui sont au milieu.
Quoique les huit doubles soient d’un seul morceau, il y a cependant une couture ; mais seulement depuis le milieu de la tête jusqu’à la nuque ; le reste n’en a pas. Pour donner à la Sainte-Coiffe une forme convenable à sa destination, il fut nécessaire de la découper, et par conséquent de faire sur le derrière une couture qui l’adaptât bien juste à la tête.
La couture a sept pouces de long et est recouverte à l’intérieur d’une petite ganse plate d’une ligne et demie de large, pour consolider la couture. La ganse se prolonge jusqu’au bord sur le front, et est entourée d’un point en chaînette.
A l’extérieur, la couture est formée de deux rangées de points en chaînette ; elle était aussi recouverte d’une ganse, qu’on voyait encore en 1708 d’après Dom Bruno. Cette ganse se prolongeait jusqu’à la bordure par-devant, et devait avoir douze pouces de long, comme celle de dedans. Il n’y en a plus qu’un morceau d’un pouce et demi vers la nuque. Le reste a disparu.
La bordure tout à l’entour est formée de la même ganse et de deux rangées de piqûres.
Au bout, du côté gauche, il y a un petit bouton en dehors ; et du côté droit il y avait une bride en forme de boutonnière, ce qui servait pour attacher la Sainte-Coiffe sous le menton.
La bride qui, d’après Dom Bruno, était de ganse, a été enlevée.
On a employé partout la même ganse et le même fil. Ils sont de même couleur et de même matière que la Sainte-Coiffe. »
Tissu
« L’étoffe est inconnue, voire la matière, ne pouvant ceux qui l’ont curieusement reconnue, juger que ce soit lin, coton ou soie, et tiennent que c’est quelque espèce de lin égyptiaque. »45
« C’est en effet du lin égyptiaque ; il n’y a plus lieu d’en douter, d’après le témoignage d’un homme expérimenté, feu M. Champollion jeune, qui jadis examina la Sainte-Coiffe avec beaucoup d’attention, reconnut parfaitement la matière dont elle est composée, et déclara que c’était de fin lin d’Égypte. »46
La Coiffe possède tous les caractères des linges mortuaires du premier siècle de notre ère : matière, forme, coupe, soutache qui la borde encore, coutures.
3.4 Formation de l’image
L’image sur le tissu s’est formée au moment de l’ensevelissement de Jésus. Les disciples couvrent la tête de Jésus après sa mort avec la Coiffe qui sert à maintenir le menton et donc la bouche fermée.
C’est à ce moment-là que la Coiffe fut marquée de traces de sang.
3.5 Description de l’image
Il reste sur ce linge plusieurs taches. À l’examen au microscope, ces taches sont des taches de sang. L’analyse chimique47 confirme qu’il s’agit de taches de sang.
Sur les photographies une grande tache de sang est visible à l'intérieur de la Coiffe et perce à l’extérieur au niveau du bas de la joue droite, correspondant à l’arrachement de la barbe sur le Linceul de Turin. Une blessure est également visible au niveau de l’arcade sourcilière gauche en correspondance à la blessure sur le Linceul. Deux taches de sang très proches se trouvent dans le bas de la nuque à gauche en correspondance avec les blessures des épines sur le Linceul.
De nombreuses empreintes de sang plus petites sont visibles représentant les blessures infligées par une couronne d’épines.
Des taches de sang, situées sur les côtés intérieurs de la Coiffe complètent celles qui sont visibles sur le front et la nuque de l'homme du Linceul. Elles dessinent ainsi le tracé complet d'une couronne de blessures provoquées par des épines.
« Ces taches, d’une si grande étendue et en si grand nombre, prouvent d’une manière irréfutable que la Sainte-Coiffe a été placée sur la tête adorable du Sauveur immédiatement après qu’elle fut lavée et avant qu’on procédât à l’embaumement. En effet le premier phénomène produit par l’application des matières qui furent employées est la coagulation du sang… »48
La Sainte-Coiffe porte des traces sanglantes que l'on peut attribuer pour dix taches à la couronne d'épines et pour trois taches à la joue droite endommagée et à l'arrachage de la partie droite de la barbe et de la moustache (Annexe 3.6).
3.6 Études complémentaires
La Coiffe a la forme et les dimensions d'un bonnet laissant le visage à découvert et muni de deux pans destinés à la fermer sous le menton. Ce dispositif explique pourquoi la barbe paraît comme poussée en avant sur l'image tridimensionnelle du Linceul de Turin.
Notons qu’aucune église au monde ne prétend posséder la Coiffe à part la cathédrale de Cahors.
Coiffe de Cahors avec les taches de sang Partie droite extérieure et gauche extérieure droite intérieure (Photographies de Pierre Milliez)
Coiffe de Cahors avec les taches de sang Partie arrière Partie arrière droite (Photographies de Pierre Milliez)
Coiffe de Cahors avec les taches de sang partie droite partie gauche (dessin de Pierre Milliez d’après le récit de l’abbé Justin Gary)
27 Chronique de Saint-Mihiel, du diocèse de Verdun
28 Cinquième calife abbasside (766 - 809) – Hârûn al-Rachîd ben Muhammad ben al-Mansûr – Avec Hârûn pour « Aaron » et rachîd pour « le droit »
29 Archevêque de Cologne en 1055
30 Dom Bouquet, Recueil Des historiens des Gaules
31 Abbé de Fouilhac et historien du XVIIe dans « De sudario cap. Christi »
32 « Quod post ecclesiœ Carduci concessit »
33 Notice historique du chanoine Montaigne
34 Parent et Paladin de Charlemagne
35 Ou Calmon d’Olt
36 Petite tribune placée latéralement à la clôture du chœur, utilisée pour les lectures du rituel de la messe et pour la prédication. (Remplacée par Jubé et chaire à prêcher)
37 Bienheureux Alain de Solminihac
38 Henri de Briqueville de la Luzerne
39 François de Vaubecourt
40 Chanoine Montaigne, historien du XIXe siècle, dans sa notice historique sur la Coiffe
41 Guyon de Maleville, historien du XVIIe, dans chroniques du Quercy
42 Dom Bruno Malvesin, historien du XVIIIe
43 Chanoine Montaigne, historien du XIXe siècle, dans sa notice historique sur la Coiffe
44 Ibid
45 Malville au XVIIème siècle
46 Montaigne dans sa notice historique
47 P. V. du 8 mars 1839 signé par MM. Lacombe, médecin, et Lacombe, pharmacien ; Montaigne, Floras et Dommergues, chanoines
48 M. Bourrières dans Histoire de St Amadour et de Ste Véronique, publiée par la revue religieuse de Cahors et de Rocamadour