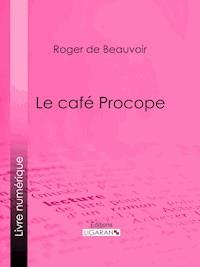
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est en Picardie que j'ai vu l'un des plus beaux châteaux de France, un château dont je dois vous taire le nom ; car, à cette heure, son nom de château lui reste à peine ; à cette heure la Bande-Noire en a fait du zinc ; ses écuries, ornées de soleils et de devises à la Louis XIV, ont croulé sous le marteau comme ses boudoirs."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je suppose un de ces provinciaux de Gresset ou de Collin d’Harleville, hobereaux en guêtres que nous envoient les départements avec un passeport : habit bleu-barbeau, prétentions littéraires de 1807, et trois cent neuvième collaborateur de l’almanach des Muses à Paris. Ce jeune homme est reste candide et pur au milieu de tous les débordements du drame moderne, et des étranges libertés de notre scène. Il cultive la poésie légère, raffole de Bertin, et a chez lui le buste de Chaulieu. Il est de quatre-vingt-cinq athénées floraux et scientifiques ; ce qui fait qu’il pourrait mettre à son habit autant de médailles que de boulons. C’est une nature douce et rangée, exempte de faste, et créée pour le vers de dix syllabes. Son horizon de poète finit à Roucher.
Ce jeune homme arrive à Paris par les messageries royales.
De quel étonnement ne sera-t-il pas saisi en voyant sa charmante poétique du dix-huitième siècle, honnie, délaissée, son auréole pâle et entourée de brouillards ? Quels regrets ne donnera-t-il pas à la Chartreuse, à l’Art d’aimer, à Vert-Vert ! Comme il se fera le champion de ces médiocrités charmantes, de ces riens délicieux, de ces badinages et de ces poèmes de mousquetaires ! Parlez-lui du chevalier Bonnard. Rival de M. de Boufflers et de Parny, dont il sait toutes les églogues par cœur, laissez-le vous réciter Aline, le Cheval et la Fille, Ah ! si, et vous lire, au soir, le Sultan Misapouf, de l’abbé de Voisenon ! Ce n’est qu’au feu de ces souvenirs qu’il s’anime, lui seul connaît à fond ce siècle frivole, dont la prose et la tête sont si légères ! lui seul qui n’en dit rien lorsque tout le monde en parle, et qui se contente de hocher la tête quand on lui dit que le dix-huitième siècle est jugé !
Ne lui montrez pas, par pitié, le drame moderne, le drame honnête, le draine intime, le drame effréné, le drame criard, le drame criminel, le drame historique, et celui même qui est extrahistorique, d’après le baptême nouveau d’un de nos grands auteurs, son parrain ; toute espèce de drame et de tragédie nouvelle en un mot. Laissez-le se confiner dans ses chères études, dans ses comédies, ses petits poèmes, ses charades. Ne donnez pas à son admiration un lait trop fort, et songez que c’est un Sybarite qui voit le pli des roses de Gentil-Bernard.
Heureux égoïste que cet homme charmant, homme des vieux soupers et des joyeuses chansons de table, homme de tradition, de sens et de poésie, qui ne voit, ne veut rien voir et rien lire, comme le pape Jules II : Afin, disait-il, de ne pas gâter sa belle latinité !
Vous le rencontrerez à cet étalage, en plein vent, du libraire Sauvaignat, dans la rue Saint-Germain-des-Prés. C’est là que, de mon temps, se pavanait au soleil, à l’angle de la rue, la poésie de ce bon dix-huitième siècle, reliée en papier rose, avec ses grands hommes lithographiques. Sur cet étalage tombera aussi la première larme de notre provincial, car il se trouve à quelques pas du café Procope.
Le café Procope ! – écriteau d’hier, regratté à blanc, et qu’il va regarder à deux fois. Serait-ce là, dira-t-il cette mémorable taverne, la taverne de Voltaire, de Préville et de Molé ? Montrez-moi, de grâce, le fauteuil en cuir de son président Piron, le gobelet de Fontenelle, et le portrait de Mlle Clairon, charbonné sur un panneau par M. Crébillon, le fils. Laissez-moi demander à M. Rameau des nouvelles de son opéra d’Hippolite et Aricie ? Ne parle-t-on pas du mariage de M. Sédaine, et M. de Voiture ne publie-t-il point Zapata ? Ce gros homme en poudre, n’est-ce pas M. Favart, garçon pâtissier avant d’être auteur, et cet autre son ami l’abbé Voisenon, ami de madame Favart ? Que donne-t-on ce soir à la Comédie-Française, et les débutants, ont-ils enfin quitté le bredouillement de Poisson ? Dites-moi, Monsieur, quel est ce seigneur cousu d’or qui raille si impitoyablement ce petit fat ? C’est le marquis de Villette, persiffleur intime de Dorât ; Dorât, l’homme aux essences et aux six maîtresses, prend à lui seul quatre chaises dans ce café, afin que le petit Poinsinet n’en trouve aucune. Poinsinet va pourtant lui donner la main, car, sans Dorât, Poinsinet serait l’homme le plus ridicule et le plus mystifié de Paris !
Oh ! le vieux, le sale, l’enfoui et pourtant le magnifique café ! Procope y a semé à profusion les miroirs, les dorures, et les tables à pieds de biche. L’astronome Lalande a donné ce baromètre à Procope ; Procope verse en revanche à Lalande ce moka céleste qui lui fait oublier les constellations. Le professeur Dellile, cet ingénieux aveugle, a fait ici ses vers fameux sur le café ! Dans ce café Procope, l’on s’est battu un beau soir et l’on a tiré l’épée contre les comédiens, au sujet de la suppression des banquettes. Les jeunes seigneurs étaient furieux contre l’ordonnance : elle coûta trois lustres et quelques chambranles à ce splendide café !
Les habitués de Procope sont des petits maîtres, des élégants, des chevau-légers et des agréables. Ils ont le teint frais et lumineux ! comme disent les comédies. Les uns sont marquis, d’autres colonels, de ces colonels, vous le savez, qui brodent au tambour. Motus, voici le financier Danville qui descend de son vis-à-vis à sept glaces : c’est un homme qui prête des politesses à des intérêts très élevés. Voyez, il salue à peine, et se renfonce dans sa houpelande à brandebourgs ; – il a soin aussi de dire tout haut qu’il a dîné chez le prince de Soubise. La pantomime de Vestris et de mademoiselle Guimard partage en deux camps les tables d’échecs. Par cette porte condamnée à l’heure qu’il est, et qui faisait face à la Comédie, sortait jadis un petit bossu nommé Lekain.
Plus tard, si quelque jeune homme bien humble, les cheveux longs, et enveloppé d’un mauvais manteau, s’est placé à la dernière table de ce café, et a payé sa tasse en gros sous, soyez sûr qu’il avait pour nom… Gilbert !
En reconstruisant de la sorte en sa mémoire cet insigne endroit, vous voyez que le provincial reconstruit son dix-huitième siècle, il croit lire encore 1760 sur les volets du moderne glacier Zoppi. Hélas, hélas ! les temps sont pourtant changés ! Les grands hommes emperruqués de l’autre siècle ont fait place aux professeurs à moustaches et à éperons de nos jours, les laquais en broderies aux garçons en tablier. L’Italien Zoppi, le successeur de Procope, n’est plus à cette heure le desservant des comédiens et des financiers, c’est l’homme du moka rhétoricien et des sorbets universitaires. Les grands seigneurs (si toutefois nous avons encore des grands seigneurs !) ne vont plus au cabaret.
Civilisation stupide et pauvre qui a privé chaque individualité de son commerce ; civilisation de gaz, de mélodrames, de progrès et de cafés. Reine absurde qui a tout nivelé, tout, jusqu’au café Procope !
Le café Procope, aujourd’hui, n’est plus en effet qu’un café comme tant d’autres ; il a des tables de marbre, des joueurs de dominos, de mauvais plaisants et des gazettes. Justinien et Hippocrate ont détrôné Panard ; M. Delvincourt boit dans la tasse de Piron.
C’est là un des grands crimes du Paris moderne que d’avoir été mauvais fils et de n’avoir rien su conserver de son aïeul, que d’avoir laissé l’ancienne Comédie Française, où jouait Lekain, devenir, vis-à-vis de ce café, une papeterie, ou la maison d’un notaire ! Sans quelques vigilantes sentinelles de ce passé, sans quelques écrivains, au nombre desquels l’auteur de ce livre s’honore de s’inscrire, les monuments et les souvenirs de ce quartier, les Universités, les Thermes, l’hôtel de Cluny, sa chapelle, et tant d’autres ruines précieuses, fleurs délicates de ce jardin des Écoles n’auraient peut-être pas reconquis leur verdeur et leur éclat. La maison de Molière, par exemple, où figurent quatre mauvais clous retenant au mur une inscription plus mauvaise encore, ne devrait-elle pas obtenir une statue de la liste civile ? Est-ce avoir fait assez que d’appeler des rues Corneille et Racine, et ne serait-il pas temps que le moellon devînt marbre ?
Ce qui excusera ce programme de réflexions, c’est le choix de notre titre lui-même, choix indéterminé, fantasque de prime abord. Nous ne dirons qu’un mot pour nous justifier aux yeux de la Critique de ce titre : Café Procope : pour la plupart, les nouvelles historiques de ce volume se passent dans le faubourg Saint-Germain. Or, il ne serait pas impossible que le rendez-vous de nos héros ait été souvent le café Procope. L’auteur aime à penser que le chevalier Folard, son petit vieillard des Convulsionnaires, entra du moins une fois dans cette buvette parisienne pour y entamer une dissertation sur ses miracles favoris. Le vieux marquis ruiné qu’épousa la demoiselle Defresne, y régala peut-être une fois, au sortir de la comédie, son ami le cordonnier. Enfin Marat lui-même, ce littérateur sanglant, nommé Marat, que fauteur de ce livre, dans le cadre rapide d’une nouvelle, s’est aventuré à peindre sous un jour nouveau et gourmé de prétentions académiques, Marat, médecin avant d’être tribun du peuple, y a peut-être préparé ses thèses de physique.
Puissent, du moins, ces légères esquisses dont la Revue de Paris a déjà publié quelques pages, valoir, pour vous, cher Lecteur, le moka du café Procope !
Paris, janvier 1835.
C’est en Picardie que j’ai vu l’un des plus beaux châteaux de France, un château dont je dois vous taire le nom ; car, à cette heure, son nom de château lui reste à peine ; à cette heure la Bande-Noire en a fait du zinc ; ses écuries, ornées de soleils et de devises à la Louis XIV, ont croulé sous le marteau comme ses boudoirs. Un gros homme bien lourd et bien constitutionnel, au nom de l’industrie et du progrès, sera venu en août 1829 flanqué d’un architecte et d’un maçon, gens aussi habiles à renverser qu’à construire ; l’architecte n’aura pas été fâché de se venger de Mansard, et le maçon, de la féodalité des anciens jours. Le mémoire réglé, le plomb des toits et le fer doré des espagnolettes vendus, la cour devenue un bazar de briques, de marbres et de moellons, le démolisseur se sera frotté les mains avec autant de joie que le premier acquéreur et constructeur de ce beau domaine, domaine seigneurial et qui appartient pourtant à la noble maison des Choiseuil !
J’avais bien seize ans quand on me fit voir ce château ; ses terrasses, ses orangeries, son beau parc, demeurent gravés dans mon souvenir. Il y avait un magnifique bassin avec des figures, un bassin presque aussi vaste que ceux de Versailles ; les gazons du parc l’encadraient avec amour. Le château, bas et carré ainsi que tous ceux de Louis XIV, ouvrait ses deux ailes au midi, comme un digne faisan épanoui au soleil. Il avait dans son avant-cour deux beaux pavillons de dégagement, lesquels servaient de communs, et se trouvaient fermés par une grille massive, grille ornée de soleils et de gros boulets de fer, des boulets dignes d’aller au cœur d’un Condé ! Le concierge avait un trousseau de clés égal au moins à celui d’un geôlier constitutionnel ; c’était une espèce de majordome âgé, Picard et Flamand tout à la fois, Flamand par sa dignité comique, et Picard en raison de ses proverbes. Je dois vous dire qu’il marchait méthodiquement et ne manquait pas de m’offrir un siège à chaque chambre, ayant soin de le replacer ensuite en toute hâte, comme si le propriétaire seigneurial eut dû venir le soir même y faire son installation. Château désert, lamentable, abandonné ! Rien qu’aux éternels gazons du parc, gazons brûlés et jaunes comme la robe d’une chanoinesse, on devinait bien qu’il ne devait plus avoir de maître ; on comprenait sa ruine et son abandon ! Je ne saurais dire comme mes pensées toutes enfantines alors se voilaient de tristesse et de réflexion à la vue de cette grave solitude. À chaque volet de fenêtre que faisait claquer le concierge, un rayon de soleil, tranchant comme le rayon d’un sabre, venait brusquement envahir l’appartement et mettre à nu ces poudreuses magnificences. Ce qui m’étonnait encore c’est que les parquets de plusieurs salles étaient cirés, frottés et lustrés comme de la veille, n’attendant que le talon rouge d’un Mortemart ou la robe à queue d’une Noailles. Les sièges de Landrecy et de Mouzon, sous Louis XIV, donnaient un aspect guerroyant à la galerie ; ces tableaux en tapisseries étaient fraîchement brossés, et les baguettes d’or de leurs grands cadres étincelaient. Tristesse plus étrange ! les girandoles en cristal de chaque chambre et les pendules étaient recouvertes de crêpes noirs. Sur une table à pieds de biche se trouvait encore le Télémaque de M. de Fénelon avec estampes ; un médaillon de la princesse Palatine, des colifichets en lave romaine et des nœuds d’épée en diamants filés d’or.
Bourguignon, le vénérable concierge, apportait à la conservation de ce désordre la dévotion d’un rigoureux catholique : il laissait à sa place le moindre oubli et se gardait des remue-ménages. Par exemple le meuble dispersé dans telle chambre était rangé dans telle autre de façon que ce conte de La belle au bois dormant et de son immobile palais vous fut revenu dès l’heure même à la mémoire ; la salle à manger du château conservant, entre autres bizarreries, les traces d’un grand et magnifique souper.
– Voici, mon cher Monsieur, la chaise de M. le comte ! Mesdemoiselles Hus et Louison Rey de l’Opéra avaient fait quarante lieues pourêtre de ce souper. La petite Rey fut servie dans ce pâté, dont il ne reste que le plat. Le chevalier Bonnard et M. Dorât y chantèrent, etc. etc. Puis mille autres souvenirs évoqués par Bourguignon, souvenirs de sa jeunesse ou de celle de son aïeul, car c’était de père en fils que les Bourguignon continuaient leur charge d’intendant. En vérité, ce repas et cette table sans convives serrait le cœur ; les serviettes étaient encore à leur place, les verres encore odorants de la liqueur brune de madame Amphoux. Seulement la poussière avait décrit d’immenses losanges sur la nappe : cette nappe et ce banquet abandonnés avaient près d’un siècle.
Comme la juridiction de ce brave concierge avait toujours été grande et son intelligence très précieuse à ses maîtres, ils s’en reposaient sur lui de la conservation de leurs domaines qu’ils fuyaient, disaient-ils, en raison des marécages, ils l’avaient conservé dans ses chartes et privilèges. Bourguignon pouvait donc revivre sans nulle crainte au milieu de son époque, soigner sa poussière et ses souvenirs à lui ; il pouvait, encore en idée, mettre au château le couvert de M. de Vergennes, le ministre, ou faire pêcher des tanches dans le grand étang pour l’arrivée de M. de Malesherbes. Les nouveaux maîtres venaient à peine chasser une fois l’an dans ce château.
L’autre été, cependant, M. Gustave y avait passé trois semaines, l’époque des élections ; M. Gustave voulait que son oncle fut député… aussi, Monsieur, vais-je vous montrer sa chambre, car je lui avais donné la chambre d’honneur, disait Bourguignon, la chambre d’honneur, et il faut que ce soit vous pour que je vous la montre après lui, ajouta mon cicerone en remuant les clés de son trousseau.
Hélas ! depuis un quart d’heure, je n’écoutais plus ce digne homme. Ces beaux lieux, si vides et si tranquilles, m’absorbaient ! Ne vous semble-t-il pas qu’un château sans maître est un roi sans courtisans ? Adieu la vie et le mouvement de ses grandes salles ; adieu le soleil qui dore au matin ses fenêtres et les rayons de son lustre émaillant au soir à la lune son grand bassin ! Encore une fois adieu le chant matinal de ses horloges, ses joies et ses trépignements de chasse ; adieu la meute, le cor et les salves d’artillerie champêtre du jardinier ! Monseigneur le comte Almaviva est parti, il s’en est allé emmenant tout, la comtesse, Suzanne, et le petit page lui-même ; il ne reste ici que Grippe-Soleil et Bazile, lequel est au village pour conserver les traditions du lutrin ! Almaviva, l’ingrat seigneur, a passé sans une larme sous sa grande allée des marronniers ; il allait jouer à la Bourse, gagner sur les Naples et faire un agioteur de Figaro !
Pourquoi donc ceux-ci, me disais-je, habiteraient-ils leur domaine ? À quoi bon ces propriétés royales, si c’est ici que viendront loger les idées mesquines, l’avarice et l’ambition bourgeoise ? Est-ce encore le temps des folies folles ; et notre siècle d’industrie n’a-t-il pas inventé la Jolie raison ? On ne s’amuse plus à l’heure qu’il est qu’entre une équerre et un compas. Voilà sans doute pourquoi M. le comte se bâtit un hôtel rue Chantereine et a sa loge au Gymnase ; M. le duc ne vient plus ici qu’une fois l’an !
Je marchais ainsi, perdu tellement dans mes pensées, que je ne remarquais pas Bourguignon debout et presque essoufflé sur le seuil d’une nouvelle pièce… Grâce à lui et à la poussière qui survint, je m’aperçus que je me trouvais enfin dans cette chambre par laquelle il avait voulu finir ses fonctions de cicerone.
– Pardieu, m’écriai-je, voilà du gothique au moins !
Pour comprendre cette exclamation, il faut être au fait de ce que je n’avais pas pris soin moi-même de constater, distrait et ami du monologue comme je l’étais, en suivant le digne concierge, à savoir que cette partie de l’édifice dans laquelle il venait de me conduire constituait l’un des pavillons de l’avant-cour ; pavillon qui, pour garder comme l’autre au dehors la forme carrée, n’en avait pas moins, à l’intérieur, celle d’un véritable donjon. La dernière marche de l’escalier à vis que je quittais en était la preuve.
Cela me parut une grande bizarrerie. Ce caprice irrégulier d’architecture au sein de cette régularité si méthodique ! Car le château était à coup sûr des plus Louis XIV ; il n’y avait pas jusqu’à sa grille, je vous l’ai dit, qui ne témoignât de cette authenticité.
L’intérieur de ce pavillon, au contraire, rappelait par sa solidité ces donjons robustes du quatorzième siècle dont l’on peut voir encore des vestiges dans notre Bretagne, illustres ruines où chaque pierre sue le nom d’Olivier Clisson ou de Jean Chandos !…
Pour un antiquaire, ami des dates et des hypothèses scientifiques, un bibliophile comme notre ami Jacob, rien ne s’opposait à ce qu’un Tanneguy ou un Duguesclin picard y eussent pris en 1540 leur collation. Cette chambre, à laquelle Bourguignon conservait le titre somptueux de Chambre-d’Honneur, avait au milieu de son parquet carrelé, un lit à quenouilles d’or surmonté de mauvaises draperies rouges, espèce de tapisseries à damas, comme les portières de Gênes. Ce lit et un grand bureau de cuir noir formaient les seuls meubles de ce vieil appartement. J’oubliais encore un large coffre posé comme un marchepied à ce lit sombre…
Ce fut peut-être la triste impression de cette salle qui rembrunit tout à coup la physionomie de Bourguignon, car il avait l’air de se repentir, tout en m’y faisant entrer. Le jour terne et gris n’éclairait cette chambre ronde que par une seule fenêtre ; la fenêtre donnait sur un fossé très profond. En vérité, je m’étonnais fort que cette chambre put s’être nommée dans le temps Chambre-d’Honneur. Elle était sévère et triste. Bourguignon me fit voir, en poussant du pied le large coffre, entre les jointures même du parquet, un cercle assez large ressemblant à celui d’une oubliette… Il marmottait tout bas des mots inintelligibles pour moi.
En même temps, et comme je soulevais en curieux le couvercle du coffre, je trouvai dans ce coffre vide un gros livret recouvert en papier gris, livret à peine cousu, taché d’huile et de notes marginales à l’encre rouge et qui avait pour titre :
Les Chaînes de l’Esclavage, par Jean-Paul Marat.
À Paris, de l’imprimerie de Marat, rue des Cordeliers, vis-à-vis celle Hautefeuille.
– Ne touchez pas à ceci, Monsieur, cria subitement Bourguignon, en m’entendant lire ce titre à voix basse : c’est ce livre-là qui a fait saisir M. le duc !
Bourguignon ajouta avec un effort pénible :
– Et c’est moi !…
Puis sans parole, il tomba évanoui…
À la suite de cet incident, ma première pensée fut que je m’étais mépris sur ce vieillard. J’ai cru, me dis-je, voir un concierge ordinaire dans cet homme à parole brève, vieux simulacre d’intendant cassé et parleur comme tous les autres, et maintenant voilà qu’il se fait acteur dans ce drame, voilà qu’il gémit amèrement et de bonne foi, comme si les malheurs de ce château et la mort même de son maître étaient son ouvrage ! Non, ce brave homme n’a pas joué la comédie devant moi ; ce n’est pas pour me tromper qu’il a pâli, et pour m’intéresser qu’il vient de tomber en défaillance… Ce pauvre vieillard chauve et délaissé, l’unique propriétaire du château, à l’heure qu’il est, se sera heurté le front à quelque souvenir, à quelque hasard, je le crains ; oui, ne fût-ce qu’à ce livre oublié qui, je touchais !
Ces réflexions seules m’auraient conduit à un examen plus sérieux de Bourguignon, si la convalescence, qui suivit cette espèce de crise arrivée sous mes yeux mêmes à ce vieillard maladif, ne m’eût pleinement dédommagé de mes soins en m’instruisant de mille détails curieux pendant ses heures de souffrance. Transporté dans la logette du garde, à l’autre extrémité du parc, et comme plus à l’aise loin de ce triste château, le digne homme se montrait à moi sous un aspect nouveau d’intérêt et de récifs. Avec une figure sereine et calme comme celle d’un patriarche, il semblait porter le poids d’un crime dont il était innocent…
Ce fut là enfin, et quelques semaines avant sa mort, qu’il me raconta en partie l’histoire suivante que je mis en ordre quatre ans après sur les débris de ce domaine vendu.
Dès le mois d’août 1789, le duc de C… manifesta l’intention de revoir le château. Le duc revenait alors d’Angleterre et en avait écrit secrètement à Bourguignon. Si vive que fût déjà la tourmente révolutionnaire, le duc, au lieu de fuir et d’émigrer, revint en Picardie accompagné de sa fille qui avait alors seize ans. Les communes environnantes présentaient, à cette époque même, l’image d’un territoire conquis et opprimé. Des clubs et des comités de surveillance s’y trouvaient organisés, et les passeports exigés par les clubistes qui singeaient en véritables énergumènes leurs confrères de Paris. Des placards injurieux contre les nobles se trouvaient affichés ou glissés sous le treillage même des annonces de mariage dans les églises. Le petit village d’Hei…y n’avait pas été préservé de la contagion. Le comte put fort bien lire sur les murs de la mairie l’annonce de l’horrible conspiration découverte en 1768, avec celle des papiers de la Bastille, papiers fameux dont le journal de Prudhomme entretint si prolixement ses lecteurs, lise publiait aussi dans les provinces et par anticipation de la guillotine des livres du libraire Garnery : livres semblables à l’échantillon qui suit : Liste des ci-devant nobles, nobles de race, robins, financiers, intrigants et autres aspirants à la noblesse ou escrocs d’icelle, avec des notes secrètes sur leurs familles, etc.
Harcelée d’ailleurs par Fréron, l’assemblée législative était journellement décriée aux yeux du peuple ; les aboyeurs se l’enlevaient toute par morceaux. Pour un esprit curieux de prévisions politiques, la France ne pouvait lutter, et l’insurrection, depuis longtemps assoupie, devait grandir. Comme à toutes les époques malheureuses de l’histoire, les avertissements les plus sinistres ne manquèrent pas à celle-ci ; cependant elle fut aveugle, l’époque d’alors, aveugle par son impuissance à croire au mal, belle et sereine époque dont les cheveux blanchirent avant l’âge, toute réalisée dans la tête auguste et sanglante de la princesse de Lamballe !
Avant d’en venir aux craintes, la noblesse de France douta longtemps ; elle se réfugiait dans son passé comme pour en obtenir une défense. Rien qu’à voir les vieilles tourelles de son sol, elle se croyait imprenable. Comment déchaîner contre son écu sa vaste population de vassaux et de villageois ? Comment la traîner presque à la barre de ses bienfaits ? Car elle avait défriché ce sol et arrosé ces provinces ; elle avait habillé son peuple à elle et baptisé ses enfants ; elle était forte comme un grand fleuve épanché qui, sans être océan, peut remuer des navires. Il ne lui manquait ni amour ni douce popularité ; c’était encore le temps des chapeaux ôtés devant son seigneur, et des flambeaux de résine allumés joyeusement pour sa venue. Voltaire lui-même, M. de Voltaire, le gentilhomme, chambellan titré du roi de Prusse, s’était bien gardé de l’attaquer, cette noblesse ! Il avait eu son couvert mis à toutes ses fêtes, ainsi que le peuple ; il l’avait vue, cette noblesse se faire bourgeoise sous Louis XV, de guindée qu’elle était sous Louis XIV ! La noblesse de France était devenue à la lettre le contrepied de M. Jourdain. Ennuyée de sa broderie de gentilhomme, elle en était venue à paraître en robe de chambre, affable et paisible sur la fin de ce règne du plus paisible et du plus bourgeois des princes. Ce lui fut donc une cruelle chose à prévoir que ces représailles et cette issue ; elle dut détourner d’abord la tête à ces présages pour ne point accuser la nation d’ingratitude ! Triste noblesse, qui ne croyait pas à ce mot !
Ce qui ne doit pas sembler moins étrange, c’est que la pensée du duc put aller, dès cet instant même, au-delà de ces prévisions ordinaires. Confiant jusqu’à l’imprudence pour lui, le duc de C…, rejeton courbé d’une vieille tige, était devenu défiant pour sa fille unique ; seulement il ne lui faisait part d’aucune de ses craintes. Il la rassurait au contraire et l’encourageait à la gaité. Heureux sans doute de racheter par cet amour les dissipations étourdies de sa jeunesse, il avait concentré dans cet enfant son avenir et ses joies. Dans un âge où les premiers et les plus simples progrès sont à peine sensibles, Eugénie, sans autre maître que son père, avait devancé déjà les éducations de couvent les plus brillantes ; elle savait l’anglais, l’italien et chantait Campra et Gluck à livre ouvert ; elle brodait les fleurs presque aussi bien que Boufflers ou un colonel de Poinsinet. C’était une belle jeune fille, blonde et presque blanche avec fadeur, de cette blancheur pâle et transparente qui caractérise les molles statues de Rysbrak. En la regardant parfois dans ce grand salon, occupée et recueillie en ses études, le duc essuyait une larme furtive, comme si la fleur de cette jeunesse dut souffrir ; comme si quelque jour les embrassements paternels dussent manquer à cette tête chérie ! Il arrive souvent que la jeunesse la plus dissipée et la plus folle devient la plus douce et la plus indulgente des vieillesses. Les moindres caprices d’Eugénie étaient respectés par son père ; pour un des oiseaux égarés de sa volière il eût couru tout le parc ! Il ne lui parlait jamais mariage ni mari. Cependant et devant les orages désastreux qui s’amoncelaient, on concevait aisément l’anxiété qui venait saisir son âme. Il se voyait presque à la veille de fuir et de laisser Eugénie aux soins d’une vieille tante paralytique. À moins, se disait-il, que je ne la confie à Bourguignon ! Mais il repoussait ces idées, il les évitait et s’encourageait lui-même ; il était trop père pour délaisser son enfant !
Cependant son voyage récent en Angleterre avait eu son but caché. En effet, ce n’était guère pour observer de près l’exemple tant de fois invoqué de cette constitution anglaise, constitution qui trouvait partout des commentateurs et des apôtres de tribune, que le duc avait traversé le détroit. Des amitiés de famille et des souvenirs d’enfance l’unissaient étroitement à sir Erkston, intendant en chef de la maison du prince de Galles. Sir Erkston, dont la fortune était médiocre d’ailleurs, n’avait qu’un fils assez jeune, Williams Erkston, qu’il destinait au barreau. Eugénie et le duc avaient passé quinze jours dans cette famille paisible et simple comme une famille de la Bible. Le puritanisme de manières, imposé au jeune homme, seul trésor de cette famille, faisait peut-être encore mieux ressortir la charmante jeunesse de sa figure. Williams Erkston pouvait avoir dix-neuf ans.
Le motif du duc, en visitant de nouveau sir Erkston et en faisant appela ses souvenirs, avait-il été de se ménager une retraite en Angleterre ? son retour démentait cette opinion. Était-ce un mariage projeté entre les deux familles ? mais la fortune du jeune Williams était bien précaire ; son père d’ailleurs était déjà soupçonné de se livrer à des spéculations d’agiotage au moins dangereuses. Le duc seul avait donc à lui le secret de ce voyage entrepris avec Eugénie.
De retour au château, il s’entretenait souvent avec elle de l’hospitalité toute cordiale des Erkston. On doit penser aussi que ce n’était peut-être pas sans intention qu’il l’entretenait parfois de sir Williams ; car, à ce nom, elle quittait vite ses pinceaux et s’empressait de parler de Cambridge où le pauvre jeune homme, disait-elle en riant, devait s’enrouer comme avocat.
– Et le voyez-vous, mon père, s’écriait la folle enfant, avec sa figure longue, sa houppe et sa simarre noire ?…
Cependant avait sonné. Cet intérieur de château triste et resserré, défendu jusque-là par sa solitude et les respects du village, allait peut-être se voir bientôt envahi. Les gazettes du soir, envoyées au duc par des amis surs, glaçaient d’effroi la tante d’Eugénie. Le comité de salut public pourprait enfin l’horizon, comme un sanglant coucher de soleil, après les massacres et les assassinats de septembre. Nos années, battues par les Autrichiens, forcées d’évacuer la Belgique, amenaient la terreur au sein de la Convention. En un mot, du sein de cette Convention même s’élançait la fatale déclaration du mot suspect.
Ce mot de sang, une fois créé, faisait comprendre enfin aux plus aveugles la révolution française. Elle s’affermissait comme une lave refroidie, n’avançant plus guère hors de son cercla, bouillonnante encore et retenant ses forces dans son lit. De sanglants pourvoyeurs amenaient au jour le jour sa pâture, à cette Convention : avec ce mot de suspect, les entrailles de la France étaient à jour.
Un soir, et sous l’enveloppe de l’Ami du Peuple, le duc reçut ce billet :
« Vous devez être arrêté le 31. »
C’était le 31 mai, ce mois aux approches duquel Marat venait de signer, comme président du club des Jacobins, une adresse dans laquelle le peuple était invité en termes formels à massacrer tous les traîtres. Marat faisait courir alors une circulaire qui invitait les départements à répéter chez eux, les massacres qui avaient eu lieu dans Paris ; il annonçait aussi aux nombreux comités de surveillance établis dans la province qu’il les visiterait lui-même bientôt, dans un rayon de trente à quarante lieues.
Ce fut peut-être moins l’émotion produite par un tel avis que son empressement à le cacher à sa fille qui amena sur le front du duc, au milieu même du salon, une décomposition presque subite… En vain le billet lui annonçait-il huit jours de répit ; il se voyait déjà livré à un tribunal de sang, il voyait son deuil porté par Eugénie. Cachant dans sa manche le fatal écrit, il regarda sa fille et tomba dans son fauteuil… Transporté bientôt dans sa chambre par Bourguignon, il s’y renferma, disant qu’il voulait écrire et être seul. Dans cette nuit même, nuit où son état parut empirer, on alla par son ordre chercher à la ville deux médecins. Le duc fit ensuite venir Eugénie, l’embrassa et lui parla seul une grande heure.





























