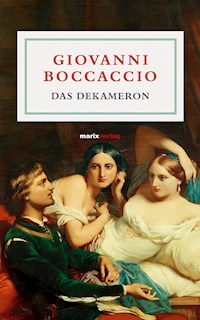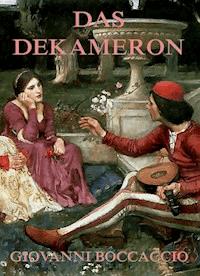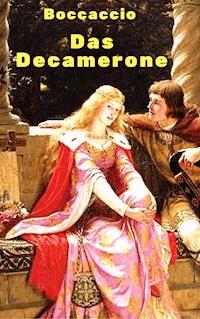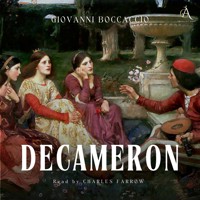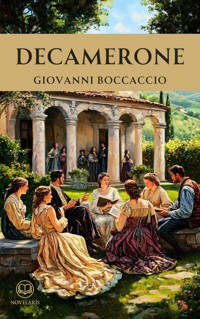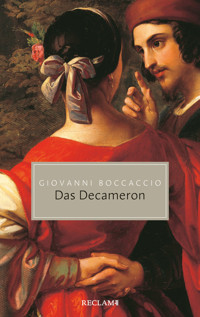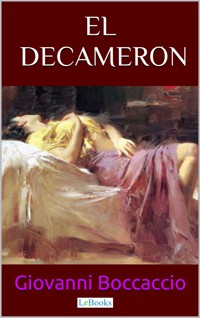Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Le Décaméron, écrit par Giovanni Boccaccio au XIVe siècle, est un chef-d'œuvre de la littérature italienne et l'un des recueils de nouvelles les plus célèbres de tous les temps. Composé de cent nouvelles racontées par dix jeunes gens, ce livre offre un aperçu fascinant de la société médiévale et de la condition humaine.
L'histoire se déroule pendant la terrible épidémie de peste qui a ravagé Florence en 1348. Dix jeunes nobles, sept femmes et trois hommes, se réfugient dans une villa à la campagne pour échapper à la maladie. Pour passer le temps, ils décident de raconter des histoires, chacun d'entre eux devant en raconter une par jour pendant dix jours.
Les récits sont variés et captivants, allant de l'amour courtois aux farces comiques, en passant par les tragédies et les réflexions philosophiques. Les personnages sont vivants et colorés, et les histoires sont empreintes d'humour, de satire sociale et de profondeur psychologique.
Le Décaméron est bien plus qu'un simple recueil de nouvelles divertissantes. Il offre une vision complexe de la nature humaine, explorant les thèmes de l'amour, de la trahison, de la vengeance, de la justice et de la morale. Boccaccio utilise également ces récits pour critiquer les vices de la société de son époque, tout en soulignant les qualités et les valeurs qui font de nous des êtres humains.
Ce livre est un témoignage précieux de la vie et de la culture de l'époque médiévale, mais il reste étonnamment actuel dans sa capacité à captiver et à émouvoir les lecteurs d'aujourd'hui. Le Décaméron est un incontournable de la littérature mondiale, un véritable trésor littéraire qui continue de fasciner les lecteurs depuis des siècles.
Extrait : ""Toutes les fois, ô gracieuses dames, que, pensant en moi-même, je regarde combien vous êtes naturellement pitoyables, autant de fois je connais que la présente oeuvre aura, à votre jugement, fâcheux et ennuyeux commencement, aussi bien comme est douloureuse la souvenance qu'elle porte en son front de la pestilentieuse mortalité dernière, universellement dommageable
à chacun qui la vit ou qui autrement la connut ; mais je ne veux pourtant que ceci vous épouvante..."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 848
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Décaméron est une de ces œuvres impérissables qui rajeunissent avec les siècles au lieu de vieillir, et celle qui porte le plus profondément peut-être l’empreinte de l’époque où elle parut. La joie de revivre y éclate, la grande joie de la Renaissance, quelque chose d’analogue à cette effusion que peint Gœthe au commencement de son Faust, quand tout le monde sort en habit de fête des maisons closes par le deuil de la semaine sainte en s’écriant : « Christ est ressuscité ! » Seulement alors c’était l’homme qui, longtemps emmailloté dans le linceul, levait enfin la pierre du tombeau et fêtait lui-même son retour à la vie. Comme pour donner plus de saveur et de raffinement aux voluptés, Boccace a mis pour frontispice à son livre la peste de Florence, tableaux lugubres de la Mort, sinistre emblème du Moyen Âge en personne, décharné par les macérations, abêti par la scolastique. Le voile de tristesse que la religion répandait sur ce monde pour faire désirer d’en sortir, Boccace le déchire en se jouant ; ce poison glacial qu’elle faisait circuler dans les veines pour abolir toute énergie, toute vitalité, Boccace en trouve dans le rire l’antidote tout puissant. Les hiboux du cloître et de l’école pourront continuer à discuter, dans leurs épaisses ténèbres, l’être, la substance, l’accident, la réalité des universaux, les hypostases et autres quintessences de chimères : Boccace a fait reluire ce clair rayon de soleil qui dissipe les ombres et chasse les cauchemars.
La Renaissance, dès son aurore, s’annonce comme un retour plus ou moins franc, mais très réel et très spontané au paganisme, une revanche de longs siècles d’oppression et d’abrutissement. Tel ne prétend que retrouver les titres perdus de l’humanité, restaurer les lettres grecques et latines qui, sans le vouloir, se refait païen. Remettre en honneur les langues d’Homère et de Platon, de Cicéron et de Virgile, c’était en effet renouer une chaîne que le Moyen Âge croyait avoir brisée pour jamais, rendre l’essor à la pensée et faire rentrer dans le néant les sciences fausses et stériles. Dérouler le tableau des civilisations et des arts de l’antiquité, c’était poser les termes d’une comparaison bien périlleuse et montrer au grand jour l’effroyable abaissement, l’ennui mortel où le catholicisme avait plongé le monde. Les Vertus théologales faisaient maigre figure à côté des trois Grâces, et il suffisait de songer aux Dieux de l’Olympe, à ces Dieux toujours jeunes, souriants et robustes, ardentes personnifications des phénomènes naturels, des forces génératrices et des joies de la vie, immuablement assis dans leur sérénité lumineuse, pour faire prendre en dégoût ce culte de l’agonie et de la souffrance, qui étale partout l’image lamentable d’un Dieu supplicié. Qu’est-ce en effet que le catholicisme du Moyen Âge, sinon l’abolition de la vie, la religion du sépulcre ? L’homme est fait pour être mangé des vers ; il n’a pas été créé pour agir, mais pour prier. Arrière donc la science, l’étude ; arrière la famille, la patrie, toutes les grandes et nobles affections humaines : ce sont autant de faces du diable, qui en peut prendre des milliers. L’homme ne doit penser qu’à une seule chose, à son salut ; se demander perpétuellement, jour et nuit, serai-je damné ? s’absorber dans l’espoir des joies paradisiaques réservées aux élus ou dans la crainte de l’enfer qui l’attend, s’il trébuche. Agir, inventer, chercher le progrès, le bien-être, développer sa volonté et son énergie, se laisser prendre au piège de l’ambition, de l’amour, de la poésie, de l’art, c’est folie ; il n’y a de vrai que le tombeau et, par derrière, la vie éternelle. Quelle violente envie de rompre ce réseau de momeries lugubres et de pratiques asservissantes devait tourmenter ceux qui se sentaient faits pour vivre, pour penser et pour agir ! Comme ils devaient aspirer à se voir délivrés d’une religion qui, sous prétexte de mater la chair, privait l’homme de tout ce qui peut le charmer, l’épouvantait, le terrifiait pour le rendre plus docile et le forçait d’user son intelligence à résoudre des questions ineptes ou insolubles ! Combien durent être de cœur avec ce Grec enthousiaste qui s’écriait : « Cela ne peut pas durer ; revenons-en aux dieux d’Homère ! »
Boccace est un païen par l’ardeur sensuelle, par le culte de la grâce, de la beauté, surtout par le mépris de la mort et de ses terreurs, si chères à l’Église dont elles remplissent l’escarcelle. Pendant que la peste ravage Florence, que le glas sonne, conviant à la prière, invitant à se couvrir du sac de cendre, il rassemble ses jeunes femmes et ses galants cavaliers dans une délicieuse villa qui rappelle les frais ombrages de Tibur, et il leur fait mettre en pratique le carpe diem des poètes épicuriens. Si la Mort arrive, elle les surprendra le sourire aux lèvres et se passant la couronne de fleurs qui chaque jour désigne le roi ou la reine du festin. Ce qui, pour un autre conteur, n’aurait été qu’un cadre ingénieux devient ici l’œuvre même et lui donne un sens. Dans ce cadre, Boccace a déroulé en cent histoires puisées un peu partout, mais rajeunies avec un art suprême, la vaste épopée héroïque, galante, libertine, tragique ou railleuse que chantent les passions dans le cœur de l’homme ; la haine, la jalousie, la vengeance et surtout l’amour, qui les inspire toutes. Paladins des anciens âges que l’on croirait détachés du Cycle d’Artus et de la Table-Ronde, tyrans farouches taillés sur le patron des Ugolin et des Ezzelino, maris débonnaires ou féroces, amants audacieux et entreprenants, gros marchands pleins d’astuce ou de bêtise, prêtres hypocrites, moines enragés de hâblerie ou de luxure, Boccace nous présente l’homme sous toutes ses faces ; comme peintre de femmes, il est sans rival. Quelle gracieuse galerie de filles d’Ève, avant ou après la pomme ! La Laure de Pétrarque, la Béatrix de Dante sont des êtres vaporeux, insaisissables ; les autres idéales figures qui traversent l’épopée du sombre Florentin, la tragique Francesca de Rimini, avec sa plaie au flanc, parcourant l’espace enlacée à son Paolo, la languissante Pia de Tolomei, fleur fanée dans l’air étouffant des Maremmes, sont des ombres plutôt que des femmes. Celles de Boccace ont plus de corps : elles ont même un corps assez épais, ces grosses et grasses matrones sur lesquelles s’assouvit sans vergogne l’appétit monacal ; ces rusées commères si adroites à passer d’un lit dans un autre, à duper leurs maris, à leur boucher le bon œil, à les occuper dans le cuvier pendant que le galant les cajole ; ces fringantes courtisanes toutes roides dans leurs robes de brocart et d’une impudence intrépide. L’artiste épris de la beauté des formes comme un païen, un Grec du temps de Praxitèle et de Parrhasius, se révèle en caressant d’un libre pinceau des nudités chatoyantes : la douce et charmante Grisélidis, si jolie en costume d’Ève ; la veuve innocente qui, dupée par un facétieux étudiant, s’en va au clair de lune, déshabillée comme une nymphe du Giorgione, guetter sous la feuillée les célestes demoiselles qui doivent lui ramener son amant ; Geneviève et Isola, blondes comme fil d’or, aux cheveux bouclés, entremêlés d’une légère guirlande de pervenche, viennent pêcher dans le vivier, sous les yeux du roi de Sicile, et montrent ingénument sous la chemise de lin leurs charmes naissants ; dans la forêt de Ravenne, une femme court toute nue et rose à travers bois, talonnée par la meute, poursuivie par le féroce veneur qui sonne du cor à pleins poumons. Dante, le fervent et mystique chrétien, eût fait de ce supplice l’expiation de quelque crime ; il eût cinglé de ses tercets, comme d’un fouet à triple lanière, les épaules de l’épouse adultère ou de la maîtresse infidèle ; mais Boccace est un épicurien : la suppliciée n’est coupable que de vertu, elle a osé résister à l’amour ! Peut-être Boccace a-t-il dit son dernier mot sur la femme dans l’histoire de cette séduisante Alaciel, qu’on ne peut voir sans la désirer, qu’on se dispute à coups de couteau, qui passe des bras de celui-ci dans ceux d’un autre, de la cabine des matelots dans le harem d’un pacha, goûte l’amour des vieux et des jeunes, des princes et des voleurs, au milieu de toutes sortes d’enlèvements et d’aventures, puis revient fraîche et souriante à son fiancé, le roi de Garbe, comme si de rien n’était : bouche baisée ne perd pas de son charme, mais se renouvelle, comme fait la lune.
Ces contes, qui ne sont pas tous aussi voluptueux et où la licence ne tient d’ailleurs pas plus de place qu’elle n’en occupait alors dans les mœurs, nous sont précieux encore à un autre titre : ils ont servi de passeport à la libre pensée. Il fallait constamment se tenir en garde contre une théologie ombrageuse, pour qui la pensée était suspecte et qui surveillait d’un œil jaloux tout ce qui pouvait faire échec à ses enseignements. Quand Boccace prit la plume, Cecco d’Ascoli venait d’être brûlé. Les temps n’étaient pas encore mûrs pour la discussion philosophique ; mais s’il est défendu de raisonner, on peut toujours rire, peindre les travers, les ridicules, les mœurs, bonnes ou mauvaises, et le conte, avec ses apparences anodines, son franc parler, ses insouciantes allures, fut la petite fissure, bientôt large brèche ouverte, par où la libre pensée s’échappa d’abord. Depuis longtemps, nos fabliaux, si plaisants, si naïfs, malheureusement écrits dans un idiome informe, destiné à périr, étaient une mine inépuisable de traits satiriques contre le clergé. Boccace leur a emprunté ce bon curé qui, voulant faire l’amour à une commère, laisse en gage sa soutane, et cet autre qui, se flattant de changer en jument la femme d’un de ses paroissiens, n’est arrêté par le bélître qu’au moment où il veut appiccar la coda. À ces histoires édifiantes, il en ajoute bien d’autres : celle du moine qui couche avec une dévote en se faisant passer pour l’ange Gabriel (on croirait lire l’aventure de la Cadière et du père Girard) ; celle de l’abbé qui enferme dans une tombe un mari gênant et lui fait accroire qu’il est en purgatoire, pour l’expiation de ses péchés ; celle du Juif qui se convertit au catholicisme après avoir vu de près, à Rome, la vie des cardinaux et des moines, persuadé qu’une religion qui dure depuis des siècles, avec de tels scélérats pour ministres, doit nécessairement être d’institution divine, etc. Nos vieux Gaulois, tout en vilipendant les mœurs des prêtres, n’osaient guère s’en prendre à leurs fourberies et respectaient les dogmes. Boccace va plus loin : il démontre la parfaite égalité des trois religions issues de la Bible, le judaïsme, le mahométisme, le christianisme, dans sa fable ingénieuse des trois anneaux ; il se moque des superstitions dans l’histoire de Messire Chappelet, ce voleur émérite qui trompe un prêtre par une fausse confession, est canonisé après sa mort, et dont les reliques font tout autant de miracles, dit le conteur, que celles d’un autre saint ; il bafoue les imbéciles à qui un prédicateur exhibe une plume de perroquet comme tombée de l’aile de l’archange dans la chambre de la Vierge, et qui se laissent marquer d’un signe de croix au front avec les charbons retirés sous le gril de saint Laurent ; son impiété va jusqu’à nous montrer la petite Alibech, agenouillée devant l’ermite et assistant à la resurrezione della carne, bien avant qu’aient sonné aux quatre coins du ciel les trompettes du Jugement dernier. Se moquer ainsi des choses saintes et des mystères ! « La liberté philosophique toute seule eût fait brûler l’auteur, dit Villemain, elle prit pour manteau la licence des mœurs ; elle a passé sous cette sauvegarde. »
Le charme des récits avait rendu le Décaméron si populaire en Italie que l’Église n’osa se fâcher : elle ne le prohiba qu’au concile de Trente ; leur hardiesse irrévérente fit sa faveur auprès des protestants. On s’en amusait depuis longtemps en France, à cette cour brillante du héros de Marignan, où tout le monde lisait et parlait l’italien, et surtout dans ce petit cénacle d’esprits indépendants groupés autour de Lefèvre d’Étaples et de Marguerite de Valois, sincèrement religieux au fond, mais qui détestaient les vices et les désordres du clergé catholique, regardaient le monachisme comme un fléau et préludaient à la Réforme en se moquant des superstitions ridicules, des saints équivoques et du culte des reliques. Pour eux, Boccace faisait plaisamment écho à Calvin, l’adversaire impitoyable des prépuces de Jésus-Christ, du vin des Noces de Cana, des patins et des peignes de la Vierge Marie, du bouclier de S. Michel archange, « toutes inventions de néant, forgées pour attraper deniers aux peuples », et les attirait autant par cette conformité avec leurs propres aspirations que par l’art exquis avec lequel il avait transfiguré les naïfs produits de la vieille veine gauloise. Marguerite, dans sa retraite de Nérac, en commanda une traduction française à son secrétaire, Antoine Le Maçon, pour remplacer une ancienne imitation, démodée et hors d’usage, qu’avait publiée Laurens de Premierfaict dès la fin du XIVe siècle. Antoine Le Maçon s’acquitta de sa tâche avec tant de goût et d’exactitude que son travail est devenu en quelque sorte définitif : Sabatier de Castres s’est borné à le retoucher prétentieusement, tout en donnant sa traduction comme nouvelle. Mieux vaut laisser dans son intégrité, avec ses tournures naïves, ses périodes quelquefois embarrassées et ses expressions archaïques mais pleines de saveur, cette langue du XVIe siècle, en comparaison de laquelle la nôtre, plus châtiée et plus régulière, semble fade.
Boccace a dédié son œuvre « aux pauvres dames qui, retirées de leurs volontés et plaisirs, par le vouloir des pères, des mères, des frères et des maris, la plupart du temps demeurent enfermées dans le petit circuit de leurs chambres » ; il pensait surtout à celles qui aiment, car il ne faut aux autres, ajoute-t-il, que l’aiguille, le fuseau et le rouet. Quoique aujourd’hui les femmes soient moins strictement recluses qu’au temps où la reine Berthe filait, elles se délectent encore aux romans d’amour, à l’exception de celles qui font « les dédaigneuses et les sucrées », et c’est à elles que l’on songe tout naturellement en réimprimant le Décaméron. Aussi a-t-il semblé superflu de l’accompagner de notes historiques ou philologiques : l’érudition alourdirait ces pages légères. Rappelons-nous que Léonard de Vinci en faisait écouter la lecture à Monna Lisa, pour amener sur ses lèvres ce sourire ambigu qu’il a pour jamais fixé dans sa Joconde.
ALCIDE BONNEAU.
(Édition Liseux, 1879.)
CI COMMENCE LE LIVRE NOMMÉ DÉCAMÉRON
et surnommé prince Galliot, auquel sont contenues cent nouvelles racontées en dix journées par sept dames et trois honnêtes jeunes hommes.
C’est chose humaine d’avoir compassion des affligés : et encore qu’à chacune personne il soit bien séant, ceux-là mêmement y ont plus d’obligation qui, autrefois, ont eu besoin de confort, et l’ont trouvé en aucuns. Entre lesquels si jamais personne en eut affaire, et qu’il l’ait eu pour agréable, ou bien qu’il en ait reçu contentement, je suis l’un de ceux-là. Pour ce que, dès ma première jeunesse jusqu’à présent, je fus outre mesure embrasé d’un amour que je mis en lieu haut et noble, trop plus par aventure que, à ma basse condition me semblerait, en le disant, appartenir, combien que j’en fusse loué et beaucoup plus estimé de ceux qui étaient discrets, et à la connaissance desquels ceci parvint. Néanmoins elle me fut fort pénible à supporter, non, certes, pour la cruauté de la dame que j’aimais, mais pour la trop abondante ardeur conçue d’un appétit peu réglé en mon entendement, laquelle me faisait souventes fois sentir plus d’ennui et de peine que besoin ne m’eut été, parce qu’elle ne me laissait demeurer content en aucun convenable état. Auquel ennui les plaisants devis et louables consolations d’un mien ami me donnèrent tant d’allégement que j’ai ferme opinion par celles-là être échappé que je ne sois mort : mais comme il plut à celui lequel, étant éternel, a voulu par loi immuable mettre fin à toutes choses mondaines, mon amour par-dessus tout autre fervent, et lequel nulle force de délibération, de conseil, de honte évidente ou de péril qui s’en fut su ensuivre, n’avait jamais pu ni rompre, ni ployer, se diminua de soi-même par succession de temps, de sorte que seulement il m’a laissé de soi en l’entendement ce plaisir qu’il a accoutumé de donner à ceux qui ne nagent trop avant en ses plus profonds abîmes. Par quoi, là où il était coutume d’être pénible et fâcheux, maintenant, ayant chassé tout travail arrière, je sens qu’il est demeuré très plaisant. Mais combien que la peine soit cessée, pour cela ne s’en est fui le souvenir des plaisirs récents, et qui m’ont été faits par ceux qui, par la bienveillance qu’ils me portaient, étaient déplaisants de mes travaux, et ne les oublierai jamais, comme je crois, sinon par mort. Et pour ce que la reconnaissance des bienfaits et plaisirs est, comme il me semble, entre les autres vertus grandement à louer, et pareillement le contraire à blâmer : pour non sembler ingrat j’ai en moi-même délibéré, maintenant que je me puis dire en liberté, de vouloir en ce peu que je pourrai, pour échange de ce que j’ai reçu, donner aucun allégement, je ne dis pas à ceux qui m’aidèrent, parce que par aventure, par leur bon sens ou par leur bonheur ils n’en sont en aucune nécessité, mais bien à ceux qui en ont besoin. Et combien que mon confort puisse être et soit assez peu de chose aux nécessiteux, néanmoins il me semble le devoir plutôt donner là où le besoin apparaît plus grand ; tant pour ce qu’il y profitera plus, comme pour ce qu’il y sera trouvé meilleur. Et qui sera celui qui voudra nier qu’il ne soit trop plus convenable donner confort aux pauvres dames qu’aux hommes ? Elles, comme honteuses et timides, tiennent le plus souvent dedans leurs cœurs délicats les amoureuses flammes cachées, lesquelles combien plus de force elles aient que les manifestes, ceux le savent qui l’ont éprouvé. En outre ceci, retirées de leurs volontés et plaisirs par le vouloir des pères, des mères, des frères et des maris, la plupart du temps demeurent enfermées dans le petit circuit de leurs chambres : là où, quasi contraintes comme oisives de demeurer assises, voulant tantôt une chose et tantôt non, forgent en une même heure en elles-mêmes diverses pensées : lesquelles il n’est possible qu’elles soient toujours plaisantes. Et si à l’occasion de celles-ci survient en leur entendement aucune mélancolie mue d’amoureux désir, il faut qu’avec peine et fâcherie grande elles y demeurent, si par fortune avec nouveaux et plaisants devis elles n’en sont ôtées. Davantage il faut confesser qu’elles sont moins fortes que les hommes à soutenir les ennuis : ce que pas n’advient ainsi des hommes qui aiment, comme nous pouvons voir clairement : car s’ils ont aucune mélancolie ou qu’ils soient chargés et travaillés de diverses pensées, ils ont mille moyens de les alléger ou de les oublier. Pour ce que, quand ils veulent, ils ne sont en telle nécessité qu’ils ne puissent aller et venir çà et là, ouïr et voir beaucoup de choses, voler, chasser, pêcher, aller à cheval, jouer ou marchander : chacun desquels moyens a force de retirer du tout ou en partie l’entendement à soi, et de l’ôter de la pensée ennuyeuse, au moins par quelque espace de temps ; après lequel, par un moyen ou par un autre, la consolation survient, ou bien l’ennui se diminue. Afin donc que par moi le péché de la fortune soit en partie amendé, laquelle, où moins y avait de force, comme nous voyons dans les pauvres dames, là plus elle a été chiche d’aide et support, je veux et entends, pour le secours de celles qui aiment, car il ne faut aux autres que l’aiguille, le fuseau et le rouet, raconter cent nouvelles, ou fables, ou paraboles, ou histoires, comme nous les voudrons baptiser, récitées en dix journées, par une honnête assemblée de sept dames et trois honnêtes jeunes gentilshommes, durant le temps pestilentiel de la dernière mortalité, ensemble aucunes chansonnettes desdites dames chantées à leur plaisir. Dans lesquelles plaisantes nouvelles on verra plusieurs étranges cas d’amour et autres aventures advenues, tant de notre temps qu’anciennement ; desquelles les dames qui les liront pourront prendre, des plaisantes choses en celles-là montrées, plaisir et profitable conseil : d’autant qu’elles pourront connaître ce qui est à éviter et ce qui est à suivre. Ce que si ainsi advient, que Dieu veuille, en rendons grâces à Amour, lequel, en me délivrant de ses liens, m’a octroyé le pouvoir de tâcher d’employer le temps à chose qui leur soit agréable.
Ci commence la première journée du Décaméron en laquelle (après démonstration faite par l’auteur, pour quelle occasion il advint que les personnes dont on aura ci parlé se dussent assembler pour conter les nouvelles), on devise, sous le gouvernement de Mme Pampinée, de ce qui vient le plus à l’idée de chacun.
Toutes les fois, ô gracieuses dames, que, pensant en moi-même, je regarde combien vous êtes naturellement pitoyables, autant de fois je connais que la présente œuvre aura, à votre jugement, fâcheux et ennuyeux commencement, aussi bien comme est douloureuse la souvenance qu’elle porte en son front de la pestilentieuse mortalité dernière, universellement dommageable à chacun qui la vit ou qui autrement la connut ; mais je ne veux pourtant que ceci vous épouvante d’en lire plus avant, comme si quasi on ne la devait voir, sinon avec soupirs et larmes, mais veux et désire que cet horrible commencement ne vous soit autre chose qu’est une montagne haute et droite à ceux qui font longs voyages à pied, après laquelle on voit assise une belle et plaisante plaine, laquelle vient de tant plus à plaisir, comme la peine du monter et descendre a été plus grande ; car tout ainsi que le plaisir prend fin par la douleur, pareillement les ennuis prennent fin par une joie survenante.
Après cette brève fâcherie, brève dis-je d’autant qu’elle est contenue en peu d’écrit, suit incontinent la douceur et le plaisir que je vous ai ci-devant promis, lequel par aventure on n’espérait d’un tel commencement, si je ne le vous promettais. Et en vérité si j’eusse pu honnêtement vous mener là où je désire, par autre part que par un si rude sentier comme est celui-ci, je l’eusse volontiers fait ; mais parce que sans cette narration ne se pouvait démontrer quelle fut l’occasion pourquoi les choses qu’on lira ci-après advinrent, je me mets, quasi contraint par nécessité, à les écrire.
Je dis donc que nous étions déjà parvenus à l’an de la salutaire incarnation de Jésus-Christ mille trois cent quarante-huit, quand la pestifère mortalité parvint en l’excellente cité de Florence, belle par-dessus toute autre d’Italie, laquelle peste, par opération des corps supérieurs, ou bien pour nos iniquités, fut envoyée sur les mortels par la juste colère de Dieu ; et aucune autre auparavant prit son commencement dans les parties d’Orient, lesquelles elle priva d’une quantité innombrable de vivants, puis sans s’arrêter s’étendit d’un lieu en autre, continuant vers l’Occident misérablement jusqu’en ladite cité. Et là, n’y servant aucun sens ou providence humaine, par lesquels la ville fût de plusieurs immondices nettoyée par les officiers à ces ordonnés, ni pareillement avoir défendu l’entrée à chaque malade, et plusieurs autres conseils et délibérations faites pour la conservation de la santé, ni encore les humbles supplications faites à Dieu par les dévotes personnes, non seulement une fois, mais plusieurs en processions ordonnées et en autres manières, environ le commencement de ladite année commença d’une sorte émerveillable à démontrer ses douloureux effets : non pas comme elle avait fait en Orient, là où quiconque saignait du nez montrait signe manifeste de mort inévitable, mais ici au commencement naissaient aux enfants mâles et femelles, ou en l’aine, ou sous les aisselles, certaines enflures, dont aucunes croissaient comme une pomme de moyenne grosseur, les autres comme un œuf, et aucunes plus grosses, et aucunes autres moindres, lesquelles en langage vulgaire on nommait bosses, et en peu de temps desdites deux parties du corps commença ladite bosse mortifère à naître et venir indifféremment par toutes les autres parties d’icelui. Et de ceci après commença la qualité de ladite maladie à se changer en taches noires ou bleues, lesquelles apparaissaient à plusieurs dans les bras, par les cuisses et en chacune autre partie du corps, aux uns grandes et rares, et aux autres menues et épaisses. Et tout ainsi que la bosse avait été au commencement et était encore indice certain de prochaine mort, autant en était à chacun de ceux à qui ces taches venaient, pour la guérison desquelles maladies il semblait que ni conseil de médecin, ni vertu de médecine n’y valussent ou fissent aucun remède, mais plutôt, ou que nature, de malheur, ne le voulût souffrir, ou que l’ignorance des médecins ne connût dont elles procédaient, et par conséquent n’en sût prendre bonne résolution. Outre le nombre desquels savants en l’art, plusieurs tant femmes que hommes, sans jamais avoir eu aucune doctrine de médecine, devinrent médecins : tellement que non seulement peu en guérirent, mais mouraient presque tous dedans le troisième jour après que lesdits signes apparaissaient, les uns plus tôt et les autres plus tard, et le plus souvent sans aucune fièvre ou autre accident. Et fut encore cette peste de plus grande force, parce qu’elle s’attachait par la fréquentation des malades aux personnes saines, ni plus ni moins que fait le feu aux choses sèches ou ointes quand elles sont bien près de lui. Et plus encore eut-elle de violence et malice, car, non seulement le parler ou le fréquenter avec les malades donnait le mal aux sains ou occasion de commune mort, mais encore le toucher aux habillements ou quelque autre chose des malades qu’on maniât, ou qu’on s’en servît, semblait qu’il transportât le mal avec soi à celui qui les touchait. C’est chose admirable à ouïr ce que je veux dire, laquelle si des yeux de plusieurs et des miens n’avait été vue, à grand-peine oserais-je non seulement l’écrire, mais ni aussi le croire, encore que je l’eusse ouï d’homme digne de foi. Je dis que de si grande efficacité fut la qualité de la peste susdite à s’attacher et prendre de l’un à l’autre que, non seulement d’homme à homme, mais fit ceci qui plus est, et que plusieurs fois visiblement on a vu, c’est à savoir que les habillements ou quelque autre chose qui eût été au malade ou mort de telle maladie, étant touchés ou maniés d’une autre bête hors de l’espèce de l’homme, non seulement la contaminaient du mal, mais celle-là qui les touchait en mourait bientôt après. De quoi mes yeux, comme ci-dessus est dit, prirent un jour entre autres telle expérience que, étant jetés en une rue publique les draps déchirés d’un pauvre homme mort de telle maladie, et s’approchant à eux deux pourceaux, lesquels, selon leur coutume, les prirent premièrement avec le groin, et après avec les dents, puis les secouèrent par les joues, tous deux en un instant après, ayant fait un tour ou deux, tombèrent morts par terre sur les draps qu’ils avaient tirés à leur malaventure, comme s’ils eussent pris du venin. Lesquelles choses et autres semblables ou plus grandes engendrèrent diverses peurs et imaginations à ceux qui demeuraient vivants, et presque tous tendaient à une fin assez inhumaine et peu charitable : c’est à savoir d’éviter et de fuir les malades et ce qu’ils avaient touché, et ainsi faisant pensaient chacun acquérir salut à soi-même. Il y en avait aucuns qui considéraient que de vivre sobrement et se garder de toute superfluité pût beaucoup résister à un tel accident. Et s’étant assemblés en une bande vivaient ainsi séparés de toute autre compagnie, s’assemblaient et s’enfermaient aux maisons où il n’y avait aucun malade ; là où pour mieux vivre ils usaient de viandes délicates et vins excellents, et fuyaient toute luxure sans parler à personne qu’entre eux, ni vouloir ouïr parler de dehors de morts ou de malades, et avec instruments et tous les plaisirs qu’ils pouvaient avoir, passaient le temps. Il y en avait d’autres de contraire opinion, lesquels affirmaient qu’il n’y avait médecine plus certaine à si grand mal que de boire beaucoup et se réjouir, chanter à tous propos, aller çà et là et satisfaire à l’appétit de toute chose qu’il pouvait souhaiter, et se rire et moquer de ce qui advenait ; et ainsi comme ils le disaient l’exécutaient jour et nuit, car ils s’en allaient maintenant à une taverne, et tantôt à une autre : vivant sans règle et sans mesure. Et ceci faisaient-ils trop plus souvent dans les maisons d’autrui, pourvu qu’ils y sussent quelque chose qui leur vînt à plaisir et à gré. Ce qu’ils pouvaient facilement faire, parce que chacun, comme si plus il ne devait vivre en ce monde, avait comme soi-même mis à l’abandon tout ce qu’il avait. Au moyen de quoi la plupart des maisons étaient devenues communes, et autant en usait l’étranger, pourvu qu’il y voulût venir, comme eût pu faire le seigneur propre. Si est-ce que avec toute cette bestiale délibération toujours fuyaient-ils tant qu’ils pouvaient les malades, et en telle affliction et misère de notre cité, l’autorité vénérable des lois, tant divines qu’humaines, était quasi détruite à faute de ministres et exécuteurs d’icelles. Lesquels étaient tous ou morts ou malades comme les autres, ou bien demeuraient si seuls et en si grande nécessité de serviteurs et valets qu’ils ne pouvaient faire aucun office : par quoi il était licite à chacun de faire ce qu’il voulait.
Plusieurs autres observaient une moyenne vie entre les deux ci-dessus, ne faisant si grande diète de viande comme les premiers, ni aussi s’abandonnant tant à boire et aux autres dissolutions comme les seconds, mais usaient de toutes choses à suffisance selon leurs appétits, et sans s’enfermer allaient çà et là, en portant à la main, les uns des bouquets de fleurs, les autres herbes odoriférantes et autre diverse manière d’épiceries, les mettant souvent au nez, estimant être chose très bonne avec telles choses conforter le cerveau, comme ainsi fut que l’air ressemblait tout engrossi de la puanteur des corps morts et des maladies, et des médecines. Aucuns autres étaient de plus inhumaine opinion (combien par aventure qu’elle fût la plus sûre), disant qu’il n’y avait meilleure médecine contre la peste ni si bonne que le fuir d’avec eux. Et mus de cet argument, ne se souciant d’aucune chose que d’eux-mêmes, plusieurs et hommes et femmes abandonnèrent la propre cité, leurs propres maisons, leurs lieux et leurs parents et leurs biens, et cherchèrent ceux d’autrui, au moins leurs villages : comme quasi si la colère de Dieu, pour punir l’iniquité des hommes avec cette peste, ne dût opprimer sinon ceux qu’elle trouverait enclos dedans les murs de leur cité, ou bien pensant qu’en icelle il ne dût plus demeurer aucune personne, et que sa dernière fin fût venue. Et combien que ceux-ci avec leurs diverses opinions ne mourussent tous, si est-ce aussi que tous n’échappaient pas ; mais étant devenus malades plusieurs des uns et des autres dessus dits, et ayant donné eux-mêmes partout l’exemple de fuir, lorsqu’ils étaient sains, à ceux qui demeuraient en santé, ils languissaient partout, comme abandonnés. Or laissons à part que l’un des citoyens fuit l’autre, et que quasi aucun voisin n’eût souci de l’autre, ni que les parents peu de fois ou jamais se visitassent, et encore de loin : cette tribulation était entrée dedans le cœur des hommes avec si grand épouvantement que l’un frère abandonnait l’autre, l’oncle le neveu, la sœur le frère, et plusieurs fois la femme le mari. Et qui plus grande chose est et quasi incroyable, les pères et les mères fuyaient de visiter et servir leurs enfants, tout ainsi comme s’ils n’eussent été à eux. Au moyen de quoi il ne demeura autre chose à ceux qui en nombre inestimable d’hommes et femmes devenaient malades que la charité des amis, et de ceux-ci y en eut peu, ou l’avarice des serviteurs, lesquels servaient contraints par gros et déraisonnables salaires, combien que pour tout ceci il s’en trouvait encore bien peu ; et ceux-là étaient hommes et femmes matériels et de gros entendement, qui jamais auparavant n’avaient servi à telles nécessités ; lesquels encore ne servaient d’autre chose que de bailler aux malades quelque chose qu’ils demandaient, ou de regarder quand ils mourraient, et faisant ainsi tels services, le plus souvent eux-mêmes avec leur gain se perdaient, tellement que cette nécessité de se voir ainsi abandonnés des voisins, parents et amis, et d’avoir indigence de serviteurs vint une coutume, non jamais auparavant ouïe, qu’il n’y avait femme tant belle, jeune ou noble fût-elle, qui devenant malade se souciât d’avoir pour son service un homme, fût-il jeune ou autre, et n’avait aucune honte lui montrer toutes les parties de son corps, comme elle eût fait à une femme, si la nécessité de son mal le requérait. Ce qui fut par après, à celles qui guérirent, occasion par aventure de moindre honnêteté. Et outre ceci il s’ensuivit la mort de plusieurs, lesquels fussent échappés si par fortune ils eussent été secourus. Au moyen de quoi, tant pour la faute des remèdes convenables, lesquels les malades ne pouvaient avoir, que par la force de la peste, la multitude de ceux qui de jour et nuit mouraient était si grande que c’était chose épouvantable, non seulement de le voir, mais de l’ouïr dire. Par quoi la nécessité quasi engendra, entre ceux qui demeurèrent vivants, certaines coutumes toutes contraires aux premières dont avaient coutume d’user les habitants de la ville.
La coutume était, comme encore nous voyons qu’elle est, que les femmes parentes et voisines s’assemblaient en la maison du trépassé et là, avec celles qui lui étaient plus proches, pleuraient ; et d’autre part au-devant de ladite maison, avec ses plus prochains parents, s’assemblaient les voisins et beaucoup d’autres citoyens, et selon la qualité du trépassé y venait le clergé, puis était par ses semblables porté sur les épaules avec pompe funèbre de torches et de chants en l’église qu’il avait élue avant sa mort. Lesquelles choses, après que la fureur de la peste commença à croître, toutes ou la plupart d’icelles cessèrent, et survinrent d’autres nouvelles coutumes en leur lieu : parce que non seulement mouraient les gens sans avoir beaucoup de femmes autour de soi, mais il y en avait assez qui passaient de cette vie sans témoins, et peu y en avait de ceux à qui les pitoyables plaintes et les amères larmes fussent données ; mais au lieu de celles-ci, le plus souvent on se riait et gaudissait en compagnie. Laquelle coutume les femmes avaient très bien apprise, ayant presque chassé d’elles la pitié féminine pour leur santé. Et était bien petit le nombre de ceux dont les corps fussent accompagnés à la sépulture de plus de dix ou douze de leurs voisins ; non que ce fussent encore d’honorables citoyens, mais une manière de porteurs de morts venus du menu peuple qui se faisaient appeler fossoyeurs, lesquels faisaient ces services pour de l’argent et chargeaient sur leurs épaules la bière, laquelle avec grande hâte ils portaient le plus souvent, non pas encore en l’église qu’ils avaient élue avant leur mort, mais à la plus prochaine qu’ils trouvaient ; et il n’y avait derrière eux que quatre ou six pauvres prêtres et clergeons avec peu de luminaire, et quelquefois point : lesquels, avec l’aide desdits fossoyeurs, sans se travailler à dire trop long et solennel service, les mettaient en la première fosse qu’ils trouvaient vide. La pitié et misère du menu peuple et encore d’une grande partie de celui de moyen état était trop plus grande à regarder, parce que la plupart avaient espérance de guérir, ou contraints par pauvreté demeuraient en leurs maisons à l’entour de leur voisinage ; et n’était jour qu’il n’en vînt de malades à milliers, lesquels, pour non être servis ni secourus d’aucune chose, mouraient presque tous. Et assez y en avait-il de ceux qui prenaient fin par les rues de jour ou de nuit, et plusieurs autres, encore qu’ils mourussent en leurs maisons, faisaient premièrement savoir à leurs voisins qu’ils étaient morts plus par la puanteur des corps morts et corrompus qu’autrement. Et de ceux-ci et des autres qui mouraient ainsi partout, les voisins généralement observaient une façon de faire, portés à ceci, non moins de la crainte que la puanteur et corruption des morts ne leur fît mal que de la charité qu’ils eussent aux trépassés, qu’eux-mêmes quand ils pouvaient, ou bien avec l’aide d’aucuns porteurs quand ils en pouvaient avoir, tiraient les corps déjà morts de leurs maisons, les mettant devant leurs huis, là où qui y fût voulu aller, même au matin, l’on en eût pu voir sans nombre. Puis après faisaient alors porter force bières, et tels y en eut qui par faute de bières les mettaient sur les tables, et non seulement une fois a-t-on vu qu’une seule bière fut chargée de deux ou trois corps morts, mais on en eût beaucoup compté de celles que la femme, le mari, deux ou trois frères, ou le père ou la mère étaient tous en une bière. Encore plus que souvent est-il advenu que quand deux prêtres avec une croix allaient pour quérir quelque trépassé, vous eussiez vu derrière eux trois ou quatre de ces porteurs avec leurs bières, et là où les prêtres ne pensaient avoir qu’un mort à ensevelir ils en avaient six ou huit et quelquefois davantage, et n’étaient pour tout cela accompagnés d’aucune honorable compagnie, ni de larmes, ni de luminaires, mais était venue la chose à tant qu’on se souciait aussi peu des hommes qui mouraient qu’on se soucierait à cette heure des chèvres. Par quoi assez manifestement apparut que ce que le naturel cours des choses n’avait pu montrer aux sages avec petit et rare dommage, c’est à savoir de supporter patiemment les infortunes et malheurs, la grandeur de ceux-ci l’enseigna non seulement aux sages mais aussi aux simples gens, tellement qu’ils ne se souciaient plus des maux qui leur survenaient.
La terre sacrée ne pouvait suffire à la grande multitude des corps morts qu’on portait en chaque église tous les jours et presque à toute heure, et même voulant donner à chaque mort lieu propre selon l’ancienne coutume : par quoi on fut contraint de faire par les cimetières des églises, après que tout était plein, de grandes fosses où l’on mettait à centaines ceux qu’on apportait, et en icelles rangés un à un comme on met les marchandises dans les navires, on les couvrait d’un bien petit de terre tant que la fosse fût pleine.
Et à cette fin que je ne vais plus rechercher, autour de chacune particularité, les misères passées advenues en notre cité, je dis que courant en celle-ci si malheureux temps comme vous avez ouï, il n’épargna en rien pour cela les villages d’alentour dans lesquels, laissant à part les châteaux fermés qui étaient en leur petitesse semblables à la ville, les laboureurs pauvres et misérables avec leur famille mouraient par les maisons séparées et par les champs sans aucune peine de médecin ou aide de serviteur, et aussi par les chemins et en leurs terres cultivées de jour et de nuit indifféremment, non comme hommes, mais comme bêtes. Pour laquelle chose eux, devenus en leurs coutumes lascifs comme les citoyens, ne se souciaient d’eux ni d’aucunes de leurs affaires : mais tous, comme attendant de jour à autre la mort, s’efforçaient de toute leur puissance non de garder du danger des bêtes les fruits de leurs terres labourables et de leurs travaux passés, mais de consommer plutôt ceux qu’ils trouvaient présents à manger, dont il advint que les bœufs, les ânes, les brebis et les chèvres, les pourceaux, les poules et même les chiens très fidèles à l’homme, chassés hors des propres maisons, s’en allaient comme bon leur semblait par les champs, là où encore les grains étaient à l’abandon sans être non pas recueillis, mais ni seulement coupés. Et plusieurs desdites bêtes comme presque raisonnables, après qu’elles avaient bien repu le jour, s’en retournaient saoules la nuit en leurs maisons sans aucun gouvernement de pasteur. Que se peut-il dire plus, laissant parler des villages et retournant à la ville ? sinon que telle et si grande fut la cruauté du ciel et par aventure en partie celle des hommes qu’entre le mois de mars et celui de juillet prochain en suivant on croit que, tant par la force de la maladie de peste que pour avoir plusieurs malades été mal secourus ou abandonnés à leur besoin par la peur qu’avaient les sains, plus de cent mille créatures moururent dans le circuit des murailles de la cité de Florence, là où avant l’accident advenu on n’eût par aventure jugé qu’il y en eût eu autant. Ô combien de grands palais, combien de belles maisons, combien de nobles habitations pleines auparavant de famille, de seigneurs et de dames vit-on toutes vides sans y demeurer jusqu’au plus petit serviteur ! Ô combien de lignées dignes de mémoire, combien de très grandes hoiries, combien de fameuses richesses vit-on demeurer sans vrai successeur ! combien d’honnêtes hommes, combien de belles femmes, combien de vaillants et gracieux jeunes hommes, lesquels non seulement un autre, mais Galien, Hippocrate et Esculapius, s’ils vivaient, eussent jugés être très sains, a-t-on vu dîner au matin avec leurs parents, compagnons et amis, qui au soir s’en allaient souper en l’autre monde avec leurs prédécesseurs !
Il m’ennuie à moi-même de me rompre la tête à raconter tant de misères : par quoi voulant désormais laisser de celles-ci ce que plus aisément je pourrai, je dis qu’étant en ces termes notre cité vide d’habitants il advint, comme depuis j’ai su de personne digne de foi, qu’en la vénérable église de Sainte-Marie-la-Neuve un mardi matin, n’y étant quasi autre personne, après avoir ouï le divin office en habit de deuil, comme la saison le requérait, se retournèrent sept sages jeunes dames toutes alliées l’une à l’autre ou par amitié ou par voisinage ou par parenté, desquelles la plus âgée ne passait vingt-huit ans, et la plus jeune n’en avait moins de dix-huit, chacune de noble parenté, belles de forme, ornées de bonnes mœurs et de gracieuse honnêteté ; les noms desquelles je pourrais bien dire, si juste occasion ne me le défendait, laquelle est celle-ci : que je ne veux par les choses qui s’ensuivent qu’elles ont récitées, ni par ce qu’on en pourra dire le temps à venir, qu’aucune d’elles en puisse avoir honte, étant les lois de plaisir plus étroites aujourd’hui, pour les occasions dessus déclarées, qu’elles n’étaient alors non seulement à leur âge, mais à beaucoup plus mûr. Ni je ne veux aussi donner matière aux envieux, prompts à médire de toute louable vie, de diminuer en aucun acte l’honnêteté des honnêtes dames avec laides et sottes paroles. Et par ainsi, afin que ce que chacune disait se puisse comprendre sans confusion, je délibère de les nommer par noms convenables en tout ou partie conformes à leurs qualités. Desquelles la première et celle qui était plus âgée nous nommerons Pampinée, la seconde Flammette, la troisième Philomène, la quatrième Émilie, la cinquième Laurette, la sixième Néiphile, et la dernière nous la nommerons, non sans occasion, Élise ; lesquelles, assemblées en un des coins de l’église, non point par délibération faite auparavant, mais par cas fortuit, et étant assises comme en rond, commencèrent, après plusieurs soupirs, ayant cessé de dire leurs patenôtres, à deviser entre elles plusieurs et diverses choses de la qualité du temps. Et un peu après Mme Pampinée commença à parler ainsi :
« Mes chères dames, vous pouvez, comme moi, plusieurs fois avoir ouï dire qu’il ne fait injure à personne qui honnêtement use de son droit. C’est chose naturelle à toute personne qui naît en ce monde d’aider, conserver et défendre sa vie tant qu’il peut : et est ceci tant permis, qu’encore est-il aucune fois advenu que pour garder celle-ci on a tué des hommes sans aucune coulpe, et si les lois permettent ceci, à la sollicitude desquelles gît le bien-vivre de tous les mortels, combien plus fort honnête est-il à nous et à toute autre personne de chercher et prendre, sans offenser autrui, tous les remèdes que nous pouvons pour la conservation de notre vie ? Toutes les fois que je viens à bien regarder notre façon de faire de cette matinée, et encore celle de plusieurs autres passées, et que je pense quels sont nos propos, je comprends, comme vous pareillement pouvez comprendre, que chacune de nous a peur de soi-même ; et ne m’en émerveille point, mais je m’ébahis bien fort, connaissant chacune de nous avoir jugement de femme, que nous ne prenons pour nous quelque remède contre ce que chacune de nous doit craindre par raison. Nous demeurons ici, comme il me semble, non autrement que si nous voulions ou devions porter témoignage de tous les corps morts qui sont portés en sépulture, ou pour écouter si les religieux de céans, dont le nombre est quasi venu à néant, chantent leur office à l’heure qu’ils doivent, ou pour montrer à quiconque vient ici par nos habits la qualité et quantité de nos misères ; et si nous sortons d’ici, nous ne voyons que corps morts, ou transporter les malades çà et là, ou bien nous voyons courir par la ville, avec une fureur déplaisante à voir, ceux que l’autorité des lois publiques avait auparavant bannis de la cité par leurs démérites et méchancetés, en méprisant quasi ces lois, parce qu’ils savent bien que les exécuteurs de celles-ci sont morts ou malades ; ou bien nous voyons encore les plus malheureux bélîtres de notre cité, lesquels engraissés de notre sang se font nommer fossoyeurs, et en moquerie et mépris de nous s’en vont courant à cheval partout, nous reprochant nos pertes et malheurs avec déshonnêtes chansons, tellement que nous n’oyons autre chose sinon : tels et tels sont morts, et tels s’en vont mourir ; et s’il y en avait qui se plaignît, nous n’ouïrions partout que douloureuses plaintes ; et si nous retournons à nos maisons, je ne sais pas s’il arrive à vous autres comme à moi, mais quand je ne trouve, de tout mon ménage, aucune autre personne sinon ma chambrière, j’ai si grand-peur que presque tous les cheveux me dressent sur la tête, et me semble que où que j’aille, ou bien que je demeure, que je vois partout l’esprit et l’ombre de ceux qui sont trépassés, non pas avec les visages que j’ai coutume de leur voir, mais avec un regard horrible qui leur est nouvellement venu, je ne sais d’où. Pour lesquelles choses ici et hors d’ici et en la maison, il me semble que je suis toujours mal ; et de tant plus encore que nulle personne, comme il me semble, qui ait de quoi ou lieu pour se retirer, comme nous avons, n’est demeurée ici sinon nous ; encore me suis-je laissé dire plusieurs fois que, si aucuns sont demeurés, ceux-là, sans faire distinction aucune des choses honnêtes à celles qui ne sont point honnêtes, seulement que l’appétit le désire, et soient-ils seuls ou accompagnés, ou de jour ou de nuit, font les choses qui leur viennent plus à appétit ; et non seulement les séculières personnes, mais encore celles qui sont recluses et enfermées dedans les monastères, rompant les lois d’obéissance et s’étant adonnées aux plaisirs de la chair, sont devenues lascives et dissolues, se faisant accroire que ce qui est convenable aux autres femmes ne leur est malséant, pensant en telle manière échapper.
Et s’il est ainsi comme manifestement il se voit, que faisons-nous ici ? qu’attendons-nous ? que songeons-nous ? pourquoi sommes-nous plus paresseuses à notre salut que tout le demeurant des citoyens ? Nous réputons-nous moins précieuses que toutes les autres ? ou croyons-nous que notre vie soit attachée à notre corps avec plus forte chaîne que celle des autres, et que, par ce, nous ne devions avoir souci d’aucune chose qui ait force de l’offense ? Nous errons : nous sommes trompées. Quelle bestialité est la nôtre si ainsi nous le croyons ! Autant de fois que nous nous voudrons souvenir quels et combien de jeunes hommes et femmes ont été vaincus de cette cruelle peste, nous en verrons argument évident.
Et par ainsi, afin que nous, par être trop scrupuleuses et nonchalantes, ne tombions là dont, quand nous voudrions, nous ne pourrions, par aventure, en aucune manière, nous relever, je jugerais très bien fait, s’il vous en semble ce qu’il m’en semblerait, que nous, ainsi comme nous sommes, au moins si nous voulions faire ce que plusieurs avant nous ont fait et font tous les jours, sortissions de cette ville, et, fuyant comme la mort les des honnêtes exemples d’aucuns autres, nous en allassions honnêtement demeurer en nos maisons aux champs, dont chacune de nous a grande abondance ; et là nous prendrions tout le plaisir et joie que nous pourrions, sans toutefois transgresser en aucun acte les limites de raison.
Là ouït-on chanter les oiselets ; on y voit les petites montagnes et les plaines verdoyer et les champs pleins de blé ondoyer ni plus ni moins que fait la mer ; pareillement on y voit de mille sortes d’arbres et aussi le ciel trop plus ouvertement que nous ne faisons ici, lequel, encore qu’il soit courroucé, non pourtant il ne nous nie point ses beautés trop plus belles à voir que les murailles de notre cité vides de personnes ; et là encore, outre ceci, l’air y est beaucoup plus frais, et généralement il y a trop plus grande abondance de tout ce qui nous est nécessaire en ce temps pour la conservation de notre vie, et moins de fâcherie et ennui qu’ici : car bien que les paysans meurent aussi bien aux champs comme font ici les citoyens, le déplaisir est néanmoins d’autant moindre, comme les maisons et les habitants y sont plus rares qu’en la cité ; et d’autre part, si bien j’y regarde, nous n’abandonnons ici personne, car plutôt nous nous pouvons dire abandonnées, parce que nos maris, parents et amis, ou mourant ou fuyant la mort, nous ont laissées seules en cette si grande affliction, comme si quasi nous ne leur fussions aucune chose. Par quoi nous ne pouvons tomber en aucune répréhension en suivant ce conseil ; là où, si nous ne le suivons, il en peut advenir douleur, ennui et, par aventure, la mort.
Et par ainsi, si bon vous semble, je pense que ce serait bien fait de prendre nos chambrières, avec les choses qui nous sont nécessaires, et nous faire suivre aujourd’hui en ce lieu, demain en cet autre, là prenant tout le plaisir et récréation que nous peut amener cette saison et demeurer en cette sorte tant que nous voyons, si premièrement la mort ne nous surprend, quelle fin nous réserve le Ciel à ceci, et veux bien qu’il vous souvienne qu’il ne nous est moins séant de sortir d’ici honnêtement qu’il est à une grande partie des autres dames d’y demeurer déshonnêtement. »
Les autres dames, après avoir ouï Mme Pampinée, non seulement louèrent son conseil, mais, désirant de le suivre, avaient déjà particulièrement entre elles commencé à aviser le moyen comme si quasi au partir de là elles devaient sur l’heure se mettre en chemin ; toutefois, Mme Philomène, qui était très sage, dit :
« Combien, mesdames, que ce qu’a proposé Mme Pampinée soit très bien dit, il n’est pourtant pas raisonnable d’y courir ainsi comme il semble que nous voulons faire ; souvenez-vous que nous sommes toutes femmes, et n’y a celle de nous si enfant qui ne puisse bien connaître comme, quand nous sommes assemblées ensemble et sans la providence ou conduite de quelque homme, nous nous savons gouverner.
Nous sommes fragiles, fâcheuses, soupçonneuses, pusillanimes et peureuses : pour lesquelles choses je doute fort, si nous ne prenons autre guide que la nôtre, que cette compagnie ne se rompe trop plutôt et avec moins d’honneur pour nous qu’il ne nous serait besoin : et pour ce serait-il bon d’y pourvoir avant que nous commencions. »
Alors Mme Élise dit : « Véritablement les hommes sont les chefs des femmes, et sans leur ordre, peu de fois a-t-on vu aucune chose de nous se pouvoir conduire à louable fin. Mais comment pourrons-nous avoir ces hommes ? Chacune de nous sait bien que la plupart des nôtres sont morts, et les autres qui sont demeurés en vie s’en vont les uns deçà et les autres delà en diverses compagnies, sans ce que nous sachons où, suivant ce que nous cherchons de fuir ; et de prendre des étrangers il ne serait convenable ; par quoi, si nous voulons avoir égard à notre santé, il nous convient trouver moyen d’ordonner si bien notre fait que, en quelque lieu que nous puissions aller pour prendre plaisir et repos, ennui et scandale ne s’ensuivent. »
Cependant qu’entre les dames étaient tels devis, voici entrer en l’église trois jeunes hommes (non pourtant si jeunes que le puîné eût moins de vingt-cinq ans) auxquels la malice du temps, ni la perte d’amis ou de parents, ni peur d’eux-mêmes n’avaient pu non pas éteindre l’amour, mais ni aussi seulement le refroidir ; desquels l’un était appelé Pamphile, le deuxième Philostrate et le dernier Dionéo. Chacun d’eux fort affable et bien conditionné, lesquels allaient cherchant, pour leur plus grande consolation en telle tribulation du temps s’ils pourraient voir leurs amies, qui, par aventure, étaient toutes trois parmi les sept des susdites, combien qu’il y en eût aucune des autres qui étaient parentes d’aucun d’entre eux ; et ne furent plus tôt les dames vues de ceux-ci que eux aussi ne fussent aperçus d’elles. Par quoi Mme Pampinée commença lors à dire en souriant : « Voyez comment la fortune est favorable à nos commencements et nous a mis devant les yeux trois sages et honnêtes jeunes hommes, lesquels volontiers nous seront guides et serviteurs si nous ne les dédaignons à cet office. » Mme Néiphile rougit toute sur l’heure de honte parce que l’une d’entre elles était aimée de l’un de ces trois et dit : « Pour Dieu, madame Pampinée, avisez bien à ce que vous dites. Je connais assez clairement qu’on ne saurait dire autre chose que toute bonté de pièce d’eux et les crois tous très suffisants à trop plus grande chose que n’est celle-ci, et si vois bien qu’ils sont dignes de tenir compagnie non seulement à nous, mais à beaucoup plus belles et précieuses que nous ne sommes ; mais pour ce qu’il est assez manifeste qu’ils portent affection à aucunes qui sont ici, je crains, si nous les menons, qu’il s’ensuive, sans notre coulpe ni la leur, quelque déshonneur ou reproche. » Dit alors Mme Philomène : « Ceci n’importe rien ; pourvu que je vive honnêtement et sans que la conscience me remorde d’aucune chose, parle qui voudra au contraire ; Dieu et la vérité prendront les armes pour moi : fussent-ils déjà en volonté de venir ! car véritablement, comme Mme Pampinée dit, nous pourrions bien dire que la fortune serait favorable à notre voyage. »
Les autres, oyant parler celle-ci en telle manière, non seulement se turent, mais d’un même accord et consentement dirent toutes qu’il serait bon de les appeler et qu’on leur dît leur intention, les priant qu’ils voulussent leur faire compagnie à tel voyage. Par quoi, sans plus de paroles, Pampinée, s’étant levée debout, parce que de l’un d’eux était aucunement parente, s’approcha d’eux qui étaient là debout attentifs à les regarder, et avec visage joyeux les ayant salués, leur déclara leur délibération et les pria de la part de toutes qu’ils se voulussent délibérer avec une volonté pure et fraternelle de leur tenir compagnie. Ceux-ci crurent au commencement qu’on se moquait d’eux, mais quand ils virent que la dame parlait à bon escient, ils répondirent qu’ils étaient de bon cœur tout prêts de ce faire, et sans plus songer, avant qu’ils partissent de là, donnèrent ordre à ce qu’ils avaient à faire sur leur départ ; par quoi ayant fait par bon moyen appareiller tout ce qui leur fut nécessaire et envoyé premièrement là où ils délibéraient aller, le lendemain matin, qui fut mercredi, sur la pointe du jour, lesdites dames, avec aucunes de leurs chambrières, et les trois hommes, avec trois de leurs serviteurs, sortirent de la cité et se mirent en chemin, de laquelle ils ne s’éloignèrent d’une lieue qu’ils n’arrivassent au lieu qu’ils avaient premièrement accordé. Lequel lieu était sur une petite monta guette un peu loin de toutes parts du grand chemin, pleine de divers arbrisseaux et tentes toutes feuillues de vertes branches, plaisantes à regarder, sur la cime de laquelle y avait un palais avec une belle et grande cour au milieu, accompagnée de galeries, salles et chambres toutes et chacune d’icelles à part soi très belles et enrichies de plaisantes peintures à voir ; et les préaux étaient à l’entour, et les jardins beaux à merveille, avec puits de très fraîches eaux ; aussi les caves pleines de vins excellents, choses plus à estimer à curieux buveurs qu’à sobres et honnêtes femmes. Lequel palais ladite compagnie trouva tout nettoyé et bien en ordre, et les lits dedans les chambres faits et dressés. Il était tout semé de fleurs, telles qu’on pouvait avoir en la saison, entremêlées de jonchées, qui ne fut sans grand plaisir de toute la compagnie : laquelle s’étant assise de pleine arrivée, Dionéo, qui par-dessus les autres était plaisant jeune homme et plein de mille bons petits mots, dit : « Votre sens, mesdames, nous a ici mieux guidés que notre prévoyance ; je ne sais ce que vous avez délibéré de faire de vos soucis : quant est des miens, je les ai laissés à la porte de la ville quand j’en suis naguère sorti avec vous ; et par ainsi délibérez-vous de passer le temps à rire et chanter avec moi (j’entends autant qu’à votre dignité s’appartient), ou bien me donnez congé que je retourne quérir mes soucis et que je demeure en notre désolée cité. » À quoi Mme Pampinée répondit en souriant comme si elle avait pareillement chassé les siens : « Dionéo, tu as très bien parlé, il faut vivre joyeusement : aussi n’y a-t-il autre occasion qui nous a fait fuir ici les tristesses de la ville ; mais pour ce que les choses qui sont sans moyen ne peuvent longuement durer, moi qui ai commencé les propos au moyen desquels cette compagnie est assemblée, pensant à la continuation de notre plaisir, il me semble qu’il est de nécessité que nous accordions qu’il en y ait entre nous un qui soit le principal de tous, en qui soit le soin de commander pour nous faire vivre joyeusement, et auquel nous portions honneur et lui obéissions comme au chef, et afin que chacun essaye le faix de la sollicitude et pareillement le plaisir de dominer ; et, par conséquent, que, tiré d’une part et d’autre, nul ne puisse, qui ne l’essaye, avoir aucune envie contre l’autre qui l’aura essayé, je suis d’avis que chacun pour un jour seul aie le faix et l’honneur ; et le premier d’entre nous qui le devra avoir soit à l’élection de nous tous, et quant est de ceux qui devront succéder après celui ou celle qui aura eu ce jour la seigneurie, nommera, quand la nuit s’approchera, celui ou celle qui lui devra succéder. Et ce tel, selon qu’il lui plaira, ordonnera et disposera du temps que sa seigneurie devra durer, du lieu et de la façon en lesquels nous aurons à vivre. »
Ces paroles plurent grandement à un chacun, et tous d’une voix élurent Mme Pampinée pour être reine de la première journée, par quoi Mme Philomène courut incontinent vers un laurier, parce qu’assez de fois elle avait ouï dire de combien d’honneur les branches d’icelui étaient dignes, et combien elles faisaient digne d’honneur celui qui, à bon droit, en était couronné ; et de ce laurier en cueillit aucunes branches dont elle fit un chapeau honorable et apparent qu’elle y mit sur la tête, qui fut, tant que leur compagnie dura, signe manifeste à tout autre de la seigneurie et grandeur royale.
Après que Mme