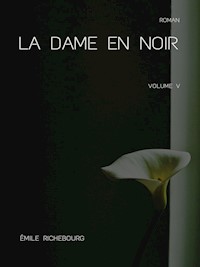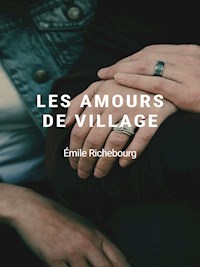Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait: "Un matin du mois d'août 1873, une voiture de place, qui venait de l'intérieur de Paris, s'arrêta à la porte de Vincennes, devant la grille de l'octroi. Deux hommes mirent pied à terre. L'un deux dit au cocher: – Nous avons quelqu'un à voir à Vincennes, vous allez nous attendre ici. Le cocher jeta un regard soupçonneux sur les deux individus et fit une grimace significative."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1154
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un matin du mois d’août 1873, une voiture de place, qui venait de l’intérieur de Paris, s’arrêta à la porte de Vincennes, devant la grille de l’octroi. Deux hommes mirent pied à terre. L’un d’eux dit au cocher :
– Nous avons quelqu’un à voir à Vincennes, vous allez nous attendre ici. Le cocher jeta un regard soupçonneux sur les deux individus et fit une grimace significative.
– C’est que, dit-il en regardant sa montre, il est six heures.
– Eh bien ?
– Il faut que je sois à sept heures rue Montmartre.
– Vous n’y serez pas, voilà tout, répliqua l’homme d’un ton rude. Ces paroles augmentèrent encore la défiance du cocher.
– J’y serai certainement, dit-il. Et sautant à bas de son siège :
– Vous ne m’avez pas pris à l’heure, reprit-il, vous allez me payer ma course tout de suite.
L’homme eut un regard de colère ; mais son compagnon s’empressa d’intervenir.
– Nous n’avons pas de temps à perdre à discuter, dit-il ; les voitures ne sont pas rares, nous en trouverons une autre.
Et il mit dans la main du cocher le prix de sa course.
Celui-ci remonta sur son siège en grommelant, pendant que les deux hommes sortaient de Paris.
Le ciel était sans nuages. Le soleil se montrait au-dessus des plus hautes maisons qui bordent la large avenue pleine déjà du bruit des camions, des voitures de blanchisseuses et de maraîchers revenant des halles.
Les boutiques de marchands de vins étaient ouvertes. Devant les comptoirs d’étain les ouvriers se faisaient servir le canon de vin blanc ou le petit verre d’eau-de-vie avant de se rendre à leur travail. Des femmes, des jeunes filles, portant le panier contenant leur déjeuner, descendaient, vers Paris d’un pas alerte et pressé.
L’air matinal était encore imprégné de l’odeur du bois. Des flots de lumière inondaient la chaussée. Les vitres des fenêtres étincelaient, piquées par les rayons obliques du soleil qui, plus loin, semblait poser une couronne d’or sur la tête du vieux donjon, sombre et énorme masse de pierre, qui n’est plus aujourd’hui qu’un souvenir du passé.
Les deux hommes dont nous venons de parler se dirigeaient rapidement vers l’entrée du bois de Vincennes. Ils marchaient côte à côte sans échanger une parole. Chacun d’eux paraissait avoir ses préoccupations ou ses pensées intimes. Ils portaient l’un et l’autre une blouse de toile blanche toute neuve et étaient coiffés d’une casquette noire de drap léger. On aurait pu les prendre pour deux ouvriers se donnant un jour de flânerie ; mais, à leur air et surtout à leurs mains fines et blanches, il eût été facile de reconnaître qu’ils n’appartenaient à aucune des nombreuses classes de travailleurs.
Sans aucun doute, ces deux hommes avaient pris le costume de l’ouvrier afin de ne pas attirer l’attention. La blouse et la casquette étaient une sorte de déguisement.
Ils n’étaient plus jeunes : le plus âgé devait avoir passé la cinquantaine, l’autre ne paraissait avoir que trois ou quatre ans de moins que son compagnon. Était-ce par privilège de l’âge, le premier semblait avoir une certaine autorité sur le second. L’attitude de celui-ci était humble sous le regard fier et hautain de l’autre. Évidemment la volonté de son compagnon dominait la sienne et il reconnaissait sa supériorité.
Ils portaient toute leur barbe, et tous deux avaient le haut de la tête dénudé. Le plus âgé avait la barbe et les cheveux blancs ; les cheveux de l’autre étaient encore d’un beau noir, mais sa barbe commençait à grisonner. Les deux fronts étaient sillonnés de rides profondes et les deux visages affreusement ravagés. Ces deux hommes avaient dû passer par de rudes épreuves, devaient avoir eu de grands chagrins ou de grandes passions. Ceux-là et celles-ci devancent l’œuvre des années. À quoi devaient-ils leur précoce vieillesse ? Était-ce la marque d’une vie tourmentée par le malheur immérité, l’amertume des déceptions, des regrets ou un stigmate de honte ? Quel était le passé de ces deux hommes ? À n’en pas douter, leur existence avait été traversée par quelque chose de terrible. Étaient-ils victimes de la fatalité ? Étaient-ils des innocents ou des coupables, des vaincus ou des révoltés ? Ils entrèrent dans le bois de Vincennes.
Les rayons du soleil se glissaient à travers les branches, s’enfonçaient sous des arceaux de verdure, creusant le taillis de longues raies lumineuses. Réveillés et mis en joie par l’annonce d’une belle journée, les oiseaux chantaient et les insectes bourdonnaient, ayant pour accompagnement le chuchotement de la brise dans les feuilles.
Les deux hommes continuaient à garder le silence. Cependant, certains mouvements brusques du plus âgé trahissaient son agitation ou son impatience.
Ils arrivèrent derrière le fort. Là, ils s’arrêtèrent : à leur gauche, au-dessus du fossé où fut fusillé le jeune duc d’Enghien, se dressait le donjon, bastille désarmée, prison vide, monstre aux dents brisées, qui reste vivant, debout sur le passé mort. À droite s’étendait le champ de manœuvre auquel on a donné le nom de Polygone. Les soldats de la garnison de Vincennes étaient à l’exercice. Les plus jeunes, des conscrits réunis par pelotons et commandés par des sous-officiers, apprenaient à porter et à manier le fusil, à se tourner à droite ou à gauche, à marcher et à se tenir dans les rangs.
Mais les deux hommes en blouse n’étaient pas venus de Paris à Vincennes pour voir manœuvrer des soldats.
– Maintenant, de quel côté nous dirigeons-nous ? demanda le plus âgé après avoir jeté autour de lui un regard rapide.
L’autre ne répondit pas ; mais après s’être orienté il allongea le bras, et la direction de sa main traça une diagonale sur le Polygone. Ils marchèrent vers le point indiqué. Quand ils furent à une trentaine de pas des derniers soldats, le plus âgé reprit la parole.
– Ainsi, dit-il, tu es bien sûr de retrouver l’endroit où tu l’as caché ?
– Oui, car je ne suppose pas que, depuis treize ans, on ait abattu les gros arbres du bois. On n’a pas creusé partout des lacs et des rivières.
– Enfin, nous verrons tout à l’heure si tu ne comptes pas trop sur ta mémoire. En attendant, tu me ferais plaisir en me disant quelle était ton idée lorsque tu as enterré le coffret au pied d’un arbre.
– Tu n’avais pas cru devoir me dire ce qu’il contenait, mais j’ai deviné qu’il renfermait des papiers importants.
– Ah !
– Naturellement, j’ai pensé que ces papiers pouvaient te servir et qu’il était utile de les conserver ; car, si j’en juge par ce que tu as fait autrefois pour les posséder, ils ont pour toi une très grande valeur. – Ils avaient alors une valeur qu’ils n’ont plus aujourd’hui ; mais n’importe, ils peuvent encore nous être utiles. – J’ai donc eu une bonne idée ?
– Excellente, car on ne peut pas savoir…
– Il n’acheva pas sa phrase. Un sourire amer crispa ses lèvres.
– Avant d’enfouir le coffret, est-ce que tu ne l’as pas ouvert ? demanda-t-il.
– Je n’ai pas eu la curiosité de voir ce qu’il contient ; et l’aurais-je eue, le temps me manquait pour la satisfaire. Un détail que tu ignores peut-être : le coffret est de cuivre et le couvercle a été soudé.
– Oui, je sais cela.
– Je te le répète et tu peux me croire, je n’ai eu qu’une seule pensée : cacher le coffret. Pour cela j’avais une double raison. N’était-ce pas le meilleur moyen de le soustraire à toutes les recherches, de le conserver pour te le remettre un jour et de me débarrasser en même temps d’un objet fort compromettant ? Je sentais le péril, j’avais le pressentiment de ce qui m’attendait. En effet, trois jours plus tard, j’étais pincé par la police.
– Oui, tu as été bien inspiré en cachant le coffret ; s’il eût été saisi en ta possession, l’affaire du château de Coulange était découverte et tu attrapais dix ou quinze ans de travaux forcés au lieu d’en être quitte pour cinq ans de prison. Allons, tu as été intelligent et adroit. Je ne veux pas te laisser ignorer que si le coffret était tombé entre les mains de la justice, les conséquences eussent été terribles. Si le secret qu’il renferme eût été révélé alors, il ne pourrait plus nous servir ; c’est ce secret, gardé depuis plus de vingt ans, qui fait encore aujourd’hui notre force tout en restant un danger pour moi.
– Pour toi et pour d’autres.
– Hein, que veux-tu dire ?
– Que d’autres personnes ont intérêt à garder ce secret.
– Mais tu sais donc ?…
– Je sais que la marquise de Coulange donnerait beaucoup, peut-être une fortune, pour rentrer en possession du son coffret et des papiers qu’il contient.
– Comment sais-tu cela ?
– Je vais te l’apprendre. Je ne t’ai pas encore parlé d’une visite que j’ai reçue pendant que j’étais détenu à Mazas…
– Va, je t’écoute.
– Un jour, un homme vint me trouver pour me réclamer le coffret.
– Quel était cet homme ?
– Je l’ignore, car il n’a pas jugé nécessaire de me faire connaître son nom et sa qualité. Mais je compris facilement qu’il était envoyé par la marquise de Coulange. Il savait ce qui s’était passé au château de Coulange ; il me montra même un poignard que je reconnus aussitôt ; c’était le mien. Tu me l’avais pris des mains, et l’homme inconnu m’apprit que tu avais voulu t’en servir pour assassiner la marquise, ta sœur.
– Si tu rencontrais cet homme, le reconnaîtrais-tu ?
– Je ne sais pas, comme nous il a dû vieillir. Mais la physionomie qu’il avait alors est restée dans ma mémoire. C’était un homme d’une quarantaine d’années, de haute taille, se tenant droit et raide sur ses longues jambes un peu grêles ; il avait l’air sévère, le visage long et pâle, le nez gros, le front large, le regard vif et perçant, d’épais sourcils noirs très rapprochés et de longues moustaches taillées en brosse.
– Cela suffit, dit l’autre, le portrait est frappant, je reconnais le personnage.
Il prononça tout bas ce nom : Morlot.
– Tu ne t’es pas trompé, reprit-il à haute voix, cet homme était bien envoyé par la marquise pour te réclamer le coffret.
– Or je me suis dit avec raison qu’il fallait que la marquise de Coulange tînt beaucoup à rentrer en possession de son coffret ou plutôt de ses papiers, puisqu’elle n’hésitait pas, pour les retrouver, à s’adresser à un pauvre diable qui, quelques jours plus tard, allait passer en cour d’assises.
– Oui, tu devais faire cette réflexion et probablement plusieurs autres dont je n’ai pas à te demander compte. Qu’as-tu répondu à l’envoyé de la marquise ?
– Tu penses bien que je n’ai pas été assez bête pour lui dire que j’avais enterré le coffret au pied d’un arbre dans le bois de Vincennes. Je lui ai répondu que ne sachant qu’en faire et voulant m’en débarrasser, je l’avais jeté dans la Marne à un endroit que je lui indiquai.
– Et il a cru cela ?
– Oui.
– En es-tu certain ?
– Avec un peu d’adresse on fait passer facilement un mensonge pour une vérité.
De sorte que l’individu est allé chercher le coffre dans la Marne.
– Nous pouvons le supposer.
– Et comme il a vainement fouillé le lit de la rivière et que, depuis, treize ans se sont écoulés, la marquise ne doit plus penser à ses papiers, qu’elle croit perdus.
Un éclair sillonna son regard et il eut un sourire singulier.
– Allons, reprit-il d’une voix creuse, tout est resté dans l’ombre, tout va bien…
Il s’arrêta brusquement, saisit les deux mains de son compagnon et, les serrant fiévreusement dans les siennes :
Il y a treize ans, reprit-il sourdement, nous avons été vaincus, terrassés, désarmés… la fatalité était contre nous. Mais j’ai gardé ma force, c’est-à-dire ma haine, et je me trouve debout, prêt pour la vengeance. – Et moi je suis là pour te suivre, te servir, t’obéir. – C’est bien, nous aurons notre revanche. Rien ne nous empêchera d’aller droit au but. Il nous faut la richesse, des millions, le luxe éblouissant. Après avoir si longtemps souffert, nous voulons des années de jouissances. Sans être moins audacieux, nous serons plus adroits, plus prudents. Cachés dans l’ombre nous frapperons, et chacun de nos coups sera terrible.
Après ces paroles menaçantes, les deux hommes se regardèrent. De leurs yeux jaillissaient de fauves éclairs.
Le plus âgé de ces deux hommes se nommait Sosthène de Perny ; l’autre s’appelait Armand Des Grolles.
Les deux hommes que nous venons de faire connaître, ayant traversé le Polygone, se trouvèrent à l’entrée d’une large et belle avenue, ombragée d’arbres séculaires.
– Nous approchons… dit Des Grolles à voix basse.
– Alors c’est dans cette partie du bois ?
– Oui. Assurons-nous que nous sommes bien seuls, que nul ne peut nous voir.
– Je crois qu’à cette heure matinale nous n’avons pas à craindre d’être surpris ; mais tu as raison, il est toujours utile de s’entourer de précautions.
Du regard ils fouillèrent les massifs à droite et à gauche. Ils ne virent rien de suspect. Ils restèrent un instant immobiles, allongeant le cou, tendant l’oreille. Ils n’entendirent que le chant des fauvettes, le bourdonnement des insectes et le bruissement, des feuilles. Complètement rassurés, ils avancèrent.
Tout en marchant, Des Grolles compta à gauche dix-neuf arbres. Il s’arrêta près du vingtième. Alors, prenant cet arbre comme marquant le sommet d’un angle droit, il s’enfonça sous bois, suivi de Sosthène.
Après avoir fait environ cinquante pas, sans dévier de la ligne perpendiculaire. Des Grolles s’arrêta de nouveau puis, ayant examiné le terrain, il fit encore deux pas en avant et se tourna vers Sosthène, en disant :
– C’est ici :
De Perny le regarda avec étonnement.
– Je suis persuadé que tu ne te trompes pas, mais comment peux-tu reconnaître l’endroit ?
– Autrefois, au collège, j’ai appris à faire des tracés géométriques, répondit Des Grolles en souriant. Tu vois ce chêne, je le reconnais à cette branche qui a été brisée il y a quinze ou vingt ans, par un vent de tempête ; maintenant, voilà un autre chêne également centenaire. De l’un à l’autre de ces arbres je tire une ligne droite dont je prends exactement le milieu, et je suis à la place où j’ai enterré le coffret.
Tout en parlant, Des Grolles avait tiré de dessous sa blouse un instrument qui y était caché. C’était une palette de fer, large et longue comme la main, une sorte de bêche, ayant un manche de bois de vingt-cinq à trente centimètres de longueur.
Les deux hommes se trouvaient au centre d’une clairière, entourés d’un épais rideau de verdure. Toujours prudent, Des Grolles plongea son regard dans toutes les directions, afin de s’assurer encore qu’il n’y avait que lui et son compagnon dans cette partie du bois.
– Rien à craindre ! murmura-t-il.
Il s’accroupit dans les hautes herbes et se mit à l’œuvre. Il eut bientôt creusé un trou d’une certaine profondeur.
Debout, immobile, les yeux ardents fixés sur le trou, Sosthène suivait avec anxiété le travail de Des Grolles.
– Eh bien, tu ne trouves rien ? dit-il, ne pouvant modérer son impatience.
Sans répondre, Des Grolles continua à creuser la terre.
Soudain, un bruit sourd sortit du fond du trou. L’instrument venait de rencontrer un corps dur faisant résistance.
Des Grolles se redressa et regarda Sosthène d’un air triomphant.
Celui-ci avait entendu le choc de la bêche. Il se mit à genoux au bord du trou, les yeux étincelants. Des Grolles enleva encore une couche de terre, et l’objet qu’ils cherchaient, le coffret de cuivre, apparut à leurs yeux.
Avec ses mains, Sosthène acheva de le déterrer. Il le sortit du trou et le cacha sous sa blouse, en se relevant.
– Maintenant, dit-il, filons vite. Et ils s’éloignèrent rapidement.
Vingt minutes plus tard ils étaient hors du bois. Ils passèrent la barrière sans éveiller l’attention des employés de l’octroi et ne tardèrent pas à arriver sur la place du Trône. Ils prirent une voiture et donnèrent l’ordre au cocher de les conduire rue de Clignancourt, devant le Château-Rouge. Là ils mirent pied à terre, payèrent le cocher et grimpèrent sur les hauteurs de Montmartre. Ils se trouvèrent bientôt dans une ruelle étroite, sombre et entièrement déserte, ouverte au milieu de jardins clos de palissades et de haies vives. Sosthène tira une clef de sa poche, ouvrit une petite porte et ils pénétrèrent dans un terrain couvert de broussailles parmi lesquelles végétaient quelques arbres fruitiers.
Au milieu de ce terrain, qui ne ressemblait plus à un jardin, s’élevait une chétive maisonnette aux murs noircis, crevassés, une mauvaise bicoque prête à tomber en ruine. L’intérieur répondait au dehors ; c’était le même délabrement, la même vétusté. Il y avait au rez-de-chaussée une cuisine, une salle à manger et au-dessus deux chambres. Celles-ci étaient assez bien meublées ; dans chacune il y avait un lit, une commode-toilette, deux chaises, un fauteuil, un guéridon et, sur la cheminée, une glace et une pendule. Le reste du mobilier acheté chez quelque bric-à-brac, ne valait pas cinquante francs. C’est dans cette espèce de masure que Sosthène de Perny et Armand Des Grolles demeuraient depuis quelque temps. Après avoir mis plus de quinze jours à chercher dans Montmartre, la Chapelle et les Batignolles un logement à leur convenance, ils avaient enfin découvert cette maison solitaire. Son aspect misérable et même sinistre ne les avait pas repoussés, au contraire, elle faisait parfaitement leur affaire et ils l’avaient choisie de préférence à toute autre.
Là, à l’extrémité de Paris, dans cet endroit perdu, ignoré, dans ce désert, ils étaient bien cachés. Ils n’avaient pas à redouter les regards curieux et indiscrets des voisins. Tranquillement et à loisir ils pouvaient méditer leurs projets ténébreux. Ils pouvaient aller et venir, changer de costume à volonté, sortir et rentrer à toute heure du jour et de la nuit sans crainte d’être remarqués, et recevoir qui bon leur semblait sans avoir peur d’attirer l’attention sur eux.
Ils étaient entrés dans la maison. Après avoir refermé la porte et poussé le verrou, Des Grolles s’empressa de rejoindre de Perny dans sa chambre. Celui-ci avait posé le coffret sur le guéridon.
– Maintenant, dit Des Grolles, il faut l’ouvrir.
– Je pourrais m’en dispenser, répondit de Perny, car je sais ce qu’il contient. Mais comme il faut qu’il soit ouvert, que ce soit aujourd’hui ou un peu plus tard…
– Alors, ouvrons-le tout de suite, dit vivement Des Grolles, qui avait hâte de connaître entièrement le secret du coffret.
– Soit, fit de Perny. Mais c’est tout un travail, il faut que le couvercle soit dessoudé. Tu as ta bêche ?
– La voilà.
– Elle va encore nous servir. Avant tout il nous faut du feu.
– Je comprends, dit Des Grolles.
Il sortit précipitamment de la chambre et revint au bout d’un instant apportant du bois et du charbon. Il alluma un feu dans la cheminée et le foyer fut bientôt rempli d’une braise ardente. Dans ce brasier ils firent rougir le fer de la bêche, dont ils se servirent pour faire fondre la soudure. L’opération réussit parfaitement. Toutefois, ils employèrent une bonne heure à cette besogne. Enfin, ils parvinrent à enlever le couvercle en faisant céder ses dernières attaches.
Des Grolles laissa échapper une exclamation et se pencha avidement sur le coffret, en écarquillant les yeux.
– Tu vois que je ne t’ai pas trompé, dit de Perny, ce sont des papiers.
Il tira du coffret un manuscrit à couverture bleue d’une cinquantaine de pages.
– Et cela, qu’est-ce-donc que cela ? s’écria Des Grolles, laissant éclater sa surprise.
– Cela répondit froidement de Perny, c’est le maillot d’un nouveau-né. Des Grolles fit un mouvement brusque.
– Voici d’abord le petit bonnet, continua de Perny, en enlevant l’un après l’autre les objets qui se trouvaient dans le coffret ; bien qu’il soit un peu froissé et fané, il n’en est pas moins fort coquet ; regarde, si je ne me trompe pas, il est brodé à la main et garni de vraie dentelle. Ceci est la petite chemise. Maintenant voilà une bandelette de toile et une autre pièce de toile, qui ont servi à envelopper le poupon. Ceci est une petite couverture de laine tricotée à la main.
Il ne restait plus rien dans le coffret.
Des Grolles regardait les divers objets étalés sur la table.
– Eh bien, comprends-tu ? lui dit de Perny.
– Oui, oui, je comprends, répondit Des Grolles. Ainsi, ce sont les langes de l’enfant ?
– Ceux qu’il portait le jour où on l’a enlevé à sa mère.
– Pour lui donner le titre de comte et une immense fortune. À la bonne heure, en voilà un qui a eu de la chance !
De Perny grimaça un sourire.
– Tiens, tiens, reprit Des Grolles, la petite chemise est marquée d’un G et d’un L, les initiales de ses noms et prénoms probablement.
– Ou du prénom et du nom de sa mère.
– C’est juste. Du reste, tu sais cela mieux que moi.
– Sur ce point je ne sais rien.
– Pourtant, tu as connu la mère.
– Je ne l’ai jamais vue et on m’a caché son nom. Je sais seulement que c’était une jeune fille de dix-huit ans qui avait été séduite et abandonnée par son séducteur au moment de devenir mère. Chaque année, dans Paris, il y a des centaines de ces malheureuses. D’ailleurs je n’ai joué qu’un rôle très effacé dans l’enlèvement de l’enfant.
– Alors tu ne sais pas ce que la mère est devenue ?
– Elle est morte, m’a-t-on dit, peu de temps après la naissance de son enfant.
– Ma foi, elle n’avait rien de mieux à faire.
Ces paroles furent suivies d’un moment de silence. Sosthène replaçait les langes dans le coffret.
– Il y a encore une chose que je ne comprends pas très bien, dit Des Grolles.
– Laquelle ?
– Je me demande pourquoi la marquise de Coulange conservait si précieusement ce maillot au lieu de l’avoir fait disparaître dès le premier jour.
Un éclair traversa le regard de Sosthène.
– En quelques mots je vais te faire comprendre, répondit-il : c’est sans le consentement de la marquise, c’est malgré elle que celui qui est aujourd’hui le comte de Coulange a été introduit frauduleusement dans la maison du marquis de Coulange.
Des Grolles se frappa le front.
– Ah ! maintenant, je devine tout, fit-il.
– Ou à peu près, rectifia de Perny. Du reste, continua-t-il, après avoir été mon complice il y a treize ans, nous sommes liés aujourd’hui par un pacte que la mort seule peut rompre ; or, dans l’intérêt même de nos projets et du but que nous voulons atteindre, je ne dois rien te cacher, il faut que tu saches tout. Quand tu auras lu ce manuscrit, écrit entièrement de la main de la marquise de Coulange, je n’aurai plus rien à t’apprendre. Alors tu sauras comment ma sœur m’a traité et avec quelle intention elle a écrit ces pages, qui étaient comme une épée de Damoclès suspendue sur ma tête. Alors tu comprendras quel intérêt j’avais à m’emparer du coffret. Il y a treize ans j’aurais détruit le manuscrit et fait disparaître ces langes. Aujourd’hui je conserve tout cela. Qu’en ferons-nous ? Je n’en sais rien. Nous verrons plus tard. Notre associé et ami, José Basco, m’a soumis un plan que j’ai approuvé et que tu connaîtras bientôt. José n’est pas comme nous forcé de se cacher ; depuis deux mois il s’est mis à l’œuvre, il travaille. Attendons les évènements.
– Dois-je lire le manuscrit maintenant ?
– José viendra ici aujourd’hui à deux heures, nous le lirons ensemble, répondit Sosthène.
– En ce cas, j’éteins le feu de ma curiosité ; mais, en attendant, puis-je regarder ?
– Tu le peux.
Des Grolles prit le manuscrit et tourna la couverture bleue. Sur la première page, en tête, il lut ces mots : « À mon mari. » – Plus bas, en grosses lettres : « Ceci est ma confession. » – Puis, au-dessous, en lettres plus petites : « Révélation du secret qui empoisonne ma vie. »
Le même jour, entre trois et quatre heures de l’après-midi, les trois associés, Armand Des Grolles, José Basco et Sosthène de Perny étaient réunis dans la chambre de ce dernier.
José Basco pouvait avoir comme de Perny de cinquante à cinquante-deux ans. C’était un homme de haute taille, sec, au teint bronzé, au regard d’aigle, froid, compassé, à l’attitude sévère, parlant peu et ne riant jamais. Il avait la barbe noire et ses cheveux très épais étaient également d’un beau noir luisant. Son visage et ses manières avaient une certaine distinction, ce qui lui permettait de se faire appeler comte de Rogas dans le monde interlope qu’il fréquentait. Il était né en Portugal, mais il n’avait plus de nationalité, ou plutôt, devenu cosmopolite par son existence nomade et aventureuse, le monde entier était sa patrie. Depuis vingt ans, il s’était montré un peu partout, à Paris, à Londres, à Rome, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, en Égypte, en Amérique et dans l’Inde. En un mot, José Basco était ce qu’on appelle un chevalier d’industrie.
Armand Des Grolles tenait encore dans ses mains le manuscrit de la marquise de Coulange dont il avait fait la lecture à haute voix.
Ce qu’il venait de lire était pour José Basco et lui une étrange révélation.
Toutefois, le manuscrit ne leur apprenait point les faits très importants qui s’étaient accomplis après le départ de Sosthène pour l’Amérique.
Nous pouvons supposer que, renseigné par José Basco, le frère de la marquise savait un peu ce qui se passait dans la maison du marquis de Coulange ; mais personne n’avait pu dire au Portugais que l’institutrice de Maximilienne, qu’on appelait madame Louise, n’était autre que la mère de l’enfant volé par Sosthène plus de vingt ans auparavant.
Les trois associés ignoraient également qu’en récompense des services qu’il avait rendus à la maison de Coulange, l’inspecteur de police Morlot était devenu le régisseur, l’intendant d’un des plus riches domaines du marquis.
À la lecture du manuscrit avait succédé un assez long silence.
José Basco avait écouté avec la plus grande attention, sans qu’aucun mouvement de son visage pût trahir ses impressions. Ce fut lui qui, le premier, prit la parole.
– Ce que Des Grolles vient de nous lire, dit-il, en s’adressant à Sosthène, est la relation très exacte des faits que vous m’avez racontés à New York. Il y a en plus les réflexions et les appréciations plus ou moins justes de votre sœur, dont nous pourrons encore profiter. L’importance de ce document n’est pas discutable, il a une valeur énorme et nous en aurons certainement besoin un jour. Il faut donc le conserver précieusement ainsi que les autres objets qui sont dans le coffret.
– C’est bien mon intention, répondit Sosthène.
– Maintenant, reprit José, d’un ton légèrement ironique, je puis, si vous le désirez, vous donner des nouvelles de votre sœur et de votre beau-frère.
Le visage de Sosthène devint subitement très sombre.
– Tous deux se portent à merveille, continua José. Le marquis, la marquise, le jeune comte de Coulange et mademoiselle Maximilienne, toute la famille, enfin, est actuellement au château de Coulange. Lâchasse ouvre dans quelques jours, le 1er septembre, et le marquis a déjà fait ses invitations. Pendant deux mois, il y aura, comme tous les ans, nombreuse réunion au château. Le marquis et le jeune comte Eugène sont, paraît-il, deux intrépides chasseurs. On dit aussi que le grand gibier abonde dans les superbes chasses de M. le marquis. Mais vous devez savoir cela mieux que personne. « Je puis vous dire encore que le marquis et sa femme ne pensent pas plus à vous que si vous n’aviez jamais existé. Mademoiselle Maximilienne ignore absolument qu’elle a le bonheur d’avoir un oncle qui se nomme Sosthène. Mademoiselle Maximilienne aura bientôt dix-huit ans ; c’est une adorable jeune fille, le portrait vivant de sa mère lorsque le marquis l’a épousée. Mais la fille ressemble plus encore à la mère par l’esprit et le cœur que par les charmes extérieurs de sa personne.
Elle a la beauté correcte et pure, la grâce parfaite, la bonté intelligente, l’ingénuité ou la naïveté charmante, la sensibilité exquise. En elle tout est délicieux et suave comme l’idéal. »
Un sourire intraduisible errait sur les lèvres de Sosthène.
José se tourna vers Des Grolles.
– Est-ce que vous aimez la chasse ? lui demanda-t-il.
– Autrefois c’était une de mes passions.
– Cela veut dire que vous étiez un chasseur terrible.
– Ne plaisantez pas, José, j’en valais un autre.
– Mais je ne plaisante pas du tout, je vous assure ; je suis enchanté de savoir que vous êtes un excellent tireur.
– Il y a des années que je n’ai pas tenu un fusil, je ne sais pas si j’aurais le coup d’œil aussi rapide et aussi juste qu’autrefois. Quand j’étais chasseur, José, à cinquante ou soixante mètres je ne manquais jamais une pièce de gibier.
– C’est très bien, Des Grolles ; je vous le répète, je suis enchanté.
– Pourquoi cela ?
– Parce que étant, moi, un très mauvais chasseur, nous serons sûrs de rapporter du gibier quand nous irons chasser, ensemble, répondit José avec son flegme ordinaire.
Des Grolles le regarda avec surprise.
– Ah ! çà, fit-il, est-ce que vous avez l’intention de vous faire inviter à quelque partie de chasse ?
– Peut-être. Mais nous reparlerons de cela un de ces jours.
– Il médite quelque chose de violent, pensa Sosthène. Il reprit à haute voix :
– José, peut-on vous demander où nous en sommes ?
– Comme je vous l’ai dit il y a quelques jours, mon plan est définitivement arrêté ; certains évènements seuls pourraient me forcer à le modifier. Le plus difficile pour moi était le personnage à trouver. Aujourd’hui je le tiens. Sans qu’il s’en doute, je le suis pas à pas, je le guette, je l’observe, je l’étudie. Le gaillard en vaut la peine ; c’est un sujet rare qui jouera d’une façon merveilleuse le rôle que je lui destine. Ce qu’il a été, ce qu’il est, ce qu’il a fait, ce qu’il fait, je le sais. Je fouille partout, rien ne m’échappe. Je suis de plus en plus convaincu qu’il m’était impossible de trouver mieux. Je crois véritablement qu’il a été créé et mis au monde pour l’emploi. Il a toutes les qualités ou, si vous le préférez, tous les défauts désirables.
« Ce n’est pas pour vous flatter, mon cher de Perny – nous n’avons pas de compliments à nous faire, – mais ce jeune homme aurait été votre élève qu’il ne serait pas plus accompli. »
Sosthène reçut ce coup de boutoir sans sourciller.
– Comme toujours, continua José, la famille de Coulange rentrera à Paris à la fin d’octobre ou au commencement de novembre. D’ici là, j’aurai trouvé sans doute à occuper vos loisirs. Dans tous les cas, je prends mes dispositions pour que nous puissions nous mettre sérieusement à l’œuvre dès le mois de novembre. Alors mon Roméo sera complètement pris dans mes filets, et quinze jours me suffiront pour le préparer à entrer en scène.
– Ainsi, tout va bien, dit Sosthène.
– Du moment que je suis satisfait, vous pouvez l’être.
– Nous ne savons toujours point, Des Grolles et moi, ce que nous aurons à faire.
– Pour une bonne raison, parbleu ; je l’ignore moi-même. Est-ce que cela ne dépend pas des évènements ? Ah ! je vous ai apporté de l’argent… Mes recommandations sont toujours les mêmes : dépensez le moins possible. Soyons prudents, très prudents, soyons sages, très sages.
Il posa sur la table deux rouleaux d’or.
– Vous n’avez pas à craindre que je fasse de folles dépenses, José, répliqua Sosthène avec aigreur, puisque vous m’avez interdit de me montrer sur les boulevards ou au foyer de l’Opéra, puisqu’il m’est défendu de revoir mes anciennes connaissances et de reparaître dans aucun salon, puisque je suis obligé de me cacher ici, dans ce quartier excentrique, comme un lépreux ou un pestiféré.
– Tout cela, mon cher, est une des nécessités de la situation ; si la marquise de Coulange apprenait que vous êtes revenu à Paris, le succès de notre entreprise serait sérieusement compromis.
– En attendant je sèche d’ennui, je meurs de consomption, et je me demande avec terreur si je ne suis pas condamné pendant un ou deux ans à cette existence de hibou ou de cloporte.
Le Portugais fit un effort qui amena sur ses lèvres un sourire railleur.
– Il faut être cela ou ne pas être, dit-il ; qui veut la fin veut les moyens. Puis, changeant de ton, il ajouta :
– Sosthène de Perny, l’ancien viveur de Paris, le lion français de New York, reparaîtra dans le monde, plus brillant que jamais, le jour du mariage de mademoiselle Maximilienne de Coulange.
Nous savons comment, treize ans auparavant, Sosthène de Perny avait quitté la France.
En arrivant à New York, avec la petite fortune qu’il avait dans son portefeuille, s’il eût voulu revenir au bien, se repentir et faire fructifier son capital par le travail, il avait la facilité de se créer une position indépendante et avouable. Il pouvait se relever, racheter son passé par une vie nouvelle, laborieuse et honnête, et peut-être mériter un jour le pardon de la marquise de Coulange.
Malheureusement, Sosthène de Perny était un pervers, un de ces monstres humains qui naissent avec le génie du mal ; il n’existait plus rien de bon en lui, sa conscience était morte, et il était incapable d’avoir seulement la pensée qu’il pouvait se réhabiliter. Il avait toujours été l’esclave de ses passions, le vice s’était incarné en lui, et il en portait la flétrissure. Si sa raison avait résisté à des excès de toutes sortes, il avait perdu complètement le sens moral. Le misérable était gangrené jusqu’à la moelle des os.
Il continua à New York l’existence honteuse qu’il avait menée à Paris. Il trouva facilement des amis dignes de lui, des oisifs, viveurs débauchés de la pire espèce.
En Amérique comme en Europe, il y a le monde interlope composé de femmes galantes, d’aventuriers et de chevaliers d’industrie. Ce monde-là, Sosthène le connaissait. Il y fit son apparition avec éclat. Il apportait au milieu de ces déclassés de toutes les catégories et de toutes les nations l’élégance, les belles manières et le beau langage des salons parisiens. On l’accueillit avec joie, toutes les mains se tendirent vers lui. Le gentilhomme parisien était très recherché, très entouré, chacun voulait être son ami. Au bout d’un mois on ne l’appelait plus autrement que le lion français.
Sosthène de Perny se trouvait dans son milieu ; il allait pouvoir se livrer à de nouveaux exploits.
Toujours avide de plaisirs, il n’en dédaignait aucun. Cependant il fréquentait de préférence les salons où l’on jouait. Les dollars sur le tapis vert l’attiraient. Joueur effréné, il passait la nuit volontiers les cartes à la main. Il jouait avec une assurance magnifique, grâce au talent qu’il avait acquis de ne perdre jamais ou seulement lorsqu’il le jugeait nécessaire, afin de ne point laisser soupçonner qu’il devait sa chance incroyable à l’adresse et à l’habileté avec lesquelles il faisait glisser les cartes entre ses doigts.
Il dépensait beaucoup ; mais l’or qu’il gagnait ou plutôt qu’il volait au jeu entretenait son luxe, et ce n’est qu’au bout de neuf ans qu’il eut entièrement dévoré ses deux cent mille francs. Un autre, à sa place, ayant la même existence, aurait été ruiné en moins de quatre années. C’est assez dire ce que le jeu, pratiqué comme il l’entendait, lui avait déjà rapporté.
Quand il n’eut plus rien à lui, il trouva le moyen de vivre tout à fait aux dépens d’autrui. Naturellement, le jeu était sa principale ressource. Mais il ne rencontrait pas tous les jours des joueurs riches et complaisants ; aussi eut-il à subir des fortunes diverses ; il lui arriva plus d’une fois de chercher vainement un dollar dans ses poches vides. Alors il était obligé de recourir à de nouveaux expédients : le grec devenait escroc ou voleur, selon l’occasion.
Un soir, dans un de ces tripots où des fils de famille et même des hommes d’un âge mûr venaient perdre au jeu des sommes énormes, Sosthène de Perny se trouva tout à coup face à face avec José Basco.
En se reconnaissant, les deux hommes tressaillirent.
Ils s’étaient déjà rencontrés à Paris, une seule fois, dans le salon d’une femme du demi-monde où l’on jouait gros jeu. Là, Sosthène avait reconnu que José était son maître dans l’art de manier les cartes.
Le premier moment de surprise passé, un sourire effleura les lèvres de José Basco, et il se décida à saluer Sosthène, qui n’hésita pas à lui rendre son salut.
Alors José passa son bras sous celui de Sosthène, et, l’entraînant à l’écart, dans un coin du salon, il lui dit :
– Vous êtes Français, vous vous nommez Sosthène de Perny.
– Et vous, répliqua Sosthène, vous êtes Portugais, et vous vous faites appeler don José, comte de Rogas.
– Donc, nous nous connaissons.
– Parfaitement.
– Il me semble que nous n’avons aucune raison d’être ennemis.
– Aucune, je le reconnais.
– Eh bien, je vous offre mon amitié.
– Je l’accepte en échange de la mienne.
– Maintenant nous pouvons nous entendre.
– Les loups ne se mangent pas entre eux, répondit cyniquement Sosthène. Ces paroles échangées, les deux grecs se serrèrent la main.
À partir de ce moment ils devinrent inséparables ; ils s’unirent pour ramasser sur les tapis verts l’or des joueurs naïfs et inexpérimentés et partagèrent fraternellement leur bonne et leur mauvaise fortune. Bientôt, ils purent se féliciter l’un et l’autre de s’être rencontrés.
L’amitié attire la confiance. José crut devoir raconter son histoire à Sosthène et celui-ci lui fit connaître la sienne, voulant donner aussi à son nouvel ami une preuve de sa confiance.
Il ne lui cacha rien. Il lui apprit comment et pourquoi il avait été forcé de quitter la France et de se réfugier en Amérique où il se trouvait, en quelque sorte, dans un lieu d’exil.
Sans cesse il pensait à Paris, et bien souvent il avait eu l’intention de retourner en France. Mais toujours la crainte le retenait, car il aimait la liberté et ne tenait pas à avoir des démêlés avec la justice.
José l’avait écouté silencieusement et avec la plus grande attention
– Vraiment, dit-il, je crois que vous ne pourrez pas résister longtemps encore à vous rapprocher des millions du marquis de Coulange, votre beau-frère.
– Malheureusement, pour retourner en France et vivre à Paris, il faut de l’argent, beaucoup d’argent.
– C’est vrai. À quel chiffre croyez-vous que s’élève la fortune du marquis ?
– Ce chiffre doit grossir chaque année, car le marquis ne dépense certainement pas tous ses revenus ; je ne pense pas exagérer en disant qu’il possède aujourd’hui vingt millions.
– Vingt millions ! exclama José Basco, vingt millions ! Mais c’est éblouissant, mon cher, c’est à donner le vertige !… Vingt millions !…
Il resta un moment silencieux, les yeux étincelants.
– Savez-vous, de Perny, reprit-il, que vous venez de me confier un secret qui vaut au moins dix millions, la moitié de la fortune du marquis pour ceux qui sauraient s’en servir ?
Sosthène redressa brusquement la tête et son regard interrogea la physionomie du Portugais.
– Oh ! ce n’est qu’une idée qui vient de passer dans ma tête, s’empressa d’ajouter José.
– Faites-la-moi connaître.
– Plus tard, quand je l’aurai suffisamment méditée et mûrie. En attendant, contentez-vous de savoir que, en s’y prenant bien, une bonne part de l’immense fortune du marquis de Coulange est à nous.
– Mon cher José, c’est un rêve.
– Oui, quant à présent. Du reste, nous ne pouvons rien faire tant que nous ne serons pas à Paris. Et encore faut-il que nous arrivions avec une somme assez ronde.
– En ce cas, nous sommes cloués ici à perpétuité.
– Mon cher, répliqua vivement le Portugais, pour certains hommes, vouloir c’est pouvoir. Dès aujourd’hui nous allons commencer à faire des économies, et le jour où nous posséderons une centaine de mille francs – il nous faut au moins cela, – nous voguerons vers la France.
– Ce sera long, dit Sosthène en hochant la tête.
– Nous verrons. Je conviens que depuis quelque temps la fortune nous est peu favorable ; mais les jours ou plutôt les nuits se suivent et ne se ressemblent pas. Sosthène et José se mirent donc à l’œuvre pour ramasser la somme qui leur était nécessaire. Mais ils avaient beau redoubler d’activité et d’adresse, leur caisse d’épargne mettait à se remplir une lenteur désespérante. – Nous n’y arriverons jamais, disait Sosthène.
– Nous verrons, répondait parfois José.
Le plus souvent il se contentait de hausser les épaules.
Un jour, Sosthène buvait un grog, assis seul à une table devant un café. Un homme qui passait dans la rue s’arrêta brusquement.
Après avoir regardé un instant le buveur afin de bien s’assurer qu’il ne se trompait point, le passant s’avança vers Sosthène et lui mit la main sur l’épaule.
De Perny se retourna vivement, leva les yeux sur l’individu et aussitôt se dressa sur ses jambes.
– Comment, c’est toi ? fit-il, ne cherchant pas à cacher sa surprise.
– À la bonne heure, tu me reconnais, dit l’autre ; je vois avec plaisir que tu te souviens de tes anciens amis ; mais tu n’en es pas moins étonné de me voir.
– Certes, je ne m’attendais guère à te retrouver ici, à New York.
– Ma foi, je pourrais t’en dire autant.
– Il faut que nous causions, reprit Sosthène, tu dois avoir des choses fort intéressantes à m’apprendre.
Il appela le garçon, paya son grog, puis il prit le bras de son ancien ami, et ils s’éloignèrent rapidement. Ils ne tardèrent pas à arriver dans un endroit de la ville à peu près désert.
– Ici, nous ne serons pas dérangés, dit Sosthène, et nous pouvons causer sans avoir peur qu’on nous entende. Voyons, y a-t-il longtemps que tu es en Amérique ?
– Depuis six ans bientôt.
– Que fais-tu à New York ?
– Je m’y ennuie considérablement.
– Cela ne me surprend pas ; mais enfin comment vis-tu ?
– Comme je peux. La mauvaise chance ne cesse pas de me poursuivre ; ce serait désespérant si, à la fin, on ne finissait point par s’habituer à tout. J’ai été successivement commissionnaire sur le port, laveur de vaisselle, valet de chambre, employé de commerce, secrétaire d’un Yankee, etc… J’ai fait treize métiers, j’ai eu les treize misères. Actuellement je fais partie d’une troupe de comédiens.
– Ah ! ah ! tu es devenu artiste ?
– Je deviens ce qu’on veut. Il faut vivre ; si difficile et si laide que la vie soit pour moi, j’y tiens. Pourquoi ? Je n’en sais rien. C’est bête, mais c’est comme cela. Oui, je suis ce que les gens du théâtre appellent une utilité ; mais je me hâte de dire que la vie de cabotin ne me va pas du tout. Je te regarde avec admiration ; tu es toujours élégant, toujours brillant. Ah ! tu es heureux, toi ; la fortune peut t’abandonner un instant, il faut quand même qu’elle te revienne. Si tu descends, tu remontes toujours. Tiens, faut-il te le dire, près de toi je me sens moins infime et il me semble que l’espoir renaît en moi. Si, comme autrefois, tu avais encore besoin de ton camarade Des Grolles, si je pouvais t’être utile, te servir, à n’importe quel titre, avec quelle joie je sauterais à bas des planches après avoir jeté mes oripeaux à la figure de mon directeur ! Eh bien, tu ne me réponds pas ? – Je réfléchis. Oui, peut-être, nous verrons. En attendant, il y a certaines choses que je dois savoir. Apprends-moi ce que tu es devenu après la visite nocturne que nous avons faite au château de Coulange. – Oh ! ce ne sera pas long.
– Surtout, ne me cache rien.
– Cette affaire du château de Coulange, si bien commencée, a failli nous être fatale à tous deux. Je sais dans quelle situation tu t’es trouvé ; heureusement, on avait intérêt à ne pas te livrer à la justice.
– Passons, dit Sosthène d’un ton bref, en fronçant les sourcils, c’est de toi qu’il s’agit et non de moi.
– Soit, passons, reprit Des Grolles. Ce jour-là, par extraordinaire, je fus plus heureux que toi, puisque j’ai pu retourner à Paris tranquillement. Mais ma chance ne fut pas de longue durée : quelques jours après, j’étais pincé avec d’autres, et je pus inscrire à mon avoir cinq ans de prison. Je soldais ainsi, d’un seul coup, ma dette du moment, et une autre que tu connais, contractée antérieurement.
– Baste, fit Sosthène railleur, qui paye ses dettes s’enrichit.
– Comme je suis toujours aussi gueux, je fais mentir ton proverbe, répliqua Des Grolles en riant.
– Arrivons, s’il te plaît, à la chose qui m’intéresse.
– Excuse-moi ; je croyais t’intéresser en te disant que j’ai été cinq ans sous les verrous.
Sosthène eut un mouvement d’impatience.
– Et le coffret ? demanda-t-il.
– Ah ! oui, le fameux coffret, le coffret de la marquise ?
– Qu’en as-tu fait ?
– Sois tranquille, il est en sûreté.
– Où cela ?
– Au fond d’un trou que j’ai creusé dans le bois de Vincennes. Sosthène regarda fixement Des Grolles.
– Est-ce bien vrai, cela ? fit-il.
– Je n’ai aucun intérêt à mentir.
– Dame, je n’en sais rien. Ainsi, tu as enterré le coffret dans le bois de Vincennes ?
– Prudemment, je tenais à m’en débarrasser.
– Si un jour j’ai besoin de ce coffret, ou plutôt de ce qu’il contient, sauras-tu le retrouver ?
– Oui, seulement…
– Seulement ?
– Je ne promets rien, tant que je serai à New York.
– Je comprends, cela suffit. Qu’as-tu fait après être sorti de prison ?
– Ce que j’ai pu et point ce que j’aurais voulu. L’entrée du département de la Seine m’étant interdite, je me gardai bien d’approcher trop près de Paris. Je ne me souciais nullement de retourner d’où je sortais, car je ne suis pas de ceux qui s’accommodent du régime des prisons. Il faut en avoir goûté pour savoir apprécier la liberté. Moi j’aime le grand air, j’aime à sentir le vent qui passe, à voir le soleil se lever et se coucher, à voir voler les oiseaux dans l’espace. Faute de mieux, je me résignai à mener une existence vagabonde. Je m’en allais n’importe de quel côté, où mes pas me conduisaient. Je travaillais quelquefois, quand je trouvais à occuper mes bras ; c’est-à-dire qu’il m’arriva souvent de tendre la main. Ne t’étonne pas, j’aurais pu faire pire. J’ai eu la force de résister à la tentation de prendre ce que souvent on ne me donnait pas. Mince mérite, j’avais peur des hautes murailles sombres et des cellules où l’on étouffe. Un jour, sans trop savoir comment j’y étais venu, je me trouvai au Havre. Là, je me fis garçon marchand de vins. La boutique était sur le port. Je voyais arriver et partir les paquebots. Cela me faisait penser à l’Amérique, où déjà j’avais trouvé un refuge, et, ma foi, l’idée me vint de revoir le nouveau monde.
« Bref, un matin je comptai l’argent qui était dans ma bourse. Ô merveille ! J’étais assez riche pour payer mon passage. Je n’hésitai pas une seconde ; je rendis mon tablier, comme on dit, et deux heures plus tard j’étais en pleine mer, debout sur le pont du navire, tournant le dos à la France. Et voilà comment je suis ici, triste exilé sur la terre étrangère. Cela se chante dans la Reine de Chypre.
Maintenant, Sosthène, je n’ai plus à te dire que ceci : Sois ma providence, ne m’abandonne pas ! »
De Perny resta un moment silencieux, ayant l’air de réfléchir.
– Il peut se faire que j’aie besoin de toi bientôt, dit-il.
– Tu dois te souvenir de mes paroles d’autrefois ; mes sentiments sont les mêmes ; corps et âme, je suis à toi.
– C’est bien, je crois que nous pourrons nous entendre. Je ne t’en dis pas davantage aujourd’hui. Tiens, continua-t-il, en lui remettant une carte, voici mon adresse ; viens me voir demain à deux heures, je te présenterai à un de mes amis.
– Je serai exact au rendez-vous.
– Alors, à demain.
Sur ces mots, ils se séparèrent.
Le lendemain, à deux heures précises, Armand Des Grolles entrait dans la chambre de Sosthène de Perny,
– Ah ! te voilà ? Bonjour ! dit celui-ci.
– Tu m’attendais ?
– Deux heures sonnent à cette pendule, j’allais t’attendre.
– Et ton ami à qui tu dois me présenter ?
– Il va venir.
Au même instant un bruit de pas se fit entendre, la porte s’ouvrit, et José Basco parut.
Il tendit la main à Sosthène, pendant que son regard clair et perçant s’arrêtait sur Des Grolles. Un mouvement de ses prunelles indiqua qu’il était satisfait de son rapide examen. Il avait déjà jugé l’homme.
– Mon cher José, lui dit Sosthène, je vous présente mon compatriote Armand Des Grolles, dont je vous ai parlé hier soir.
Des Grolles s’inclina.
– Oui, dit le Portugais en prenant son air le plus grave, hier soir mon ami de Perny m’a parlé de vous longuement, et, votre modestie dût-elle en souffrir, je ne vous cacherai pas qu’il m’a fait votre éloge.
Des Grolles ouvrit de grands yeux et regarda Sosthène qui, lui aussi, avait un air très grave. Ne sachant pas encore en présence de quel personnage il se trouvait, Des Grolles resta tout interdit.
– De Perny m’a raconté vos petites misères, continua José Basco avec la même gravité ; ce sont les vicissitudes de la vie auxquelles nous sommes tous exposés. Les temps sont durs et les affaires difficiles ; nous devons cela à la civilisation, au progrès. Aujourd’hui, cher monsieur, pour faire son chemin dans le monde, il faut passer par de rudes épreuves ; ce sont les épreuves qui font les hommes forts. Pour savoir il faut apprendre. Vous avez appris, vous avez de l’expérience ; c’est bien, vous ne devez pas vous plaindre.
Des Grolles, ahuri, se demandait si l’on ne se moquait pas de lui.
– Vous ne manquez pas d’énergie, poursuivit José, et vous êtes intelligent et actif. Ce sont des qualités indispensables. Vous avez de l’ambition et le désir d’arriver ; c’est parfait. Enfin je sais que, le moment venu, vous pouvez être un homme d’action. Vous vous êtes mis à la disposition de mon ami de Perny en lui offrant vos services. Sosthène n’a pas oublié de me dire qu’on pouvait compter sur vous, que vous étiez un homme sûr. D’abord je n’ai rien répondu, je voulais prendre le temps de réfléchir. De Perny et moi nous avons formé une association pour mettre à exécution un vaste projet, dont nous ne parlons pas encore ; or j’ai calculé qu’un troisième associé pouvait être nécessaire. Eh bien, cher monsieur Des Grolles, vous êtes l’homme qu’il nous faut ; si vous le voulez, vous serez notre associé.
– Mais je ne demande pas mieux, dit vivement Des Grolles ; je l’ai dit à Sosthène autrefois et hier encore, je suis à lui corps et âme.
– De Perny vous connaît et répond de vous ; c’est pour cela que je vous dis : Soyez avec nous.
Jusqu’ici les trois hommes étaient restés debout.
– Il me semble que nous avons le droit de nous asseoir, dit le Portugais, en prenant un siège.
Les autres l’imitèrent.
S’adressant de nouveau à Des Grolles, José Basco reprit :
– Notre intention est de quitter prochainement l’Amérique ; il faut absolument que nous retournions en France, à Paris. Je suppose que rien ne vous retient à New York, que vous êtes prêt à partir.
– Ce soir, s’il le faut, répondit Des Grolles.
– Très bien. Mais à Paris comme à New York et ailleurs, sans argent on fait triste figure.
– C’est vrai, fit piteusement Des Grolles.
– Si je ne me trompe pas, il y a vingt-deux mille francs dans la caisse de notre société.
– Oui, vingt-deux mille francs, confirma Sosthène.
– Eh bien, c’est à peu près comme si nous n’avions rien, car cette somme n’est pas le dixième de ce qui nous est nécessaire pour mener à bien notre entreprise. Il faut donc, – et pour cela tous les moyens sont bons, – que nous complétions notre capital.
Sosthène se rapprocha du Portugais. – Voyons, est-ce qu’il y a quelque chose à faire ce soir ? lui demanda-t-il.
– Ce soir, non, mais dimanche prochain, c’est-à-dire dans cinq jours, puisque c’est aujourd’hui mardi.
– Ainsi vous êtes sûr ?
– Je suis sûr qu’il y a quelque chose à faire ; seulement il faut réussir.
– Enfin de quoi s’agit-il ?
– Je vous le dirai tout à l’heure. Comme il ne faut jamais être pris au dépourvu nous devons agir comme si le succès était assuré et faire d’avance nos préparatifs de départ. Le paquebot français, Ferragus doit partir lundi prochain, à six heures du matin, dès aujourd’hui, chacun de nous ira retenir sa place et se faire inscrire sur le livre des passagers. Lundi, nous nous rendrons à bord, séparément, comme si nous ne nous connaissions pas. Il est toujours bon d’être prudent.
– Et si l’affaire en question n’a pas réussi ? objecta Sosthène.
– Dans ce cas, répondit José, nous resterons encore à New York, le Ferragus partira sans nous.
Il y eut un moment de silence.
– Maintenant, reprit José Basco, écoutez-moi.
À son tour, Des Grolles se rapprocha du Portugais. Celui-ci regarda ses deux associés en passant ses doigts dans sa barbe.
– Nous écoutons, dit Sosthène.
– Eh bien, voici de quoi il s’agit, reprit José en baissant la voix. Il y a à New York un vieux juif qui a plus de trois millions de fortune. Il s’est enrichi en vendant toutes sortes de marchandises. Entre autres trafics il a fait celui des diamants et autres pierres précieuses. Depuis quelques mois il s’est retiré des affaires ; mais il lui reste environ pour trois cent mille francs de pierreries qu’il ne tient pas à conserver et dont il cherche à se débarrasser.
– Comment, savez-vous cela ? demanda Sosthène.
– Par une conversation entre le vieux juif et un de ses coreligionnaires, dont j’ai été l’auditeur invisible. Les deux fils d’Israël étaient dans un jardin et se croyaient seuls, de plus ils causaient en arabe ; mais je comprends et parle la langue arabe avec autant de facilité que toutes les langues de l’Europe.
Je continue. Je n’ai pas besoin de vous dire que la conversation m’avait vivement intéressé. Je voulus savoir où demeurait le vieux juif et obtenir sur lui certains renseignements qui pouvaient ne pas être inutiles. Dès le lendemain je me mis en campagne et je sus bientôt tout ce que je tenais à savoir.
Le juif habite, à l’extrémité de la ville, une petite maison de modeste apparence qui lui appartient. Cette maison est bâtie au milieu d’un jardin carré, clos de murs assez élevés ; elle se cache dans les arbres et est suffisamment isolée. On entre dans le jardin par une porte unique, qui s’ouvre sur une petite rue peu fréquentée dans la journée, complètement déserte la nuit. Le vieux juif n’a qu’un domestique, un juif aussi, presque aussi âgé que lui. Ce domestique est un serviteur modèle : très attaché et très dévoué à son maître, il est en même temps sa ménagère, son valet de chambre, son cuisinier et le chien de garde de la maison.
Le vieux Virth. – c’est le nom du juif millionnaire, – vit très retiré ; il est peu connu à New York, et il n’y voit personne. Rarement, il reçoit quelques juifs, d’anciens amis, à sa table. Régulièrement, tous les samedis, il quitte sa maison et se rend à pied chez un de ses amis qui habite une villa à six ou huit milles de New York. Il y passe la journée du dimanche et ne revient à la ville que le lundi vers midi. Tels sont les renseignements que j’ai recueillis successivement.
Maintenant, puisque le vieux juif ne tient pas à conserver son lot de pierres fines, ne vous semble-t-il pas que ce serait lui rendre service et nous rendre service à nous-mêmes que de l’en débarrasser ?
– Certes, oui, dit Sosthène, dont les yeux flamboyaient ; il reste à savoir si la chose est possible.
– Il faut qu’elle le soit, répliqua José.
– Cela dépend des difficultés à vaincre, opina Des Grolles.
– Je vois que vous m’avez compris tous les deux, reprit José. À deux le succès pouvait être douteux, à trois je crois qu’il est certain.
– Alors, vous avez un plan tout tracé ? dit Sosthène.
– Oui, si vous voulez agir, si aucune crainte ne vous arrête.
– L’occasion est trop belle pour que nous la laissions échapper, répondit Sosthène.
– L’affaire est superbe, il n’y a pas à hésiter, ajouta Des Grolles.
– Donc, c’est entendu. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous pénétrerons dans la maison du vieux Virth. Je sais que les pierreries sont enfermées dans une cassette, laquelle est enfermée elle-même dans un meuble qui se trouve dans la chambre à coucher du juif.
– Très bien, fit Sosthène ; mais sachons d’abord comment nous entrerons dans le jardin.
– Une porte à ouvrir, c’est facile.
– Cette porte a probablement un ou plusieurs verrous solides ?
– L’obstacle est prévu. Dans ce cas, l’un de nous grimpera sur le mur, sautera dans le jardin et tirera les verrous sans bruit pour faire entrer les autres.
– La porte de la maison sera également bien fermée ?
– Sans aucun doute ; mais nous ne l’ouvrirons pas.
– Que ferons-nous ?
– Je vous ai dit que la maison était cachée dans des arbres. J’ai remarqué qu’un de ces arbres a de fortes branches qui s’étendent sur le toit. Il faudra donc s’introduire dans la maison par des lucarnes pratiquées dans la toiture pour éclairer le grenier. Le chemin peut-être périlleux, mais il y a cet avantage qu’on peut arriver dans la chambre du juif, au premier étage, et s’emparer de la cassette sans attirer l’attention du vieux domestique, qui couche dans une pièce du rez-de-chaussée. Mais comme celui-ci peut avoir le sommeil léger ou ne pas dormir, il faudra entrer deux dans la maison. Du reste, voici quel est mon plan : Vous, de Perny, vous restez près de la porte du jardin pour protéger notre retraite et prêt à nous avertir d’un danger quelconque, au moyen d’un signal convenu. Des Grolles et moi nous grimpons dans l’arbre, nous gagnons le toit en rampant sur une branche, nous ouvrons une lucarne et nous pénétrons dans le grenier. Alors j’allume une petite lanterne sourde que j’ai dans ma poche. Je n’ai pas besoin de vous dire que j’ai aussi sur moi les instruments qu’il faut pour forcer une serrure. Nous sortons du grenier, et nous descendons au premier étage doucement, sans bruit. Des Grolles se place en sentinelle sur le palier, prêt à recevoir le domestique, s’il paraît ; moi, je pénètre dans la chambre du vieux Virth, je m’empare de la cassette, et nous nous empressons de revenir dans le jardin par le même chemin. Comme vous le voyez, mon plan est simple et d’une exécution facile.
– Et si le domestique entend du bruit, s’il se lève, s’il vient ? interrogea Des Grolles.