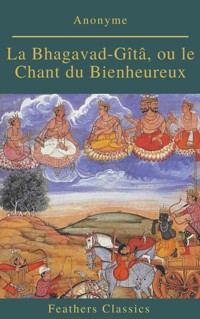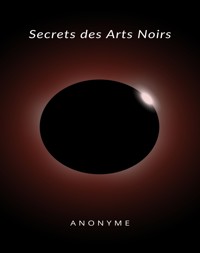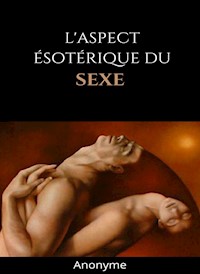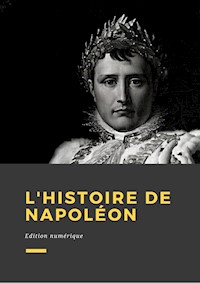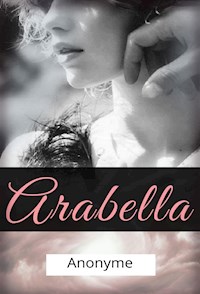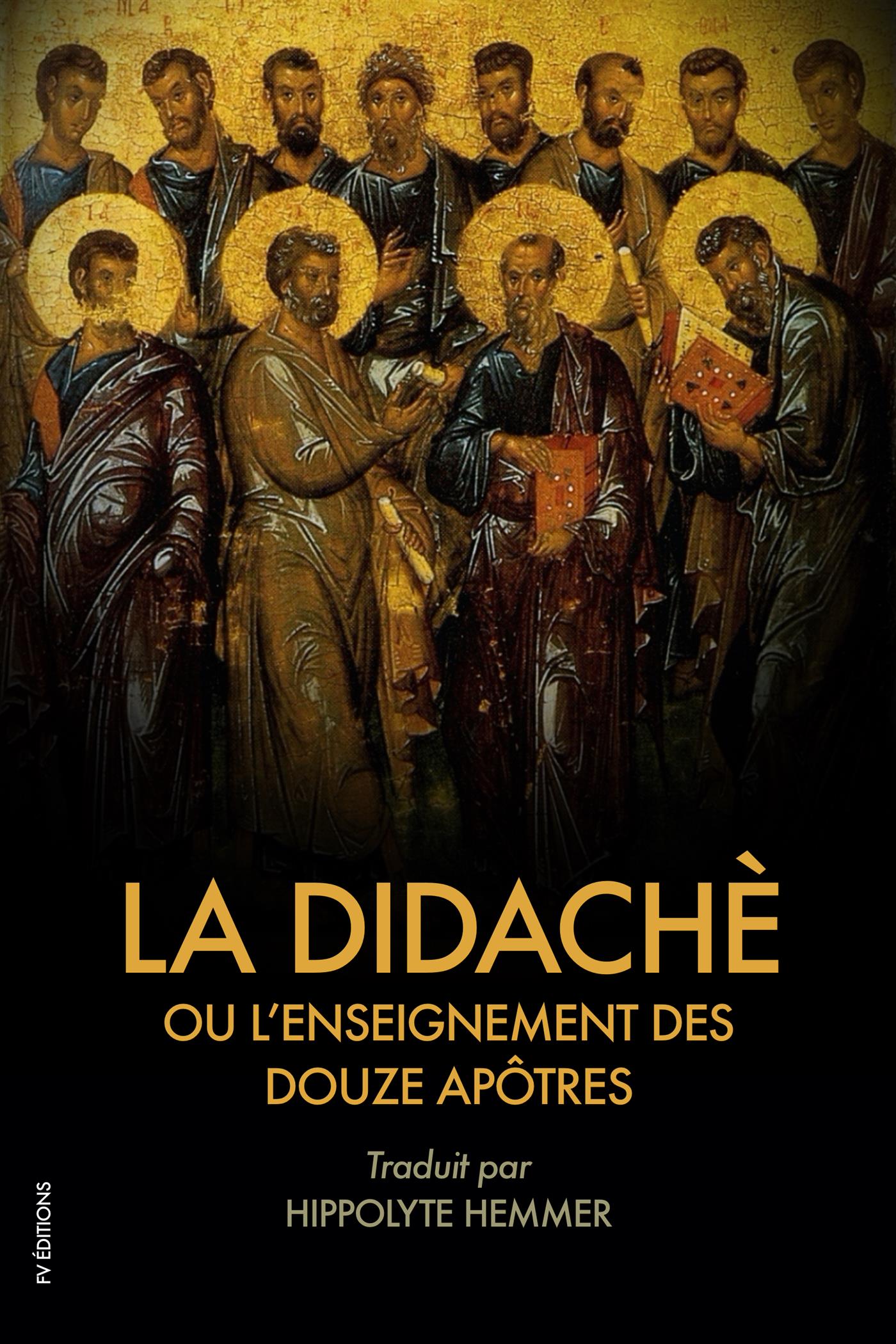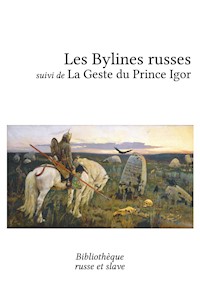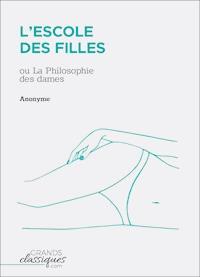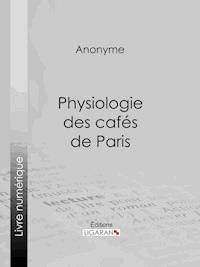Extrait : "Apprends, ô Vizir (que la bénédiction de Dieu soit sur toi), que les hommes et les femmes sont de diverses espèces ; que parmi eux il y en a qui sont dignes d'éloges, comme il y en a qui méritent des éloges. Lorsqu'un homme méritant se trouve près des femmes, son membre grossit, devient fort, vigoureux, dur ; il est lent à éjaculer et, après le tressaillement causé par la sortie du sperme, il est prompt à l'érection."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Jardin parfumé du cheikh Nefzaoui est la traduction faite en 1850, par M. le baron R ***, capitaine d’état-major à Alger, d’un manuscrit arabe du XVIe siècle.
Cette traduction fut autographiée en 1876 à 35 exemplaires numérotés, in-4° en feuilles, illustrés de deux portraits, de treize planches hors texte également autographiées, tirées sur papier bleuté, et de quarante-trois dessins, la plupart libres.
Le chiffre du tirage suffit à indiquer la rareté de cette édition. Un exemplaire a été vendu en 1886 au prix de 600 francs sur papier ordinaire ; deux exemplaires sur japon ont atteint la somme de 1 200 francs.
Isidore Liseux en a publié en 1886 une nouvelle traduction, revue et corrigée, en un in-8° de XVI-300 pages.
Enfin, une nouvelle « Édition privée » a été publiée en 1904, à Paris, tirée à 320 exemplaires, et « réimpression conforme à l’édition publiée en 1886 par Isidore Liseux ».
Le texte arabe de cet ouvrage fort curieux se rencontre assez couramment à Alger même.
(1850)
Le nom du cheikh Nefzaoui n’est passé à la postérité que par l’ouvrage dont la traduction est ci-après, et qui est le seul qui soit connu de lui.
Malgré la nature du sujet qui y est traité et les erreurs multipliées qui s’y rencontrent, suite de la négligence et de l’ignorance des copistes, on reconnaît que ce traité est dû à la plume d’un homme d’une grande érudition et réunissant généralement plus de connaissances en littérature et en médecine que l’on n’est habitué à en rencontrer chez les Arabes.
D’après la notice historique qui se trouve dans les premiers feuillets du manuscrit, et nonobstant l’inexactitude qu’elle semble renfermer au sujet du nom du Bey qui régnait à Tunis, il est présumable que cet ouvrage a été composé dans le commencement du seizième siècle, vers l’an 925 de l’Hégire.
Quant à la patrie de l’auteur, on est autorisé à penser, en raison de l’habitude qu’ont les Arabes de joindre souvent à leur nom celui de leur pays, qu’il est né à Nefzaoua, ville situé dans le canton de ce nom, sur les bords du lac dit Sebka Melrir, au sud du royaume de Tunis.
Ainsi que le dit le Cheikh lui-même, il habitait Tunis, et c’est dans cette ville qu’il aurait composé son ouvrage. Un motif tout particulier, et que rapporte la tradition, l’aurait amené à s’occuper d’un travail auquel ses goûts simples et retirés semblaient devoir le rendre étranger.
Ses connaissances en jurisprudence et en littérature, ainsi qu’en médecine, l’ayant signalé au Bey de Tunis, celui-ci aurait voulu lui faire remplir l’emploi de cadi, et cela malgré sa répugnance à occuper des fonctions publiques.
Hésitant toutefois à mécontenter le Bey par un refus formel, qui aurait pu ne pas être sans danger pour lui, il demanda seulement un court délai pour mettre la dernière main à un ouvrage qu’il avait entrepris.
Ce délai accordé, il l’employa à composer le traité dont il s’agit, traité qui, lorsqu’il fut connu, appela tellement l’attention sur son auteur qu’il devint dès lors impossible de lui confier des fonctions de la nature de celles de cadi.
Mais cette version, qui n’est appuyée d’aucun témoignage authentique, et qui tendrait à faire passer le cheikh Nefzaoui pour un homme d’une morale peu sévère, ne me paraît pas devoir être admise. Il suffit, en effet, de jeter un coup d’œil sur ce livre pour se convaincre que son auteur, en le composant, a été animé des plus louables intentions et que, loin d’être blâmable, il s’est créé, au contraire, par les services qu’il a cherché à rendre à l’humanité, des droits à sa reconnaissance, ainsi qu’à celle de la postérité.
Contrairement à l’habitude des Arabes, il n’existe aucun commentaire de ce livre ; peut-être faudrait-il rechercher la cause de cette lacune dans la nature même du sujet qui y est traité et qui aurait effrayé, mal à propos, les esprits sérieux et adonnés à l’étude. Je dis : mal à propos, parce que cette œuvre, plus que toute autre, avait besoin de commentaires ; des questions graves y sont traitées et ouvraient un vaste champ au travail, à la méditation.
Quoi de plus important, en effet, que l’étude des principes sur lesquels repose le bonheur de l’homme et de la femme, en raison de leurs relations mutuelles, relations qui elles-mêmes sont toutes assujetties à des causes de caractère, de santé, de tempérament et de constitution qu’il appartient aux philosophes d’approfondir ? J’ai cherché à combler cette omission par des notes qui, bien qu’incomplètes, je l’avoue, peuvent cependant jusqu’à un certain point servir de guide.
Dans les cas douteux et difficiles, et lorsque la pensée de l’auteur ne me semblait pas ressortir d’une façon suffisamment claire, je n’ai point hésité à chercher la lumière auprès des savants de l’une et de l’autre religion, et c’est grâce à leur obligeant concours que bien des difficultés, que je croyais insurmontables, ont été vaincues. Je me plais à leur adresser ici tous mes remerciements.
Parmi les auteurs qui ont traité de matières semblables, on n’en trouve point qui puissent être complètement comparés au Cheikh, car son œuvre tient à la fois de l’Arétin, de l’Amour Conjugal et de Rabelais ; ses rapports avec ce dernier auteur m’ont même paru quelquefois si frappants que je n’ai pu résister au désir de mettre en regard de la traduction quelques passages analogues tirés de cet ouvrage.
Mais ce qui fait surtout de ce traité un livre tout à fait à part, et peut-être unique en son genre, c’est le sérieux avec lequel les questions les plus lascives et les plus obscènes sont présentées ; on voit que l’autour est persuadé de l’importance des questions qu’il y traite et que le désir d’être utile à ses semblables est le seul mobile de ses efforts.
Il n’hésite point d’ailleurs, pour donner plus de poids à ses recommandations, à multiplier les citations religieuses et, en plusieurs circonstances, il invoque l’autorité du Koran, le livre sacré par excellence chez les Musulmans.
Il y a lieu de penser que cette œuvre, sans être précisément une compilation, n’est pas due tout entière au génie du cheikh Nefzaoui et que plusieurs emprunts ont été faits à des auteurs arabes et indiens. Ainsi tout ce qui est relatif à Moçaïlama et à Chedjâ est tiré de l’ouvrage de Mohammed ben Djerir et Taberi ; les diverses positions décrites pour le coït, ainsi que les mouvements qui leur sont applicables, proviennent de livres indiens ; enfin le Traité des Oiseaux et des Fleurs, par Azeddineel Moccadecci, paraît avoir été consulté en ce qui est relatif à l’interprétation des songes. Mais on ne peut qu’approuver l’auteur d’avoir cherché à s’entourer des lumières des savants qui l’avaient précédé, et il y aurait de l’ingratitude à ne pas reconnaître les bienfaits que son livre a répandus chez un peuple encore dans l’enfance en ce qui concerne l’art d’aimer.
Il est à regretter seulement que cet ouvrage, complet sous tant de rapports, présente cependant une omission fâcheuse relativement à une habitude trop commune chez les Arabes pour ne pas mériter une attention particulière. Je veux parler de ce goût si répandu chez les Grecs et chez les Romains, et qui consiste à préférer un jeune garçon à une femme, ou bien à considérer celle-ci comme un jeune garçon.
Il y avait, à ce sujet, de bons et salutaires conseils à donner, ainsi que sur les plaisirs que prennent entre elles les femmes tribades. Le même silence est gardé par l’auteur à l’égard de la bestialité ; cependant les deux contes qu’il rapporte et qui parlent, l’un de deux femmes se caressant mutuellement, et l’autre d’une femme recherchant les caresses d’un âne, prouvent que ces genres de plaisir ne lui étaient pas inconnus : il est dès lors inexcusable de n’être pas entré dans quelques détails au sujet de ces diverses manières d’entendre l’amour. Certes, il eût été intéressant de connaître quels sont les animaux qui, en raison de leurs mœurs et de leur conformation, sont le mieux appropriés pour servir au plaisir soit de l’homme, soit de la femme, et quels peuvent être les résultats de ces accouplements.
Enfin le Cheikh garde également le silence sur les jouissances qu’est susceptible de donner la bouche ou la main d’une jolie femme, ainsi que sur les cunnilinges.
Qui a pu motiver un pareil oubli à l’égard de questions aussi intéressantes ? Le silence de l’auteur à ce sujet ne peut être attribué à l’ignorance, car, dans le cours de son ouvrage, il a donné les preuves d’une érudition trop étendue et trop variée pour qu’il soit permis de suspecter son savoir.
Faut-il rechercher la cause de cette lacune dans l’espèce de mépris qui existe réellement chez le Musulman pour la femme et qui l’amène à croire qu’il dégraderait sa dignité d’homme s’il s’abaissait à des caresses paraissant s’écarter des règles qu’a tracées la nature ? Ou bien enfin l’auteur s’est-il tu, craignant, s’il abordait de pareilles matières, de laisser présumer qu’il partageait des goûts que-beaucoup de personnes regardent comme dépravés ?
Quoi qu’il en soit, cet ouvrage, tel qu’il est, contient encore un grand nombre de renseignements utiles et de faits curieux, et j’en ai entrepris la traduction parce que, comme dit le cheikh Nefzaoui dans le préambule de son ouvrage : « J’en jure par Dieu, certes ! la connaissance de ce livre était nécessaire ; il n’y aura que l’ignorant éhonté, ennemi de toute science, qui ne le lira pas ou qui le tournera en ridicule. »
INTRODUCTION
Considérations générales sur le coït.
Louange à Dieu, qui a mis le plus grand plaisir des hommes dans les parties naturelles des femmes et qui a fait consister celui des femmes dans les parties naturelles des hommes.
Il n’a donné de bien-être aux parties des femmes, il ne leur a accordé de satisfaction et de bonheur qu’elles n’aient été pénétrées par les organes du mâle ; de mêmes les parties sexuelles du mâle n’ont ni repos ni tranquillité qu’elles ne soient entrées dans celles de la femme.
Lorsque a lieu cette opération mutuelle, ce sont, entre les deux acteurs, des ébats, des entrelacements, une sorte de combat animé. La jouissance ne tarde pas à venir, par suite du contact des parties inférieures des deux ventres. L’homme travaille comme un pilon, et la femme le seconde par des mouvements lascifs ; enfin l’éjaculation arrive !
Dieu a fait le baiser sur la bouche, sur les deux joues et sur le cou, ainsi que le sucement des lèvres fraîches, afin de provoquer l’érection à l’instant favorable. C’est lui qui, dans sa sagesse, a embelli la poitrine de la femme par les seins, son cou par un double menton, et ses joues par des joyaux et des brillants.
Il lui a donné aussi des yeux qui inspirent l’amour, avec des cils tranchants comme des glaives polis.
Il l’a douée d’un ventre rebondi, d’un nombril admirable ; les plis et les flancs en font ressortir la beauté ; il l’a dotée aussi d’une croupe majestueuse, et toutes ces merveilles sont supportées par les cuisses. C’est entre celles-ci que Dieu a placé l’arène du combat ; lorsqu’elle est abondante en chair, elle ressemble, dans son amplitude, à la tête du lion : on la nomme vulve. Oh ! quelle quantité innombrable d’hommes sont morts à cause d’elle ! et, ô douleur ! combien de héros parmi eux !
Dieu a fait à cet objet une bouche, une langue, deux lèvres ; il ressemble à l’empreinte du pied de la gazelle sur les sables du désert.
Tout cela est supporté par deux colonnes merveilleuses, témoignages de la puissance et de la sagesse de Dieu ; elles ne sont ni trop longues, ni trop courtes, et il les a ornées de genoux, de mollets, de jarrets et de talons sur lesquels reposent des anneaux précieux.
Le Tout-Puissant a ensuite plongé les femmes dans une mer de splendeurs, de voluptés et de délices ; il les a couvertes de vêtements précieux, avec des ceintures éclatantes et des sourires excitants.
Qu’il soit donc exalté et élevé Celui qui a créé les femmes et leurs beautés, avec des chairs appétissantes ; qui les a dotées de cheveux, de taille, de gorge, de seins qui se gonflent et de gestes amoureux appelant le désir.
Le Maître de l’univers leur a donné l’empire de la séduction sur tous les hommes ; faibles ou puissants, il a, sans distinction, asservi leur faiblesse à l’amour des femmes. C’est par elles qu’existent la société ou la dispersion, le séjour ou l’émigrement.
L’état d’humilité dans lequel sont tenus les cœurs de ceux qui aiment et qui sont séparés de l’objet de leur affection fait brûler leurs poitrines du feu de l’amour ; il fait peser sur eux l’asservissement, le mépris et la misère, et les soumet à toutes les vicissitudes, conséquence de leur passion : et tout cela, par suite du désir ardent du rapprochement.
Moi, Serviteur de Dieu, je lui rends grâce de ce que nul ne peut se défendre de l’amour pour les belles femmes et de ce que nul ne peut se soustraire au désir de les posséder, ni par le changement, ni par la fuite, ni par la séparation !
Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre Dieu que DIEU seul, et qu’il n’a point d’associé ! Ce témoignage, je le conserve précieusement pour le jour du jugement dernier.
Je témoigne également, en ce qui concerne notre Seigneur et notre Maître MOHAMMED, serviteur et envoyé de Dieu, le Seigneur des Prophètes (que la bénédiction et la miséricorde de Dieu soient sur lui, ainsi que sur sa famille et sur ses disciples !). Je réserve les prières et les bénédictions pour le jour de la rétribution, pour ce moment terrible.
Historique de l’ouvrage.
Ce livre magnifique, je l’ai composé après un petit livre connu sous le nom de Flambeau de l’Univers, qui concerne les mystères de la génération.
Ce dernier ouvrage avait été porté à la connaissance du Vizir et notre Seigneur ABD EL AZIZ, maître de Tunis la bien gardée.
Ce Vizir illustre était son poète, son compagnon, son ami et son secrétaire particulier. Il était judicieux, éprouvé, sagace et sage, le plus savant des gens de son temps et le plus entendu en toutes choses. Il s’appelait Mohammed ben Ouana ez Zouaoui et tirait son origine des Zouaoua. Il avait été élevé à Alger, et c’est dans cette ville qu’il avait été connu de notre seigneur Abd et Aziz el Hafsi.
Le jour de la prise d’Alger, ce Seigneur se réfugia avec lui à Tunis (que Dieu le conserve par sa puissance jusqu’au jour de la résurrection !) et il le nomma son grand Vizir.
Lorsque arriva entre ses mains le livre désigné ci-dessus, il m’envoya chercher afin que j’allasse chez lui, m’invitant à ce rendez-vous avec les plus grandes instances. Je me rendis aussitôt dans sa demeure, et il me reçut de la manière la plus honorable.
Trois jours après il vint me trouver et, me montrant mon livre, il me dit : « Voilà ton œuvre ! » Comme je rougissais, il ajouta : « N’aie pas honte, parce que tout ce que tu as dit est la vérité ; il n’y a de quoi effrayer personne dans tes paroles. Tu n’es point d’ailleurs le premier de ceux qui ont traité de cette matière, et, j’en jure par Dieu ! certes, la connaissance de ce livre était nécessaire, il n’y aura que l’ignorant éhonté et ennemi de toute science qui ne le lira pas ou le tournera en ridicule. Mais il te reste encore plusieurs choses à dire. » Je lui demandai quelles étaient ces choses ; il me répondit : « Je désire que tu ajoutes dans cet ouvrage un supplément dans lequel tu traiteras des remèdes dont tu n’as pas parlé, en y joignant les faits qui s’y rattachent, sans omettre aucun détail. Tu y décriras les motifs de l’acte de la génération, ainsi que les choses qui peuvent y mettre obstacle. Tu mentionneras également, dans cet ouvrage, les remèdes pour dénouer l’aiguillette et ceux qui augmentent les dimensions des petits membres et les rendent superbes. Tu citeras ceux qui enlèvent la mauvaise odeur des aisselles et des parties naturelles de la femme et ceux qui rétrécissent ces partie. Tu parleras également de la grossesse des femmes, de manière que ton livre soit complet, sans omettre aucune chose. Enfin, tu auras atteint ton but si ce livre satisfait tous les désirs. »
Je répondis au Vizir : « Ô notre maître ! tout ce que tu as décrit n’est pas difficile à exécuter, s’il plaît à Dieu très élevé !.
Je me suis mis aussitôt à l’œuvre pour la composition de cet ouvrage, en implorant le secours de Dieu (qu’il répande sa bénédiction sur son prophète ! que le salut et la miséricorde soient avec lui ! »
J’ai appelé ce livre le JARDIN PARFUMÉ POUR LE DÉLASSEMENT DE L’ESPRIT (Er Roud el âater fi nezaha el khater).
Et Dieu, qui dispose tout pour le bien (et il n’y a d’autre Dieu que lui, et il n’y a de bien que celui qui provient de lui !), nous lui demandons de nous aider de son appui et de nous diriger dans la bonne voie. Car il n’y a de force et de jouissance qu’en Dieu le très élevé, le très puissant.
J’ai divisé cet ouvrage en vingt et un chapitres, afin d’en faciliter la lecture au taleb (l’étudiant, celui qui désire la science) et de lui permettre de trouver facilement la matière qu’il désire. Chaque chapitre est relatif à un objet particulier, soit médicamentation, soit anecdotes, soit enfin ruses et trahisons des femmes.
Apprends, ô Vizir (que la bénédiction de Dieu soit sur toi), que les hommes et les femmes sont de diverses espèces ; que parmi eux il y en a qui sont dignes d’éloges, comme il y en a qui méritent des reproches.
Lorsqu’un homme méritant se trouve près des femmes, son membre grossit, devient fort, vigoureux et dur ; il est lent à éjaculer et, après le tressaillement causé par la sortie du sperme, il est prompt à l’érection.
Un pareil homme est goûté et apprécié par les femmes, parce que la femme n’aime l’homme que pour le coït ; il faut donc que son membre soit riche en dimensions, qu’il soit long pour la jouissance ; que cet homme ait en outre la poitrine légère et la croupe pesante ; qu’il soit maître de son éjaculation et prompt à entrer en érection ; que son membre pénètre au fond du canal de la femme, le bouche complètement et y adhère dans toutes ses parties. Celui-là sera le bien-aimé des femmes, car le poète a dit :
Qualités que les femmes recherchent chez les hommes.
On raconte qu’un certain jour Abd el Melick ben Merouane alla trouver Leïlla, sa maîtresse, et lui posa des questions sur beaucoup de choses. Entre autres, il lui demanda quelles étaient les qualités que les femmes recherchaient dans les hommes.
Leïlla lui répondit : « Ô mon maître, il faut qu’ils aient des joues comme les nôtres. » – « Puis quoi ensuite ? » dit Ben Merouane. Elle ajouta : « Et des cheveux semblables aux nôtres ; enfin il faut qu’ils soient pareils à toi, ô prince des croyants ; car, certes ! l’homme, à moins qu’il ne soit puissant et riche, n’obtiendra rien des femmes. »
Diverses longueurs du membre viril.
Les membres virils, pour plaire aux femmes, doivent avoir en longueur, au plus, douze travers de doigt, c’est-à-dire trois poignées, et, au moins, six travers de doigt ou une poignée et demie.
Il y a des hommes dont le membre atteint douze doigts ou trois poignées, d’autres, dix doigts ou deux poignées et demie. D’autres enfin ont huit doigts ou deux poignées. L’homme dont le membre reste au-dessous de cette dimension ne peut être agréable aux femmes.
Utilité des parfums pour le coït. – Histoire de Moçaïlama.
L’usage des parfums, pour la femme comme pour l’homme, excite à l’acte du coït. La femme, en respirant les senteurs dont s’est parfumé l’homme, entre en pâmoison, et souvent l’emploi des odeurs a été un puissant auxiliaire pour l’homme et lui a permis d’arriver à la possession de la femme.
On raconte, à ce sujet, que Moçaïlama l’imposteur, fils de Kaïss (que Dieu le maudisse !) prétendait avoir le don de prophétie, et qu’il imitait le prophète de Dieu (que la bénédiction et le salut soient sur lui !). À cause de cela, lui et un grand nombre d’Arabes ont encouru la colère du Tout-Puissant.
Moçaïlama, fils de Raïs, l’imposteur, dénatura en outre le Koran par ses mensonges et par ses impostures, et, au sujet d’un chapitre du Koran que l’ange Gabriel (que le salut soit sur lui !) avait apporté au Prophète (que la miséricorde de Dieu et le salut soient sur lui !), des gens de mauvaise foi étaient venus trouver Moçaïlama, qui leur avait dit : « À moi aussi, l’ange Gabriel m’a apporté un chapitre pareil. »
Il tournait en dérision le chapitre intitulé l’Éléphant. Il disait : « Dans le chapitre l’Éléphant, je vois l’éléphant. Qu’est-ce que c’est que l’éléphant ? Qu’est-ce qu’il signifie ? Qu’est-ce que ce quadrupède ? Il a une queue, et un bout de queue, et une longue trompe. Certes ! c’est une des créations de notre Dieu le magnifique. »
Le chapitre du Koran nommé le Kouter était également l’objet de ses controverses. Il disait : « Nous t’avons donné des pierreries pour que tu les choisisses pour toi-même et de préférence à tout autre, mais garde-toi d’en tirer de l’orgueil. »
Moçaïlama avait dénaturé ainsi divers chapitres du Koran par ses mensonges et ses impostures.
Il était encore occupé de cela lorsqu’il entendit parler du Prophète (que le salut et la miséricorde de Dieu soient sur lui !). Il apprit que lorsqu’il avait posé ses mains vénérables sur une tête chauve, les cheveux repoussaient aussitôt ; que s’il crachait dans un puits, l’eau arrivait en abondance, et que si elle était salée, elle devenait à l’instant bonne et douce à boire ; que s’il crachait dans un œil borgne ou atteint d’ophtalmie, la vue lui était immédiatement rendue ; que s’il portait ses mains sur la tête d’un enfant en lui disant : « Vis un siècle », l’enfant vivait cent ans.
Lorsque les disciples de Moçaïlama virent ces faits ou en entendirent parler, ils vinrent à lui et lui dirent : « N’as-tu pas connaissance de Mohammed et de ce qu’il fait ? » Il leur répondit : « Je ferai mieux que cela. »
Or Moçaïlama était un ennemi de Dieu, et, s’il posait sa malheureuse main sur la tête de quelqu’un qui avait peu de cheveux, celui-ci devenait chauve aussitôt ; s’il crachait dans un puits où il y avait peu d’eau, de douce qu’elle était, elle devenait salée, et cela par la volonté de Dieu ; enfin, s’il crachait dans un œil malade, cet œil perdait la vue à l’instant ; et s’il posait la main sur la tête d’un enfant en lui disant : « Vis cent ans », l’enfant mourait sur l’heure.
Voyez, ô mes frères, ce qui arrive à ceux dont les yeux restent fermés à la lumière et qui sont privés du secours du Tout-Puissant !
Et ainsi a agi cette femme des Beni-Temim, nommée Chedjâ et Temimia, qui se prétendait prophétesse : elle entendit parler de Moçaïlama, et de même ce dernier entendit parler d’elle.
Cette femme était puissante, car les Beni-Temin formaient une troupe nombreuse. Elle disait : « La prophétie ne convient pas à deux personnes. Il faut que lui soit prophète, et alors je suivrai ses lois ainsi que mes disciples ; ou bien moi je serai prophétesse, et lui et ses disciples suivront mes lois. »
Ceci arriva après la mort du Prophète de Dieu (que le salut et la miséricorde de Dieu soient sur lui !).
Chedjâ écrivit alors à Moçaïlama une lettre dans laquelle elle lui disait : « La prophétie ne peut convenir à deux personnes simultanément, mais seulement à une seule ; nous nous réunirons et nous nous examinerons mutuellement, nous et nos disciples. Nous discuterons sur ce que Dieu a fait descendre sur nous » (le Koran), « et celui qui sera reconnu pour être le véritable prophète, nous suivrons ses lois. »
Elle ferma ensuite sa lettre, la donna à un courrier en lui disant : « Rends-toi avec cette missive à el Yamama, et remets-la à Moçaïlama ben Kaïs ; quant à moi, je marche sur tes pas avec l’armée. »
Le jour suivant, la prophétesse monta à cheval avec son goum et marcha sur les traces de son envoyé. Lorsque ce dernier arriva près de Moçaïlama, il le salua et lui présenta la lettre.
Moçaïlama l’ouvrit, la lut, et il en comprit le contenu ; il fut consterné de ce qui arrivait et se mit à prendre conseil des gens de son goum les uns après les autres : mais il ne vit rien dans leurs avis ou dans leurs idées qui pût le tirer d’embarras.
Comme il était ainsi perplexe, voilà qu’un des hommes considérables de son goum s’avança vers lui et lui dit : « Ô Moçaïlama, calme ton esprit et rafraîchis ton œil. Je vais te donner le conseil d’un père à son fils. »
Moçaïlama lui dit : « Parle, et que tes paroles soient sincères ! »
Il dit alors : « Dans la matinée de demain, élève hors de la ville une tente de brocards de diverses couleurs et ornée de meubles de soie et de toutes espèces. Remplis-la ensuite de parfums délicieux de diverses natures, d’ambre, de musc et de toutes les odeurs, comme la rose, la fleur d’oranger, la jonquille, le jasmin, la jacinthe, l’œillet et autres plantes semblables. Cela fait, tu placeras dans la tente des cassolettes d’or remplies de parfums divers, comme l’aloès vert, l’ambre gris, le nedde et autres odeurs suaves. Cela fait, tu lâcheras les cordons de la tente, de manière que rien ne sorte au dehors de ces parfums. Puis, lorsque tu verras leur vapeur devenue assez intense pour en imprégner l’eau, assieds-toi sur ton trône et envoie prévenir la prophétesse, afin qu’elle vienne te trouver dans la tente où elle sera seule avec toi. Quand vous serez ainsi réunis tous les deux et qu’elle sentira les parfums, elle se délectera, tous ses os se relâcheront dans un mol abandon ; enfin elle se pâmera. Après l’avoir possédée, tu seras délivré de l’embarras qu’elle te cause avec son goum. »
Moçaïlama s’écria : « Tu m’as dit une bonne chose. Par Dieu ! ce conseil est favorable et l’avertissement salutaire. » Il fit ensuite tout ce que lui avait dit le Cheikh.
Dès qu’il vit la vapeur des parfums devenue assez intense pour imprégner l’eau qui se trouvait dans la tente, il s’assit sur son trône et fit prévenir la prophétesse. Lorsqu’il la vit s’avancer vers lui, il ordonna de la faire entrer sous sa tente ; elle entra, et il resta seul avec elle. Il l’engagea à parler.
Pendant que Moçaïlama lui adressait la parole, elle perdait toute présence d’esprit : elle était interdite et comme stupéfaite.
Lorsqu’il la vit dans cet état, il comprit qu’elle désirait le coït ; il lui dit : « Allons, lève-toi pour que je te possède, cet endroit a été préparé à ton intention. Si tu le désires, tu te coucheras sur le dos ou bien tu te mettras à quatre pattes, ou enfin tu prendras la position de la prière, à genoux, le front courbé dans la poussière et la croupe en l’air, formant ainsi le trépied. Quelle que soit la position qui te convienne, parle, tu seras satisfaite. »
La prophétesse répondit : « Je veux de toutes les manières. Fais descendre en moi la révélation de Dieu, ô prophète du Tout-Puissant. »
À ce moment, il se jeta sur elle et en jouit à son gré ; puis elle lui dit : « Dès que je sortirai d’ici, demande-moi en mariage à mon goum. »
Lorsqu’elle eut quitté la tente et qu’elle se rencontra avec ses disciples, ceux-ci lui dirent : « Quel est le résultat de la conférence ? ô prophétesse de Dieu ! » Elle répondit : « Moçaïlama m’a montré ce qui lui avait été révélé, et j’ai trouvé que c’était la vérité : ainsi, obéissez-lui. »
Moçaïlama la demanda alors en mariage à son goum, qui la lui accorda. Lorsque le goum l’interrogea sur la dot de la future épouse, il lui répondit : « Je vous dispense de la prière de l’aceur » (qui a lieu à trois ou quatre heures). C’est depuis cette époque que les Beni-Temim ne prient plus à ce moment de la journée, et lorsqu’ils sont interrogés à cet égard, ils répondent : « C’est à cause de notre prophétesse : elle seule connaît le chemin de la vérité. » Et, en effet, ils ne reconnaissent d’autre prophète qu’elle.
C’est à ce sujet qu’un poète a dit :
La mort de Moçaïlama fut annoncée par la prophétie d’Abou Beker (que Dieu lui soit favorable !). Il fut, en effet, tué par Xeïdben Khettah ; d’autres disent que ce fut par Ouhcha, un de ses disciples. Or Dieu sait que ce fut, en effet, Ouhcha. Celui-ci a même dit à ce sujet : « J’ai tué, dans mon ignorance, le meilleur des hommes, Hamza ben Abd el Motaleb, et j’ai ensuite tué le plus mauvais des hommes. Moçaïlama. J’espère que Dieu me pardonnera une de ces actions en considération de l’autre. »
Le sens de ces paroles : « J’ai tué le meilleur des hommes dans l’ignorance » est que lorsque Ouhcha n’avait point encore reconnu le Prophète, il avait tué Hamza (que Dieu lui soit favorable !) et, après avoir embrassé l’islamisme, il tua Moçaïlama.
Quant à Chedjâ et Temimia, elle se repentît par la grâce de Dieu très élevé ; elle devint Musulmane, et elle épousa un des sectateurs du Prophète (que Dieu soit favorable à son mari !).
Ainsi se termine l’histoire.
Le méritant parmi les hommes, aux yeux des femmes, est celui qui sera empressé auprès d’elles. Il faut que, recherché dans sa tenue, il se distingue par sa beauté de ceux qui l’entourent, qu’il ait la taille gracieuse et la tournure séduisante ; que, véridique auprès des femmes, il soit toujours sincère dans ses paroles ; qu’il soit généreux, brave ; qu’il ne tire point vanité de lui-même et que son commerce soit agréable. Il doit être esclave de sa parole ; s’il fait une promesse, il doit n’y point manquer, il doit dire toujours la vérité et ne point faillir à ce qu’il a annoncé.
Celui qui tire vanité de ses relations avec les femmes, de leur connaissance et de leur amitié, celui-là est un homme méprisable. Il sera question de lui dans le chapitre suivant.
On raconte qu’il y avait autrefois un roi nommé Mamoun, qui avait un bouffon que l’on appelait Bahloul, lequel servait d’amusement aux princes et aux vizirs.
Un certain jour, ce bouffon se présenta chez Mamoun, qui était occupé à se divertir. Le roi lui ordonna de s’asseoir, et après qu’il se fut assis devant lui, il lui dit en détournant la tête : « Pourquoi es-tu venu, ô fils de la débauchée ? » Bahloul lui répondit : « Je suis venu pour savoir ce qui est arrivé à notre Seigneur (que Dieu le rende victorieux !). »
« Et que t’est-il arrivé, à toi ? reprit le roi, et comment te comportes-tu avec ta nouvelle et ton ancienne femme ? » Car Bahloul, ne se contentant pas de sa première femme, en avait épousé une seconde.
« Je ne suis heureux, ô notre maître, dit-il, ni avec l’ancienne, ni avec la nouvelle ; en outre, la pauvreté m’accable. »
Le roi lui dit : « Peux-tu me réciter quelques vers à ce sujet ? »
Le bouffon lui ayant répondu affirmativement, Mamoun lui ordonna de réciter ce qu’il savait, et Bahloul commença ainsi avec la parole de la poésie :
Mamoun lui dit : « Où iras-tu ? »
Il répondit : « Vers Dieu et son Prophète, ô prince des croyants. »
« C’est bien ! reprit le roi. Celui qui se réfugie vers Dieu et vers son Prophète, et ensuite vers nous, nous l’accueillons. Mais peux-tu me dire encore quelques vers au sujet de tes deux épouses et sur ce qui t’est arrivé avec elles ? »
« Assurément », dit Bahloul.
« Eh bien ! fais-nous entendre ce que tu sais », dit le roi.
Bahloul commença alors ainsi, avec la parole de la poésie :
Lorsque Mamoun entendit ces paroles, il se prit à rire au point de se renverser en arrière. Puis, voulant donner à Bahloul une preuve de sa bonté, il lui fit présent de sa robe dorée, le plus beau des vêtements.
Bahloul partit, l’esprit joyeux, se dirigeant du côté de la demeure du grand vizir. Or il arriva que Hamdouna, du haut de son palais, tourna ses regards de son côté et le vit. Elle dit à sa négresse : « Par le Dieu du temple et de la Mecque ! voilà Bahloul revêtu d’une belle robe dorée. De quel stratagème pourrai-je bien me servir pour me la procurer ? »
La négresse lui dit : « Ô ma maîtresse, cette robe, tu ne saurais la prendre. »
Hamdouna lui répondit : « J’ai imaginé une ruse à ce sujet, et je lui soustrairai sa robe. »
« Bahloul est un homme rusé, reprit la négresse. On croit généralement se moquer de lui, et, par Dieu ! c’est lui qui se moque des autres. Abandonne ton dessein, ô ma maîtresse, et crains qu’il ne te fasse tomber dans le piège que tu veux lui tendre. »
Mais Hamdouna répliqua : « Il faut que cela se fasse ! » Puis elle envoya sa négresse avec Bahloul, pour lui dire qu’il eût à venir à elle. Celui-ci dit : « Par la bénédiction de Dieu ! celui qui t’appelle, réponds-lui », et il se présenta devant Hamdouna.
Hamdouna le salua et dit : « Ô Bahloul, je crois que tu es venu ici pour m’entendre chanter. » Il répondit : « Assurément, ô maîtresse. » Or elle avait un talent merveilleux pour le chant. Puis elle ajouta : « Je crois aussi qu’après avoir entendu mes chants, tu consentiras à prendre quelque nourriture. » – « Oui », répondit-il.
Elle se mit alors à chanter d’une manière admirable, et tous ceux qui l’auraient entendue seraient morts d’amour.
Lorsque Bahloul eut entendu ses chants, elle lui fit servir des rafraîchissements ; il mangea et il but. Elle lui dit ensuite : « Je ne sais pourquoi je me figure que tu te dépouilleras volontiers de ta robe pour m’en faire don. » Bahloul répondit : « Ô ma maîtresse, j’ai fait le serment de ne la donner qu’à la personne à laquelle j’aurai fait ce que l’homme fait à la femme. »
« Quoi ! tu sais ce que c’est, ô Bahloul ? » reprit-elle.
« Comment ! je l’ignorerais ? dit-il, moi qui instruis à ce sujet les créatures de Dieu ! C’est moi qui les fais accoupler par l’amour, qui leur enseigne quels sont les plaisirs de la femme, comment il faut la caresser, quelles sont les choses qui l’excitent et qui la satisfont. Ô ma maîtresse ! qui donc connaîtrait l’art du coït féminin, si ce n’est moi ? »
Cette Hamdouna était fille de Mamoun et épouse du grand vizir. Elle était douée de la beauté la plus parfaite ; elle éblouissait par sa taille et par l’harmonie de ses formes. Personne, au monde, dans son temps, ne la surpassait en grâce, en éclat et en perfection. Si des héros la voyaient, ils demeuraient humbles et soumis et baissaient les yeux vers la terre, de crainte de tentation, tellement Dieu très élevé avait été prodigue envers elle de charmes et de perfections. Celui d’entre les hommes qui fixait son regard sur elle tombait dans le trouble, et, à cause d’elle, combien de héros ont été mis en péril ! Bahloul avait toujours évité de la rencontrer, craignant de succomber à la tentation. Elle l’avait envoyé chercher pour qu’il vienne à elle, et, comme il craignait pour son repos, il n’y avait jamais été, si ce n’est dans la circonstance présente.
Bahloul se mit à converser avec elle. Tantôt il la regardait et tantôt il baissait les yeux vers la terre, craignant de ne pouvoir commander à sa passion. Hamdouna, elle, brûlait du désir d’avoir la robe, et lui ne voulait pas la céder sans en avoir reçu le prix. Elle lui demanda : « Quel est ce prix que tu exiges ? » À quoi il répondit : « Le coït, ô prunelle de mes yeux ! » – « Tu connais cela, ô Bahloul ? » lui dit-elle. – « Par Dieu ! s’écria-t-il, personne ne connaît les femmes mieux que moi ; c’est l’occupation de ma vie. Personne n’a étudié ce qui les concerne autant que moi. Je sais ce qu’elles aiment ; car apprends, ô ma maîtresse, que les hommes, dans ce monde, s’adonnent à diverses occupations, en raison de leur esprit et de leurs idées. Celui-ci prend, celui-là donne ; celui-ci vend, celui-là achète. Pour moi seul, toutes ces choses sont sans attraits. Ma seule pensée, c’est l’amour et la possession des belles femmes. Je guéris celles qui ont des maladies d’amour et j’apporte un soulagement à leurs vulves avides. »
Hamdouna s’étonnait des paroles de Bahloul et de la douleur de son langage. Elle lui dit : « Pourrais-tu me réciter quelques vers à ce sujet ? » Il lui répondit : « Certainement. » – « Eh bien ! dit-elle, ô Bahloul, fais-nous entendre ce que tu as à nous dire. »
Bahloul récita les vers suivants :
Lorsque Hamdouna eut entendu ces paroles elle se pâma et se mit à examiner le membre de Bahloul, qui était en érection entre ses cuisses comme une colonne. Tantôt elle se disait : « Je me donnerai à lui » ; et tantôt : « Je ne lui céderai pas. » Pendant cette incertitude, la jouissance se fit pressentir entre ses cuisses, et Éblis fit couler entre ses parties naturelles la liqueur avant-courrière du plaisir. Elle ne résista plus alors au plaisir du coït et se rassura en se disant intérieurement : « Si ce Bahloul, après avoir joui de moi, vient à le divulguer, personne n’ajoutera fois à ses paroles. »
Elle le pria alors d’ôter sa robe et d’entrer dans le cabinet, mais Bahloul lui répondit : « Je ne m’en dépouillerai que lorsque j’aurai assouvi mon désir, ô prunelle de mes yeux ! »