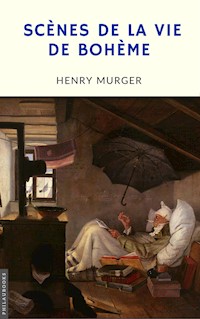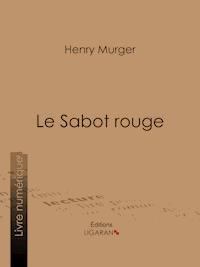
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Gros, court, la face pulpeuse, rouge et brûlée comme une feuille de vigne aux derniers soleils de l'automne, le fermier justifiait au premier examen la réputation qu'il possédait dans le pays. Il suffisait de le voir une fois pour qu'on devinât en lui le satyre rustique qui existe dans tous les villages et fait pendant au prêteur sur hypothèques."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALEXANDRE DUMAS FILS
Saint-Clair est un village d’environ cent cinquante feux, situé sur la lisière de la forêt de Fontainebleau, où se trouvent de nombreux gisements de grès qui depuis longtemps suffisent à l’entretien du pavé de Paris.
Comme dans tous les pays où la nature particulière du sol a créé une industrie spéciale, l’exploitation des carrières de grès est devenue pour les riverains de la forêt une sorte de métier naturel. Aussi, dès qu’un enfant commence à avoir l’âge du travail, on l’envoie au rocher comme on l’enverrait à la mer dans les provinces du littoral maritime, ou aux mines dans les départements qui produisent la houille. Mais, si les travaux dans la carrière exigent peu d’apprentissage, ils réclament en revanche une grande dépense de forces, et, outre les dangers accidentels, comme les éboulements ou les explosions, ils sont soumis à des influences pernicieuses dont la science a constaté les effets. L’impalpable pulvérin de grès qui se dégage des blocs, lorsqu’on les débite, pénètre dans les organes et peut, avec le temps, déterminer des altérations assez graves pour causer la mort. Les ouvriers qui travaillent aux carrières appellent cette affection la maladie du sable.
Cependant, malgré les dangers inhérents au métier, l’exploitation du grès manque rarement de bras ; car, dans un pays de petite propriété où chacun possède à peine son toit et son champ, dont le rapport est insuffisant pour assurer l’existence, l’habitant pauvre trouve une ressource dans une occupation où le salaire relativement élevé, compense à ses yeux les périls et les fatigues du labeur.
À cette industrie, dont vivent un grand nombre de familles, les hameaux situés dans le rayon de la forêt de Fontainebleau en ajoutent une autre non moins productive, mais plus dangereuse, puisqu’elle place ceux qui s’y livrent en état permanent d’hostilité avec la loi. Nous voulons parler du braconnage, délit aussi commun dans le voisinage des forêts que la contrebande peut l’être à la frontière, et d’autant plus difficile à réprimer, qu’il trouve presque un encouragement chez les gens même qui craindraient de le commettre. – Si active que soit la surveillance des agents spéciaux, si bien armée de peines sévères que puisse être la législation, il est des pays où elle ne pourra jamais détruire complètement le braconnage ; car il est des pays où cette industrie occulte est une tradition héréditaire, une sorte de passion native du sol même.
Le village de Saint-Clair était noté dans toutes les garderies du canton comme recélant le plus grand nombre de braconniers. Voisin de l’une des parties les plus giboyeuses de la forêt, et entouré de toutes parts par une agglomération de bois communaux, la position accidentée de ce hameau en rendait la surveillance plus difficile qu’ailleurs. Aussi, de tous temps, Saint-Clair avait-il été un véritable nid de maraudeurs. Il n’était point de maison où ne se trouvât, dans un coin mystérieux, quelque engin prohibé dont les enfants même ne fussent en état de faire usage. – Malgré l’évidente complicité de presque tous les habitants de Saint-Clair, il était rare que les gardes de l’État pussent constater quelque délit dont la répression vînt servir d’exemple, et ceux des particuliers se bornaient à faire leur devoir sans y ajouter le zèle. Quant à la gendarmerie, lorsqu’elle était requise pour quelque expédition au hameau de Saint-Clair, elle y marchait dans l’attitude d’une troupe qui va à l’ennemi, le sabre au poing et la carabine armée. Ces précautions étaient justifiées d’ailleurs par la résistance que l’autorité avait souvent rencontrée dans ce pays, où l’on parle encore avec enthousiasme du siège soutenu pendant un jour et une nuit dans l’auberge du Sabot rouge par dix braconniers contre toute la brigade de gendarmerie du canton, obligée de recourir à l’assistance d’un détachement de la garnison pour avoir raison des mutins. Cette affaire, dans laquelle le sang avait coulé, envoya aux assises sept ou huit personnes, parmi lesquelles deux furent condamnées au bagne. On put croire pendant quelque temps que les habitants de Saint-Clair étaient disposés à s’amender ; mais, si les rigueurs de la justice les avaient d’abord frappés d’intimidation, l’habitude, plus forte que la crainte, les ramena bientôt au mépris de la loi ; et, deux ans après le siège du Sabot rouge, les choses en étaient revenues au point où elles se trouvaient auparavant.
Cette auberge du Sabot rouge était plutôt un cabaret qu’une hôtellerie, car Saint-Clair n’étant pas un endroit de communication, le passage d’un voyageur n’y est point un fait familier. Ceux que le hasard y amenait, trouvaient bien juste le gîte et le repas, encore fallait-il qu’ils ne se montrassent pas exigeants. La clientèle ordinaire se composait des ouvriers carriers qui, avant de se rendre au chantier, c’est ainsi qu’on désigne la carrière, entraient au cabaret pour y boire l’eau-de-vie ou le vin blanc, libation matinale dont l’usage, resté fréquent parmi les ouvriers, a donné naissance au dicton proverbial : tuer le ver. Le dimanche et les jours fériés, les paysans venaient jouer aux boules sur un terrain préparé ; le soir, la jeunesse du pays s’y rassemblait, à la danse, dans une sorte de grange qui servait encore de salle de spectacle, où les charlatans et les saltimbanques forains obtenaient quelquefois du maire la permission de venir débiter leurs drogues ou donner une représentation du théâtre des marionnettes.
Le Sabot rouge était tenu par les époux Pampeau, et le sieur Eustache Pampeau, lui-même, avait dans le village la réputation d’être la meilleure pratique de son cabaret. Né d’ailleurs à l’ombre de la côte dorée où mûrissent les grands crus qui sont l’honneur de la vigne bourguignonne, il semblait avoir dans le gosier un morceau de cette éponge altérée, qu’un préjugé bachique partageait jadis entre l’ordre des Templiers et la corporation des sonneurs. Doué d’une de ces robustes santés pour lesquelles l’excès est peut-être une hygiène, Eustache Pampeau, qui à cinquante ans n’avait jamais été malade, rappelait à l’imagination un de ces frères quêteurs des abbayes rabelaisiennes, montrant sous le capuchon monacal une large face de silène, où brilla l’œil émerillonné du satyre.
Pendant les premiers temps de leur mariage, sa femme avait essayé de le corriger de son penchant à l’ivresse, si nuisible aux intérêts de leur maison ; mais toutes les remontrances qu’elle avait pu lui faire étant restées sans résultat, elle avait renoncé à d’inutiles querelles et laissait Pampeau vivre à son aise en compagnie des liquides de son établissement. Le cabaretier savait, au reste, jusqu’à un certain point, concilier sa passion avec le devoir et faisait exception avec les gens chez qui l’usage immodéré de la boisson engendre l’habitude de la paresse. Chez lui, l’ivresse même n’excluait ni le goût ni la possibilité du travail, et il mettait une sorte d’amour-propre à prouver à sa femme, lorsque celle-ci le gourmandait, que le gain qu’il retirait de son métier de tisserand pouvait nourrir ou plutôt abreuver son vice.
À l’exemple des clients du Sabot rouge qui inscrivaient leurs dépenses non payées sur une ardoise, Pampeau, ne sachant ni lire ni écrire, s’était ouvert un compte particulier sur un de ces cadres destinés dans les cafés à marquer les points des joueurs au billard. La double rangée de billes rouges et blanches qu’on fait glisser sur une tringle lui servait à désigner le nombre des litres de vin ou des petits verres qu’il consommait. Eustache apportait la plus grande probité dans cette tenue de livres originale. Dès qu’il avait épuisé les deux séries de billes du marquoir, il se débitait auprès de sa femme du chiffre qu’elles représentaient et en recommençait une nouvelle ; il appelait cela tourner la page. Bien qu’il eût confiance en sa solvabilité, il était rare qu’il laissât grossir sa dette, et lorsqu’il avait renouvelé deux ou trois fois le marquoir, il venait, selon son expression, ressusciter Crédit en se payant lui-même entre les mains d’Héloïse Pampeau, sa femme, que, dans cette circonstance, il obligeait à le régaler d’une tournée hors de compte.
Cependant cette double personnalité de cabaretier et d’ivrogne donnait quelquefois naissance à des épisodes bizarres. Lorsqu’il arrivait à Pampeau de laisser attarder le règlement de son compte, il s’emportait en de belles colères contre son inexactitude et reprochait à sa femme de se montrer trop complaisante envers les mauvaises pratiques. Au milieu de son ivresse, il se préoccupait d’être son débiteur, et cette idée suffisait pour lui faire trouver son vin amer. Un huissier de Nemours racontait que dans une de ces circonstances, il avait un jour reçu la visite d’Eustache, lequel était furieux contre lui-même et voulait se faire assigner chez le juge de paix au payement d’une somme arriérée.
En réalité, la plus grande place occupée par Pampeau dans sa propre maison était encore celle tenue par son verre, et sa seule manière de se rendre utile dans son cabaret consistait à en être la vivante enseigne. Hors les heures qu’il passait quotidiennement à faire courir la navette sur le métier, il n’était bon à rien. Propriétaire d’un bout de jardin attenant à sa maison et de quelques perches dispersées sur le terroir de la commune, il ne lui arrivait pas deux fois dans l’année d’y mettre le pied. – Si c’était de la vigne, disait-il à sa femme, passe encore, je suis Bourguignon ; mais des légumes, c’est dans le département du pot-au-feu, cela te regarde. Aussi laissait-il à Héloïse tous les soins du ménage, tous les soucis du commerce ; il ne l’aidait point même dans les travaux de force qui réclament le bras d’un homme.
Néanmoins les deux époux vivaient en assez bonne intelligence ; Pampeau avait, d’ailleurs, quelques-unes des qualités de son vice. Doué d’une nature franche, il était d’une intarissable bonne humeur, et, le verre en main, il savait trouver d’heureuses saillies qui, le soir, couraient les veillées et flattaient l’amour-propre de sa femme, lorsqu’elle les entendait répéter en allant emplir ses seaux au puits communal, besogne fatigante que son mari lui abandonnait comme toutes les autres, sous le prétexte ingénieux qu’un marchand de vin ne pouvait aller puiser de l’eau sans paraître suspect à ses voisins.
Pampeau était, en outre, cité dans le pays pour l’étendue extraordinaire de sa voix, dont l’énorme volume reculait la limite d’extension ordinairement assignée au son humain. Cette particularité, qui lui aurait permis de rendre l’écho poitrinaire, lui fournissait souvent l’occasion de prélever un impôt sur la curiosité des gens des environs. Le rustique Stentor pariait de briser les vitres d’une chambre fermée en chantant à franc gosier le refrain favori, dans lequel se résumait sa philosophie :
Lorsqu’on lui tenait le pari, arrosé avec abondance, sur le dernier vers de ce couplet, Eustache lançait une note inconnue au registre vocal, mais qui avait, en effet, sur les objets fragiles la puissance d’une détonation. Sous le choc de cette vibration pénétrante et prolongée, non seulement les vitres éclataient, mais encore tous les ustensiles ménagers contenus dans les dressoirs et dans les buffets. Les assiettes et les verres, les cuivres et les ferrailles, tous les corps mis brutalement en contact avec l’éclat de ce poumon d’airain, réveillaient leurs sonorités particulières et formaient un chœur de bruits étranges, qui semblait saluer dans la personne d’Eustache Pampeau le démon du charivari.
En sa qualité de beau chanteur, le cabaretier du Sabot rouge était le premier invité à toutes les noces qu’on célébrait non seulement à Saint-Clair, mais dans toutes les communes environnantes, à deux et trois lieues à la ronde. Eustache pouvait d’ailleurs mettre son riche organe au service d’un répertoire varié qui lui permettait, selon les circonstances et selon le précepte, de passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Sa mémoire musicale était meublée de chants en l’honneur des braves et de chants en l’honneur des belles. Il alternait volontiers la romance sentimentale, usée sur les orgues de Paris, avec un des noëls bourguignons de son compatriote Lamonnoye ou avec quelques-uns de ces rondeaux bachiques dont les rimes, ayant le goût un peu salé du terroir gaulois, faisaient d’eux-mêmes sauter les bouchons des bouteilles.
Quelquefois, au milieu du silence nocturne, troublé lugubrement par les cris des oiseaux des ténèbres, les gens de Saint-Clair qui rentraient tardivement du marché, en pressant du fouet ou du talon l’allure de leur mule paresseuse ou de leur âne rétif, entendaient venir au-devant d’eux, sur les chemins de la forêt, l’écho d’une voix chantant avec la sereine conviction que donne l’ivresse :
S’arrêtant un moment sur la route déserte, ils portaient alors à leur oreille leur main à demi fermée, en forme de cornet à recueillir le son, et, selon le point éloigné d’où leur arrivait ce refrain qui pouvait, sans altérer sa sonorité, traverser les fureurs du vent d’équinoxe, ils se disaient entre eux : Il y a ce soir une noce à Sorques ou à Récloses.
C’était en effet Eustache Pampeau lui-même, installé sans doute à quelque repas nuptial, et se torchant la bouche à la nappe du souper, où il payait son écot de bonne humeur en brisant avec sa note fantastique la vaisselle du nouveau ménage.
Au retour de ces liesses matrimoniales, prolongées par l’usage jusqu’à une heure avancée de la nuit, il arrivait souvent que le cabaretier du Sabot rouge, ayant laissé son équilibre au fond des gobelets, s’égarait sur les routes ou dans les chemins de traverse. La première pierre où buttait son pied chancelant lui servait d’oreiller, et une heure de sommeil sur l’humide rosée avait sur son ivresse une vertu pareille à celle que les anciens attribuaient à la plante du lierre dont ils se couronnaient le front pendant les festins. On sait que le proverbe a créé une divinité spécialement préposée à la protection des ivrognes. Ce n’était pas seulement un Dieu, mais tout un Olympe qui surveillait Pampeau, et le préservait des accidents de toute nature provoqués par l’intempérance. Aussi en était-il arrivé à nier le danger, et disait-il quelquefois, en imitant un mot resté populaire :
– Le pavé sur lequel je dois me fendre la tête n’est pas encore taillé.
Un jour, il reçut cependant un avertissement qui altéra sa sécurité. Revenant, une nuit du mois de novembre, d’un hameau voisin où on l’avait convié à fêter la première cuvée de la vendange, en arrivant à la fourche formée par deux chemins dont l’un devait le ramener chez lui, Eustache, égaré dans le double brouillard de l’ivresse et de la nuit, prit un sentier opposé, au bout duquel il sentit tout à coup le terrain devenir mouvant et humide sous ses pieds. Il était entré dans une sorte de mare où l’on menait les bestiaux s’abreuver. Les efforts qu’il tenta instinctivement pour se retirer l’enfonçaient encore davantage dans la marne vaseuse de l’abreuvoir, où les pluies diluviennes de l’automne avaient répandu assez d’eau pour qu’un homme peut s’y noyer. Eustache, qui ne savait pas nager, eut bientôt le sentiment du danger qu’il courait, car il était déjà d’ans l’eau jusqu’aux épaules, et la vase continuait à fléchir sous le poids de son corps. Il cria au secours, et fit un appel mental à sa Providence ordinaire. Le secours qu’il demandait lui arriva par une de ces voies détournées familières à la Providence. Elle mit le feu à une bergerie voisine de la mare où par négligence elle avait laissé choir l’ivrogne, et les gens qui accoururent chercher de l’eau pour éteindre l’incendie le repêchèrent au moment où il allait complètement disparaître.
En racontant son aventure à sa femme, Eustache lui déclara qu’il avait fait un vœu pendant son péril aquatique. Héloïse crut naturellement qu’il avait promis de ne plus boire.
– Oui, lui répondit-il, de ne plus boire de l’eau. C’est bien ça.
Le vœu de Pampeau était seulement un vœu fait à la prudence, et, depuis sa chute dans l’abreuvoir, il ne s’aventura plus la nuit, en expédition bachique, sans être accompagné de son chien, qu’il avait patiemment dressé à marcher devant lui, tenu en laisse comme les chiens d’aveugle, et, pour plus de précaution, portant suspendu à son cou un petit falot allumé.
Séparé de son chien, le portrait du cabaretier de Saint-Clair devant rester une figure incomplète, nous croyons utile de donner un croquis de cet animal qui, après la bouteille, tenait la plus grande place dans les affections d’Eustache Pampeau.
Toto était un hideux caniche, et, pour le peindre fidèlement d’un seul mot, si saint Roch l’eût rencontré il l’aurait renvoyé à saint Antoine.
Toto était né dans le fourgon d’un saltimbanque qui parcourait les foires en arrachant les dents à la pointe d’un sabre. Son maître le présentait à sa clientèle comme un élève du fameux Munito, la gloire scientifique de la race canine. En réalité, Toto était surtout l’élève de ses instincts, et l’habit de marquis dont il était revêtu pour la parade cachait un franc chevalier d’industrie. S’il avait réellement su jouer aux cartes, comme le prétendait son instituteur, il eût été imprudent de faire sa partie. Toto devait tricher.
Toto avait deux ans quand il devint le commensal du Sabot rouge, où son maître l’avait laissé en payement d’un écot. Ce ne fut pas sans protestation qu’Héloïse Pampeau avait consenti à recueillir ce nouvel hôte. Sa qualité d’artiste n’était pas une recommandation aux yeux de cette ménagère économe, qui partageait les instincts de défiance répandus dans les campagnes contre la race errante des baladins. Elle dut céder cependant à l’insistance de son mari. Pampeau supposa que les talents acrobatiques et autres dont le caniche était pourvu attireraient la pratique à son cabaret. Pendant deux ou trois dimanches, Toto augmenta en effet les recettes du Sabot rouge ; mais Eustache ayant négligé de lui apprendre quelques nouveaux tours, une fois qu’il eut épuisé son répertoire, déjà peu varié, Toto, suivant une expression de l’argot dramatique, cessa d’avoir une influence sur l’affiche. N’étant plus, d’ailleurs, excité par l’émulation que font naître le succès et les applaudissements, il renonça officiellement à l’art et rentra dans la nature. – Voici par quelle porte :
Un jour qu’on l’avait chargé de tourner la broche, – besogne dont il s’était acquitté jusque-là avec autant d’adresse que de fidélité, – Toto détourna le rôti ; et pour éviter la correction dont on le menaçait, se sauva dans les bois qui environnent Saint-Clair, en emportant le gigot. Il ne rentra au Sabot rouge que le lendemain matin, tenant encore dans sa gueule, comme preuve de son crime, l’os du gigot qu’il achevait de ronger. Héloïse l’attacha à un arbre de son jardin, prit un échalas et commença à gourmer le voleur. – L’échalas s’étant rompu avant qu’elle crût la correction satisfaisante, elle en prit un nouveau et recommença à frapper l’animal, dont l’impassibilité persistait à ne pas vouloir accuser réception des coups qu’il recevait. Il poussa à la fin deux ou trois cris que la cabaretière prit pour des excuses. – Elle laissa Toto rompu, mais non corrigé, – car le surlendemain il déroba le pot-au-feu pendant que sa maîtresse avait le dos tourné, et prit la route du bois où il passa la nuit comme il avait déjà fait. Au retour de cette seconde escapade, il alla de lui-même se placer au pied de l’arbre où la première fois il avait été châtié, et se laissa lier pacifiquement par la cabaretière furieuse, dont la colère ne s’était calmée qu’après la rupture du troisième échalas. Elle put croire pendant quelque temps que cette double correction avait enfin corrigé le caniche de sa gloutonnerie. C’était une erreur : Toto n’avait aucunement renoncé à la viande de boucherie ; seulement il avait apprécié le prix auquel on la lui faisait payer, et, trouvant le bœuf trop cher à trois échalas brisés sur ses côtes, il préférait le gigot qui ne lui en coûtait que deux ; ce fut pourquoi, sans doute, il respecta la marmite autant par goût que par économie ; mais la première fois qu’il vit flamber l’âtre et sa maîtresse décrocher la rôtissoire, il se tint sournoisement aux aguets, et, profitant de la minute où il avait échappé à la surveillance, captura le rôti attendu par des ouvriers carriers qui avaient reçu leur paye.
Lorsqu’il revint le lendemain, selon son habitude, ce fut un des carriers, chargé d’exercer la rancune de ses camarades, qui lui administra la correction au-devant de laquelle il allait naturellement, sachant bien qu’il avait un compte à régler. Il reçut patiemment et sans résistance le nombre de coups auquel l’avait habitué l’ancien tarif. Mais la correction s’étant prolongée, Toto protesta contre cette augmentation par des hurlements plaintifs, et ayant réussi à rompre la corde qui le retenait captif sous le châtiment, il se sauva dans le bois, où il demeura, cette fois, plusieurs jours.
Lorsqu’il reparut au Sabot rouge, il s’y montra d’une sobriété qui allait jusqu’à l’abstinence, et flairait dédaigneusement, sans y toucher, la pâtée que son maître lui préparait avec une sollicitude particulière. Ce changement ne fut pas le seul qu’on pût remarquer dans ses instincts. Toto, dont la gloutonnerie était égalée par la paresse, et qui passait sa vie, couché en rond, au soleil, ou dans les cendres de l’âtre, renonça subitement à ses goûts de farniente et s’accoutuma au vagabondage. Parti dès le matin, il allait on ne savait où pour ne rentrer que le soir, altéré comme le sol en temps de canicule, ou comme son maître en tout temps, portant la langue pendante, l’oreille ensanglantée, ayant l’haleine courte et sifflante, le museau terreux, le lainage de son poil poudreux, rempli de feuilles mortes, de ronces ou d’aiguilles de pin. À peine revenu, il faisait une apparition dans le cabaret, comme pour constater sa présence, lapait précipitamment un demi-seau d’eau, et disparaissait aussitôt pour aller rejoindre Pampeau sur le galetas où celui-ci l’avait habitué à venir lui tenir compagnie.
Un écrivain cynégétique, dont l’autorité n’est pas contestée, a prétendu qu’à l’état sauvage tous les chiens sont chasseurs, quelle que soit leur race.
Toto était retourné à l’état sauvage, et, depuis le jour où on lui avait interdit la cuisine du Sabot rouge, il avait pris le parti d’aller se nourrir au merveilleux garde-manger que la nature ouvrait à sa voracité dans un rayon de dix lieues.
Il eût d’ailleurs été difficile qu’il échappât à la contagion de braconnage répandue dans un pays où les chats eux-mêmes, renonçant à leurs habitudes sédentaires et dédaigneux du vulgaire butin que leur offre la chasse domestique, vont se mettre à l’affût du gibier que la verte odeur de la plaine attire le soir hors du bois.
Tous les matins, Toto partait pour les taillis, poussait en forêt une pointe aventureuse, et lorsqu’il rentrait au logis, au coucher du soleil, il pesait ordinairement un lapin ou un lièvre de plus qu’au départ.
Pampeau ne devait pas ignorer longtemps la nouvelle profession adoptée par le marquis, surnom qu’on avait donné au caniche, sans doute à cause du costume sous lequel on l’avait jadis vu travailler au Sabot rouge. Le manège du hardi maraudeur n’avait pu échapper aux gardes du pays, dont les plaintes arrivaient au Sabot rouge et menaçaient de se formuler en procès-verbaux.
Effrayé par l’idée d’une poursuite qui entraînerait à des frais, Eustache promit de surveiller son chien. Mais la première fois qu’il voulut l’attacher, Toto rongea la corde et prit sa course. On l’enferma dans la cave, il se sauva par le soupirail. On le mit aux arrêts dans le grenier, il se rappela ses anciens exercices d’acrobate et s’échappa par la lucarne en faisant un saut de vingt pieds. Sa passion pour la chasse lui donnait le génie de l’évasion.
Non seulement les gardes se plaignaient, mais encore les chasseurs légaux du pays et les braconniers eux-mêmes, à qui Toto faisait concurrence en venant relever le gibier pris dans leurs collets, ou en courant, au temps de l’éclosion, les jeunes volées de perdreaux rouges ou de faisandeaux, espoir de la prochaine ouverture.
Un des plus fidèles habitués du Sabot rouge était le beau-père du cabaretier lui-même, un vieil ouvrier carrier nommé Cantain, qui depuis son veuvage se prétendait attaquer de la maladie du sable, pour donner un prétexte à sa paresse, et combattait cette affection chimérique par un traitement que la régie des alcools eût sans doute beaucoup mieux apprécié que la Faculté.
Pour l’intelligence de ce qui va suivre, il est nécessaire de remonter de quelques années dans la vie de ce personnage, dont l’histoire sert, pour ainsi dire, de point de départ à ce récit.
Cantain avait épousé une fille de la commune de Pontisy, située à un quart de lieue de Saint-Clair. Cette fille, nommée la Roussotte, sans doute à cause de son teint et de ses cheveux, était alors servante au Sabot rouge, chez le prédécesseur de Pampeau. Elle y avait été fort compromise par un garçon appelé Claudet, dont le père était garde du prince de ***, alors propriétaire du château de Pontisy.
Cantain et sa femme n’étaient pas riches ; ils ne possédaient pour tout bien que la maison qu’ils habitaient. Cette méchante masure, dont une tolérance municipale laissait encore subsister la toiture de chaume, si dangereuse en cas d’incendie, s’appelait dans le pays la Maison de paille. Elle n’avait d’autre attenance que quatre ou cinq perches d’un terrain sablonneux, dont la culture ingrate était d’un rapport presque nul. Les Cantain n’avaient, en outre, aucun avantage futur à espérer de leurs parents, tous deux étant nés de familles qui, de père en fils, ne laissaient à leurs héritiers que leur ombre au soleil. Ils s’étaient mariés sans amour, et Cantain lui-même n’ignorait pas les propos tenus sur le compte de la servante du Sabot rouge.
La Cantain n’était rien moins que jolie ; rousse et marquée de petite vérole, elle offrait le type rustique dans son aspect lourd et quasi difforme, mais elle avait des cheveux pour lesquels une duchesse aurait donné son écrin. Physiquement mieux doué qu’elle, son mari était un grand et vigoureux garçon, dont la force apparente annonçait qu’il appartenait à cette race de bœufs humains asservis nativement au joug des fatigues exceptionnelles. L’union de ces deux êtres qui n’avait été ni une affaire de sentiment, ni une affaire d’intérêt, fut pourtant heureuse. – On avait dit d’eux que c’était la famine qui épousait la misère ; ils donnèrent dès les premiers mois de leur mariage un démenti à ces prédictions, par la scrupuleuse probité qu’ils mirent chacun de son côté dans l’apport des qualités réciproques qui formaient leur unique dot à l’un comme à l’autre.
Cantain trouva dans sa femme une créature active, ne laissant jamais à la mousse le temps de croître dans sa main, selon une locution proverbiale. Économe, sobre, soigneuse d’elle-même et de son intérieur, elle réalisait toutes les vertus domestiques, qui rendent possible l’existence de certains ménages pauvres et déroutent les calculs de l’arithmétique. – Son mari se montra reconnaissant à sa manière du bien-être nouveau qu’elle introduisait dans sa vie. Sans effort, presque à son insu, il modifia certaines rugosités de sa personne et de son caractère. – Sa bouche, habituée à mâcher le juron, en devint moins prodigue. – Bien qu’il eût toujours été laborieux autant par goût que par nécessité, étant garçon, il n’avait pu échapper complètement aux entraînements de l’âge et de l’exemple et passait pour un des meilleurs gobelets de l’endroit, mais à gobelet plein, bourse vide, dit un proverbe qui n’est pas bourguignon.
Cantain cessa de paraître le dimanche au cabaret, et se montra fort indifférent aux plaisanteries que cet éloignement, attribué à la volonté de sa femme, lui attirait de la part de ses anciens camarades. Il passait dans son ménage tout le temps qu’il ne donnait pas à son travail, et, sans chercher à lui donner un nom, il éprouvait un sentiment de plaisir lorsqu’au retour de la carrière, en descendant les chemins de la forêt, il voyait de loin fumer le toit de sa maison. – Sans le remarquer lui-même, il marchait alors d’un meilleur pas qu’à l’époque où il savait ne devoir trouver chez lui que la solitude, et s’il fredonnait encore en marchant quelque refrain emprunté au licencieux répertoire des chantiers, il s’arrêtait instinctivement en approchant du seuil de sa demeure.
La Cantain, dont la nature un peu fière ne s’était pas soumise sans en souffrir à la servitude chez les étrangers, puisait dans le sentiment de sa liberté la jouissance qu’éprouve l’esclave affranchi à supporter des fatigues contre lesquelles il eût protesté au temps de son esclavage, et qui lui semblent moins pénibles parce qu’elles ne lui sont imposées que par lui-même. Quant au carrier, il n’avait pas tardé à comprendre le bénéfice de la vie régulière, et lorsqu’il comparait sa situation actuelle avec le passé, il ne pouvait s’empêcher de trouver douce la tyrannie de l’ordre.
Une sorte d’affection placide existait dans le ménage et se prouvait quotidiennement entre les deux époux, moins par les paroles que par un échange de bons procédés, dont les étrangers, bien plus qu’eux-mêmes, auraient pu apprécier la délicatesse.
Cantain gagnait soixante-dix ou quatre-vingts francs par mois, selon les époques où l’exploitation plus ou moins active de la carrière réclamait un plus ou moins grand nombre de bras. C’était avec ce gain modeste qu’il fallait faire face à toutes les dépenses que comportent les besoins de deux personnes.
Tous les samedis, le carrier remettait à sa femme l’argent qu’il avait reçu pour son travail de la semaine, et se réservait seulement une somme modique destinée à son tabac et à la petite mesure d’eau-de-vie qu’il avait coutume d’emporter au chantier.
À une époque où les récoltes donnaient quelques inquiétudes, il y eut sur les grains une hausse subite. En revenant du marché la Cantain ne put s’empêcher de se plaindre de cet enchérissement qui atteignait le ménage dans une consommation de première nécessité et devenait plus menaçante aux approches de l’hiver. Elle craignait d’être obligée de demander une taille au boulanger, et ce petit morceau de bois rayé quotidienne ment l’effrayait plus qu’une grosse maladie.
– Farine à crédit fait du pain amer, disait-elle à son mari.
Il existe encore dans les campagnes de ces probités rétives pour lesquelles devoir et une humiliation, et qui ne la subissent que lorsqu’elles y sont contraintes par les plus impérieux besoins. Pour ces natures lentes à se dépouiller de leurs sains préjugés, la dette dans la pauvreté, c’est une ronce dans un champ de pierres.
Revenant un soir de la carrière, où il avait reçu sa paye, Cantain la remit tout entière à sa femme, et comme elle lui faisait observer qu’il oubliait de garder l’argent nécessaire à son tabac et à son eau-de-vie, il refusa de le prendre.
– Faut se nourrir avant de nourrir ses défauts, répondit-il, – et tirant de sa besace sa pipe et sa petite fiole à eau-de-vie, il alla les serrer dans un coin de l’armoire.
Cette privation, celle de fumer surtout, devait lui coûter cependant ; c’était son unique plaisir, sa distraction unique, et on renonce difficilement à une habitude, que le temps a naturalisée besoin. Mais si peu coûteuse qu’elle fût, cette habitude occasionnait une dépense, et il n’y a pas de petits chiffres pour les petits budgets. L’argent du tabac et de l’eau-de-vie aidait à rétablir dans celui du ménage l’équilibre dérangé par la cherté du pain. Cependant, les premiers jours, après son repas, Cantain, en se levant de table, tournait machinalement dans la maison avec l’attitude d’un homme auquel il manque quelque chose, et son regard, qui de temps en temps s’arrêtait sur l’armoire où sa pipe était serrée, disait assez de quoi il manquait.
Au chantier, les camarades du carrier n’avaient pas été sans remarquer qu’il ne fumait plus, et cette abstinence, dont celui-ci n’avait pas cru devoir leur expliquer la cause, était devenue de leur part un motif de plaisanterie.
Un des carriers prétendit un jour que c’était la Cantain qui avait cassé la pipe de son mari, parce que l’odeur du tabac lui était désagréable.
Cette supposition, accueillie par de grossiers éclats de rire, fut suivie d’autres propos du même goût, auxquels Cantain paraissait vouloir rester sourd ; assis sur un quartier de roc, il mangeait tranquillement un morceau de pain avec du fromage aigre.
Son mutisme dédaigneux encouragea les agressions de ses camarades, et l’un d’eux, un de ses voisins, nommé Roussel, qui semblait prendre à tâche de faire sortir le carrier de son indifférence, s’avisa de dire, en lui jetant un coup d’œil narquois :
– Bah ! la Roussotte est une délicate qui n’aime pas la pipe parce qu’elle a été habituée à l’odeur du cigare.
Ces paroles étaient à peine achevées, que celui qui les avait prononcées se recula instinctivement de plusieurs pas, comme l’artificier s’éloigne du projectile dangereux auquel il vient de mettre le feu.
Un silence général avait accueilli cette remarque, dont le sens injurieux ne pouvait échapper à personne, puisqu’elle rappelait par allusion, au souvenir de tout le monde, l’époque où la Roussotte était courtisée au Sabot rouge, par le fils Claudet, le seul garçon du pays qui fumât des cigares.
Tous les regards des carriers étaient fixés sur Cantain et Roussel, qu’une dizaine de pas séparaient à peine l’un de l’autre.
Cantain s’était levé subitement et tout droit, comme mû par un ressort.
À ce mouvement déjà agressif, Roussel avait encore reculé, et, se trouvant arrêté par un énorme bloc de grès sur lequel étaient posés ses outils, il s’y appuya après avoir eu la précaution de passer la main derrière son dos, et de s’emparer d’un marteau à manche très court, mais d’un poids de quinze kilogrammes, et qui sert à enfoncer dans le rocher le coin de fer destiné à le faire éclater.
Cette attitude défensive n’arrêta cependant point Cantain, et Roussel, voyant qu’il continuait à s’avancer, éleva sa masse de fer au-dessus de lui dans une position de garde haute, qui allait placer le mari de la Roussotte, s’il faisait un pas de plus, sous la perpendiculaire menaçante du pesant marteau.
Ce dernier pas, Cantain le fit cependant de la même allure tranquille dont il avait fait les autres.
– Prends garde ! lui crièrent ses camarades, pétrifiés par cette sorte d’attention anxieuse qui paralyse les mouvements.
Roussel et Cantain étaient souffle à souffle.
Assurant dans sa main, par une vigoureuse pression des doigts, le manche du marteau dont la masse carrée profilait un angle d’ombre sur le front découvert de Cantain, Roussel lui dit à voix basse :
– Ne me touche pas.
Roussel était de cette race de méchants hargneux qui sont le tourment des faibles. Même dans ses querelles de cabaret, lorsqu’elles se terminaient en lutte, il ne portait jamais le premier coup, et, pour montrer quelque énergie dans ces pugilats grossiers, il fallait qu’il irritât par des injures ses faux instincts belliqueux, passagèrement puisés dans l’ivresse.
En prenant une attitude défensive qui devait rendre toute lutte inégale avec lui, Roussel espérait que le carrier dépenserait sa colère en paroles ou en vaines menaces. Dans le premier moment où, obéissant à un machinal instinct de défense, il s’était emparé du dangereux outil, peut-être en eût-il fait usage pour repousser une agression instantanée. Mais le silence qui régnait autour de lui, la lenteur mesurée des mouvements de son adversaire, l’incertitude où il était sur ses intentions, le dédaigneux défi que celui-ci lançait par les yeux à l’arme mortelle dont son approche était menacée, en alourdissaient déjà le poids dans la main de Roussel, effrayé par l’idée qu’il allait peut-être être mis en demeure de répondre à une provocation par un meurtre.
Un instant, il pensa à accepter une lutte dans des conditions égales, mais il comprit qu’il ne se relèverait pas vivant d’un combat où il n’aurait pas d’autre arme que son courage ; il se sentait pour ainsi dire le cœur sous la dent de Cantain, dont la figure avait cette effrayante placidité que donne la certitude de la vengeance.
– Que me veux-tu, Cantain ? demanda-t-il au mari de la Roussotte, avec une voix étranglée par le râle de la peur.
– Fils du guillotiné, tu es blanc, dit Cantain, je veux te faire rougir.
Et il lui cracha au visage.
Un cri sortit en même temps de toutes les poitrines, et tous les témoins de cette scène crurent voir le terrible marteau s’abaisser pour répondre à la terrible injure.
Roussel n’avait pas bougé ; les paroles de Cantain, et l’acte qui les avait accompagnées, semblaient l’avoir immobilisé. Au moment où il allait frapper Cantain, le souvenir de son père exécuté pour crime d’assassinat avait évoqué dans son imagination une vision rapide, où se mouvait le sinistre appareil de la justice criminelle, et comme ses yeux, perdus dans le brouillard de l’épouvante, erraient vaguement autour de lui, il aperçut sa femme qui se dirigeait vers la carrière, en tenant son enfant par la main. L’enfant montra de loin à son père sa petite marmite dans laquelle il lui apportait son goûter.
Cette apparition acheva de paralyser Roussel, qui réalisait déjà la prédiction de Cantain, car son visage avait passé de l’extrême pâleur à une coloration extrême.
On vit l’artère du bras roidi par une tension fatigante, se gonfler soudainement comme un ruisseau sous l’orage et précipiter à flots bleus dans les veines du col la foudroyante congestion apoplectique qui se répandit bientôt sur la face, où elle injecta les yeux d’un filet pourpre, en même temps qu’elle amenait à la bouche, vainement ouverte à l’aspiration de l’air, la première écume de ce flux sanglant.
Cantain, attribuant à la colère l’état dans lequel il voyait son ennemi, conservait sa position. Solidement arc-bouté sur une de ses jambes, il avait pris une attitude qui lui permettait de tenter une volte rapide pour éviter le coup terrible dont il pouvait se croire menacé. Voyant l’immobilité de Roussel et n’en soupçonnant pas la cause, il ajouta en faisant allusion à l’injure qui venait de souiller son visage :
– Lâche ! faut donc encore que je t’essuie ! Et il leva la main pour le frapper. En ce moment, à travers les mortelles ténèbres qui envahissaient sa vue, Roussel apercevait sa femme entrant dans le chantier avec son fils.
L’attitude agressive des deux hommes lui faisait seulement deviner une querelle ; elle accourut auprès d’eux pour les séparer, accompagnée de tous les ouvriers carriers. Mais avant qu’ils fussent arrivés, la main de Cantain était retombée sur la figure de Roussel, et celui-ci, trouvant un dernier cri dans sa gorge étranglée par l’étau de l’apoplexie, abaissa son bras sur le mari de la Roussotte.
Le lourd marteau échappant à sa main mal dirigée par ses yeux, que voilaient déjà l’agonie, effleura seulement du manche dans sa chute l’épaule de Cantain, et tomba, en rebondissant, sur la tête du petit garçon de Roussel, qui s’était approché, sa petite marmite à la main.
L’enfant s’affaissa sur le sable, et mourut en même temps que son père, tué par la congestion cérébrale.
Une enquête fut ouverte à la suite de ces évènements, et Cantain fut arrêté provisoirement, mais on le relâcha sur la déposition des témoins.
Bien qu’il eût été renvoyé par la justice, l’opinion publique, excitée par la veuve de Roussel, n’en attribua pas moins à Cantain ces deux morts dont la fatalité seule avait été la cause. Elles devinrent le principe d’une répulsion instinctive qui se manifesta contre les hôtes de la Maison de paille et qui devait encore s’augmenter lorsqu’on vit, dans deux autres circonstances, le même hasard intervenir en faveur de Cantain, et l’entourer d’une de ces protections sinistres que la superstition populaire croit achetées par un pacte sacrilège.
Pendant une saison rigoureuse qui avait provoqué le chômage dans les chantiers, la Cantain ayant épuisé toutes ses ressources, vainquit ses scrupules et se décida à recourir au crédit. Sans en instruire Cantain, elle se rendit un jour chez le boulanger de Pontisy. La boulangère n’osa prendre sur elle de lui donner une taille sans le consentement de son mari ; mais lui voyant sur les bras un enfant chétif, elle lui offrit un pain de seigle en lui disant :
– Tiens, prends, c’est pour faire du lait à ton innocent.
– Dieu t’amène le tien sans te faire souffrir ! répondit la Roussotte en regardant la taille de la boulangère, qui était grosse.
Ainsi que l’avait prévu celle-ci, son mari refusa d’ouvrir un crédit aux Cantain.
– Son mari n’a pas d’ouvrage, dit la boulangère ; elle a un petit enfant ; ça m’a fait de la peine ; je lui ai donné un pain.
– Tu as eu tort, dit le boulanger ; c’est autant de perdu pour nous.
– Mais ils meurent de faim ! répondit la femme.
– Eh bien, qu’ils meurent ! ça débarrassera le pays du mauvais monde, répliqua le boulanger, ordinairement humain, mais qui partageait l’animosité commune propagée contre le ménage de la Maison de paille.
Dans le méchant terrain qui entourait leur masure, les Cantain avaient, pendant la moisson précédente, récolté quelques masures de seigle, dont la plus grande partie avait été attaquée de cette maladie particulière qu’on appelle l’ergot. L’ergot est une sorte de superfétation corrompue, de couleur noire, qui s’attache à l’épi. On lui a donné, dans quelques campagnes, le nom de blé de corneilles, parce que ces oiseaux s’en montrent très friands. Lorsque cette maladie a sévi avec rigueur sur une moisson, la récolte est à peu près perdue, car il faut beaucoup de temps et de soins pour opérer le triage de cette ivraie d’avec le bon grain. Oublié, même à petite dose, dans la farine, l’ergot peut rendre l’alimentation malsaine, car il renferme un principe vénéneux qui l’assimile à la famille des poisons végétaux. La médecine l’emploie dans certains cas.
Dans la profonde détresse où elle se trouvait, la Cantain se rappela qu’il lui restait deux ou trois mesures résultant du triage de sa dernière récolte, attaquée par l’ergot, et ne connaissant qu’à demi les propriétés malfaisantes de cette farine avariée, elle résolut d’en faire usage.
– Nous n’avons pas le droit d’être délicats, dit-elle à son mari ; pendant que nous mangerons ce pain-là, le bon Dieu nous en enverra peut-être d’autre. – Comme elle faisait ce souhait hasardeux, la boulangère de Pontisy, qui venait d’achever sa distribution à Saint-Clair, entra dans la Maison de paille.
Les Cantain remarquèrent qu’elle n’avait pas arrêté sa voiture devant leur maison, et qu’elle était entrée par la porte qui ouvrait sur la plaine.