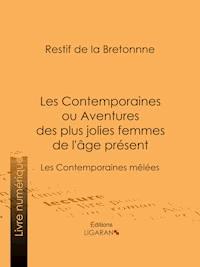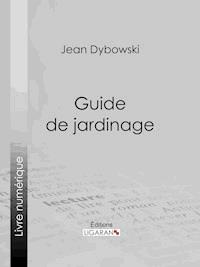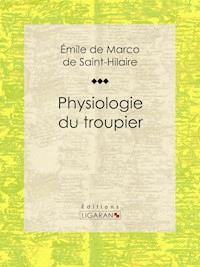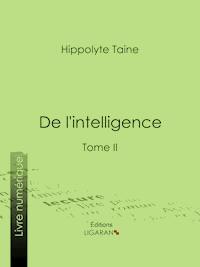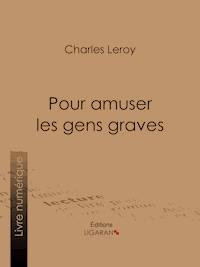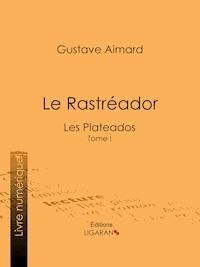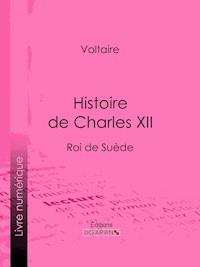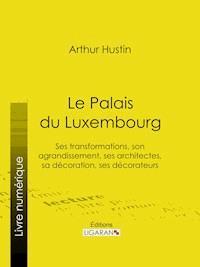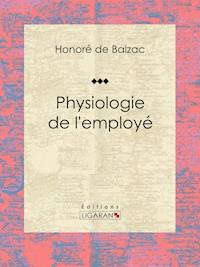Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "La découverte en 1852 d'une sorte de nouvelle égyptienne, analogue aux récits des Mille et une nuits, fut une surprise réelle pour la plupart des savants de l'Europe. On s'attendait bien à trouver dans les papyrus des hymnes à la divinité, des poèmes historiques, des écrits de magie ou de science, des lettres d'affaire, une littérature sérieuse et solennelle, mais des contes ?"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La découverte en 1852 d’une sorte de nouvelle égyptienne, analogue aux récits des Mille et une Nuits, fut une surprise réelle pour laplupart des savants de l’Europe. On s’attendait bien à trouver dans les papyrus des hymnes à la divinité, des poèmes historiques, des écrits de magie ou de science, des lettres d’affaire, une littérature sérieuse et solennelle, mais des contes ? Les hauts personnages dont les momies reposent dans nos musées avaient un renom de gravité si bien établi, que personne au monde n’avait jusqu’alors osé les soupçonner d’avoir lu ou composé des romans, au temps où ils n’étaient encore momies qu’en espérance. Le conte existait pourtant ; il avait appartenu à un prince, à un enfantde roi qui fut roi lui-même, à Séti II, fils de Mînephlah, petit-fils de Ramsès II. Une dame anglaise de passage à Paris, Madame Élisabeth d’Orbiney, avait remis à M. de Rougé un papyrus qu’elle avait acheté en Italie, et dont elle désirait connaître le contenu. La plupart de nos manuscrits ne renferment que des extraits plus ou moins soignés du Rituel funéraire ; celui-là recélait un conte. Il y était question de deux frères dont le plus jeune, accusé faussement par la femme de l’autre, et contraint à la fuite, se transformait successivement en taureau, puis en arbre, avant de renaître une dernière fois dans le corps d’un roi. Le premier mémoire de M. de Rougé était une analyse plutôt qu’une traduction . Certaines parties du texte étaient à peine effleurées ; d’autres étaient coupées à chaque instant par des lacunes, provenant, soit de l’usure du manuscrit, soit de la difficulté qu’on éprouvait alors à déchiffrer certains mots ou à suivre certaines tournures grammaticales : le nom même du héros était mal lu . Depuis, nul morceau de littérature égyptienne n’a été plus minutieusement étudié, ni à plus de profit. L’industrie incessante des savants en a corrigé les fautes et comblé les vides : à quelques mots près, la traduction du Conte des Deux Frères est certaine.
Pendant douze ans, le manuscrit étudié par M. de Rougé demeura comme un monument unique. Mille reliques du passé reparurent successivement au jour, listes de provinces conquises, catalogues de noms royaux, inscriptions funéraires, chants de victoires, des épîtres familières, des livres de compte, des formules d’incantation magique, des pièces judiciaires, jusqu’à des traités de médecine et de géométrie, rien qui ressemblât à un roman. En 1864, le hasard des fouilles fit découvrir, en pleines ruines de Thèbes, à Déïr-el-Médinéh, et dans la tombe d’un moine copte, un coffre en bois qui contenait, avec le cartulaire d’un couvent voisin, des manuscrits de nature moins édifiante, les recommandations morales d’un scribe Ani à son fils Khonshotpou, des prières pour les douze heures de la nuit, et un conte fantastique plus étrange encore que le Conte des Deux Frères. Le héros s’appelle Satni, fils d’un roi de Memphis : il s’agite au milieu d’une bande de momies parlantes, de sorcières, de magiciens, d’êtres ambigus, dont on se demande s’ils sont morts ou vivants. Ce qu’un roman de mœurs païennes venait faire dans la tombe d’un moine, j’imagine qu’il sera toujours malaisé de le savoir exactement. On conjecture que le possesseur des papyrus a dû être un des derniers Égyptiens qui aient entendu quelque chose aux anciennes écritures ; lui mort, on aurait enterré près de lui des manuscrits que personne ne comprenait plus, et sous lesquelsde dévots confrères flairaient sans doute un piège du démon. Quoi qu’il en soit, le roman était là, incomplet du début, mais assez bien conservé partout ailleurs pour qu’un savant accoutumé au démotique le déchiffrât sans trop de difficulté. L’étude de l’écriture démotiquen’a jamais été populaire parmi les égyptologues : la ténuité et l’indécision des caractères qui la composent, la nouveauté de plusieurs formes grammaticales, l’aridité ou la niaiserie des textes, ont effrayé ou rebuté bien des gens. Ce que M. de Rougé avait fait pour le papyrus d’Orbiney, M. Brugsch était seul capable de le faire pour le papyrus de Boulaq : la traduction qu’il en a donnée dans la Revue archéologique est si fidèle, qu’aujourd’hui encore on n’a presque rien à y changer.
Des trouvailles récentes ont accru nos richesses. En 1874, M. Goodwin, furetant au hasard dans la collection Harris, que le British Museum venait d’acquérir, mit la main sur les Aventures du Prince Prédestiné , et sur un fragment qu’il prit pourun récit historique et qui n’est en réalité qu’un roman. Quelques semaines après, M. Chabas signalait à Turin ce qu’il pensait être les débris d’un conte licencieux , et parmi les papyrus de Boulaq les restes d’une histoire d’amour. M. Golénischeff a découvert depuis à Pétersbourg deux nouvelles dont le texte est demeuré inédit jusqu’à présent . Enfin, il y a, dans un des papyrus de Berlin, le début d’un roman d’aventures, trop mutilé pour qu’on puisse en deviner sûrement le sujet , et, sur deux ostraca du musée de Florence, un long morceau d’une histoirede revenants. Ajoutez que certaines œuvres considérées généralement comme des documents historiques, les Mémoires de Sinouhit, la Querelle entre l’employé et le paysan, les négociations entre le roi Apôpi et le roi Soknounrî, sont en réalité des morceaux de littérature romanesque. Même après vingt siècles de ruines et d’oubli, l’Égypte a conservé presque autant de contes amusants que de poèmes lyriques ou d’hymnes adressés à la divinité.
L’examen de ces contes soulève diverses questions plus ou moins difficiles à résoudre. Sont-ils originaires du pays même, ou l’Égypte les a-t-elleempruntés à des peuples voisins qui les connaissaient avant elle ? Je ne prétends pas indiquer tout ce que le Conte des Deux Frères, par exemple, a de commun avec des récits recueillis ailleurs, un peu partout ; mais prenez-en quelques traits au hasard, et vous serez étonnésde voir à quel point la donnée et le détail en ressemblent à certaines données et à certains détails qu’on retrouve dans la littérature populaire d’autres nations.
Il se résout à première vue en deux contes différents. Au début, c’est l’histoire de deux frères, l’un marié, l’autre célibataire, qui vivent dans la même maison et s’occupent aux mêmes travaux. La femme d’Anoupou s’éprend de Bitiou sur le vu de sa force, et veut profiter de l’absence du mari pour satisfaire brutalement un accès de passion subite. Il refuse avec indignation ; elle l’accuse de viol, et manœuvre si adroitement que le mari, saisi de fureur, se décide à tuer son frère en trahison. Celui-ci, prévenu par les bœufs qu’il conduisait, se sauve, échappe à la poursuite grâce à la protection du soleil, se mutile et se disculpe, mais refuse de revenir à la maison commune et s’exile au Val de l’Acacia. Le frère aîné, désespéré, rentre chez lui, met à mort la calomniatrice, puis « demeure en deuil de son petit frère ».
Jusqu’à présent, le merveilleux ne tient pas trop de place dans l’action : sauf quelques discours prononcés par les bœufs, et l’apparition miraculeuse d’une eau remplie de crocodiles entre les deux frères, au plus chaud de la poursuite, le narrateur ne s’est guère servi que de faits empruntés à la vie courante. L’autre conte n’est que prodiges d’un bout à l’autre. Bitiou s’est retiré au Val de l’Acacia pour vivre seul, et a déposé son cœur dans une fleur de l’arbre. C’est unemesure de précaution des plus naturelles : on enchante son cœur, on le place en lieu sûr, au sommet d’un arbre ; tant qu’il y restera intact, aucune force ne prévaudra contre le personnage auquel il appartient. Cependant, les dieux, descendus en visite sur la terre, ont pitié de la solitude de Bitiou et lui fabriquent une belle femme. Il en tombe amoureux fou, lui confie le secret de sa vie, et lui recommande de ne pas quitter la maison, car le fleuve qui passe à travers la vallée s’éprendrait d’elle et ne manquerait pas à vouloir l’enlever. Cette confidence faite, il part pour la chasse, et naturellement la fille des dieux s’empresse d’agir au rebours des prescriptions de son mari : le fleuve la poursuit et s’emparerait d’elle, si le cèdre qui joue, on ne sait trop comment, le rôle de protecteur, ne la sauvait en livrant une boucle de sa chevelure. La boucle, charriée jusqu’en Égypte, est remise à Pharaon, et Pharaon, conseillé par ses magiciens, envoie des troupes à la recherche. La force échoue une première fois ; à la seconde tentative la trahison réussit, Pharaon coupe l’Acacia, et la chute de l’arbre produit la mort immédiate de Bitiou. Trois années durant il reste inanimé ; mais la quatrième il ressuscite avec l’aide de son frère, et songe à tirer vengeance du mal qu’on lui a fait. C’est désormais entre l’épouse infidèle et le mari outragé une lutte implacable. Bitiou se change en taureau et dévoile l’indignité de la fille des dieux : la fille des dieux obtient qu’on égorge le taureau. Du sang naissent deuxperséas magnifiques qui trouvent une voix pour reprocher à la fille des dieux sa double perfidie : la fille des dieux obtient qu’on abatte les deux perséas, qu’on en façonne des planches, et, pour être certaine de sa vengeance, veut assister à l’opération. Un copeau, envolé sous l’herminette des menuisiers, lui entre dans la bouche : elle l’avale, conçoit, met au monde un fils qui devient roi d’Égypte à la mort de Pharaon. Ce fils n’est que l’incarnation de Bitiou : à peine monté sur le trône, il rassemble les conseillers de la couronne, leur expose ses griefs, et condamne celle qui, après avoir été sa femme, est devenue sa mère.
Ces deux histoires sont complètement indépendantes l’une de l’autre, et auraient pu fournir la matière de deux récits différents. La fantaisie populaire les a réunies bout à bout : c’est une liberté qu’elle s’accorde souvent, et cela d’après cet axiome que la plus longue histoire est toujours la meilleure. La soudure entre les deux récits est assez grossière : les Égyptiens n’ont pas déployé un grand effort d’imagination pour l’opérer. Avant de s’exiler, Bitiou a déclaré à son frère qu’un malheur lui arriverait bientôt, et a décrit les prodiges qui doivent annoncer un évènement fâcheux. Au moment où l’Acacia tombe, les prodiges prédits s’accomplissent : Anoupou se met en marche et part à la recherche du cœur de son frère. Le service rendu en cette circonstance compense la tentative de meurtre dont il s’était rendu coupable dans le premier conte.
La tradition grecque, elle aussi, avait ses romans où le héros est tué ou menacé de mort pour avoir dédaigné l’amour coupable d’une femme, Hippolyte, Pélée, Phinée. Bellérophon, fils de Glaucon, « à qui donnèrent les dieux la beauté et une aimable vigueur », avait résisté aux avances de la divine Anteia, et celle-ci, furieuse, s’adressa au roi Prœtos : « Meurs, Prœtos, ou tue Bellérophon, car il a voulu s’unir d’amour avec moi, qui n’ai point voulu. » Prœtos, n’osant point tuer le héros, l’envoya en Lycie, où il dut combattre la Chimère . La tradition hébraïque nous donne un récit analogue au récit égyptien. Joseph vit dans la maison de Pôtîfar comme Bitiou dans celle d’Anoupou : « Or il était beau de taille et de figure. Et il arriva, à quelque temps de là, que la femme du maître de Joseph jeta ses yeux sur lui et lui dit : “Couche avec moi !” Mais il s’y refusa et lui répondit : “Vois-tu, monmaître ne se soucie pas, avec moi, de ce qui se passe dans sa maison, et il m’a confié tout son avoir. Lui-même n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m’a rien interdit, si ce n’est toi, puisque tu es sa femme. Comment donccommettrais-je ce grand crime, ce péché contre Dieu ?” Et quoiqu’elle parlât ainsi à Joseph tous les jours, il ne l’écouta point et refusa de coucher avec elle et de rester avec elle. Or, il arriva un certain jour, qu’étant entré dans la chambre pour y faire sa besogne, et personne des gens de la maison ne s’y trouvant, elle le saisit par ses habits en disant :
“Couche avec moi !”Mais il laissa son habit entre ses mains et sortit en toute hâte. Alors, comme elle vit qu’il avait laissé son habit entre ses mains et qu’il s’était hâté de sortir, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes : “Voyez donc, on nous a amené là un homme hébreu pour nous insulter. Il est entré chez moi pour coucher avec moi, mais j’ai poussé un grand cri, et quand il m’entendit élever la voix pour crier, il laissa son habit auprès de moi et sortit en toute hâte. ” Et elle déposa l’habit près d’elle, jusqu’à ce que son maître fût rentré chez lui ; puis elle lui tint le même discours, en disant : “Il est entré chezmoi, cet esclave hébreu que tu nous as amené, pour m’insulter, et quand j’élevai la voix pour crier, il laissa son habit auprès de moi et se hâta de sortir. ” Quand son maître eut entendu les paroles de sa femme qu’elle lui adressait en disant : “Voilà ce que m’a fait ton esclave !” il se mit en colère, et il le prit, et il le mit en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Et ilresta là dans cette prison . » La comparaison avec le Conte des Deux Frères est si naturelle que M. de Rougé l’avait faite dès 1852. Ebers a remarqué avec justesse qu’après tout, l’idée de la séduction tentée par la femme adultère, de ses craintes en se voyant repoussée, de la vengeance qu’elle essaie de tirer en accusant celui qu’elle n’a pu corrompre, est assez naturelle pour qu’elle se soit présentée indépendamment, et sur plusieurs points du globe, à l’esprit des conteurs populaires . Il n’est pas nécessaire de reconnaître dans le début du roman de Joseph une forme du récit dont le papyrus d’Orbiney nous a conservé la version courante à Thèbes, vers la fin de la XIXe dynastie.
Peut-être faut-il traiter avec la même réserve un conte emprunté aux Mille et une Nuits, et qui paraît d’abord n’être qu’une variante du nôtre. La donnée primitive y est aggravée et dédoublée d’une manière singulière : au lieu d’une belle-sœur qui s’offre à son beau-frère, ce sont deux belles-mères qui essaient de débaucher les fils de leur mari commun. Le prince Kamaralzaman avait eu Amgiâd de la princesse Badoûr et Assâd de la princesse Haïât-en-néfoûs. Amgiâd et Assâd étaient si beaux, si bienfaits, que, dès l’enfance, ils inspirèrent aux deux sultanes une tendresse incroyable. Les années s’écoulent ; ce qui paraissait n’être qu’affection maternelle se change en passion violente : au lieu de combattre leur ardeur criminelle, Badoûr et Haïât-en-néfoûs se concertent et déclarent leur amour par lettres en beau style. Repoussées avec mépris, elles craignent une dénonciation. À l’exemple de la femme d’Anoupou, elles prétendent qu’on a voulu leur faire violence, pleurent, crient, et se couchent ensemble dans un même lit, comme si la résistance avait épuisé leurs forces. Le lendemain matin, Kamaralzaman, revenu de la chasse, les trouve abîmées dans la douleur et leur demande la cause de leur chagrin. On devine la réponse : « Seigneur, le chagrin qui nous accable est de telle nature que nous ne pouvons plus supporter la lumière du jour, après l’outrage dont les deux princes vos enfants se sont rendus coupables à notre égard. Ils ont eu, pendant votre absence, l’audace d’attaquer notre honneur. » Colère du père, sentence de mort portée contre les fils ; le vieil émir chargé de l’exécuter ne l’exécute point, sans quoi il n’y aurait plus de conte. Kamaralzaman ne tarde pas à reconnaître l’innocence d’Amgiâd et d’Assâd : cependant, au lieu de tuer ses deux femmes comme Anoupou avait fait de la sienne, il se contente de les emprisonner pour le restant de leurs jours. C’est la donnée du Conte des Deux Frères, mais adaptée aux habitudes du harem et auxbesoins de la polygamie musulmane : à se modifier de la sorte, elle n’a gagné ni en intérêt, ni en moralité .
Les versions du second conte sont à la fois et plus nombreuses et plus curieuses . On les retrouve partout : en France , en Italie , dans les différentes parties de l’Allemagne , en Hongrie, en Russie et dans les pays slaves , chez les Roumains , dans le Péloponèse, en Asie-Mineure, en Abyssinie , dans l’Inde. En Allemagne, Bitiou est un berger, possesseur d’une épée invincible : une princesse lui dérobe son talisman ; il est vaincu, tué, mis en morceaux, puis rendu à la vie par des enchanteurs qui lui donnent la faculté de « revêtir toutes les formes qui lui plairont. » Il se change en cheval, est vendu au roi ennemi, et reconnu par la princesse qui recommande qu’on lui coupe la tête. Il intéresse à son sort la cuisinière du château : « Quand on me tranchera la tête, trois gouttes de mon sang sauteront sur ton tablier : tu les enterreras pour l’amour de moi. » Le lendemain, un superbe cerisier avait poussé à l’endroitmême où avaient été enterrées les trois gouttes de sang. La princesse fait abattre le cerisier ; mais la cuisinière a ramassé trois copeaux et les a jetés dans l’étang de la princesse, où ils se transforment en autant de canards d’or. La princesse en tue deux à coups de flèches et s’empare du troisième. À la nuit, elle l’enferme dans sa chambre ; le canard reprend l’épée magique et disparaît. En Russie, Bitiou s’appelle Ivan, fils de Germain le sacristain. Il trouve dans un buisson une épée magique dont il s’empare, puis va guerroyer contre les Turcs qui avaient envahi le pays d’Arinar, en tue quatre-vingt mille, cent mille, et reçoit pour prix de ses exploits la main de Cléopâtre, fille du roi. Son beau-père meurt, le voilà roi à son tour ; mais sa femme le trahit, livre son épée aux Turcs, et, quand Ivan désarmé a péri dans la bataille, s’abandonne au sultan comme la fille des dieux à Pharaon. Cependant, Germain le sacristain, averti par un flot de sang qui jaillit au milieu de l’écurie, part et retrouve le cadavre. « Si tu veux le ranimer, dit son cheval, ouvre mon ventre, arrache mes entrailles, frotte le mort de mon sang, puis, quand les corbeaux viendront me dévorer, prends-en un et l’oblige à t’apporter l’eau merveilleuse de vie. » Ivan ressuscite et renvoie son père : « Retourne à lamaison ; moi je me charge de régler mon compte avec l’ennemi. » En chemin, il rencontre un paysan : Je vais me changer pour toi en un cheval « merveilleux, avec une crinière d’or ; tu le conduiras devant le palais du sultan. » Quand le sultan vit le cheval, il l’acheta, le mit dans son écurie et ne cessa plus d’aller le visiter. « Pourquoi, seigneur, lui dit Cléopâtre, es-tu toujours aux écuries ? – J’ai acheté un cheval qui a une crinière d’or. – Ce n’est pas un cheval, c’est Ivan, le fils du sacristain : commande qu’on le tue. » Du sang du cheval naît un bœuf au pelage d’or : Cléopâtre le fait tuer. De la tête du taureau naît un pommier aux pommes d’or : Cléopâtre le fait abattre. Le premier copeau se métamorphose en un canard magnifique. Le sultan ordonne qu’on lui donne la chasse et se jette lui-même à l’eau pour l’attraper. Le canard s’échappe vers l’autre rive, reprend sa figure d’Ivan, mais avec des habits de sultan, jette sur un bûcher Cléopâtre et son amant, puis règne à leur place .
Voilà bien, à plus de trois mille ans d’intervalle, les grandes lignes de la version égyptienne. Si l’on voulait se donner la peine d’examiner un à un les détails, on en retrouverait certainement d’analogues. La boucle de cheveux enivre Pharaon de son parfum ; dans un récit breton, la mèche de cheveux lumineuse de la princesse de Tréménéazour rend amoureux le roi de Paris. Bitiou place son cœur sur la fleur de l’Acacia ; dans le Pantchatantra, un singe raconte qu’il ne quitte jamais la forêt où il habite sans y laisser son cœur caché dans le creux d’un arbre. Anoupou est averti de la mort de Bitiou par du vin et de la bière qui se troublent ; dans divers contes européens, un frère partant en voyage annonce à son frère que le jour où l’eau d’une certaine fiole se troublera, c’est que lui sera mort. Et ce n’est pas seulement la littérature populaire qui possède l’équivalent des aventures de Bitiou : les religions de la Grèce et de l’Asie occidentale renferment des mythes qu’on peut leur comparer presque point par point. Pour ne citer que le mythe phrygien, Alys dédaigne l’amour de la déesse Cybèle, comme Bitiou l’amour de la femme d’Anoupou ; il se mutile comme Bitiou ; de même que Bitiou en vient de changement en changementà n’être plus qu’un perséa, Atys est transformé en pin. D’autres ont fait ou feront mieux que moi les rapprochements et les comparaisons nécessaires ; j’en ai dit assez pour montrer que les deux récits, dont est sorti le conte égyptien, se retrouvent ailleurs qu’en Égypte, et en d’autres temps qu’aux époques pharaoniques.
Est-ce une raison suffisante à déclarer qu’ils ne sont pas ou sont originaires de l’Égypte ? Un seul point me paraît hors de doute pour le moment : la version égyptienne est de beaucoup la plus vieille que nous ayons. Elle nous est parvenue en effet dans un manuscrit du XIVe siècle avant notre ère, c’est-à-dire nombre d’années avant le moment où nous commençons à reconnaître la trace des autres. Si le peuple égyptien a emprunté ou transmis au dehors les données qu’elle contient, l’opération a dû s’accomplir à une époque plus ancienne encore ; qui peut dire aujourd’hui comment et par qui elle s’est faite ?
Que le fond soit ou ne soit pas étranger, la forme est partout égyptienne : s’il y a eu assimilationdu récit, au moins l’assimilation est-elle complète. Et d’abord les noms. Quelques-uns, Bitiou et Anoupou, appartiennent à la légende : Anoupou est le dieu Anubis, et son frère, Bitiou, porte le nom du roi mythique Bytis, qui passait pour avoir régné sur le Nil longtemps avant Mini .
D’autres sont empruntés à l’histoire et rappellent le souvenir des plus célèbres parmi les Pharaons. L’instinct qui porte les conteurs à choisir partout, comme héros, des rois ou des seigneurs de haut rang s’associait en Égypte à un sentiment patriotique très vif. Un homme de Memphis, né au pied du temple de Phtah et grandi, pour ainsi dire, à l’ombre des Pyramides, était familier avec Mini et Khouwou : les bas-reliefs et les peintures étalaient leurs portraits à ses yeux ; les inscriptions énuméraient leurs titres et célébraient les gloires de leurs règnes. Sans remonter aussi loin que Memphis dans le passé de l’Égypte, Thèbes n’était pas moins riche en monuments : sur la rive droite comme sur la rive gauche du Nil, à Karnak et à Louqsor comme à Gournah et à Médinet-Thabou, les murailles parlaient de grandes victoires remportées sur de grandes nations, de guerres toujours heureuses, d’expéditions lointaines au-delà des mers. Quand le conteurmettait des rois en scène, l’image qu’il évoquait n’était pas seulement celle d’un mannequin superbe affublé d’oripeaux souverains : son auditoire et lui-même songeaient aussitôt à ces princes toujours vainqueurs, dont la figure et la mémoire vivaient encore au milieu d’eux. Il ne suffisait pas d’avancer que le héros était un monarque et de l’appeler Pharaon : il fallait dire de quel Pharaon glorieux on parlait, si c’était Pharaon Ramsès ou Pharaon Khouwou, un constructeur de pyramides ou un conquérant des dynasties guerrières. La vérité en souffrait souvent. Si familiers qu’ils fussent avec les rois monumentaux, les Égyptiens qui n’avaient pas fait de leurs annales une étude spéciale étaient assez portés à corrompre le nom des rois ou à brouiller les époques. Dès la douzième dynastie, le roi auquel Sinouhit raconte ses aventures est un certain Khoperkerî Amenemhâït, qu’on chercherait en vain dans les listes officielles. Snowrou, de la quatrième dynastie, est introduit dans le roman conservé à Pétersbourg avec Amoni de la onzième ; Merkerî de la troisième figure dans l’un des papyrus de Berlin ; Ousirmarî et Mînibphtah de la dix-neuvième, dans le Conte de Satni, Rahotpou dans un fragment d’histoire de revenant conservé à Florence, et un roi d’Égypte anonyme dans le Conte du Prince Prédestiné. Tous ces noms d’autrefois prêtaient au récit un air de vraisemblance qu’il n’aurait pas eu sans cela : une aventure merveilleuse mise au compte de Sésostris devenait plus probable qu’elle n’aurait été, si on l’avait rapportée simplement de quelque personnage inconnu.
Il s’établit ainsi, à côté de l’histoire réelle, une histoire populaire parfois bouffonne, toujours amusante. De même qu’on eut dans l’Europe du Moyen Âge le cycle de Charlemagne où le caractère de Charlemagne ne fut guère respecté, on eut en Égypte des cycles de Sésostris, des cycles de Thoutmôs III, des cycles de Khéops où la personne de Sésostris, de Thoutmôs III, de Khéops se modifia au point de devenir souvent méconnaissable. La plupart sont perdus, et les rares fragments qui en subsistent, le roman d’Apôpi, les aventures de Thoutii, n’ont pas toujours été appréciés à leur juste valeur.
Le roman d’Apôpi est par malheur fort mutilé. Le roi Pasteur Apôpi envoie ambassade sur ambassade au prince thébain Soknounrî et le somme de chasser les hippopotames du lac de Thèbes qui l’empêchent de dormir. On ne se douterait guère que ce message bizarre sert avant tout de prétexte à une propagande religieuse : c’est pourtant la vérité. Si le roi de Thèbes refuse d’obéir, on l’obligera à renoncer au culte de Râ pour prendre le culte de Set. Aussi bien la querelle d’Apôpi et de Soknounrî semble n’être qu’une version égyptienne d’un récit populaire en Orient. « Les rois d’alors s’envoyaient les uns aux autres des problèmes à résoudre sur toutes sortes de matières, à condition de se payer une espèce de tribut ou d’amende, selon qu’ils répondraient bien ou mal aux questions proposées. » C’est ainsi qu’Hiram faisait résoudre, par un certain Abdémon, les énigmes que lui proposait Salomon. Sans examiner ici les différentes formes de ce conte, je me bornerai à en citer une qui me paraît avoir une certaine analogie avec ce qui subsiste du récit égyptien. Le Pharaon Nectanébo envoie un ambassadeur à Lycerus, roi de Babylone, et à son ministre Ésope : « J’ay des cavales en Égypte qui conçoivent au bannissement des chevaux qui sont devers Babylone : qu’avez-vous à répondre là-dessus ? » Le Phrygien remit sa réponse au lendemain ; et, retourné qu’il fut au logis, il commanda à des enfants de prendre un chat et de le mener fouettant par les rues. Les Égyptiens, qui adorent cet animal, se trouvèrent extrêmement scandalisez du traitement que l’on lui faisait. Ils l’arrachèrent des mains des enfants, et allèrent se plaindre au Roy. On fit venir en sa présence le Phrygien. « Ne savez-vous pas, lui dit le Roy, que cet animal est un de nos dieux ? Pourquoi donc le faites-vous traiter de la sorte ? – C’est pour l’offense qu’il a commise envers Lycerus, reprit Ésope ; car la nuit dernière il lui a étranglé un coq extrêmement courageux et qui chantoit à toutes les heures. – Vous estes un menteur, reprit le Roy ; comment seroit-il possible que ce chat eust fait, en si peu de temps, un si long voyage ? – Et comment est-il possible, reprit Ésope, que vos juments entendent de si loin nos chevaux hennir et conçoivent pour les entendre ? » Les hippopotamesdu lac de Thèbes, qu’il faut chasser pour que le roi du Nord puisse dormir, me paraissent présenter quelque analogie avec les chevaux dont le hennissement porte jusqu’à Babylone, et avec le chat qui fait en une seule nuit le voyage d’Assyrie, aller et retour. Je ne doute pas qu’après avoir reçu le second message d’Apôpi, Soknounrî ne trouvât, dans son conseil, un sage aussi perspicace qu’Ésope le Phrygien. Grâce à ce secours, il se tirait sain et sauf de l’épreuve. Le roman allait-il plus loin, et montrait-il la guerre éclatant entre les princes du Nord et du Sud, et l’Égypte délivrée du joug des Pasteurs ? Il faudrait pour répondre à ces questions trouver un manuscrit renfermantla fin de l’histoire, et c’est ce qu’on ne peut guère espérer.
Le roman de Thoutii n’est pas moins caractéristique. Le prince de Joppé s’était révolté contre Thoutmôs III. Thoutii attire le rebelle dans son camp sous prétexte de lui montrer la grande canne du roi, et le tue. Mais ce n’est pas tout de s’être débarrassé du chef ; il faut prendre la ville. Thoutii cache cinq cents soldats dans des jarres, les fait transporter jusque sous les murs, et là, contraint l’écuyer du prince à déclarer que les Égyptiens ont été battus et qu’on ramène leur général prisonnier. On le croit, on ouvre les portes, les soldats sortent de leurs jarres et prennent la ville. Avons-nous là le récit d’un épisode réel des guerres égyptiennes ?
Joppé a été de bonne heure occupée par les Égyptiens. Thoutmôs Ier l’avait probablement soumise dès ses premières campagnes au-delà de l’isthme ; en tout cas, elle figure sur la liste des conquêtes de Thoutmôs III. Selon l’usage du temps, elle payait un tribut au vainqueur, mais conservait son chef héréditaire. Le Vaincu de Jôpou, puisque tel est, dans le langage de la chancellerie égyptienne, le titre officiel des princes syriens soumis ou rebelles à l’Égypte, dut agir souvent comme le Vaincu de Tounipou, le Vaincu de Kodshou et tant d’autres, qui se révoltaient sans cesse et attiraient sur leurs villes la colère de Pharaon. Le fait d’un seigneur de Joppé en lutte