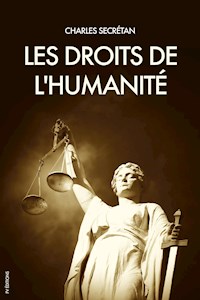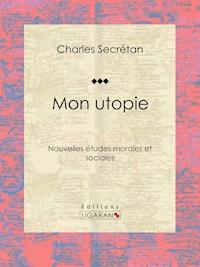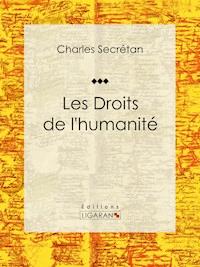
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "À la prendre dans son ensemble, l'humanité n'est pas heureuse. Le plus grand nombre des individus qui la composent ne sont pas tels qu'ils devraient être, ils ne sont pas vraiment formés, mais ils peuvent se préparer à des meilleures destinées s'ils cherchent à s'en rendre dignes ; et le premier symptôme de progrès chez eux sera de connaître leur imperfection, de sentir leurs besoins."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054088
©Ligaran 2015
L’auteur a voulu dans ces pages, écrites à la demande de quelques amis, énoncer et justifier les vœux formés aujourd’hui par le public éclairé relativement aux droits qu’une bonne législation doit consacrer. Leur cadre est donc celui d’un traité de droit naturel, dont l’idée dominante serait que le droit naît du devoir, mais que le juge du devoir étant la conscience individuelle, l’accomplissement n’en est exigible par voie de contrainte que dans la mesure indispensable à la conservation des droits d’autrui. Nos conclusions pratiques sont déduites de ce principe, et la notion du devoir exposée dans l’Introduction, la seule partie du livre dont la juste appréciation demande peut-être au lecteur une attention quelque peu soutenue.
Voulant faire tout le possible pour empêcher les malentendus, si fréquents en ces matières, les idées rectrices sont rappelées et reproduites en toute occasion, d’où résultent des répétitions qui fatigueront la patience, mais qui ne laisseront pas l’essentiel passer inaperçu.
Cependant ce petit volume n’est point un traité scientifique ; il ne résume pas un système, il ne veut être qu’un programme des principales réformes à réaliser soit par la loi, soit par le concours spontané des volontés. Aussi les sujets les plus importuns sont-ils passés sous silence ou dépêchés en quelques mots lorsqu’il n’y a pas d’urgence à s’en occuper ou que l’attention générale ne s’étant pas portée sur eux, la discussion n’en offrirait aujourd’hui qu’un intérêt spéculatif. Ce que nous aurions voulu rendre sensible, c’est l’étendue des réformes qu’implique et que réclame un libéralisme effectif ; c’est plus encore peut-être la solidarité de ces réformes, afin qu’elles soient abordées de concert par tous les amis de la liberté.
À la prendre dans son ensemble, l’humanité n’est pas heureuse. Le plus grand nombre des individus qui la composent ne sont pas tels qu’ils devraient être, ils ne sont pas vraiment formés, mais ils peuvent se préparer à de meilleures destinées s’ils cherchent à s’en rendre dignes ; et le premier symptôme de progrès chez eux sera de connaître leur imperfection, de sentir leurs besoins.
Pour se rapprocher du but, il faut savoir où le but se trouve. L’homme n’est pas nécessairement le jouet d’une aveugle destinée, la fatalité ne saurait être qu’accidentelle ; nous pouvons quelque chose pour nous-mêmes, car nous avons des devoirs.
Que nous ayons des devoirs, nous sommes incapables de le prouver. Mais ce n’est pas une chose qui ait besoin d’être prouvée : toute la structure de nos lois et de notre vie, toute la connaissance que nous avons de nous-mêmes reposent sur le devoir. Avec lui nous sommes, sans lui nous ne sommes rien.
Nous avons des devoirs, qui se résument en un seul devoir : celui de nous réaliser nous-mêmes. Connaître notre devoir ou nous connaître est donc tout un. Mais nous ne possédons pas cette connaissance au début de notre carrière, nous l’acquérons graduellement, péniblement ; à chaque étape franchie, nous découvrons l’étape nouvelle, la cime qui reste à vaincre, et qui peut-être n’est pas encore le plus haut sommet. L’idéal est notre boussole ; sans idéal, ni l’individu, ni le peuple, ni l’humanité ne savent où ils vont et ce qu’ils font ; en cherchant la satisfaction présente, ils commencent peut-être à descendre une pente sur laquelle ils rouleront jusqu’au fond du précipice, sans trouver où se retenir. Le mépris de l’idéal, décoré souvent des noms de sagesse pratique et de sens commun, n’est que l’aveuglement de la folie.
On ne saurait concevoir un idéal trop vaste, trop beau, trop parfait ; se proposer un but différent de la perfection telle qu’on la conçoit serait se détourner volontairement de la bonne voie. Mais une fois le but reconnu, il faut jalonner de son mieux le chemin qui nous en sépare, compter et mesurer les obstacles, fixer l’ordre dans lequel il convient de les attaquer, reconnaître en un mot ce qu’il est possible de faire dans le moment et dans l’état présent pour nous rapprocher d’une manière effective du bien que nous avons conçu. Le meilleur ou le moins mauvais possible dans les circonstances du présent, sérieusement et froidement considérées, sera l’objet pratique de notre effort ; mais sans la claire vision de l’idéal nous ne concevrions point ce mieux relatif, et de plusieurs maux nous choisirions peut-être le pire.
Toutefois, nous le rappelons, la perfection qui nous paraît absolue n’est que relative. Les éléments dont notre idéal se compose sont toujours suggérés, sinon fournis, par l’expérience de notre condition actuelle. Ainsi notre connaissance du bien à poursuivre et de la route à parcourir trouvera sa mesure dans les progrès réalisés jusqu’à ce jour.
Le droit découle du devoir, il faut que chacun de nous puisse accomplir la tâche qui lui est proposée, la tâche qui est sa raison d’être et qui proprement le constitue. Chaque individu, chaque peuple, chaque civilisation trouvent la mesure, le nombre et la définition de leurs droits dans la notion du devoir à laquelle ils sont parvenus.
Nous nous proposons dans les pages qui suivent de résumer d’après nos lumières les droits de l’humanité, tels qu’ils sont impliqués dans la civilisation occidentale et compris des hommes qui participent à cette civilisation. Proclamés par quelques législateurs, parfois sous-entendus, trop souvent contredits, l’opinion du public éclairé demande qu’ils soient reconnus partout et que la loi, s’inspirant d’une logique intègre, en tire partout les conséquences. Pour expliquer ce vœu, pour établir ces droits, il faut donc les appuyer sur la manière dont cette portion de l’humanité comprend le devoir. Si la formule nous en appartient en quelque mesure, nous pensons que l’idée en est, au fond, commune à tous.
Le devoir n’a rien d’arbitraire ; notre raison repousserait un commandement arbitraire, quelle que fût l’apparente autorité de celui qui chercherait à l’imposer. Le devoir est naturel ; notre devoir c’est notre nature même, ou plutôt notre nature c’est notre devoir.
Il s’agit de nous constituer, de nous développer, de nous réaliser, de nous manifester nous-mêmes. Notre nature, c’est ce que nous sommes destinés à devenir, et le trait distinctif de cette nature, c’est de nous sentir tenus à le faire. Nous sommes appelés à nous faire nous-mêmes et nous pouvons nous soustraire à cet appel ; nous nous sentons libres. Séduits par des raisons spécieuses, plusieurs contestent cette liberté, ce qui les conduit à nier le devoir ; mais ne souffrant pas qu’on touche au devoir, nous n’avons pas à discuter la liberté.
Notre nature est la liberté, notre devoir est de nous constituer, de nous établir dans la liberté, de maintenir avec un soin jaloux la puissance de nous déterminer qui nous inspire un légitime orgueil.
L’ivrogne, le voluptueux, l’ambitieux ne sont pas libres ; ils sont poussés, ils sont entraînés, ils ne se possèdent pas, leur passion les possède, ils sont contraints ; ils ne sont pas d’accord avec eux-mêmes et n’approuvent pas toujours ce qu’ils font.
En cédant à leur vice, ils se rendent toujours moins en état d’y résister ; finalement ils deviennent incapables de le juger et de se juger eux-mêmes. Une apparente unité s’établit, momentanément du moins, dans leur être ; mais s’ils pratiquent sans résistance et sans scrupule ce qu’ils faisaient d’abord en le condamnant, leur apparente liberté n’est qu’un esclavage, ils se sont réalisés d’une façon contraire à leur primitive essence, ils sont devenus d’autres êtres que ceux qu’ils étaient appelés à devenir, et cette contradiction entre leur nature vraie et leur nature acquise ne tarde pas à se manifester. Ainsi, l’homme a pour devoir de se constituer comme un être libre.
Il doit réaliser extérieurement cette liberté en élargissant sa sphère d’action, en exerçant, en développant ses facultés, en étendant constamment son pouvoir sur la nature par une connaissance de ses lois toujours plus étendue. Intérieurement, il réalise sa liberté en acquérant une possession toujours plus complète de son propre vouloir, de telle sorte qu’il ne fasse jamais rien sans l’approuver, soit, en termes équivalents, qu’il se détermine toujours par l’idée du bien.
Maintenant, qu’est-ce que le bien ? Pour répondre à cette question, il ne suffit pas d’en appeler à la conscience de chacun de nous, ainsi que le ferait volontiers le grand nombre, que l’abstraction et la réflexion fatiguent bientôt. Chacun se fait sans doute une idée du bien, mais chacun ne s’en fait pas la même idée, quoiqu’on aime à se figurer le contraire, et qu’on y parvienne en ne regardant ni trop au loin ni de trop près. Chacun se fait une certaine idée du bien, mais peu de gens se rendent compte de leur propre sentiment à cet égard, et pourtant il faut avoir du bien une notion claire, distincte et pleinement justifiée, pour en pouvoir tirer les conséquences sans tomber dans l’arbitraire et dans la confusion.
L’idée du bien pour l’homme doit, comme la notion du devoir de l’homme, se trouver comprise dans la conception de l’homme lui-même.
Quand nous assignons un devoir à l’homme, nous parlons, suivant le commun usage, de l’homme individuel, qui seul se perçoit lui-même, qui seul est perçu et qui dans ce sens, est seul réel. Mais cet homme, l’individu, ne subsiste que dans l’humanité, c’est-à-dire dans la collection et dans la succession des hommes individuels qui peuplent la terre. Ces hommes individuels, appelés par le devoir à se réaliser eux-mêmes tels qu’ils sont, sont-ils donc en vérité des êtres complets, indépendants, possédant en eux-mêmes les conditions de leur existence et de leur développement ? Ils ne le sont point.
Corporellement, chacun d’eux est une parcelle de matière organique détachée du corps de ses deux parents, pour grandir et pour se développer en s’assimilant par la respiration et par la nourriture les éléments du monde extérieur. L’humanité collective n’est donc point un amas de grains séparés, mais un tissu de fils continus et croisés en mille manières.
Mentalement, les facultés de l’homme individuel ne se développent que par imitation et par réaction, au contact de ses parents, puis de ses frères et de ses camarades. Le sein maternel est notre premier trésor, le regard maternel allume en nous la pensée, qu’il nous révèle, le baiser maternel fait sourdre en nous le flot de l’amour. L’homme ne comprend qu’en distinguant, il ne distingue qu’en formulant, il ne saurait formuler qu’au moyen du langage, et le langage est une invention collective. Prise dans un sens large, non comme une simple imitation des sons, mais comme un rapport instinctivement aperçu des mouvements extérieurs et des mouvements des organes vocaux, l’onomatopée est certainement le germe des langues ; mais ces rapports ne sont pas assez précis, assez rigoureux, assez exclusifs pour se fixer dans la mémoire de celui qu’ils auraient frappé le premier, s’ils n’étaient compris par d’autres et reçus comme signes d’une sensation d’abord, puis d’un objet et enfin d’une idée. L’individu ne parle donc, et par conséquent ne pense qu’avec le concours d’autres hommes.
Économiquement, l’enfant ne saurait subsister s’il n’est nourri et protégé par les adultes. Ceux-ci ne sauraient trouver isolement leur entretien sur la terre. Ils ont besoin de se réunir pour se défendre contre les animaux plus forts qu’eux ; la chasse et la pêche exigent un concert d’efforts pour devenir fructueuses, et du moment où les hommes se multiplient et sont contraints à cultiver la terre, ils ne peuvent la cultiver que si les récoltes leur en sont garanties, il leur devient indispensable de s’associer, et la patrie est fondée.
L’homme est un fabricant d’outils, il ne subsiste que par l’outil, mais tous ne sont pas capables de créer, de perfectionner l’outil dont tous ont besoin. L’invention d’un seul se propage et profite à tous, grâce à l’esprit d’imitation qui les anime. L’individu physique et moral ne subsiste que par la communauté, dans la communauté, comme celle-ci ne subsiste que par les efforts concertés des individus. Si quelques-uns parviennent à s’isoler, ce n’est qu’une apparence, car leur solitude même n’est garantie et ne devient possible que par le plus haut développement des institutions communes.
L’individu séparé n’est pas possible, l’individu n’est qu’une abstraction ; mais c’est dans l’individualité que le corps social trouve le progrès, la vie et la force. Il n’est donné qu’au petit nombre, au très petit nombre, d’être quelqu’un, de découvrir un îlot ignoré, d’inventer un procédé nouveau, de perfectionner un mécanisme, de formuler un théorème, de créer un rythme, un vers, une figure, une mélodie qui lui appartienne, de dire un mot qui fasse rire et n’ait pas été déjà dit mille fois. Nous sommes des copies de copies, et nous devons l’existence aux originaux. Ainsi l’individu, subsistant par l’ensemble, se développe au moyen des individus qui s’élèvent en quelque mesure au-dessus du commun niveau.
Le devoir d’être soi-même, de s’aimer, de se vouloir, de se réaliser soi-même n’a donc pas pour objet l’individu dans un isolement impossible ; l’égoïsme est contradictoire ; il contient en lui-même le germe de sa destruction. Le bien que chacun doit vouloir et réaliser, c’est le maintien, l’affermissement, le développement de l’ensemble dont il fait partie. Le bien-être de l’ensemble est le bien moral, le but positif que l’individu doit se proposer pour tâche. Et ce bien-être de l’ensemble a pour condition le bien-être de ses membres, lequel consiste essentiellement à ce que chacun d’eux veuille l’ensemble.
« Je veux que nous soyons » c’est-à-dire, je veux que nous voulions ; je veux que nous nous voulions : telle est la formule abstraite de la vérité, qui est la charité, la justice au sens positif du mot justice.
Ce nous qui est le bien, ce nous qui est l’objet du devoir, ce n’est pas la famille, ce n’est pas le clocher, ce n’est pas la patrie, ce nous, c’est l’univers, dans la mesure où nous estimons pouvoir exercer quelque influence sur la direction et l’accomplissement des volontés dans l’univers. Et comme cette influence ne saurait déployer d’effet vérifiable que dans l’humanité, le nous qu’il faut vouloir pour se vouloir vraiment soi-même, le nous dont le bien comprend notre bien, c’est l’humanité. L’objet de notre devoir raisonnable, parce qu’il est impliqué dans les conditions mêmes de notre existence, c’est de travailler à l’accomplissement, à la manifestation de toutes les puissances physiques, mentales et morales de l’humanité, ce qui implique avant tout le développement de nos propres puissances, l’avènement de notre originalité personnelle, si nous possédons le principe d’une telle originalité, ce que l’effort seul peut mettre en lumière.
Être soi-même au service du genre humain : quel que soit le sentier par où l’on y monte, cette conception du devoir est commune à tous les civilisés ; ceux qui s’en écarteraient après l’avoir atteinte sortiraient de la civilisation, non pour la dépasser, mais pour retomber dans ces formes inférieures de l’existence et de la conscience que sert à désigner le terme de barbarie.
Le patriotisme, sentiment très fort et très doux, est une vertu plus ou moins ambiguë. La nature et l’histoire ont créé les nations, dont les diversités font en s’harmonisant la richesse et la beauté de la vie terrestre. Leurs oppositions s’émoussent, elles ne s’effaceraient pas sans dommage pour l’humanité ; mais leur antagonisme lui cause une perte incalculable.
Les frontières de la patrie bornent fatalement l’horizon du plus grand nombre. La patrie est la mère qui nous élève pour devenir des hommes possédant chacun leur valeur propre ; c’est le théâtre où les individualités peuvent se produire, le champ que nous pouvons travailler, la place où nous pouvons en général le plus aisément et le plus complètement nous rendre utiles. L’amour de la patrie est vénérable aussi longtemps qu’il est la forme naturelle de l’amour de l’humanité. Mais quand l’esprit national, quand la tradition nationale dictent nos jugements et pétrissent nos caractères, la liberté de l’esprit en souffre, les individualités s’émoussent et l’humanité s’en trouve appauvrie ; quand le patriotisme s’enorgueillit, il devient petit et ridicule ; quand il nous fait oublier ou méconnaître la justice, quand séduits par la passion ou trompés par l’illusion qu’elle évoque, nous préférons le bien d’un membre au bien du corps, le patriotisme dégrade et corrompt. Civilisation vient de cité, mais longtemps avant que ce mot fût introduit dans nos langages, les sages inspirateurs du droit dont procèdent nos codes modernes ne voyaient dans le monde qu’une même ville, dont les États particuliers figuraient à leurs yeux les maisons.
Chaque foyer avait autrefois ses Lares, chaque nation sa divinité protectrice ; les nationalités se sont formées sous une influence religieuse. Ces barrières qui les séparaient devaient tomber avec la pluralité des dieux, et les nations ne former qu’un peuple. La fusion n’en est assurément point achevée ; aussi bien le polythéisme n’est-il pas tant mort qu’il le semble. L’opposition des États modernes coïncide avec la renaissance des lettres antiques et la résurrection de la mythologie. Sous les masques divers de la dévotion, de l’athéisme et de l’indifférence, le culte de la patrie a remplacé chez un grand nombre le culte de l’Esprit créateur, et ces nouveaux dieux des armées sont aussi des dieux jaloux.
Cependant l’échange des produits, des idées et des services personnels ont fait naître chez nos contemporains le sentiment de la fraternité des peuples. Malgré l’opposition naturelle entre ceux qui chassent une même proie, malgré les savantes combinaisons imaginées pour soutenir un régime intérieur artificiel par l’artificiel appui d’ennemis héréditaires, dont on fait des institutions publiques en manipulant l’opinion, nous ne saurions plus voir des étrangers dans un Schiller, dans un Manzoni, dans un Tolstoï, dans un Shakespeare. Nous savons que les peuples sont faits pour se compléter et non pour se combattre. Nous savons que la guerre n’est pas seulement le plus fâcheux des accidents, ainsi que le chef d’état-major d’une grande armée en a fait récemment l’aveu, mais qu’elle est presque toujours un crime, et toujours l’indice d’une éducation morale imparfaite et d’une constitution sociale inachevée. L’étranger n’est plus un ennemi. Pour tout dire, il n’y a plus d’étranger et l’humanité cherche un organe.
La religion du patriotisme est un culte sanguinaire, dont se détournent les cœurs droits et les esprits élevés. Qu’ils croient marcher seuls ou qu’ils éprouvent le besoin d’une aide invisible, l’objet pratique de leur devoir et de leur dévouement ne saurait plus être que l’humanité tout entière.
Ils le savent, et cette connaissance obscure ou distincte de leur devoir leur apprend quel est leur droit. Ils ont droit au libre développement de leurs facultés personnelles, ils ont droit à une place où ils puissent appliquer ces facultés personnelles au service, à la construction de l’humanité. Liberté, Solidarité telle est la nature humaine, tel est le devoir, tel est le droit.
« Au nom de Dieu, ainsi soit-il. Nous soussignés, fidèles serviteurs, par la grâce de Dieu, du roi d’Angleterre et d’Écosse, ayant entrepris, pour la gloire de Dieu, l’avancement de la foi chrétienne, l’honneur de notre roi et de notre patrie, un voyage à l’effet de fonder la première colonie dans le nord de la Virginie, reconnaissons solennellement et mutuellement, en présence de Dieu et en présence l’un de l’autre, que par cet acte nous nous réunissons en un corps politique et civil, pour maintenir entre nous le bon ordre et parvenir au but que nous nous proposons. Et en vertu dudit acte, nous ferons et établirons telles justes et équitables lois, telles ordonnances, tels actes, telles constitutions et tels officiers qu’il nous conviendra, suivant que nous le jugerons opportun et utile pour le bien général de la colonie. Moyennant quoi nous promettons toute due soumission et obéissance. En foi de quoi nous avons signé au cap Cod, le 11 novembre anno domini 1620. »
Cette charte, souscrite à bord du May Flower par une centaine d’hommes en quête d’un pays où ils pussent servir Dieu suivant leurs lumières, contient le germe d’un État fondé par une association volontaire en prenant pour base l’égalité des contractants, c’est-à-dire la substance des droits politiques.
Un siècle et demi plus tard, étant assemblés en congrès à Philadelphie, les descendants des Pèlerins et les délégués des autres colonies anglaises dans l’Amérique du Nord, qui déjà formaient les États-Unis, entreprirent de justifier devant le monde et devant l’histoire la révolte de leur pays. Dans cette déclaration solennelle, qui porte la date à jamais mémorable du 4 juillet 1776, l’énumération de leurs griefs contre le gouvernement de la mère-patrie est introduite par un énoncé de principes dont voici le texte :
« Nous tenons les vérités suivantes pour évidentes et incontestables :
Tous les hommes ont été créés égaux.
Le Créateur leur a conféré des droits inaliénables, dont les premiers sont le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit au bonheur.
C’est pour s’assurer la jouissance de ces droits que l’homme s’est donné des gouvernements, dont l’autorité devient légitime par le consentement des administrés.
Lorsqu’un gouvernement, quelle qu’en soit la forme, tend à détruire les fins pour lesquelles il existe, le peuple a le droit de le changer, de l’abolir et de le renouveler en imposant au nouveau pouvoir les limites et en lui accordant les compétences qui lui paraîtront utiles pour son bonheur et sa sécurité. La prudence enseigne, il est vrai, qu’on ne doit pas lever la main contre les gouvernements établis pour des causes frivoles et passagères ; l’homme supporte volontiers les maux supportables plutôt que de renverser les institutions qui le régissent, mais si des abus prolongés, des usurpations répétées tendent à faire peser sur un peuple le joug d’une autorité absolue, celui-ci peut et doit abattre un tel gouvernement et chercher dans un autre régime la protection de soi-même et de ses enfants. »
Au commencement de la révolution française, le marquis de La Fayette, représentant naturel des idées américaines, jugea qu’une profession de foi semblable avait une place marquée dans l’œuvre que l’Assemblée constituante s’était donné la mission d’élaborer. Sa proposition fut agréée et, à la suite de longs débats, plusieurs fois interrompus, les articles suivants, déjà votés partiellement au mois d’août 1789, furent arrêtés par l’Assemblée nationale le 3 septembre 1791 et prirent force de loi par le serment royal le 14 du même mois. Avant d’aborder l’exposition des droits de l’humanité que le sentiment général nous semble réclamer en cette fin de siècle, il est à propos de s’arrêter un moment sur ce texte, dont l’esprit a suscité bien des mouvements et dicté les constitutions de l’Europe moderne, celles qui s’appliquent à le tempérer aussi bien que celles où il domine sans contradiction.
« LES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
I. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
V. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
VI. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement-ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
VIII. La loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
XIII. Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
XV. La société a le droit de demander compte a tout agent public de son administration.
XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Les textes que nous tenions à transcrire ici n’exigent pas un long commentaire. Les fondateurs de la République fédérative américaine ont borné leur exposition du droit naturel à ce qui leur semblait nécessaire pour justifier leur rupture avec la mère-patrie ; la Constituante française, en revanche, entendait poser didactiquement les principes de toute bonne législation. Ces principes se résument en deux mots retentissants, mais dont la conciliation n’est point aisée : Liberté, Égalité. Liberté pour l’individu de faire tout ce qui n’empêche pas le voisin d’en faire autant (art. IV) ou, suivant une définition moins étroite, tout ce qui ne nuit pas à la société (art. V). Entre ces deux formules tout peut passer : la première établit une règle fixe, l’autre laisse tout à l’arbitraire des appréciations personnelles. Telle est donc la liberté que les lois devront garantir.
Mais ces lois sont l’expression de la volonté générale : tous les citoyens ont qualité pour concourir à leur élaboration. Tous sont admissibles à tous les emplois (art. VI). Telle est l’égalité. La volonté générale accordera-t-elle effectivement à chacun la faculté de faire tout ce qui est compatible avec l’exercice du même droit de la part d’autrui ? Dans ce cas la liberté et l’égalité subsisteront l’une auprès de l’autre ; mais si la volonté générale, c’est-à-dire, en fait, la majorité, commande ce qui lui plaît et défend ce qui lui déplaît sans s’arrêter devant cette règle, la liberté des particuliers dissidents ne trouvera d’appui nulle part. La liberté ne subsiste donc qu’à bien plaire. La définition en fût-elle absolument nette et sans équivoque, l’omnipotence du nombre ne renverserait pas moins tous les abris dont elle chercherait à se couvrir, sans excepter ceux que lui voudrait ménager l’article XVI.