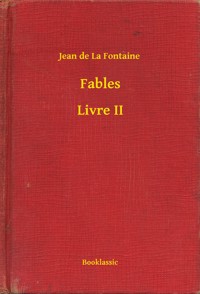Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
"Les Fables de La Fontaine sont un recueil de contes et de récits écrits par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. Ce livre est considéré comme l'un des plus grands classiques de la littérature française et est étudié dans les écoles du monde entier.Les Fables de La Fontaine sont des histoires courtes qui mettent en scène des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux qui ont des caractéristiques humaines. Chaque fable raconte une histoire avec une morale à la fin, qui est souvent une leçon de vie.Les Fables de La Fontaine sont un livre intemporel qui a traversé les siècles. Les histoires sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus de trois cents ans. Les personnages sont attachants et les morales sont toujours d'actualité.Les Fables de La Fontaine sont un livre que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. C'est un livre qui peut être apprécié par les enfants et les adultes, et qui peut être lu à haute voix en famille ou entre amis. Les Fables de La Fontaine sont un livre qui vous fera rire, réfléchir et vous émerveiller.Extrait : ""LE CORBEAU ET LE RENARD - Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à peu près ce langage : ""Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !"""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335004649
©Ligaran 2014
La Fontaine (Jean de), le fabuliste par excellence, né à Château-Thierry le 8 juillet 1621, entra par désœuvrement, et peut-être sans y avoir songé, à l’âge de 19 ans, chez les Pères de l’Oratoire, qu’il quitta dix-huit mois après, pour se soustraire à l’assujettissement des règles d’une congrégation régulière.
À 22 ans, il ignorait encore ses talents pour la poésie. La belle ode de Malherbe sur l’assassinat de Henri IV, dont il entendit la lecture, les lui fit sentir, et à l’imitation du Corrège il s’écria : « Anch’io son pittore ! Et moi aussi je suis peintre ! »
Un de ses parents, nommé Pintrel, homme instruit et de qui nous avons une traduction des Épîtres de Sénèque, ayant vu ses premiers essais, l’encouragea et lui fit lire les meilleurs auteurs, anciens et modernes, français et étrangers.
Il se nourrit de la lecture de Virgile, d’Horace, de Térence, dont il traduisit l’Eunuque, sa première production. Rabelais, Marot, d’Urfé, firent aussi ses délices : l’un par ses plaisanteries, le second par sa naïveté, l’autre par ses images champêtres.
L’esprit de simplicité, de candeur, de naïveté, qui lui plaisait tant dans ces écrivains, caractérisa bientôt ses ouvrages, et le caractérisait lui-même. Jamais auteur ne s’est mieux peint dans ses livres. Doux, ingénu, naturel, sincère, crédule, facile, timide, sans ambition, sans fiel, prenant tout en bonne part, il était, dit un homme d’esprit, aussi simple que les héros de ses fables. C’était un véritable enfant, mais un enfant sans malice. Il parlait peu, et parlait mal, à moins qu’il ne se trouvât avec des amis intimes, ou que la conversation ne roulât sur quelque sujet qui pût échauffer son génie.
La duchesse de Bouillon, l’une des nièces du cardinal Mazarin, exilée à Château-Thierry, avait connu la Fontaine et lui avait même, dit-on, fait faire ses premiers contes. Rappelée à Paris, elle y amena le poète : la Fontaine avait un de ses parents auprès de Fouquet. La maison du surintendant lui fut ouverte, et il en obtint une pension pour laquelle il faisait à chaque quartier une quittance poétique. Après la disgrâce de son bienfaiteur, dont le poète reconnaissant déplora les malheurs dans une élégie touchante et peut-être la meilleure que nous ayons en notre langue, et dans une ode moins connue adressée à Louis XIV, dont les vers sont moins beaux, mais plus hardis, il entra en qualité de gentilhomme ordinaire chez la princesse Henriette d’Angleterre.
La mort lui ayant enlevé cette princesse, il trouva de généreux protecteurs dans M. le Prince, dans le prince de Conti, le duc de Vendôme et le duc de Bourgogne ; et des protectrices dans la duchesse de Bouillon, de Mazarin, et dans l’ingénieuse madame de la Sablière, qui le retira chez elle, et prit soin de son existence.
En effet, son inertie et son imprévoyance étaient telles que, sans les soins qu’elle prit de lui, il se serait trouvé en proie à tous les besoins. Madame de la Sablière, lui rendit à cet égard les plus grands services en l’accueillant chez elle et en pourvoyant à tous ses besoins pendant vingt années : ce furent les plus heureuses de sa vie.
Elle venait de renvoyer à la fois tous ses domestiques. La reconnaissance et l’amitié de notre poète pour cette aimable dame furent sans bornes, il l’a immortalisée dans ses chefs-d’œuvre.
On a remarqué que Louis XIV ne fit pas tomber ses bienfaits sur la Fontaine comme sur les autres génies qui illustrèrent son règne. Ce prince ne goûtait pas assez le genre dans lequel ce conteur charmant excella : il traitait les fables de la Fontaine à peu près comme les tableaux de Téniers.
La bienfaitrice du poète enfant étant morte, il se rendait chez M. d’Hervart, son ami, qui le rencontra : « J’ai su, lui dit-il, le malheur qui vous est arrivé ; vous logiez chez madame de la Sablière ; elle n’est plus. Je vous prie de venir habiter ma maison. – J’y allais, répondit le poète. » Cet abandon touchant de confiance est un digne hommage rendu à l’amitié généreuse.
Il mourut à Paris, le 15 avril 1695. Il faisait partie de l’Académie française depuis 1684.
Parmi les ouvrages immortels qui nous restent de cet, homme inimitable, il faut placer au premier rang ses Fables que tout le monde connaît et a su apprécier. Quelle aisance ! quelle vivacité, quelle finesse à la fois et quelle naïveté ! car il réunissait ces deux qualités à un degré supérieur, et c’est ce mélange qui fait le prodige. C’est véritablement le poète de la nature, surtout dans ses fables, on dirait qu’elles sont tombées de sa plume.
D.-A.
Épître dédicatoire à Monseigneur Le Dauphin
Monseigneur,
S’il y a quelque chose d’ingénieux dans la république des lettres, on peut dire que c’est la manière dont Ésope a débité sa morale. Il serait véritablement à souhaiter que d’autres mains que les miennes y eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des anciens a jugé qu’ils n’y étaient pas inutiles. J’ose, Monseigneur, vous en présenter quelques essais. C’est un entretien convenable à vos premières années. Vous êtes en un âge où l’amusement et les jeux sont permis aux princes ; mais en même temps vous devez donner quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Ésope. L’apparence en est puérile, je le confesse ; mais ces puérilités servent d’enveloppes à des vérités importantes.
Je ne doute point, Monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble si agréables ; car que peut-on souhaiter davantage que ces deux points ? Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Ésope a trouvé un art singulier de les joindre l’un avec l’autre : la lecture de son ouvrage répand insensiblement dans une âme les semences de la vertu, et lui apprend à se connaître sans qu’elle s’aperçoive de cette étude, et tandis qu’elle croit faire tout autre chose. C’est une adresse dont s’est servi très heureusement celui sur lequel Sa Majesté a jeté les yeux pour vous donner des instructions. Il fait en sorte que vous apprenez sans peine, ou, pour mieux parler, avec plaisir, tout ce qu’il est nécessaire qu’un prince sache. Nous espérons beaucoup de cette conduite. Mais, à dire la vérité, il y a des choses dont nous espérons infiniment davantage : ce sont, Monseigneur, les qualités que notre invincible monarque vous a données avec la naissance ; c’est l’exemple que tous les jours il vous donne. Quand vous le voyez former de si grands desseins ; quand vous le considérez qui regarde sans s’étonner l’agitation de l’Europe et les machines qu’elle remue pour le détourner de son entreprise ; quand il pénètre dès sa première démarche jusque dans le cœur d’une province où l’on trouve à chaque pas des barrières insurmontables, et qu’il en subjugue une autre en huit jours, pendant la saison la plus ennemie de la guerre, lorsque le repos et les plaisirs règnent dans les cours des autres princes ; quand, non content de dompter les hommes, il veut triompher aussi des éléments ; et quand, au retour de cette expédition où il a vaincu comme un Alexandre, vous le voyez gouverner ses peuples comme un Auguste, avouez le vrai, Monseigneur, vous soupirez pour la gloire aussi bien que lui, malgré l’impuissance de vos années ; vous attendez avec impatience le temps où vous pourrez vous déclarer son rival dans l’amour de cette divine maîtresse. Vous ne l’attendez pas, Monseigneur ; vous le prévenez. Je n’en veux pour témoignage que ces nobles inquiétudes, cette vivacité, celle ardeur, ces marques d’esprit, de courage et de grandeur d’âme, que vous faites paraître à tous les moments. Certainement c’est une joie bien sensible à notre monarque ; mais c’est un spectacle bien agréable pour l’univers, que de voir ainsi croître une jeune plante qui couvrira un jour de son ombre tant de peuples et de nations.
Je devrais m’étendre sur ce sujet ; mais, comme le dessein que j’ai de vous divertir est plus proportionne à mes forces que celui de vous louer, je me hâte de venir aux fables, et n’ajouterai aux vérités que je vous ai dites que celle-ci : c’est Monseigneur, que je suis, avec un zèle respectueux,
Votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur,
DE LA FONTAINE.
L’indulgence que l’on a eue pour quelques-unes de mes fables me donne lieu d’espérer la même grâce pour ce recueil. Ce n’est pas qu’un des maîtres de notre éloquence n’ait désapprouvé le dessein de les mettre en vers : il a cru que leur principal ornement est de n’en avoir aucun ; que d’ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité de notre langue, m’embarrasserait en beaucoup d’endroits, et bannirait de la plupart de ces récits la brièveté, qu’on peut fort bien appeler l’âme du conte, puisque sans elle il faut nécessairement qu’il languisse. Cette opinion ne saurait partir que d’un homme d’excellent goût ; je demanderais seulement qu’il en relâchât quelque peu, et qu’il crût que les grâces lacédémoniennes ne sont pas tellement ennemies des muses françaises, que l’on ne puisse souvent les faire marcher de compagnie.
Après tout, je n’ai entrepris la chose que sur l’exemple, je ne veux pas dire des anciens, qui ne tire point à conséquence pour moi, mais sur celui des modernes. C’est de tout temps, et chez tous les peuples qui font profession de poésie, que le Parnasse a jugé ceci de son apanage. À peine les fables qu’on attribue à Ésope virent le jour, que Socrate trouva à propos de les habiller des livrées des Muses. Ce que Platon en rapporte est si agréable, que je ne puis m’empêcher d’en faire un des ornements de cette préface. Il dit que, Socrate étant condamné au dernier supplice, l’on remit l’exécution de l’arrêt à cause de certaines fêtes. Cébès l’alla voir le jour de sa mort. Socrate lui dit que les dieux l’avaient averti plusieurs fois, pendant son sommeil, qu’il devait s’appliquer à la musique avant qu’il mourût. Il n’avait pas entendu d’abord ce que ce songe signifiait : car, comme la musique ne rend pas l’homme meilleur, à quoi bon s’y attacher ? Il fallait qu’il y eût du mystère là-dessous, d’autant plus que les dieux ne se lassaient point de lui envoyer la même inspiration. Elle lui était encore venue une de ces fêtes. Si bien qu’en songeant aux choses que le ciel pouvait exiger de lui, il s’était avisé que la musique et la poésie ont tant de rapport, que possible était-ce de la dernière qu’il s’agissait. Il n’y a point de bonne poésie sans harmonie : mais il n’y en a point non plus sans fictions ; et Socrate ne savait que dire la vérité. Enfin il avait trouvé un tempérament : c’était de choisir des fables qui continssent quelque chose de véritable, telles que sont celles d’Ésope. Il employa donc à les mettre en vers les derniers moments de sa vie.
Socrate n’est pas le seul qui ait considéré comme sœurs la poésie et nos fables. Phèdre a témoigné qu’il était de ce sentiment ; et, par l’excellence de son ouvrage, nous pouvons juger de celui du prince des philosophes. Après Phèdre, Aviénus a traité le même sujet. Enfin les modernes les ont suivis : nous en avons des exemples, non seulement chez les étrangers, mais chez nous. Il est vrai que, lorsque nos gens y ont travaillé, la langue était si différente de ce qu’elle est, qu’on ne les doit considérer que comme étrangers. Cela ne m’a point détourné de mon entreprise ; au contraire, je me suis flatté de l’espérance que, si je ne courais dans cette carrière avec succès, on me donnerait au moins la gloire de l’avoir ouverte.
Il arrivera possibleque mon travail fera naître à d’autres personnes l’envie de porter la chose plus loin. Tant s’en faut que cette matière soit épuisée, qu’il reste encore plus de fables à mettre en vers que je n’en ai mis. J’ai choisi véritablement les meilleures, c’est-à-dire celles qui m’ont semblé telles : mais, outre que je puis m’être trompé dans mon choix, il ne sera pas bien difficile de donner un autre tour à celles-là même que j’ai choisies ; et si ce tour est moins long, il sera sans doute plus approuvé. Quoi qu’il en arrive, on m’aura toujours obligation, soit que ma témérité ait été heureuse, et que je ne me sois point trop écarté du chemin qu’il fallait tenir, soit que j’aie seulement excité les autres à mieux faire.
Je pense avoir justifié suffisamment mon dessein : quant à l’exécution, le public en sera juge. On ne trouvera pas ici l’élégance ni l’extrême brièveté qui rendent Phèdre recommandable : ce sont qualités au-dessus de ma portée. Comme il m’était impossible de l’imiter en cela, j’ai cru qu’il fallait en récompense égayer l’ouvrage plus qu’il n’a fait. Non que je le blâme d’en être demeuré dans ces termes : la langue latine n’en demandait pas davantage ; et si l’on y veut prendre garde, on reconnaîtra dans cet auteur le vrai caractère et le vrai génie de Térence. La simplicité est magnifique chez ces grands hommes : moi, qui n’ai pas les perfections du langage comme ils les ont eues, je ne la puis élever à un si haut point. Il a donc fallu se récompenser d’ailleurs : c’est ce que j’ai fait avec d’autant plus de hardiesse, que Quintilien dit qu’on ne saurait trop égayer les narrations. Il ne s’agit pas ici d’en apporter une raison ; c’est assez que Quintilien l’ait dit. J’ai pourtant considéré que, ces fables étant sues de tout le monde, je ne ferais rien si je ne les rendais nouvelles par quelques traits qui en relevassent le goût. C’est ce qu’on demande aujourd’hui : on veut de la nouveauté et de la gaieté. Je n’appelle pas gaieté ce qui excite le rire ; mais un certain charme, un air agréable qu’on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux.
Mais ce n’est pas tant par la forme que j’ai donnée à cet ouvrage qu’on en doit mesurer le prix que par son utilité et par sa matière : car qu’y a-t-il de recommandable dans les productions de l’esprit qui ne se rencontre dans l’apologue ? C’est quelque chose de si divin, que plusieurs personnages de l’antiquité ont attribué la plus grande partie de ces fables à Socrate, choisissant, pour leur servir de père, celui des mortels qui avait le plus de communication avec les dieux. Je ne sais comme ils n’ont point fait descendre du ciel ces mêmes fables, et comme ils ne leur ont point assigne un dieu qui en eut la direction, ainsi qu’a la poésie et à l’éloquence. Ce que je dis n’est pas tout à fait sans fondement, puisque, s’il m’est permis de mêler ce que nous avons de plus sacré parmi les erreurs du paganisme, nous voyons que la Vérité a parlé aux hommes par paraboles : et la parabole est-elle autre chose que l’apologue, c’est-à-dire un exemple fabuleux, et qui s’insinue avec d’autant plus de facilité et d’effet qu’il est plus commun et plus familier ? Qui ne nous proposerait à imiter que les maîtres de la sagesse nous fournirait un sujet d’excuse : il n’y en a point quand des abeilles et des fourmis sont capables de cela même qu’on nous demande.
C’est pour ces raisons que Platon, ayant banni Homère de sa république, y a donné à Ésope une place très honorable. Il souhaite que les enfants sucent ces fables avec le lait ; il recommande aux nourrices de les leur apprendre : car on ne saurait s’accoutumer de trop bonne heure à la sagesse et à la vertu. Plutôt que d’être réduits à corriger nos habitudes, il faut travailler à les rendre bonnes pendant qu’elles sont encore indifférentes au bien ou au mal. Or, quelle méthode y peut contribuer plus utilement que ces fables ? Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parthes, s’engagea dans leur pays sans considérer comment il en sortirait, que cela le fit périr lui et son armée, quelque effort qu’il fit pour se retirer. Dites au même enfant que le renard et le bouc descendirent au fond d’un puits pour y éteindre leur soif ; que le renard en sortit s’étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d’une échelle ; au contraire, le bouc y demeura pour n’avoir pas eu tant de prévoyance ; et par conséquent il faut considérer en toute chose la fin : je demande lequel de ces deux exemples fera le plus d’impression sur cet enfant. Ne s’arrêtera-t-il pas au dernier, comme plus conforme et moins disproportionné que l’autre à la petitesse de son esprit ? Il ne faut point m’alléguer que les pensées de l’enfance sont d’elles-mêmes assez enfantines, sans y joindre encore de nouvelles badineries. Ces badineries ne sont telles qu’en apparence ; car dans le fond, elles portent un sens très solide. Et comme, par la définition du point, de la ligne, de la surface, et par d’autres principes très familiers, nous parvenons à des connaissances qui mesurent enfin le ciel et la terre, de même aussi, par les raisonnements et conséquences que l’on peut tirer de ces fables, on se forme le jugement et les mœurs, on se rend capable des grandes choses.
Elles ne sont pas seulement morales, elles donnent encore d’autres connaissances : les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés ; par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l’abrégé de ce qu’il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables. Quand Prométhée voulut former l’homme, il prit la qualité dominante de chaque bête : de ces pièces si différentes il composa notre espèce ; il fit cet ouvrage qu’on appelle le Petit-Monde. Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu’elles nous représentent confirme les personnes d’âge avancé dans les connaissances que l’usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu’il faut qu’ils sachent. Comme ces derniers sont nouveaux venus dans le monde, ils n’en connaissent pas encore les habitants ; ils ne se connaissent pas eux-mêmes : on ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu’on peut ; il leur faut apprendre ce que c’est qu’un lion, un renard, ainsi du reste, et pourquoi l’on compare quelquefois un homme à ce renard ou à ce lion. C’est à quoi les fables travaillent : les premières notions de ces choses proviennent d’elles.
J’ai déjà passé la longueur ordinaire des préfaces ; cependant je n’ai pas encore rendu raison de la conduite de mon ouvrage.
L’apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l’une le corps, l’autre l’âme. Le corps est la fable : l’âme, la moralité. Aristote n’admet dans la fable que les animaux ; il en exclut les hommes et les plantes. Cette règle est moins de nécessité que de bienséance, puisque ni Ésope, ni Phèdre, ni aucun des fabulistes ne l’a gardée ; tout au contraire de la moralité, dont aucun ne se dispense. Que s’il m’est arrivé de le faire, ce n’a été que dans les endroits où elle n’a pu entrer avec grâce, et où il est aisé au lecteur de la suppléer. On ne considère en France que ce qui plaît : c’est la grande règle, et, pour ainsi dire, la seule. Je n’ai donc pas cru que ce fût un crime de passer par-dessus les anciennes coutumes, lorsque je ne pouvais le mettre en usage sans leur faire tort. Du temps d’Ésope, la fable était contée simplement ; la moralité séparée et toujours ensuite. Phèdre est venu, qui ne s’est pas assujetti à cet ordre : il embellit la narration, et transporte quelquefois la moralité de la fin au commencement. Quand il serait nécessaire de lui trouver place, je ne manque à ce précepte que pour en observer un qui n’est pas moins important : c’est Horace qui nous le donne. Cet auteur ne veut pas qu’un écrivain s’opiniâtre contre l’incapacité de son esprit, ni contre celle de sa matière. Jamais, à ce qu’il prétend, un homme qui veut réussir n’en vient jusque-là ; il abandonne les choses dont il voit bien qu’il ne saurait rien faire de bon.
Et quæ
Desperat tractata nitescere posse, relinquit.
C’est ce que j’ai fait à l’égard de quelques moralités du succès desquelles je n’ai pas bien espéré.
Il ne reste plus qu’à parler de la vie d’Ésope. Je ne vois presque personne qui ne tienne pour fabuleuse celle que Planude nous a laissée. On s’imagine que cet auteur a voulu donner à son héros un caractère et des aventures qui répondissent à ses fables. Cela m’a paru d’abord spécieux ; mais j’ai trouvé à la fin peu de certitude en cette critique. Elle est en partie fondée sur ce qui se passe entre Xantus et Ésope : on y trouve trop de niaiseries. Eh ! qui est le sage à qui de pareilles choses n’arrivent point ? Toute la vie de Socrate n’a pas été sérieuse. Ce qui me confirme en mon sentiment, c’est que le caractère que Planude donne à Ésope est semblable à celui que Plutarque lui a donné dans son Banquet des sept Sages, c’est-à-dire d’un homme subtil, et qui ne laisse rien passer. On me dira que le Banquet des sept Sages est aussi une invention. Il est aisé de douter de tout : quant à moi, je ne vois pas bien pourquoi Plutarque aurait voulu imposer à la postérité dans ce traité-là, lui qui fait profession d’être véritable partout ailleurs, et de conserver à chacun son caractère. Quand cela serait, je ne saurais que mentir sur la foi d’autrui : me croira-t-on moins que si je m’arrête à la mienne ? Car ce que je puis est de composer un tissu de mes conjectures, lequel j’intitulerai : Vie d’Ésope. Quelque vraisemblable que je le rende, on ne s’y assurera pas ; et, fable pour fable, le lecteur préférera toujours celle de Planude à la mienne.
Le Phyrgien
Nous n’avons rien d’assuré touchant la naissance d’Homère et d’Ésope : à peine même sait-on ce qui leur est arrivé de plus remarquable. C’est de quoi il y a lieu de s’étonner, vu que l’histoire ne rejette pas des choses moins agréables et moins nécessaires que celle-là. Tant de destructeurs de nations, tant de princes sans mérite ont trouvé des gens qui nous ont appris jusqu’aux moindres particularités de leur vie ; et nous ignorons les plus importantes de celles d’Ésope et d’Homère, c’est-à-dire des deux personnages qui ont le mieux mérité des siècles suivants. Car Homère n’est pas seulement le père des dieux, c’est aussi celui des bons poètes. Quant à Ésope, il me semble qu’on le devait mettre au nombre des sages dont la Grèce s’est tant vantée, lui qui enseignait la véritable sagesse, et qui l’enseignait avec bien plus d’art que ceux qui en donnent des définitions et des règles. On a véritablement recueilli les vies de ces deux grands hommes ; mais la plupart des savants les tiennent toutes deux fabuleuses, particulièrement celle que Planude a écrite. Pour moi, je n’ai pas voulu m’engager dans cette critique. Comme Planude vivait dans un siècle où la mémoire des choses arrivées à Ésope ne devait pas être encore éteinte, j’ai cru qu’il savait par tradition ce qu’il a laissé. Dans cette croyance, je l’ai suivi, sans retrancher de ce qu’il a dit d’Ésope que ce qui m’a semblé trop puéril, ou qui s’écartait en quelque façon de la bienséance.
Ésope était Phrygien, d’un bourg appelé Amorium. Il naquit vers la cinquante-septième olympiade, quelque deux cents ans après la fondation de Rome. On ne saurait dire s’il eut sujet de remercier la nature, ou bien de se plaindre d’elle ; car, en le douant d’un très bel esprit, elle le fit naître difforme et laid de visage, ayant à peine figure d’homme, jusqu’à lui refuser presque entièrement l’usage de la parole. Avec ces défauts, quand il n’aurait pas été de condition à être esclave, il ne pouvait manquer de le devenir. Au reste, son âme se maintint toujours libre et indépendante de la fortune.
Le premier maître qu’il eut l’envoya aux champs labourer la terre, soit qu’il le jugeât incapable de toute autre chose, soit pour s’ôter de devant les yeux un objet si désagréable. Or il arriva que ce maître étant allé voir sa maison des champs, un paysan lui donna des figues : il les trouva belles, et les fit serrer fort soigneusement, donnant ordre à son sommelier, nommé Agathopus, de les lui apporter au sortir du bain. Le hasard voulut qu’Ésope eût affaire dans le logis. Aussitôt qu’il y fut entré, Agathopus se servit de l’occasion, et mangea les figues avec quelques-uns de ses camarades : puis ils rejetèrent cette friponnerie sur Ésope, ne croyant pas qu’il se pût jamais justifier, tant il était bègue et paraissait idiot ! Les châtiments dont les anciens usaient envers leurs esclaves étaient fort cruels, et cette faute très punissable. Le pauvre Ésope se jeta aux pieds de son maître ; et, se faisant entendre du mieux qu’il put, il témoigna qu’il demandait pour toute grâce qu’on sursît de quelques moments sa punition. Cette grâce lui ayant été accordée, il alla quérir de l’eau tiède, le but en présence de son seigneur, se mit les doigts dans la bouche, et ce qui s’ensuit, sans rendre autre chose que cette eau seule. Après s’être ainsi justifié, il fit signe qu’on obligeât les autres d’on l’aire autant. Chacun demeura surpris : on n’aurait pas cru qu’une telle invention pût partir d’Ésope. Agathopus et ses camarades ne parurent point étonnés. Ils burent de l’eau comme le Phrygien avait fait, et se mirent les doigts dans la bouche ; mais ils se gardèrent bien de les enfoncer trop avant. L’eau ne laissa pas d’agir, et de mettre en évidence les figues toutes crues encore et toutes vermeilles. Par ce moyen Ésope se garantit : ses accusateurs furent punis doublement, pour leur gourmandise et pour leur méchanceté. Le lendemain, après que leur maître fut parti, et le Phrygien à son travail ordinaire, quelques voyageurs égarés (aucuns disent que c’étaient des prêtres de Diane) le prièrent, au nom de Jupiter hospitalier, qu’il leur enseignât le chemin qui conduisait à la ville. Ésope les obligea premièrement de se reposer à l’ombre ; puis, leur ayant présenté une légère collation, il voulut être leur guide, et ne les quitta qu’après qu’il les eut remis dans leur chemin. Les bonnes gens levèrent les mains au ciel, ci prièrent Jupiter de ne pas laisser cette action charitable sans récompense. À peine Ésope les eut quittés, que le chaud et la lassitude le contraignirent de s’endormir. Pendant son sommeil, il s’imagina que la Fortune était debout devant lui, qui lui déliait la langue, et par même moyen lui faisait présent de cet art dont on peut dire qu’il est l’auteur. Réjoui de cette aventure, il se réveilla en sursaut ; et en s’éveillant : Qu’est-ce ci ? dit-il : ma voix est devenue libre ; je prononce bien un râteau, une charrue, tout ce que je veux. Cette merveille fut cause qu’il changea de maître. Car, comme un certain Zénas, qui était là en qualité d’économe et qui avait l’œil sur les esclaves, en avait battu un outrageusement pour une faute qui ne le méritait pas, Ésope ne put s’empêcher de le reprendre, et le menaça que ses mauvais traitements seraient sus. Zénas, pour le prévenir et pour se venger de lui, alla dire au maître qu’il était arrivé un prodige dans sa maison ; que le Phrygien avait recouvré la parole, mais que le méchant ne s’en servait qu’à blasphémer et à médire de leur seigneur. Le maître le crut, et passa bien plus avant ; car il lui donna Ésope, avec liberté d’en faire ce qu’il voudrait. Zénas de retour aux champs, un marchand l’alla trouver, et lui demanda si pour de l’argent il le voulait accommoder de quelque bête de somme. Non pas cela, dit Zénas ; je n’en ai pas le pouvoir : mais je te vendrai, si tu veux, un de nos esclaves. Là-dessus, ayant fait venir Ésope, le marchand dit : Est-ce afin de te moquer que tu me proposes l’achat de ce personnage ? On le prendrait pour une outre. Dès que le marchand eut ainsi parlé, il prit congé d’eux, partie murmurant, partie riant de ce bel objet. Ésope le rappela, et lui dit : Achète-moi hardiment ; je ne te serai pas inutile. Si tu as des enfants qui crient et qui soient méchants, ma mine les fera taire ; on les menacera de moi comme de la bête. Cette raillerie plut au marchand. Il acheta notre Phrygien trois oboles, et dit en riant : Les dieux soient loués ! je n’ai pas fait grande acquisition, à la vérité ; aussi n’ai-je pas déboursé grand argent.
Entre autres denrées, ce marchand trafiquait d’esclaves : si bien qu’allant à Éphèse pour se défaire de ceux qu’il avait, ce que chacun d’eux devait porter pour la commodité du voyage fut départi selon leur emploi et selon leurs forces. Ésope pria que l’on eut égard à sa taille ; qu’il était nouveau venu, et devait être traité doucement. Tu ne porteras rien, si tu veux, lui repartirent ses camarades. Ésope se piqua d’honneur, et voulut avoir sa charge comme les autres. On le laissa donc choisir. Il prit le panier au pain : c’était le fardeau le plus pesant. Chacun crut qu’il l’avait fait par bêtise ; mais dès la dînée le panier fut entamé, et le Phrygien déchargé d’autant ; ainsi le soir, et de même le lendemain : de façon qu’au bout de deux jours il marchait à vide. Le bon sens et le raisonnement du personnage furent admirés.
Quant au marchand, il se défit de tous ses esclaves, à la réserve d’un grammairien, d’un chantre et d’Ésope, lesquels il alla exposer en vente à Samos. Avant que de les mener sur la place, il fit habiller les deux premiers le plus proprement qu’il put, comme chacun garde sa marchandise : Ésope, au contraire, ne fut vêtu que d’un sac, et placé entre ses deux compagnons, afin de leur donner lustre. Quelques acheteurs se présentèrent, entre autres un philosophe appelé Xantus. Il demanda au grammairien et au chantre ce qu’ils savaient faire. Tout, reprirent-ils. Cela fit rire le Phrygien : on peut s’imaginer de quel air. Planude rapporte qu’il s’en fallut peu qu’on ne prît la fuite, tant il fit une effroyable grimace. Le marchand fit son chantre mille oboles, son grammairien trois mille ; et, en cas que l’on achetât l’un des deux, il devait donner Ésope par-dessus le marché. La cherté du grammairien et du chantre dégoûta Xantus. Mais, pour ne pas retourner chez soi sans avoir fait quelque emplette, ses disciples lui conseillèrent d’acheter ce petit bout d’homme qui avait ri de si bonne grâce : on en ferait un épouvantail ; il divertirait les gens par sa mine. Xantus se laissa persuader, et fit prix d’Ésope à soixante oboles. Il lui demanda, devant que de l’acheter, à quoi il lui serait propre, comme il l’avait demandé à ses camarades. Ésope répondit : À rien, puisque les deux autres avaient tout retenu pour eux. Les commis de la douane remirent généreusement à Xantus le sou pour livre, et lui en donnèrent quittance sans rien payer.
Xantus avait une femme de goût assez délicat, et à qui toutes sortes de gens ne plaisaient pas : si bien que de lui aller présenter sérieusement son nouvel esclave, il n’y avait pas d’apparence, à moins qu’il ne la voulût mettre en colère et se faire moquer de lui. Il jugea plus à propos d’en faire un sujet de plaisanterie, et alla dire au logis qu’il venait d’acheter un jeune esclave le plus beau du monde et le mieux fait. Sur cette nouvelle, les filles qui servaient sa femme se pensèrent battre à qui l’aurait pour son serviteur ; mais elles furent bien étonnées quand le personnage parut. L’une se mit la main devant les yeux ; l’autre s’enfuit ; l’autre fit un cri. La maîtresse du logis dit que c’était pour la chasser qu’on lui amenait un tel monstre ; qu’il y avait longtemps que le philosophe se lassait d’elle. De parole en parole, le différend s’échauffa jusqu’à tel point que la femme demanda son bien et voulut se retirer chez ses parents. Xantus fit tant par sa patience, et Ésope par son esprit, que les choses s’accommodèrent. On ne parla plus de s’en aller ; et peut-être que l’accoutumance effaça à la fin une partie de la laideur du nouvel esclave.
Je laisserai beaucoup de petites choses où il fit paraître la vivacité de son esprit ; car, quoiqu’on puisse juger par là de son caractère, elles sont de trop peu de conséquence pour en informer la postérité. Voici seulement un échantillon de son bon sens et de l’ignorance de son maître. Celui-ci alla chez un jardinier se choisir lui-même une salade ; les herbes cueillies, le jardinier le pria de lui satisfaire l’esprit sur une difficulté qui regardait la philosophie aussi bien que le jardinage : c’est que les herbes qu’il plantait et qu’il cultivait avec un grand soin ne profitaient point, tout au contraire de celles que la terre produisait d’elle-même sans culture ni amendement. Xantus rapporta le tout à la Providence, comme on a coutume de faire quand on est court. Ésope se mit à rire ; et, ayant tiré son maître à part, il lui conseilla de dire à ce jardinier qu’il lui avait fait une réponse ainsi générale, parce que la question n’était pas digne de lui : il le laissait donc avec son garçon, qui assurément le satisferait. Xantus s’étant allé promener d’un autre côté du jardin, Ésope compara la terre à une femme qui, ayant des enfants d’un premier mari, en épouserait un second qui aurait aussi des enfants d’une autre femme : sa nouvelle épouse ne manquerait pas de concevoir de l’aversion pour ceux-ci, et leur ôterait la nourriture afin que les siens en profitassent. Il en était ainsi de la terre, qui n’adoptait qu’avec peine les productions du travail et de la culture, et qui réservait toute sa tendresse et tous ses bienfaits pour les siennes seules : elle était marâtre des unes, et mère passionnée des autres. Le jardinier parut si content de cette raison, qu’il offrit à Ésope tout ce qui était dans son jardin.
Il arriva quelque temps après un grand différend entre le philosophe et sa femme. Le philosophe, étant de festin, mit à part quelques friandises, et dit à Ésope va porter ceci à ma bonne amie. Ésope l’alla donner à une petite chienne qui était les délices de son maître. Xantus, de retour, ne manqua pas de demander des nouvelles de son présent, et si on l’avait trouvé bon. Sa femme ne comprenait rien à ce langage ; on fit venir Ésope pour l’éclaircir. Xantus, qui ne cherchait qu’un prétexte pour le faire battre, lui demanda s’il ne lui avait pas dit expressément : Va-t’en porter de ma part ces friandises à ma bonne amie. Ésope répondit là-dessus que la bonne amie n’était pas la femme, qui, pour la moindre parole, menaçait de faire un divorce ; c’était la chienne, qui endurait tout, et qui revenait faire caresses après qu’on l’avait battue. Le philosophe demeura court ; mais sa femme entra dans une telle colère qu’elle se retira d’avec lui. Il n’y eut parent ni ami par qui Xantus ne lui fit parler, sans que les raisons ni les prières y gagnassent rien. Ésope s’avisa d’un stratagème. Il acheta force gibier, comme pour une noce considérable, et fit tant qu’il fut rencontré par un des domestiques de sa maîtresse. Celui-ci lui demanda pourquoi tant d’apprêts. Ésope lui dit que son maître, ne pouvant obliger sa femme de revenir, en allait épouser une autre. Aussitôt que la dame sut cette nouvelle, elle retourna chez son mari, par esprit de contradiction ou par jalousie. Ce ne fut pas sans la garder bonne à Ésope, que tous les jours faisait de nouvelles pièces à son maître, et tous les jours se sauvait du châtiment par quelque trait de subtilité. Il n’était pas possible au philosophe de le confondre.
Un certain jour de marché, Xantus, qui avait dessein de régaler quelques-uns de ses amis, lui commanda d’acheter ce qu’il y aurait de meilleur, et rien autre chose. Je t’apprendrai, dit en soi-même le Phrygien, à spécifier ce que tu souhaites, sans t’en remettre à la discrétion d’un esclave. Il n’acheta donc que des langues, lesquelles il fit accommoder à toutes les sauces ; l’entrée, le second, l’entremet, tout ne fut que langues. Les conviés louèrent d’abord le choix de ce mets ; à la fin ils s’en dégoûtèrent. Ne t’ai-je pas commandé, dit Xantus, d’acheter ce qu’il y aurait de meilleur ? Eh ! qu’y a-t-il de meilleur que la langue ? reprit Ésope. C’est le lien de la vie civile, la clef des sciences, l’organe de la vérité et de la raison : par elle on bâtit les villes et on les police ; on instruit, on persuade, on règne dans les assemblées, on s’acquitte du premier de tous les devoirs, qui est de louer les dieux. Eh bien ! dit Xantus (qui prétendait l’attraper), achète-moi demain ce qui est de pire : ces mêmes personnes viendront chez moi ; et je veux diversifier.
Le lendemain Ésope ne fit encore servir que le même mets, disant que la langue est la pire chose qui soit au monde : c’est la mère de tous débats, la nourrice des procès, la source des divisions et des guerres. Si on dit qu’elle est l’organe de la vérité, c’est aussi celui de l’erreur, et, qui pis est, de la calomnie. Par elle on détruit les villes, on persuade de méchantes choses. Si d’un côté elle loue les dieux, de l’autre elle profère des blasphèmes contre leur puissance. Quelqu’un de la compagnie dit à Xantus que véritablement ce valet lui était fort nécessaire ; car il savait le mieux du monde exercer la patience d’un philosophe. De quoi vous mettez-vous en peine ? reprit Ésope. Eh ! trouve-moi, dit Xantus, un homme qui ne se mette en peine de rien Ésope alla le lendemain sur la place ; et voyant un paysan qui regardait toutes choses avec la froideur et l’indifférence d’une statue, il amena ce paysan au logis. Voilà, dit-il à Xantus, l’homme sans souci que vous demandez. Xantus commanda à sa femme de faire chauffer de l’eau, de la mettre dans un bassin, puis de laver elle-même les pieds de son nouvel hôte. Le paysan la laissa faire quoiqu’il sût fort bien qu’il ne méritait pas cet honneur ; mais il disait en lui-même : C’est peut-être la coutume d’en user ainsi. On le fit asseoir au haut bout ; il prit sa place sans cérémonie. Pendant le repas, Xantus ne fit autre chose que blâmer son cuisinier ; rien ne lui plaisait : ce qui était doux, il le trouvait trop salé ; et ce qui était trop salé, il le trouvait doux. L’homme sans souci le laissait dire, et mangeait de toutes ses dents. Au dessert, on mit sur la table un gâteau que la femme du philosophe avait fait ; Xantus le trouva mauvais, quoiqu’il fût très bon. Voilà, dit-il, la pâtisserie la plus méchante que j’aie jamais mangée ; il faut brûler l’ouvrière, car elle ne fera de sa vie rien qui vaille : qu’on apporte des fagots. Attendez, dit le paysan ; je m’en vais quérir ma femme : on ne fera qu’un bûcher pour toutes les deux. Ce dernier trait désarçonna le philosophe, et lui ôta l’espérance de jamais attraper le Phrygien.
Or, ce n’était pas seulement avec son maître qu’Ésope trouvait occasion de rire et de dire de bons mots. Xantus l’avait envoyé en certain endroit : il rencontra en chemin le magistrat, qui lui demanda où il allait. Soit qu’Ésope fût distrait, ou pour une autre raison, il répondit qu’il n’en savait rien. Le magistrat, tenant à mépris et irrévérence cette réponse, le fit mener en prison. Comme les huissiers le conduisaient : Ne voyez-vous, pas, dit-il, que j’ai très bien répondu ? Savais-je qu’on me ferait aller où je vais ? Le magistrat le fit relâcher, et trouva Xantus heureux d’avoir un esclave si plein d’esprit Xantus, de sa part, voyait par là de quelle importance il lui était de ne point affranchir Ésope, et combien la possession d’un tel esclave lui faisait d’honneur. Même un jour, faisant la débauche avec ses disciples, Ésope, qui les servait, vit que les fumées leur échauffaient déjà la cervelle, aussi bien au maître qu’aux écoliers. La débauche de vin, leur dit-il, a trois degrés : le premier, de volupté ; le second, d’ivrognerie ; le troisième, de fureur. On se moqua de son observation, et on continua de vider les pots. Xantus s’en donna jusqu’à perdre la raison, et à se vanter qu’il boirait la mer. Cela fit rire la compagnie. Xantus soutint ce qu’il avait dit, gagea sa maison qu’il boirait la mer tout entière ; et, pour assurance de la gageure, il déposa l’anneau qu’il avait au doigt.
Le jour suivant, que les vapeurs de Bacchus furent dissipées, Xantus fut extrêmement surpris de ne plus retrouver son anneau, lequel il tenait fort cher. Ésope lui dit qu’il était perdu, et que sa maison l’était aussi par la gageure qu’il avait faite. Voilà le philosophe bien alarmé : il pria Ésope de lui enseigner une défaite. Ésope s’avisa de celle-ci.
Quand le jour que l’on avait pris pour l’exécution de la gageure fut arrivé, tout le peuple de Samos accourut au rivage de la mer pour être témoin de la honte du philosophe. Celui de ses disciples qui avait gagé contre lui triomphait déjà. Xantus dit à l’assemblée : Messieurs, j’ai gagé véritablement que je boirais toute la mer, mais non pas les fleuves qui entrent dedans ; c’est pourquoi, que celui qui a gagé contre moi détourne leurs cours, et puis je ferai ce que je me suis vanté de faire. Chacun admira l’expédient que Xantus avait trouvé pour sortir à son honneur d’un si mauvais pas. Le disciple confessa qu’il était vaincu, et demanda pardon à son maître. Xantus fut reconduit jusqu’en son logis avec acclamation.
Pour récompense, Ésope lui demanda la liberté. Xantus la lui refusa, et dit que le temps de l’affranchir n’était pas encore venu ; si toutefois les dieux l’ordonnaient ainsi, il y consentait : partant, qu’il prit garde au premier présage qu’il aurait étant sorti du logis ; s’il était heureux, et que, par exemple, deux corneilles se présentassent à sa vue, la liberté lui serait donnée ; s’il n’en voyait qu’une, qu’il ne se lassât point d’être esclave. Ésope sortit aussitôt. Son maître était logé à l’écart, et apparemment vers un lieu couvert de grands arbres. À peine notre Phrygien fut hors, qu’il aperçut deux corneilles qui s’abattirent sur le plus haut. Il en alla avertir son maître, qui voulut voir lui-même s’il disait vrai. Tandis que Xantus venait, l’une des corneilles s’envola. Me tromperas-tu toujours ? dit-il à Ésope : qu’on lui donne les étrivières. L’ordre fut exécuté. Pendant le supplice du pauvre Ésope, on vint inviter Xantus à un repas : il promit qu’il s’y trouverait. Hélas ! s’écria Ésope, les présages sont bien menteurs ! moi, qui ai vu deux corneilles, je suis battu ; mon maître, qui n’en a vu qu’une, est prié de noces. Ce mot plut tellement à Xantus, qu’il commanda qu’on cessât de fouetter Ésope ; mais, quant à la liberté, il ne se pouvait résoudre à la lui donner, encore qu’il la lui promît en diverses occasions.
Un jour ils se promenaient tous deux parmi de vieux monuments, considérant avec beaucoup de plaisir les inscriptions qu’on y avait mises. Xantus en aperçut une qu’il ne put entendre, quoiqu’il demeurât longtemps à en chercher l’explication. Elle était composée des premières lettres de certains mots. Le philosophe avoua ingénument que cela passait son esprit. Si je vous fais trouver un trésor par le moyen de ces lettres, lui dit Ésope, quelle récompense aurai-je ? Xantus lui promit la liberté et la moitié du trésor. Elles signifient, poursuivit Ésope, qu’à quatre pas de cette colonne nous en rencontrerons un. En effet, ils le trouvèrent après avoir creusé quelque peu dans la terre. Le philosophe fut sommé de tenir parole ; mais il reculait toujours. Les dieux me gardent de t’affranchir, dit-il à Ésope, que tu ne m’aies donné avant cela l’intelligence de ces lettres ! ce me sera un autre trésor plus précieux que celui que nous avons trouvé. On les a ici gravées, poursuivit Ésope, comme étant les premières lettres de ces mots :’πόϐας, βήματα, etc. ; c’est-à-dire : « Si vous reculez quatre pas, et que vous creusiez, vous trouverez un trésor. » Puisque tu es si subtil, repartit Xantus, j’aurais tort de me défaire de toi : n’espère donc pas que je t’affranchisse. Et moi, répliqua Ésope, je vous dénoncerai au roi Denys ; car c’est à lui que le trésor appartient, et ces mêmes lettres commencent d’autres mots qui le signifient. Le philosophe intimidé dit au Phrygien qu’il prît sa part de l’argent, et qu’il n’en dît mot ; de quoi Ésope déclara ne lui avoir aucune obligation, ces lettres ayant été choisies de telle manière qu’elles enfermaient un triple sens, et signifiaient encore : « En vous en allant, vous partagerez le trésor que vous aurez rencontré. » Dès qu’il fut de retour, Xantus commanda qu’on enfermât le Phrygien, et que l’on lui mit les fers aux pieds, de crainte qu’il n’allât publier cette aventure. Hélas ! s’écria Ésope, est-ce ainsi que les philosophes s’acquittent de leurs promesses ? Mais faites ce que vous voudrez, il faudra que vous m’affranchissiez malgré vous.
Sa prédiction se trouva vraie. Il arriva un prodige qui mit fort en peine les Samiens. Un aigle enleva l’anneau publie (c’était apparemment quelque sceau que l’on apposait aux délibérations du conseil), et le fit tomber au sein d’un esclave. Le philosophe fut consulté là-dessus, et comme étant philosophe, et comme étant un des premiers de la république. Il demanda temps, et eut recours à son oracle ordinaire : c’était Ésope. Celui-ci lui conseilla de le produire en public, parce que, s’il rencontrait bien, l’honneur en serait toujours à son maître ; sinon, il n’y aurait que l’esclave de blâmé. Xantus approuva la chose, et le fit monter à la tribune aux harangues. Dès qu’on le vit, chacun s’éclata de rire : personne ne s’imagina qu’il pût rien partir de raisonnable d’un homme fait de cette manière. Ésope leur dit qu’il ne fallait pas considérer la forme du vase, maris la liqueur qui y était enfermée. Les Samiens lui crièrent qu’il dit donc sans crainte ce qu’il jugeait de ce prodige. Ésope s’en excusa sur ce qu’il n’osait le faire. La Fortune, disait-il, avait mis un débat de gloire entre le maître et l’esclave : si l’esclave disait mal, il serait battu ; s’il disait mieux que le maître, il serait battu encore. Aussitôt on pressa Xantus de l’affranchir. Le philosophe résista longtemps. À la fin le prévôt de ville le menaça de le faire de son office, et en vertu du pouvoir qu’il en avait comme magistrat ; de façon que le philosophe fut obligé de donner les mains. Cela fait, Ésope dit que les Samiens étaient menacés de servitude par ce prodige ; et que l’aigle enlevant leur sceau ne signifiait autre chose qu’un roi puissant qui voulait les assujettir.
Peu de temps après, Crésus, roi des Lydiens, fit dénoncer à ceux de Samos qu’ils eussent à se rendre ses tributaires ; sinon, qu’il les y forcerait par les armes. La plupart était d’avis qu’on lui obéit. Ésope leur dit que la Fortune présentait deux chemins aux hommes : l’un, de liberté, rude et épineux au commencement, mais dans la suite très agréable ; l’autre, d’esclavage, dont les commencements étaient plus aisés, mais la suite laborieuse. C’était conseiller assez intelligiblement aux Samiens de défendre leur liberté. Ils renvoyèrent l’ambassadeur de Crésus avec peu de satisfaction.
Crésus se mit en état de les attaquer. L’ambassadeur lui dit que, tant qu’ils auraient Ésope avec eux, il aurait peine à les réduire à ses volontés, vu la confiance qu’ils avaient au bon sens du personnage. Crésus le leur envoya demander, avec promesse de leur laisser la liberté, s’ils le lui livraient. Les principaux de la ville trouvèrent ces conditions avantageuses, et ne crurent pas que leur repos leur coûtât trop cher quand ils l’achèteraient aux dépens d’Ésope. Le Phrygien leur fît changer de sentiment en leur contant que, les loups et les brebis ayant fait un traité de paix, celles-ci donnèrent leurs chiens pour otages. Quand elles n’eurent plus de défenseurs, les loups les étranglèrent avec moins de peine qu’ils ne faisaient. Cet apologue fit son effet : les Samiens prirent une délibération toute contraire à celle qu’ils avaient prise. Ésope voulut toutefois aller vers Crésus, et dit qu’il les servirait plus utilement étant près du roi, que s’il demeurait à Samos.
Quand Crésus le vit, il s’étonna qu’une si chétive créature lui eût été un si grand obstacle. Quoi ! voilà celui qui fait qu’on s’oppose à mes volontés ! s’écria-t-il. Ésope se prosterna à ses pieds. Un homme prenait des sauterelles, dit-il ; une cigale lui tomba aussi sous la main. Il s’en allait la tuer comme il avait fait les sauterelles. Que vous ai-je fait ? dit-elle à cet homme : je ne ronge point vos blés ; je ne vous procure aucun dommage ; vous ne trouverez en moi que la voix, dont je me sers fort innocemment. Grand roi, je ressemble à cette cigale : je n’ai que la voix, et ne m’en suis point servi pour vous offenser. Crésus, touché d’admiration et de pitié, non seulement lui pardonna, mais il laissa en repos les Samiens à sa considération.