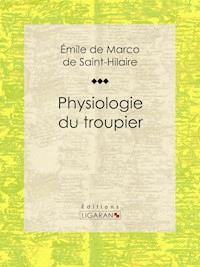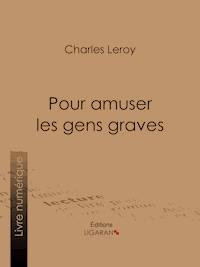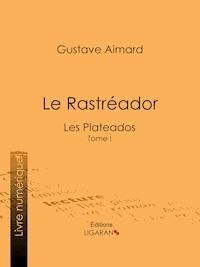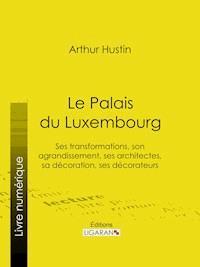Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "Placée au beau milieu du bassin rhénan, entre la Gaule et le Germanie, sur la grande route des invasions, l'Alsace a été, dès l'origine des temps historiques, le théâtre principal de la guerre entre deux races, entre deux civilisations. Conquise et perdue tour à tour par la France et par l'Allemagne, subissant leur double influence, mais ne perdant jamais son individualité propre, elle n'a cessé d'être l'enjeu même de cette grande lutte."
À PROPOS DES ÉDITIONS Ligaran :
Les éditions Ligaran proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MON AMI CHARLES DE POMAIROLS
À vous, qui avez montré, dans votre LAMARTINE, l’ÂME FRANÇAISE embrassant tout l’horizon de l’Humanité, je dédie ce livre qui cherche l’ÂME CELTIQUE à sa source.
E.S.
Si je me demande ce qu’a été pour moi ce livre, qui va des sommets des Vosges aux landes de Bretagne et jusqu’à la pointe extrême du Finistère, si j’essaye de comprendre à quelle voix intérieure, à quelle volonté latente j’ai obéi en l’écrivant, – je m’aperçois qu’un but mystérieux en a déterminé, à mon insu, les étapes successives.
Ce livre a été un voyage à la découverte de l’ÂME CELTIQUE.
L’Âme celtique est l’âme intérieure et profonde de la France. C’est d’elle que viennent les impulsions élémentaires comme les hautes inspirations du peuple français. Impressionnable, vibrante, impétueuse, elle court aux extrêmes et a besoin d’être dominée pour trouver son équilibre. Livrée à l’instinct, elle sera la colère, la révolte, l’anarchie ; ramenée à son essence supérieure, elle s’appellera : intuition, sympathie, humanité. Druidesse passionnée ou Voyante sublime, l’Âme celtique est dans notre histoire la glorieuse vaincue qui toujours rebondit de ses défaites, la grande Dormeuse qui toujours ressuscite de ses sommeils séculaires. Écrasée par le génie latin, opprimée par la puissance franque, criblée d’ironie par l’esprit gaulois, l’antique prophétesse n’en ressort pas moins d’âge en âge de sa forêt épaisse. Elle reparaît, jeune toujours, et couronnée de rameaux verts. Ses plus profondes léthargies annoncent ses plus éclatants réveils. Car l’âme est la partie divine, le foyer inspirateur de l’homme. Et comme les hommes, les peuples ont une âme. Qu’elle s’obscurcisse et s’éteigne, le peuple dégénère et meurt ; qu’elle s’allume et brille de toute sa lumière, et il accomplira sa mission dans le monde. Or, pour qu’un homme ou un peuple remplisse toute sa mission, il faut que son âme arrive à la plénitude de sa conscience, à l’entière possession d’elle-même.
Voilà ce qui n’est pas encore advenu, mais ce qui se prépare pour l’âme celtique de la France. La Bretagne est son vieux sanctuaire, mais elle vit, elle palpite sur toute l’étendue de notre sol et dans toutes les périodes de notre histoire, depuis la guerre des Gaules jusqu’à la guerre de Cent ans, et de celle-ci à la Révolution française, et aujourd’hui elle est prête à dire au monde son secret. Elle n’a cessé de parler par les héros, les poètes et les penseurs de la France. Je l’ai cherchée ici, à sa source, dans quelques-unes de nos vieilles légendes et dans les paysages qui furent leur berceau.
La Légende, rêve lucide de l’âme d’un peuple, est sa manifestation directe, sa révélation vivante.
Comme une double conscience plus profonde, elle reflète l’Avenir dans le Passé. Des figures merveilleuses apparaissent dans son miroir magique et parlent de ces vérités qui sont au-dessus des temps.
Si les destinées de la race germanique sont écrites dans l’Edda, la mission du génie celtique brille dans les triades des bardes, elle se personnifie dans les grandes légendes de saint Patrice, de Merlin l’Enchanteur et du mage Taliésinn. Mais souvent les fils oublieux ne se souviennent plus de leurs ancêtres. J’ai tenté de faire revivre ces premiers prophètes de notre race, qui savaient le passé et voyaient l’avenir, parce qu’ils vivaient dans l’Éternel-Présent.
Ô Âme celtique, toi qui dors au cœur de la France et qui veilles au-dessus d’elle, j’aurais voulu faire vibrer toutes les cordes de ta harpe mélodieuse, et je n’ai pu qu’en tirer quelques notes éparses. Mais, si tout livre n’est par lui-même qu’un verbe imparfait, puisses-tu, âme tendre et puissante, connaître un jour tes plus intimes profondeurs et tes plus vastes harmonies ! Alors, oubliant tes longs deuils et tes égarements, ta parole ne sera plus une lettre morte, mais une parole de vie, et tu diras – avec la voix de l’Âme – aux nations sœurs – ton verbe d’amour, de justice et de fraternité !
En adoptant pour ce livre le titre de Grandes Légendes de France, j’ai la conscience de n’avoir fait que peu de pas dans un vaste domaine. Jusqu’à présent la légende n’a été guère chez nous qu’un objet d’érudition ou de fantaisie. Son importance au point de vue de la philosophie de l’histoire et de la psychologie intime ou transcendante n’a pas encore été mise en lumière. Le romantisme avait traité les légendes comme de simples thèmes à imagination. On a compris depuis qu’elles sont la poésie même en ce qu’elle a de plus subtil, se manifestant dans un état d’âme intuitif que nous appelons inconscient, et qui ressemble parfois à une conscience supérieure. Replacer la légende en son cadre pittoresque et sur son terrain historique m’a semblé la meilleure manière d’en épanouir la fleur, d’en exprimer tout le suc et tout le parfum.
Par les grandes légendes de France, je voudrais qu’on entende celles qui, dépassant l’intérêt local, ont quelque rapport avec le développement national de la France et prennent une valeur symbolique dans son histoire, parce qu’elles représentent un élément essentiel de son âme collective.
Ce livre n’est donc qu’une première et humble gerbe cueillie dans une ample moisson.
Noël 1891.
Édouard SCHURÉ
1884
L’avenir de l’Europe est engagé dans la question de l’Alsace-Lorraine.
Allemandes et asservies, ces provinces affirment une Europe anarchique régie par le droit de la Force. Françaises et libres, elles affirmeront une Europe organique, gouvernée par la force du Droit.
L’Alsace n’a joué dans l’histoire qu’un rôle secondaire ; mais sa position géographique et l’instinct secret de sa race lui ont donné un rôle unique dans le concert multiple des populations européennes et semblent l’avoir prédestinée à une mission spéciale. Placée au beau milieu du bassin rhénan, entre la Gaule et la Germanie, sur la grande route des invasions, l’Alsace a été, dès l’origine des temps historiques, le théâtre principal de la guerre entre deux races, entre deux civilisations. Conquise et perdue tour à tour par la France et par l’Allemagne, subissant leur double influence, mais ne perdant jamais son individualité propre, elle n’a cessé d’être l’enjeu même de cette grande lutte. C’est la lutte vieille de deux mille ans, entre la civilisation gréco-latine, continuée, renouvelée par tous les peuples latins, dont la France est l’avant-garde, et la civilisation germanique, dont l’Allemagne est le vaste réservoir et vient de devenir sous la main de la Prusse l’agent actif et formidable.
Nous voyons l’Alsace sortir de la nuit des temps sous l’éclair d’un grand coup d’épée. C’est le jour où les légions romaines jettent dans le Rhin, entre Colmar et Cernay, Arioviste et les douze rois teutons ses alliés. Après cette victoire, César, avec l’œil du génie, désigna la bande de terre entre les Vosges et le Rhin comme le boulevard de la Gaule. De fait, elle le demeure jusqu’à la chute de l’empire romain. Les victoires de Julien et de Gratien y assurent la domination de Rome. Mais enfin le flot des barbares rompit la digue. Du IVe au VIe siècle, l’Alsace est foulée, piétinée par les Vandales, les Goths, les Ostrogoths et les Huns. Clovis, après avoir conquis la Gaule, incorpore l’Alsace au royaume des Francs et y rétablit la paix. Elle dure sous les Mérovingiens et les Carlovingiens. Mais la race de Charlemagne une fois éteinte, les empereurs d’Allemagne s’emparent du pays, pendant que la France se constitue peu à peu sous les Capétiens. Dès lors, ce ne sont plus en Alsace que guerres de seigneurs et de familles ; ces querelles remplissent son histoire sous le saint empire romain. Mais un grand fait domine : c’est la force et l’indépendance croissante des villes libres. On peut dire qu’à travers tout le Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, l’Alsace gravite insensiblement vers la France. Elle est attirée vers elle moins encore par les nécessités politiques que par l’urbanité et la grâce, par cette humanité chevaleresque qui fait le plus beau trait du caractère français. Lorsque l’Alsace passe à la monarchie française, sous Louis XIV, le détachement se fait sans violence et de son plein gré. Si, d’une part, la réformation avait établi entre l’Alsace et l’Allemagne un puissant lien spirituel, le grand mouvement national qui soulève la France pendant la révolution remue l’Alsace jusqu’aux entrailles. C’est alors qu’elle sent son âme devenir française. File se donne à la France parce qu’elle épouse son idéal de justice et de liberté. Ni malheurs, ni mécomptes, ni folies ne peuvent l’en séparer. Et c’est au moment où, prenant en quelque sorte conscience d’elle-même, où, forte de son passé, sûre de son avenir, elle veut apporter à la patrie de son choix le tribut de ses meilleures forces et de sa vivace originalité, que la terrible Némésis, la guerre implacable, l’arrache de nouveau à sa mère adoptive pour la livrer pieds et poings liés à une marâtre. Étrange destinée qui a remis en question son bonheur et sa sécurité, mais non pas sa foi invincible.
On voit dès l’abord l’intérêt particulier qu’offre le développement d’un tel pays. Placée entre l’Allemagne et la France, l’Alsace a bu tour à tour à ces deux sources. Comment les deux génies se sont-ils combinés ou combattus en elle ? N’ont-ils pu régner qu’en se détruisant l’un l’autre, ou tendent-ils à trouver en elle une fusion harmonieuse ? Est-ce dans l’exclusion ou dans la prépondérance de l’un des deux qu’est la vraie destinée de la province, son rôle à la fois patriotique et international ?
Qu’on ne s’étonne pas trop, c’est aux humbles légendes populaires que nous allons demander quelques éclaircissements sur ces graves questions. Il est de nos jours une classe d’esprits si convaincus de la supériorité de notre temps, si parqués dans leur étroite modernité, qu’ils voudraient biffer de notre mémoire tout ce qui précède la date de leur naissance. On les surprendrait fort si l’on allait chercher les racines de notre être moral « au temps où la reine Berthe filait ». Ce n’est pas à eux, disons-le tout de suite, que s’adressent ces pages. Quant à ceux qui estiment comme chose précieuse les manifestations spontanées et involontaires de l’esprit humain, qui aiment à chercher dans les légendes les éléments de la psychologie nationale et le plus suave parfum de la poésie, qu’ils me permettent une comparaison. N’y a-t-il pas en nous comme deux êtres : l’homme imparfait, grossier, plein de taches et de faiblesses, et cet autre moi, ce double lumineux, cet idéal intérieur que nous affirmons aux heures de force et d’enthousiasme ? Ce prototype de nous-mêmes, que certes nous serons appelés à poursuivre dans les existences futures, est à la fois le titre de noblesse et l’éternel tourment de ceux qui en ont pris conscience. Malheur et bonheur à ceux qui ont eu cette vision ! Ils sont forcés de combattre le grand combat. Car qui voudrait renoncer à son moi divin après l’avoir entrevu, ne fût-ce qu’une seule fois ? – Or, ce qui est vrai pour l’individu l’est également pour les peuples. Il y a dans la vie nationale des manifestations plus ou moins superficielles, plus ou moins profondes. Tout à la surface, nous trouvons le tissu grossier des faits matériels ; la littérature proprement dite nous fait déjà pénétrer plus avant dans la conscience d’un peuple ; la légende nous introduit dans son fond, à son point générateur, car elle tient au sentiment religieux par sa source, à la poésie par sa forme. L’histoire nous apprend ce qu’un peuple a été dans le cours des temps ; la légende nous fait deviner ce qu’il a voulu être, ce qu’il a rêvé de devenir à ses meilleurs moments. N’est-ce donc rien pour la connaissance de sa psychologie intime ?
Qu’on ne s’y trompe pas cependant. Les légendes alsaciennes ne se présentent point à nous sous la forme achevée, définitive, qui séduit et qui s’impose. Les trouvères et les rhapsodes leur ont manqué. La plupart d’entre elles sont à peine sorties de la poussière des chroniques, et les hasards de l’histoire ne leur ont point permis d’atteindre tout leur développement. Ce sont, en général, des traditions demeurées à l’état flottant et embryonnaire ; mais, par ces germes et ces pousses vigoureuses, on devine le caractère de la végétation. En voyant la pépinière on imagine la forêt. Nous entendrons ici par légendes les traditions mystérieuses, les visions poétiques et tous les grands souvenirs qui ont traversé les temps, surnagé dans le torrent des siècles, que l’origine en soit mythologique, ecclésiastique, populaire, ou strictement historique. En un mot, nous voudrions rappeler ce qui a vibré et vécu, tout ce qui vibre et chante encore dans l’âme de l’Alsace. Ce sera comme un résumé de son histoire.
Parmi les rochers sans nombre qui couronnent les Vosges et parsèment leurs flancs, il y a, comme en Bretagne, des pierres qui parlent. Debout sur la crête nue des montagnes ou sur la pente abrupte au milieu de vastes sapinières, ces menhirs gigantesques dominent des océans de verdure. Ce sont les témoins muets des âges disparus. Quand, par les nuits sombres, on approche l’oreille des fissures du grès couvert de mousse, on croit entendre des rires clairs ou des soupirs mélodieux s’échapper des entrailles de la pierre. Est-ce le vent qui joue dans les volutes de ces vieilles rocailles ? Est-ce le frémissement musical des hautes branches d’un sapin séculaire ? Les filles du village vous diront que c’est la voix des fées qui révèlent le passé et prédisent l’avenir.
Appliquons un instant notre oreille aux vieilles et jeunes légendes du pays, et tâchons d’entendre chanter son âme à travers les âges.
Lorsqu’on parcourt ce vaste verger qui se nomme la plaine d’Alsace, l’œil rencontre à l’horizon une bande ondulée d’un bleu sombre ; ce sont les Vosges. Par-delà les moissons jaunes et les hautes houblonnières par-dessus les champs de colza ou derrière les rideaux d’aulnes qui enveloppent les villages riants sans les cacher, partout vous apercevez cette bordure lointaine de croupes boisées ou de cimes abruptes qui attirent le regard et reposent la vue. C’est aussi vers cette chaîne de montagnes que nous reportent les plus anciennes traditions, les grandes légendes du pays, comme vers des lieux en quelque sorte sacrés.
Franchissons la zone des vignobles qui longent les montagnes, engageons-nous dans une des nombreuses vallées latérales, et gagnons les cimes à travers les épaisses forêts de chênes, de hêtres et de sapins : un autre spectacle s’offre à nos yeux. Du sommet du Ballon, du Honeck, du Brésoir ou du Donon, le relief des montagnes se dessine. Au-dessus de l’enchevêtrement des vallées profondes, les sommets des Vosges émergent des forêts comme des îles. Ce ne sont pas les pics escarpés des Alpes ni les plateaux monotones du Jura, mais de larges dômes ou des dos allongés qui affectent la forme d’animaux gigantesques, antédiluviens. Suivez ces crêtes rocheuses, promenez-vous sur ces landes, et vous vous croirez dans un autre monde. On dirait des lieux créés par la nature pour des réunions secrètes. La vie moderne s’est éloignée avec la plaine, qui prend d’ici les aspects changeants, les stries claires ou sombres d’une mer immense. Les burgs, les châteaux-forts, les ruines innombrables disparaissent à nos pieds. Nous pénétrons, bien au-delà du Moyen Âge, dans une région préhistorique. Sur la crête du Taenichel, qui descend du Brésoir aux châteaux de Ribeauvillé, des rochers étranges bordent la hauteur. Ce sont des blocs aux flancs creusés ou équarris. D’énormes caïrns surplombent l’abîme des forêts ; ils profilent sur les nuages leurs têtes de sauriens ou allongent dans le vide des museaux de sangliers. Çà et là les sapins envahissent l’enceinte monumentale ; plus loin, un chaos de rochers s’éboule dans les bois. Partout, aux formes des pierres, à leurs entailles, à leurs dépressions on croit distinguer la main de l’homme sous les caprices de la nature. Un peuple disparu adorait-il ici ses dieux terribles ? Vient l’orage ; de lourdes nuées enveloppent la montagne ; l’éclair bleuit la lande blafarde, les vallées se renvoient le bruit de la foudre, – et, frappés d’épouvante, vous croirez voir le Tarann gaulois lancer sa hache de pierre contre les angles de la montagne et entendre la voix d’Ésus sortir des forêts fouettées par l’ouragan.
Poursuivez cette promenade sur les sommets du sud au nord, et vous trouverez les traces de plus en plus visibles et certaines des peuples primitifs, des civilisations disparues. Au Schneeberg, c’est une pierre branlante parfaitement équilibrée ; au Donon, ce sont les restes d’un temple gaulois ; à Sainte-Odile enfin et au Menelstein, c’est le mur païen, prodigieuse construction qui fait depuis cent ans le bonheur des touristes et le désespoir des archéologues. Nous abandonnons aux savants le soin de déterminer à quelles époques diverses se rattachent ces monuments mégalithiques. À eux de décider si les premiers habitants de l’Alsace furent des Troglodytes, des peuples à silex ou à pierre polie, des crânes déprimés ou allongés, des Aryens, des Touraniens ou pis encore. Allons droit à l’âge gaulois et celtique, qu’on peut appeler le premier âge historique de l’Alsace, puisqu’il a laissé dans la langue et la légende des souvenirs ineffaçables.
Transportons-nous à l’époque où les Gaulois occupaient encore la rive gauche du Rhin, cent ans avant César et cinquante ans avant la grande invasion des Cimbres et des Teutons. La plaine d’Alsace était couverte de forêts et de pâturages. Vue d’en haut, on eût dit une peau noire tigrée de taches vertes. Là sont parsemés les villages des Séquanes et des Médiomatrices, maisons rondes de bois, couvertes de toits de joncs, peuple de pêcheurs et de chasseurs. Ils adoraient Vogésus, le dieu des Vosges. Les Gaulois se le représentaient tantôt comme un berger colossal poussant devant lui les troupeaux d’aurochs et de chevaux sauvages qui peuplaient alors ces forêts inextricables, tantôt comme un guerrier géant debout sur une haute cime de la chaîne, en face de la Germanie. Ils invoquaient aussi Rhénus, le dieu du Rhin, vieillard toujours en colère, auquel ils attribuaient la puissance prophétique. Mais, au-dessus de ces divinités locales créées par les indigènes régnaient les grands dieux aryens de la Gaule : Ésus, Tarann, Bélen, dont le culte était entre les mains des druides et qu’on révérait sur le sommet des montagnes.
Dès ces temps reculés, l’Alsace avait sa montagne sainte, et, chose étrange, c’était la même qu’aujourd’hui. Car, comme nous le verrons plus tard, la légende chrétienne vint se greffer sur les lieux consacrés par les vieux cultes païens. Mais, pour le moment, il nous faut oublier que nous nous trouvons sur la montagne de sainte Odile et substituer à son couvent le temple du Soleil, qui la couronnait alors. Par sa situation comme par sa forme, cette montagne est la plus remarquable de l’Alsace. Placée en évidence, elle était prédestinée à la vénération des siècles. De plus de dix lieues on aperçoit ce haut plateau. Le Menelstein forme son angle gauche et son point culminant. Il envoie dans la plaine un long promontoire mamelonné, où se dessine le château de Landsberg. À l’angle droit, un rocher isolé domine à pic les sombres forêts de sapins comme une citadelle en vedette. Un couvent l’occupe aujourd’hui ; mais il y a deux mille ans, il portait le temple de Bélen et s’appelait la montagne du Soleil. – Plaçons-nous maintenant sur le roc du Menelstein, à l’angle du plateau, et nous jouirons d’une vue à la fois splendide et sauvage, éblouissante de contrastes et d’immensité. On plane ; montagnes et plaines se déroulent à perte de vue. Les ruines d’Andlau et de Spesbourg, si majestueuses lorsqu’on les voit d’en bas, disparaissent dans les profondeurs comme des taupinières. Quatre ou cinq chaînes de montagnes se succèdent l’une derrière l’autre, comme un océan dont les vagues gigantesques vont du vert clair à l’indigo et qui roulent sur vous. Mais à côté du vertige des cimes s’étalent le charme et le repos de la plaine. Elle s’étend tout autour comme un verger sans fin, avec ses prairies, ses clochers, ses bouquets d’arbres, jusqu’à la Forêt-Noire. Par les beaux soirs d’été, les Alpes dentelées scintillent, mirage aérien, au-dessus de la ligne vaporeuse du Jura.
Une lande couverte de genêts occupe le sommet et se recourbe en fer à cheval jusqu’au rocher qui forme saillie au nord. Une chose frappe l’attention sur tout ce parcours, c’est un vieux mur qui longe et contourne le plateau. Il est bâti en énormes blocs de grès vosgien grossièrement équarris, mais si larges et si bien campés qu’ils n’ont pas bougé depuis des siècles. Quelquefois on les a trouvés reliés entre eux par ces petites pièces de bois nommées queues d’aronde. Çà et là, les pierres s’encastrent dans le roc, s’appuient aux angles de la montagne, appelés chaires de Bélen par la mythographie celtique. Quelquefois le mur, suivant les accidents de terrain, est forcé de descendre dans une ravine, mais c’est pour regrimper sur la crête. Sur un espace de plus de deux lieues, il fait le tour du plateau. Autrefois, le peuple, frappé de cette puissante construction, l’attribuait au diable. De là son nom de mur païen. Ni les hommes ni les éléments n’ont pu le démolir. La foudre a eu beau tomber, le levier creuser les interstices ; les sapins, drus et serrés, se sont lancés par milliers à l’assaut contre lui ; il n’a pas bougé. Ils ont recouvert ses parois, fouillé ses entrailles de leurs racines ; mais les arbres se dessèchent et meurent, le mur immuable est toujours là : il est resté le maître de la montagne qu’il couronne, et durera autant qu’elle.
Quel que soit l’âge de ce mur prodigieux sur lequel s’est épuisée la sagacité des antiquaires, il est évident qu’il avait pour but la défense du plateau. D’autre part, les tumuli trouvés dans l’enceinte, les menhirs postés sur les flancs, les dolmens et les pierres de sacrifices qui parsèment la montagne et les vallées environnantes, les noms mêmes de certaines localités, tout prouve que la montagne fut dans les temps celtiques le siège d’un grand culte. Rapprochons maintenant les deux ordres de faits qui découlent de ces monuments et des traditions celtiques, aidons-nous de l’Histoire et de la légende et tâchons de ressusciter les scènes dont ces pierres furent les témoins avant l’arrivée des Romains.
Il y eut dans la Gaule celtique quatre grands centres religieux où se réunissaient les tribus des diverses régions. On y traitait à certaines époques les affaires religieuses, politiques, militaires et judiciaires de la confédération. Ces lieux étaient Karnut (Chartres), au centre de la Gaule ; Karnac en Bretagne ; le massif d’Alaise dans le pays de Besançon ; et la montagne d’Ell (Bel ou Bélen), aujourd’hui le mont de Sainte-Odile. Ce dernier dut être l’avant-garde de la Gaule en vue de la frontière germaine. Lorsque les druides, venus de Bretagne avec les Kymris, s’emparèrent du gouvernement religieux et politique de la Gaule, ils apportèrent avec eux des dieux nouveaux et une doctrine secrète sur révolution de la vie, sur l’âme et sur la vie future. Cette doctrine, parente des mystères de Samothrace, se rattachait au culte des révolutions célestes. Eux seuls et leurs disciples en avaient le privilège. Quant aux peuples maintenus par la terreur sous leur autorité, ils étaient admis à la vénération des dieux supérieurs sans être initiés à leur nature. Rien de plus redoutable que l’inconnu. Ces dieux n’habitaient que les cimes ou les îles sauvages de l’océan. Or, le mont de Bélen se prêtait admirablement à la mise en scène de ce culte. Les grandes fêtes avaient lieu au solstice d’hiver et au solstice d’été, quand l’astre vainqueur remontait vers le zénith ou lorsque, parvenu au plus haut du ciel, il s’arrêtait pour contempler son empire. Une grande quantité de Gaulois accourait alors du nord et de l’ouest et venait camper aux abords du mont sacré. Mais la foule n’était admise à l’ascension que la nuit. Les ovates ou cubages gardaient les chemins et guidaient les visiteurs avec des torches de résine. On s’engageait dans une des sombres vallées. C’était la région pleine de terreur des dieux du mal, des démons de la terre. Çà et là, dans un fourré, à la lueur des pins flambants, on voyait luire un couteau de sacrifice. Quelquefois le cri d’une victime feinte ou réelle perçait l’oreille et donnait le frisson. Mais peu à peu, à travers les massifs de sapins, les bouquets de bouleaux, par les sentiers qui s’enroulaient autour de la montagne comme des bandelettes, on gagnait les régions supérieures. On parvenait enfin sur la lande de Ménel, éclairée par la lune, où les visiteurs se prosternaient devant Sirona, la Diane gauloise. Après toutes sortes de rites solennels, vers l’aube, on approchait par le plateau du temple de Bélen. Mais il était interdit aux profanes de franchir sa triple enceinte sous peine de mort. Tout ce qu’ils pouvaient obtenir, c’était de voir le dieu lui-même, le soleil levant sortir de la Forêt-Noire et dorer de son premier rayon le temple circulaire aux sept colonnes, debout sur l’abîme.
La sainte terreur que les Gaulois avaient de leurs dieux garantissait la montagne contre toute profanation. Mais il y avait d’autres ennemis à craindre : les Germains, qui dès le premier siècle avant notre ère menaçaient la Gaule. Les historiens romains nous ont décrit la formidable invasion des Teutons que Marius seul parvint à vaincre. Ils nous ont montré ces hommes de taille gigantesque, vêtus de peaux de bêtes, coiffés de mufles d’animaux effrayants ou bizarres, ou d’énormes ailes d’oiseaux de proie, pour se rendre plus effrayants. Ils nous ont fait entendre « leurs rugissements, pareils à ceux des fauves ». Ils nous ont fait voir ces peuples cheminant avec leurs chariots, leurs trésors et leurs femmes, et se répandant « comme une mer soulevée ». Mais cette invasion ne fut pas la seule. Beaucoup d’autres la précédèrent et la suivirent. Ces hordes venaient du fond de la Germanie, par la forêt hercynienne, pour ravager la Gaule ; les Vosges recevaient le premier choc, les trésors du temple avaient de quoi tenter la cupidité des Teutons ; et c’est sans doute pour le protéger que les druides firent construire ce mur énorme. Une armée pouvait camper dans l’enceinte. Plus d’une fois, elle dut être attaquée et vaillamment défendue. La muette éloquence des lieux nous retrace encore une de ces batailles où le génie ardent de la Gaule luttait avec la Germanie envahissante comme avec les éléments déchaînés : les feux allumés sur les plus hautes cimes pour rassembler toutes les tribus de l’Est ; le mont de Bélen investi par les Teutons ; les attaques nocturnes ; les combats sur les avant-monts à coup de hache et de framée ; l’enceinte escaladée, franchie, le temple menacé ; les druides se jetant dans la lutte, flambeaux allumés ; la mêlée au hasard, corps à corps, dans le chaos des rochers et des bois, et l’ennemi enfin précipité de ravine en ravine.
Plus belles que les fêtes du solstice étaient les fêtes de victoire. Alors la montagne de la guerre redevenait la montagne du soleil. Elle se hérissait de tribus armées. Les premiers guerriers étaient admis dans l’enceinte du feu sacré qui brûlait au centre du temple circulaire sur une pierre noire tombée du ciel. Le soleil renaissant embrasait le temple, les forêts, les montagnes. Peut-être qu’un barde, debout sous les colonnes, chantait pour la circonstance un de ces hymnes dont les traditions irlandaises et galloises nous ont conservé des fragments : « Il s’élance impétueusement, le feu aux flammes, au galop dévorant ! Nous l’adorons plus que la terre ! Le feu ! le feu ! comme il monte d’un vol farouche ! Comme il est au-dessus des chants du barde ! comme il est supérieur à tous les éléments ! Il est supérieur au grand Être lui-même. Dans les guerres, il n’est point lent !… Ici, dans ton sanctuaire vénéré, ta fureur est celle de la mer ; tu t’élèves, les ombres s’enfuient ! Aux équinoxes, aux solstices, aux quatre saisons de l’année, je te chanterai, juge de feu, guerrier sublime, à la colère profonde ! » – Et les sept vierges gardiennes du feu, symboles des sept planètes, vêtues de lin blanc et couronnées de feuilles de bouleau, tournaient autour du temple en frappant leurs cymbales et en poussant des cris de joie sur l’abîme.
De tout cela que reste-t-il aujourd’hui ? Quelques pierres et le vieux mur impassible. La montagne des Gaulois, des Francs et des Français est retombée au pouvoir des Teutons. Elle porte çà et là des écriteaux allemands, et c’est dans la langue de Teutobocchus qu’on nous montre le chemin des cromlechs, des dolmens, du rocher des druides et du plateau des fées ! Et quand tout semble avoir oublié ce passé lointain, sauf les pierres, la légende à la mémoire tenace se souvient encore. Elle parle d’armées entières aux cuirasses de feu qui se combattent la nuit sur les landes, de fées qui dansent au clair de lune entre les bouleaux. Une superstition singulière est restée attachée à la chapelle qui s’élève sur l’emplacement du temple de Bélen. Les jeunes filles qui veulent se marier dans l’année en font trois fois le tour. C’est peut-être un souvenir de l’ancien culte solaire et des vierges gardiennes du feu.
The dream is changed, comme dit Byron. Pour les peuples comme pour les individus, la vie est un rêve dont les tableaux se succèdent et s’effacent, dont le temps n’est qu’une vaine mesure. – Nous sommes à l’époque des Mérovingiens. Sept siècles ont passé sur l’Alsace. Après les Romains, les barbares se sont succédé. Attila a rasé l’enceinte primitive de Strasbourg. Les Francs enfin ont pacifié le pays. Çà et là apparaissent les premières traces de la civilisation. Dans les forêts encore pleines de bêtes fauves, des commencements de villes et de villages se groupent autour des castels romains et des fermes, où se sont installés les chefs francs avec leur truste qui comprend toute une armée de vassaux. Après tant d’horribles invasions, les faibles se serrent autour des forts, les paysans autour des guerriers. Le serf est trop heureux d’avoir un maître qui empêche son champ d’être brûlé. La féodalité, à son origine, est une protection. Quant aux rois mérovingiens qui ont conquis la Gaule, après un siècle de débauches effrénées et de cruautés sans nombre, ils sont tombés dans la mollesse. Le royaume est en train de se démembrer. Bientôt les maires du palais, s’emparant du sceptre, vont faire expier à leurs derniers descendants la paresse et les crimes de leurs pères. La chevelure du dernier des Mérovingiens, cette longue chevelure blonde, signe de la liberté et du pouvoir royal, tombera au fond d’un couvent sous le ciseau de la tonsure. La France proprement dite est à peine en formation ; l’Allemagne n’est encore qu’une matrice de barbares, un foyer d’invasions que l’épée des Francs commence à maintenir en respect.
Mais une autre lutte agite ce temps, lutte profonde, tout intérieure et fertile en conséquences. C’est la lutte du christianisme contre la barbarie. L’église s’est emparée de l’esprit des Francs, et, forte de sa supériorité intellectuelle, les dirige selon de vastes desseins. Mais la conquête spirituelle des âmes se fait par le monachisme, qui représente l’église libre de ce temps. Les inspirés, les saints, les héros de l’époque sont les Patrice, les Colomban et tous ces disciples de saint Benoît que l’Italie envoie à la Gaule. Ces hommes doux et sans armes sont plus redoutés des rois barbares que les plus grosses armées. Ce sont des dompteurs d’âmes et de bêtes fauves. Ils prêchent la douceur, la charité, la mansuétude au milieu des haines sauvages, de la férocité et du crime. Et, chose étrange, les barbares tremblent, écoutent, obéissent. C’est à cette victoire morale du sentiment chrétien sur la barbarie que se rapporte la plus belle peut-être et la plus complète des légendes alsaciennes. Nous la raconterons avec son merveilleux et dans sa simplicité naïve, telle qu’on la trouve dans les vieilles chroniques, sans chercher à démêler l’histoire de la fiction.
Du temps du roi Childéric II, vers l’an 670, Atalric était duc d’Alsace. Il résidait tantôt à son château d’Obernai, tantôt à Altitona, castel romain bâti au sommet de la montagne, sur l’emplacement du vieux sanctuaire gaulois. Cet Austrasien, au caractère violent et cruel, avait pour femme la sœur d’un évêque, la pieuse Béreswinde. Depuis longtemps, les époux attendaient un héritier, quand la duchesse accoucha d’une fille aveugle. Le duc s’en fâcha si fort qu’il voulut tuer l’enfant : « Je vois bien, dit-il à sa femme, que j’ai étrangement péché contre Dieu pour qu’il m’inflige pareille honte, qui jamais n’est arrivée à aucun de ma race. » – Ne t’afflige pas ainsi, lui répondit Béreswinde. Ne sais-tu pas que le Christ a dit d’un aveugle-né : « Il n’est pas né aveugle à cause de la faute de ses pères, mais afin que la gloire de Dieu apparaisse en lui » ? Ces paroles ne purent apaiser la colère sauvage du duc. Il reprit : « Fais que l’enfant aveugle soit tué par un des nôtres ou qu’on l’emporte assez loin pour que je l’oublie ; sinon, plus de joie pour moi. » Ces mots remplirent Béreswinde de terreur. Mais elle se souvint d’une serve fidèle. Elle lui remit sa fille aveugle, et, recommandant l’enfant à Dieu, elle pria la pauvre femme de le porter en secret au couvent de Baume-les-Dames, en Bourgogne. Bientôt après, un évêque vint baptiser l’enfant adoptif du monastère. Pendant qu’il versait l’eau baptismale sur le front de la petite, celle-ci ouvrit tout à coup de beaux yeux couleur d’améthyste, qui semblaient voir des merveilles et regarda l’évêque comme si elle le reconnaissait. L’aveugle-née avait reçu la vue. L’évêque lui donna le nom d’Odile et s’écria transporté de joie : « Chère fille, maintenant je demande à te revoir dans la vie éternelle ! »
Odile fut élevée au couvent de Baume-les-Dames par de nobles Austrasiennes qui préféraient la retraite en Dieu aux terreurs de ces temps barbares. Elle grandit au milieu de la solitude des forêts, dans le silence du cloître, comme une fleur au calice brillant et coloré. Lorsqu’elle fut devenue une belle jeune fille, un hasard lui apprit sa naissance et son origine. Surprise, émerveillée de cette découverte, elle fut saisie d’un désir impétueux de voir son père, de le presser dans ses bras. Et comme on lui dit qu’elle avait un jeune frère ardent et généreux, elle lui écrivit une lettre en le priant d’intercéder pour elle. À cette lecture, Hugues fut pris de pitié et d’une sorte de passion pour cette sœur inconnue qui faisait appel à ses sentiments les plus intimes et croyait en lui comme en son sauveur. Il supplia son père de l’écouter. Mais au seul nom d’Odile, Atalric fronça le sourcil et imposa silence à son fils. Hugues ne tint aucun compte de cette défense et imagina un stratagème pour faire rentrer sa sœur en grâce. Il lui envoya secrètement un équipage pour revenir en Alsace. Un jour, Atalric était assis avec quelques-uns de ses vassaux sur la terrasse d’Altitona, d’où l’on domine à pic un profond ravin. Sur la route qui monte vers le haut castel par un grand circuit, il vit arriver un char traîné par six chevaux, orné de branchages et de la bannière ducale. Il demanda : « Qui vient en si grande pompe ? » – Son fils répondit : « C’est Odile ! » – Blême de colère, Atalric s’écria : « Qui est assez hardi et assez fou pour l’appeler sans mon ordre ? – Seigneur, reprit Hugues, c’est moi, ton fils et ton serviteur. C’est grande honte que ma sœur vive en telle misère. Par pitié, je l’ai appelée. Grâce pour elle ! » – À ces mots, qui, aux yeux du Franc autocrate et implacable, étaient plus qu’une révolte et constituaient un véritable attentat à sa puissance, il brandit son sceptre en fer et en frappa son fils avec tant de violence que celui-ci mourut peu après.
Cependant Atalric, effrayé de son forfait, rentra en lui-même, et, en signe de repentir, appela sa fille auprès de lui. Des prétendants se présentèrent. Mais l’horreur de la vie avait envahi l’âme d’Odile et l’image de son frère mort pour elle y régnait seule. Elle refusa de se marier. Cette fermeté exaspéra l’âme irritable du Franc. Il résolut de lui faire épouser par force un prince allemand. Instruite par sa mère, Odile s’échappa la nuit dans un costume de mendiante. Elle traversa la plaine, passa le Rhin dans la barque d’un pêcheur et s’enfuit jusqu’aux montagnes. Harassée de fatigue, elle venait d’atteindre une vallée déserte et sauvage de la Forêt-Noire. La nuit tombait, lorsqu’elle entendit derrière elle le galop des chevaux et le cliquetis des armes. Elle comprit que c’était son père qui la poursuivait avec son prétendant et toute une troupe de vassaux. Ramassant le reste de ses forces, elle voulut gravir la montagne pour se cacher. Mais elle tomba épuisée au pied d’un roc. Saisie de désespoir, mais pleine d’une foi vive, elle étendit ses bras vers le ciel en invoquant le protecteur invisible, le roi glorieux des persécutés. Et voici que le dur rocher s’ouvrit tout d’un coup, la reçut dans son sein et se referma sur elle. Atalric, étonné, appela sa fille par son nom en lui promettant la liberté. Alors le rocher s’ouvrit comme une caverne et Odile apparut à la troupe émerveillée dans l’éclat de son innocence et de sa beauté. Toute la grotte rayonnait d’une lumière surnaturelle qui partait de la vierge, et Odile déclara qu’elle se donnait pour toujours à son rédempteur céleste.
À partir de ce jour, le duc d’Alsace fut l’humble serviteur de sa fille. Retiré lui-même au château d’Obernai, il céda à Odile le castel d’Altitona. Elle y fonda un couvent de bénédictines et en devint l’abbesse. Ainsi le sommet de l’altière montagne qui avait servi tour à tour de temple aux Gaulois belliqueux, de position militaire à l’empereur Maximien, et de résidence à un Franc ripuaire, devint enfin l’asile de l’ascétisme chrétien. Odile en donna l’exemple. Elle ne mangeait que du pain d’orge, couchait sur une peau d’ours, et mettait une pierre sous sa tête en guise de coussin. Mais elle avait l’âme trop aimante pour se contenter des joies de la vie contemplative, de ces voluptés exquises où le mystique trouve la compensation de ses tortures corporelles. Ses propres souffrances l’avaient rendue voyante dans le sens le plus profond du mot. Elle avait perdu un frère bien-aimé, premier rêve de son cœur, mais tous ceux qui souffrent étaient devenus ses frères et ses sœurs. Son ardente charité ne s’étendait pas seulement sur ses compagnes, mais encore sur tous les gens de la contrée. Elle fonda un hôpital dans le vallon qui s’ouvre au pied du couvent, afin que les malades pussent jouir du bon air et fussent plus près d’elle. Tous les jours, Odile, en robe de laine blanche, descendait d’Altitona au bas moustier, à travers les colonnades des hauts sapins, pour soigner et consoler ses malades. La chronique et la voix populaire disent merveille de ses miracles. Le plus touchant est celui qu’elle fit pour un pèlerin qu’elle rencontra mourant de soif. La sainte toucha le roc de son bâton. Aussitôt une eau claire et fraîche jaillit des fissures profondes du grès. C’est la fontaine qu’on rencontre tout près du sommet et à laquelle le peuple attribue toutes sortes de vertus.
En ce temps, Atalric vint à mourir. Odile reconnut dans son esprit que son père était en grande souffrance dans le purgatoire, à cause de ses crimes qu’il n’avait pas expiés sur la terre. Elle en ressentit une grande douleur et, redoublant d’austérités, elle pria pour lui des années. Elle pria si longtemps et si fort qu’une nuit, vers le matin, elle aperçut une vive lueur vers le fond de l’espace et entendit une voix forte lui dire : « Odile, ne te tourmente plus pour ton père, car le Dieu tout-puissant t’a exaucée et les anges ont délivré son âme. » À ce moment, les sœurs accourues la trouvèrent agenouillée en extase et presque inanimée. Elles voulurent la réveiller pour lui administrer les sacrements, mais Odile leur dit : « Ne me réveillez pas ; j’étais si heureuse ! » Et comme transfigurée, elle rendit l’âme. Aussitôt il se répandit sur le sommet de la montagne un parfum plus suave que celui des lis et des roses, plus éthéré que le baume des pins qui s’envole dans la brise.
Telle est la légende qui, depuis un millier d’années, a fait couler les larmes des âmes simples au pays d’Alsace. Les savants alsaciens ont beaucoup discuté sur son origine et son authenticité. Quelques-uns ont nié jusqu’à l’existence d’Atalric et de sa fille. Le couvent aurait été fondé par une des femmes de Charlemagne, et l’histoire inventée après coup par un moine d’Ebersheim. Quant à nous, nous ne pensons pas que ces nobles et poétiques figures naissent dans l’imagination populaire sans qu’une puissante personnalité l’ait d’abord fécondée. L’âme du peuple élabore et traduit ensuite à sa manière ce qui l’a ému, transporté au-dessus de lui-même. Mais l’action a précédé le rêve ; l’action est à l’origine de tout. Il y a dans ce récit un symbolisme naïf, un pathétique intime, une psychologie profonde, qui sont à peine indiqués, mais qui se devinent. L’idée de la voyante, de la vision spirituelle de l’âme, qui voit et possède le monde intérieur supérieur à la réalité visible, domine toute la légende, y jette comme des rais de lumière. La lutte entre l’égoïsme, la dureté, la violence du père et la pureté victorieuse de la vierge consciente et forte y introduit un élément profondément dramatique. Enfin la charité qui ouvre des sources dans le désert, le dévouement sans bornes qui demande à souffrir pour le coupable afin de le sauver, lui donnent son couronnement.
Quiconque a gravi cette montagne, quiconque, après avoir visité la chapelle des pleurs et la chapelle des anges, a contemplé ce vaste horizon et vu trembler la ligne azurée du Jura dans la pourpre du couchant, n’aura pas de peine à croire à la vierge des temps mérovingiens. Il lui semblera même que son âme respire dans cet air si pur. En redescendant par ces grandes forêts de sapins dont les fûts élancés se perdent dans une brume bleuâtre comme des nefs infinies, il ne pourra s’empêcher de rêver à l’église invisible, mais éternelle des grandes âmes qui est au-dessus de tous les temps et de toutes les discussions ; car elle a pour colonnes la charité sublime et la foi en l’âme immortelle.
De sainte Odile à la reine Richardis il n’y a pas loin. Il suffit pour cela de passer d’une vallée à l’autre et de nous transporter du VIIe au IXe siècle. Pour ce temps-là, qui n’avait ni chemins de fer, ni presse, ni démocratie, ni tout ce qui nous enfièvre et nous précipite comme un train lancé à toute vapeur, deux cents ans représentent à peine vingt des nôtres. Cependant le monde avait marché. Aux Mérovingiens avaient succédé les Carlovingiens. Un grand homme avait surgi parmi eux. Charlemagne avait compris que les deux instruments de la civilisation étaient la tradition latine et le christianisme ; il les imposa au monde barbare à grands coups d’épée. De l’alliance de Charlemagne avec l’Église sortira la féodalité. L’idée de la fidélité de l’homme à l’homme, se combinant avec celle du monde intérieur et spirituel, produira la chevalerie, cette manifestation surprenante et originale des races du Nord, germaniques et celtiques. La chevalerie est une conception nouvelle de la vie qui comprend à la fois un idéal plus élevé de l’homme et de la femme. Le type du chevalier joignant à la féauté la parfaite courtoisie et l’attrempance