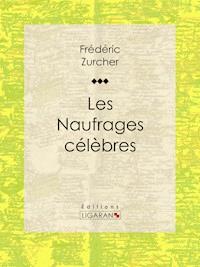
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Les Naufrages célèbres de Zurcher, Frédéric est un livre fascinant qui retrace les histoires de certains des naufrages les plus célèbres de l'histoire. L'auteur, Frédéric Zurcher, est un passionné de l'histoire maritime et a passé des années à étudier les événements tragiques qui ont marqué l'histoire de la navigation.
Dans ce livre, Zurcher nous emmène à travers les siècles pour découvrir les histoires de navires célèbres tels que le Titanic, le Lusitania et le Costa Concordia. Il explore les circonstances qui ont conduit à leur naufrage, les conséquences pour les passagers et l'équipage, ainsi que les leçons apprises pour l'avenir.
Mais Les Naufrages célèbres ne se limite pas aux grands navires de croisière. Zurcher explore également les histoires de navires de pêche, de navires de guerre et de navires marchands qui ont tous connu des tragédies en mer. Il nous raconte les histoires de courage et de survie des marins qui ont tout perdu en mer, ainsi que les efforts des sauveteurs pour les secourir.
Ce livre est un must pour tous les passionnés d'histoire maritime et pour tous ceux qui s'intéressent aux histoires de survie et de courage en mer. Les Naufrages célèbres de Zurcher, Frédéric est un livre captivant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page.
Extrait : ""Il n'existe dans l'histoire de l'Angleterre aucun fait maritime dont l'importance puisse être comparée à la destruction de la flotte espagnole envoyée, en 1588, par Philippe II, pour conquérir le royaume d'Elisabeth. Jamais nos voisins d'outre-mer ne coururent un plus grand danger et ne déployèrent une constance plus courageuse. Ajoutons qu'ils ne furent jamais
plus visiblement favorisés par la fortune."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001181
©Ligaran 2014
Hélas ! hélas ! notre flotte,
Hélas ! hélas ! nos vaisseaux ont péri.
Eschyle, les Perses.
Pendant que Xerxès se disposait à partir pour Abydos, on travaillait à construire des ponts sur l’Hellespont, afin de passer d’Asie en Europe.
Ceux que le roi avait chargés de ces ponts les commencèrent du côté d’Abydos et les continuèrent jusqu’à la côte fort rude qui s’avance dans la mer vis-à-vis de ce point : les Phéniciens, en attachant des vaisseaux avec des cordages de lin ; et les Égyptiens, en se servant pour le même effet de cordages d’écorce de byblos. Or, depuis Abydos jusqu’à la côte opposée, il y a un trajet de sept stades. Ces ponts achevés, il s’éleva une affreuse tempête qui rompit les cordages et brisa les vaisseaux.
À cette nouvelle, Xerxès indigné fit donner dans sa colère trois cents coups de fouet à l’Hellespont, et y fit jeter une paire de ceps. J’ai ouï dire qu’il avait aussi envoyé, avec les exécuteurs de cet ordre, des gens pour en marquer les eaux d’un fer ardent. Il fit ainsi châtier la mer, et l’on coupa la tête à ceux qui avaient présidé à la construction des ponts.
Ceux qu’il avait chargés de cet ordre barbare l’ayant exécuté, il employa d’autres entrepreneurs à ce même ouvrage. Voici comment ils s’y prirent : ils attachèrent ensemble trois cent soixante vaisseaux de cinquante rames et des trirèmes, et de l’autre côté trois cent quatorze. Les premiers présentaient le flanc au Pont-Euxin, et les autres, du côté de l’Hellespont, répondaient au courant de l’eau, afin de tenir les cordages encore plus tendus. Les vaisseaux ainsi disposés, ils jetèrent de grosses ancres, partie du côté du Pont-Euxin, pour résister aux vents qui soufflent de cette mer, partie du côté de l’occident et de la mer Égée, à cause des vents qui viennent du sud et du sud-est. Ils laissèrent aussi en trois endroits différents un passage libre entre les vaisseaux à cinquante rames, pour les petits bâtiments qui voudraient entrer dans le Pont-Euxin ou en sortir.
Ce travail fini, on tendit les câbles avec des machines de bois qui étaient à terre. On ne se servit pas de cordages simples, comme on avait fait la première fois, mais on les entortilla, ceux de lin blanc deux à deux, et ceux d’écorce de byblos quatre à quatre. Le pont achevé, on scia de grosses pièces de bois suivant la longueur du pont, et on les plaça l’une à côté de l’autre sur les câbles, qui étaient bien tendus. On les joignit ensemble, et, lorsque cela fut fait, on posa dessus des planches jointes les unes avec les autres, et puis on les couvrit de terre qu’on aplanit. Tout étant fini, on pratiqua de chaque côté une barrière, de crainte que les chevaux et autres bêtes de charge ne fussent effrayés en voyant la mer.
Les ponts achevés, ainsi que les digues qu’on avait faites aux embouchures du canal du mont Athos, afin d’empêcher le flux d’en combler l’entrée, le canal même étant tout à fait fini, on en porta la nouvelle à Sardes, et Xerxès se mit en marche. Tandis qu’il était en route, le soleil quittant la place qu’il occupe dans le ciel, disparut, quoiqu’il n’y eût point alors de nuages, et la nuit prit la place du jour. Xerxès, inquiet de ce prodige, consulta les mages sur ce qu’il pouvait signifier. Les mages lui répondirent que le dieu présageait aux Grecs la ruine de leurs villes, parce que le soleil annonçait l’avenir à cette nation, et la lune à la leur. Xerxès, charmé de cette réponse, se remit en marche.
Le jour même de leur arrivée à Abydos, les Perses se préparèrent à passer le pont. Le lendemain, ils attendirent quelque temps pour voir lever le soleil. En attendant qu’il se levât, ils brûlèrent sur le pont toutes sortes de parfums, et le chemin fut jonché de myrte. Dès qu’il parut, Xerxès fit avec une coupe d’or des libations dans la mer, et pria le soleil de détourner les accidents qui pourraient l’empêcher de subjuguer l’Europe avant que d’être arrivé à ses extrémités. Sa prière finie, il jeta la coupe dans l’Hellespont avec un cratère d’or et un sabre, à la façon des Perses. Je ne puis décider avec certitude si, en jetant ces choses dans la mer, il en faisait un don au soleil, ou si, se repentant d’avoir fait fustiger l’Hellespont, il cherchait à l’apaiser par ces offrandes.
L’armée de terre montait en total à dix-sept cent mille hommes. Voici comment se fit le dénombrement. On assembla un corps de dix mille dans un même espace, et les ayant fait serrer autant qu’on le put, l’on traça un cercle alentour. On fit ensuite sortir ce corps de troupes, et l’on environna ce cercle d’un mur à hauteur d’appui. Cet ouvrage achevé, on fit entrer d’autres troupes dans l’enceinte, et puis d’autres, jusqu’à ce que par ce moyen on les eut toutes comptées. Le dénombrement fait, on les rangea par nations.
Le nombre des vaisseaux était de douze cent sept. Les Perses, les Mèdes et les Sardes combattaient sur tous ces vaisseaux, dont les meilleurs voiliers étaient phéniciens, et principalement ceux de Sidon.
Tandis que les Grecs portaient en diligence du secours aux lieux qu’ils avaient ordre de défendre, les Delphiens inquiets et pour eux et pour la Grèce, consultèrent le dieu. La Pythie leur répondit d’adresser leurs prières aux vents, qu’ils seraient de puissants défenseurs de la Grèce. Les Delphiens n’eurent pas plutôt reçu cette réponse, qu’ils en firent part à tous ceux d’entre les Grecs qui étaient zélés pour la liberté ; et comme ceux-ci craignaient beaucoup le roi, ils acquirent par ce bienfait un droit immortel à leur reconnaissance. Les Delphiens érigèrent ensuite un autel aux vents à Thya, où l’on voit un lieu consacré à Thya, fille de Céphise, qui a donné son nom à ce canton, et leur offrirent des sacrifices. Ils se les rendent encore actuellement propices en vertu de cet oracle.
L’armée navale des Perses ayant abordé au rivage de la Magnésie, située entre la ville de Casthanée et la côte de Sépias, les premiers vaisseaux se rangèrent vers la terre, et les autres se tinrent à l’ancre près de ceux-là. Le rivage n’étant pas, en effet, assez grand pour une flotte si nombreuse, ils se tenaient les uns à la suite des autres, la proue tournée vers la mer, sur huit rangs de hauteur. Ils passèrent la nuit dans cette position. Le lendemain, dès la pointe du jour, après un temps serein et un grand calme, la mer s’agita ; il s’éleva une furieuse tempête, avec un grand vent de nord-est, que les habitants des côtes voisines appellent hellespontias (vent d’Hellespont). Ceux qui s’aperçurent que le vent allait en augmentant, et qui étaient en rade, prévinrent la tempête, et se sauvèrent ainsi que leurs vaisseaux, en les tirant à terre. Quant à ceux que le vent surprit en pleine mer, les uns furent poussés contre ces endroits du mont Pélion qu’on appelle Ipnes (Fours) ; les autres contre le rivage ; quelques-uns se brisèrent au promontoire Sépias ; d’autres furent portés à la ville de Mélibée ; d’autres enfin à Casthanée, tant la tempête fut violente.
On dit qu’un oracle ayant répondu aux Athéniens d’appeler leur gendre à leurs secours, ils avaient, sur l’ordre de cet oracle, adressé leurs prières à Borée. Borée, selon la tradition des Grecs, épousa une Athénienne, nommée Orithye, fille d’Érechthée. Ce fut, dit-on, cette alliance qui fit conjecturer aux Athéniens que Borée était leur gendre. Ainsi, tandis qu’ils étaient avec leurs vaisseaux à Chalcis d’Eubée pour observer l’ennemi, dès qu’ils se furent aperçus que la tempête augmenterait, ou même avant ce temps-là, ils firent des sacrifices à Borée et à Orithye, et les conjurèrent de les secourir, et de briser les vaisseaux des barbares, comme ils avaient été auparavant brisés aux environs du mont Athos. Si, par égard pour leurs prières, Borée tomba avec violence sur la flotte des barbares, qui était à l’ancre, c’est ce que je ne puis dire ; mais les Athéniens prétendent que Borée, qui les avait secourus auparavant, le fit encore en cette occasion. Aussi lorsqu’ils furent de retour dans leur pays, ils lui bâtirent une chapelle sur les bords de l’Illissus.
Il périt dans cette tempête quatre cents vaisseaux, suivant la plus petite évaluation. On y perdit aussi une multitude innombrable d’hommes, avec des richesses immenses. Les commandants de la flotte, craignant que les Thessaliens ne profitassent de leur désastre pour les attaquer, se fortifièrent d’une haute palissade qu’ils firent avec les débris des vaisseaux, car la tempête dura trois jours. Enfin les mages l’apaisèrent le quatrième jour, en immolant des victimes au vent, avec des cérémonies magiques en son honneur, et outre cela par des sacrifices à Thétis et aux Néréides, ou peut-être s’apaisa-t-elle d’elle-même.
Il n’existe dans l’histoire de l’Angleterre aucun fait maritime dont l’importance puisse être comparée à la destruction de la flotte espagnole envoyée, en 1588, par Philippe II, pour conquérir le royaume d’Élisabeth. Jamais nos voisins d’outre-mer ne coururent un plus grand danger et ne déployèrent une constance plus courageuse. Ajoutons qu’ils ne furent jamais plus visiblement favorisés par la fortune.
Une rivalité politique envenimée par les dissentiments religieux préparait depuis longtemps la guerre entre le roi d’Espagne et la reine d’Angleterre. Les négociants des deux pays se disputaient depuis un demi-siècle les marchés du monde ; les Espagnols avaient pour eux une supériorité maritime depuis longtemps acquise ; les Anglais une activité plus jeune et une ambition inassouvie.
Quant aux chefs des deux nations, ils apportaient dans cette lutte l’acharnement de convictions absolues. Si Philippe d’Espagne représentait le catholicisme le moins tolérant, Élisabeth d’Angleterre personnifiait le protestantisme le plus exclusif. Tandis que le premier livrait les hérétiques à l’inquisition en déclarant « qu’il porterait les fagots pour brûler son propre fils, s’il trempait seulement un pied dans l’hérésie, » l’autre condamnait à la prison et à l’amende quiconque assistait une seule fois à la messe, et frappait l’oubli de la moindre pratique protestante d’une amende de vingt livres par mois. Elle avait en outre établi une commission d’ecclésiastiques anglicans, chargés de prononcer sur toutes les opinions religieuses, et autorisés à employer l’emprisonnement et la torture.
On comprend la répulsion que devaient éprouver l’un pour l’autre deux souverains aussi opposés et aussi tyranniques dans leurs croyances respectives.
Des griefs politiques vinrent se joindre à ces motifs d’hostilité. Dès 1378, l’amiral Drake avait ravagé les côtes du Pérou, et, un peu plus tard, Philippe avait soudoyé les troupes que le duc de Parme conduisit aux rebelles d’Irlande. En 1585, des escadres anglaises avaient attaqué, sans déclaration de guerre, Saint-Domingue et Carthagène. Une année plus tard, Drake insulta Lisbonne et détruisit, à Cadix, une flotte entière de navires de transport. Tant d’injures appelaient une vengeance ; Philippe voulut y répondre par la conquête de l’Angleterre.
Malgré la perte des Pays-Bas, c’était encore le plus puissant prince du monde. Non seulement il possédait les Espagnes. Naples, la Sicile, le duché de Milan et la Franche-Comté, mais il commandait à Tunis, à Oran, au cap Vert et aux îles Canaries, et possédait plus de la moitié de l’Amérique.
Il équipa pour son expédition contre l’Angleterre la flotte la plus formidable qu’on eût vue jusqu’alors sur l’Océan : elle comptait vingt-deux mille hommes de débarquement, distribués sur cent cinquante-deux vaisseaux, et devait prendre en Flandre vingt-cinq mille vieux soldats, commandés par Alexandre Farnèse. Enfin douze mille Français étaient réunis en Normandie pour se joindre à eux.
La flotte avait pris le nom ambitieux de l’Invincible Armada.
Malheureusement ce gigantesque armement avait entraîné des délais. L’Angleterre eut le temps de se mettre en défense. Élisabeth parcourut son royaume pour encourager le peuple à la résistance. Le besoin d’animer les esprits fit créer le premier journal qui ait paru en Angleterre, l’English Mercury. On conserve encore au Musée britannique un exemplaire de cette curieuse publication, imprimée en lettres romaines. La reine réunit au camp de Tilbury tous les soldats qu’elle put rassembler, en passa la revue à cheval et déclara qu’elle marcherait elle-même à l’ennemi.
Les quinze mille matelots que possédait l’Angleterre furent embarqués sur cent quatorze navires, dont le plus fort n’était que de trois cents tonneaux. Un seul, nommé le Triumph, portait quarante canons. Mais cette escadre, à laquelle manquait la force matérielle, avait la force intelligente, qui peut seule faire valoir l’autre, et qui souvent la remplace. Elle était commandée par les meilleurs marins du temps : Drake, Hawkins, Frobisher et Charles Howard. Les Hollandais, de leur côté, avaient équipé quatre-vingt-dix navires, qui furent, pour la flotte anglaise, de très utiles auxiliaires.
L’Invincible Armada devait avoir pour amiral le marquis de Santa-Cruz ; mais il mourut pendant les préparatifs, et le commandement fut donné au duc de Medina-Sidonia, marin de cour, dont la présomption égalait l’ignorance. Santa-Cruz avait recommandé de s’assurer un port en cas de tempête ou d’échec, et le duc de Parme proposa de s’emparer de Flessingue ; mais le nouvel amiral déclara la précaution inutile, et il appareilla le 19 mai 1588.
Philippe le vit partir le cœur enorgueilli des plus hautes espérances, bien que le souvenir du passé eût dû le rendre moins confiant. De tout temps la mer lui avait été ennemie. Outre l’expédition de Medina-Celi contre Tripoli, dont le résultat avait été si funeste, il avait vu, en revenant des Pays-Bas, une escadre entière broyée par la tempête, presque sous ses yeux, et la précieuse collection de tableaux recueillie par Charles-Quint, en Flandre et en Italie, disparaître sous les flots. L’Invincible Armada ne fut pas plus heureuse ; accueillie par un ouragan à la hauteur du cap Finistère, elle perdit plusieurs vaisseaux sur les côtes de la Galice et de la France. Un prisonnier anglais, qui faisait partie de la chiourme d’un des navires, excita ses compagnons à la révolte, s’empara du bâtiment qu’il montait, en attaqua deux autres qu’il prit à l’abordage, et gagna un port de France.
La flotte, désemparée et déjà revenue de son orgueilleuse assurance, se réfugia dans la rade de la Corogne, où elle passa trois semaines à réparer ses avaries.
Ce premier désastre fut annoncé à Élisabeth comme la destruction complète des ennemis, et elle ordonna aussitôt le désarmement des vaisseaux anglais. Par bonheur, Charles Howard tarda à lui obéir, et l’on apprit la réapparition de l’escadre espagnole.
Victime encore une fois de l’ignorance de ses pilotes, elle avait pris le cap Lizard pour celui de Ram, près de Plymouth. Elle perdit du temps à poursuivre quelques vaisseaux anglais qui lui échappèrent, et se dirigea enfin vers la France et la Flandre, où elle allait prendre les deux corps d’armée avec lesquels devait s’accomplir la conquête de l’Angleterre. Mais sa marche était lente et inégale ; poursuivie par l’ennemi, dont les bâtiments légers la harcelaient, elle vit son arrière-garde coupée le 21 juillet. L’amiral fut forcé de l’attendre pour la dégager. Au bout de six jours, l’Invincible Armada n’avait pu encore atterrir au port flamand ; elle alla imprudemment jeter l’ancre près de Calais.
La côte lui était inconnue, le ciel annonçait un prochain ouragan. Au milieu de la nuit, des brûlots lancés par les Anglais vinrent tomber au milieu de l’escadre. Les capitaines effrayés coupèrent leurs câbles et s’efforcèrent de gagner la haute mer. Dans cette manœuvre précipitée, plusieurs navires s’abordèrent ; le lendemain, la flotte entière se trouva dispersée le long de la côte de Calais à Ostende ; les vaisseaux anglais l’attaquèrent sur plusieurs points, mais principalement dans la direction de Gravelines. Le vent se déclara contre les Espagnols, qui perdirent des navires sur les bas-fonds des bouches de l’Escaut.
Cependant le peu de forces des Anglais permit à la plus grande partie de l’Armada d’échapper à ce nouveau péril ; bien qu’elle eût perdu quinze vaisseaux et près de cinq mille hommes, elle était encore assez forte pour tenir tête à l’ennemi. Le duc de Medina-Sidonia ne montra pas plus de résolution qu’il n’avait montré d’habileté. Il donna l’ordre de la retraite, et, pour mieux éviter ses adversaires, il voulut doubler les Orcades.
Une fois engagé dans ces mers orageuses et ignorées, sa perte était certaine. Une tempête jeta dix-sept navires sur la côte d’Irlande, où tous les Espagnols qui purent gagner la terre furent massacrés. Beaucoup d’autres vaisseaux furent brisés sur les rochers des îles écossaises ; enfin, lorsque l’Invincible Armada put atteindre le port de Saint-André, elle était réduite à quarante-six navires ! Il fut établi que l’expédition entraîna pour l’Espagne une perte de cent vingt millions.
En apprenant cette nouvelle, Philippe se contenta de dire : « J’avais envoyé combattre les Anglais et non les tempêtes ; que la volonté de Dieu soit faite ! »
Il fit ordonner ensuite des prières d’actions de grâce pour remercier le ciel de ce que quelques vaisseaux avaient échappé, et il écrivit au pape ces paroles remarquables : « Saint-Père, tant que je resterai maître de la source, je regarderai comme peu de chose la perte d’un ruisseau ; je remercie l’arbitre suprême des empires qui m’a donné le pouvoir de réparer aisément un malheur que mes ennemis ne doivent attribuer qu’aux éléments qui ont combattu pour eux. »
La joie des Anglais fut proportionnée au danger qu’ils avaient couru. Ils célébrèrent leur victoire par une fête que l’on a comparée aux triomphes romains. Une médaille fut frappée avec cette légende : « Dux femina facti : Une femme a tout conduit ; » mais le doyen de Saint-Paul fit sentir adroitement à la reine l’orgueil impie de cette inscription en prenant pour texte du sermon qu’il prononça à cette occasion le verset : « Nisi Dominus custodierit civilatem : Que serait devenue la cité, si Dieu ne l’eût gardée ? » Élisabeth comprit la leçon et fit frapper une seconde médaille avec la légende : « Afflavit Deus et dissipantur : Dieu a soufflé, et ils ont été dispersés. »
Une tapisserie du temps d’Élisabeth, conservée au Parlement et brûlée lors du dernier incendie, représentait également la destruction de l’Invincible Armada.
Tous les poètes du temps célébrèrent ce jugement de la droite du Seigneur, et les chansons populaires en ont conservé le souvenir. Quelques couplets de l’une de ces dernières ont été recueillis et publiés parmi les ballades maritimes de l’Angleterre.
« – Mousse, combien sont-ils de navires sur la mer, et combien vois-tu de grands pavillons ? – Maître, ils sont autant que les moules sur le rocher, et il y a chez eux plus de pavillons de soie que de bonnets de matelots sur notre flotte.
Ils ont autant de rames que les poissons de la Manche ont de nageoires, et autant, de canons que notre virginale reine porte de perles dans les grands jours ; leurs matelots sont aussi nombreux que les grains de sel sur un quartier de bœuf d’Irlande.
…
– Mousse, que vois-tu venir là-bas contre eux ?
– Maître, je vois les petits vaisseaux de l’Angleterre qui accourent en battant des ailes comme des oiseaux de mer. – Et que vois-tu encore après ? – Je vois nos bons amis les vents et nos grand-mères les vagues salées.
…
– Mousse, que vois-tu maintenant sur l’Océan ? – Maître, je vois les débris des navires espagnols qui fument comme des mottes de terre qu’on brûle dans les champs : je vois les flots qui roulent des pavillons de soie, des canons et des matelots, au teint de cuir. – Et plus loin, plus loin ? – Plus loin, maître, je vois le drapeau de la glorieuse Angleterre qui se promène seul sur la mer, comme le soleil dans les cieux. »
Les premiers explorateurs des légions polaires furent les baleiniers, qui poursuivaient leur proie de refuge en refuge, jusque dans les parages où les cétacés trouvaient un abri derrière les banquises de glace. Un intérêt commercial très important poussa d’autres navigateurs dans les mêmes mers. Ces marins cherchaient à découvrir au-delà des limites boréales de l’Asie et de l’Amérique un passage pour atteindre les riches contrées de l’Inde et de la Chine. Ils avaient à résoudre un problème difficile auquel il n’a été donné que récemment une réponse purement géographique, car on a reconnu en même temps l’impossibilité de se servir des routes trouvées pour la circulation suffisamment facile exigée par un trafic régulier.
Les premières tentatives du côté nord-est ont été faites par les Hollandais, parmi lesquels l’habile et courageux capitaine Barentz a surtout acquis un grand renom. Il périt dans sa troisième expédition, après avoir débuté par la découverte du Spitzberg. Sur les côtes de la Nouvelle-Zemble, les glaces bloquèrent son navire de telle sorte qu’il fut obligé de l’abandonner. Il se réfugia avec son équipage dans deux embarcations non pontées, et osa faire route vers le continent à travers une mer très agitée et parsemée de glaces. Un port fut heureusement atteint après que la grande distance de onze cents milles eut été franchie ; mais le vaillant capitaine, déjà malade depuis longtemps, avait succombé pendant la traversée.
Cette expédition avait eu lieu dans les dernières années du seizième siècle. Au commencement du dix-septième, les Anglais cherchèrent, également, du même côté le passage des Indes orientales, entre autres les capitaines Fox et James, en 1632 ; mais on n’obtint pas plus de succès que précédemment, et une assez longue période de découragement s’ensuivit.
Rien n’avait été entrepris depuis plus de trente ans lorsque, en 1675, un marin anglais, Jean Wood, qui avait acquis une réputation d’excellent navigateur, proposa de faire une nouvelle tentative, dans un remarquable mémoire qu’il présenta au roi et au duc d’York. Une commission, composée des personnes les plus compétentes en ce qui concernait la navigation arctique, l’examina et émit un avis favorable au projet. Jean Wood fut nommé au commandement de la frégate le Speedwell, construite par le meilleur ingénieur de l’Angleterre, et il eut en outre sous ses ordres un navire plus petit, la pinque le Prospère, commandée par le capitaine Guillaume Flawes.
Ces bâtiments mirent à la voile le 28 mai 1676 ; et pendant le premier mois leur navigation ne présenta rien d’extraordinaire. On voit seulement que Jean Wood suivit fidèlement les indications de Barentz, en gouvernant au nord-est à partir du cap Nord, afin de tomber comme lui entre le Groenland et la Nouvelle-Zemble. Toutefois, vers le 22 juin, il rencontra la banquise et se mit à la côtoyer, en avançant vers l’est. Il avait l’espoir, à chaque pointe de glace qu’il doublait, de trouver une mer libre devant lui. La réalité ne répondit pas à son attente, et lorsqu’il arriva en vue des terres de la Nouvelle-Zemble, la mer était entièrement obstruée par les glaces.
Depuis le 25 jusqu’au 28 juin, il essaya de pénétrer par toutes les ouvertures apparentes, mais ne trouva aucun passage. Le temps était généralement calme, avec d’épais brouillards.
Le 29, les deux navires se trouvaient au milieu des glaces flottantes, et toujours en vue de la Nouvelle-Zemble, lorsque le Speedwell donna sur un écueil et s’y échoua, sans pouvoir être relevé. Le Prospère put virer de bord à temps.
Dans une situation aussi fâcheuse, Jean Wood justifia pleinement la haute opinion qu’on avait de son habileté et de son sang-froid. Contrarié par la violence du vent et l’agitation de la mer, il ne put empêcher la perte de sa frégate, mais il eut, du moins, la satisfaction de sauver son équipage. Nous transcrivons l’intéressante relation que son journal donne de ce naufrage :
Nous étions, dit-il, le 29 juin au matin, entre les glaces et nous pensâmes y être enfermés. Tout le jour le temps fut fort embrumé et le vent à l’ouest. Nous avions le cap au sud-sud-ouest, et par notre estime nous présumions que la terre la plus occidentale demeurait à l’est-sud-est : erreur qui fut la cause de notre infortune. Le capitaine Flawes tira un coup de canon pour avertir qu’on touchait aux glaces, et porta sur nous. Peu s’en fallut que les deux bâtiments ne se choquassent et ne périssent ensemble. Le Speedwell fut le seul malheureux ; dans son mouvement, il toucha sur un écueil, tandis que la pinque prit le large. Notre vaisseau fut trois ou quatre heures à se tourmenter sur le rocher ; mais quelque effort que nous fissions, nous ne pûmes parvenir à le relever à cause de la violence du vent.
Après quelques heures d’incertitude et de crainte, nous découvrîmes le rocher sous la poupe. J’ordonnai aussitôt de débarquer les chaloupes avant d’abattre les mâts, et j’envoyai un maître avec la pinasse vers le rivage pour voir s’il n’y avait pas moyen de prendre terre. Il revint une demi-heure après, et nous dit qu’il n’y avait pas possibilité de sauver un homme, le rivage étant inaccessible et battu par une mer affreuse. À cette triste nouvelle, nous implorâmes tous la miséricorde divine. Nos prières finies, la brume se dissipa en partie ; je découvris alors une petite pointe de rivage où je présumais qu’on pourrait prendre terre, et j’y envoyai la pinasse avec quelques matelots pour y aborder, mais ils n’osèrent le tenter. Je me déterminai à expédier la chaloupe, montée par vingt hommes, qui furent plus hardis et entraînèrent ensuite les autres.
Ceux qu’on avait mis à terre m’ayant fait demander des armes à feu et des munitions pour se défendre contre les ours, qui paraissaient en grand nombre, je fis mettre dans la pinasse deux barils de poudre, des armes à feu, quelques provisions, mes papiers et mon argent ; mais elle chavira à peu de distance de la frégate, et tout fut perdu. L’embarcation se brisa elle-même, et il ne resta plus que la chaloupe. La mer continuant d’être en furie, la plupart des matelots qui étaient à bord nous forcèrent, mon lieutenant et moi, à abandonner le bâtiment, disant qu’il était impossible que la chaloupe pût soutenir longtemps les secousses de la mer, et qu’ils aimaient mieux périr eux-mêmes que de me voir englouti dans les eaux, se contentant de me recommander de leur renvoyer la chaloupe aussitôt que nous serions à terre.
Nous n’étions pas arrivés à moitié chemin du rivage, lorsque nous vîmes la frégate se renverser ; de sorte que nous fîmes la plus grande diligence pour y retourner, afin de sauver ces pauvres gens qui m’avaient témoigné tant d’affection. Ce ne fut pas sans beaucoup de peine que je pus y arriver ; tous entrèrent dans la chaloupe, à l’exception d’un seul, qu’on laissa pour mort. Il avait été renversé avec la pinasse et semblait noyé.
L’eau ayant pénétré jusqu’au premier pont dans le bâtiment, nous ne pûmes emporter que deux sacs de biscuit, quelques pièces de porc et un peu de fromage. On parvint à tirer la chaloupe sur le rivage.
Les hommes qui avaient gagné terre avant nous étaient rassemblés à peu de distance sur une hauteur ; les uns allumaient du feu et les autres dressaient une tente reposant sur des avirons et des barres. Nous creusâmes à la hâte un fossé pour nous garantir des ours. Ces animaux, d’une grandeur, prodigieuse, et aussi hardis que féroces, étaient venus nous faire visite aussitôt notre arrivée. Un coup de fusil leur avait fait rebrousser chemin. Nous passâmes la nuit sous la tente, extrêmement fatigués, toujours mouillés et pénétrés de froid.
Le lendemain matin, le matelot que nous avions laissé à bord revint à lui et eut la force de monter sur le mât d’artimon ; c’était le seul que nous n’avions pas abattu. Ce matelot s’était fait aimer, et nous le reçûmes avec la plus grande joie dans la chaloupe au premier voyage qu’elle fit au lieu du naufrage.
Le 1er juillet, le vent continua avec la même force et fut accompagné de brouillards très épais et de neige. Nous nous occupâmes à dresser de nouvelles tentes. Le vaisseau, toujours battu par les vagues, ne tarda pas à être mis en pièces ; la mer en jeta la plus grande partie sur le rivage, et ces débris vinrent fort à propos pour nous mettre à l’abri et pour faire du feu. Nous fûmes encore assez heureux pour recueillir quelques tonneaux de farine, plusieurs barils d’eau-de-vie et de bière, avec des pièces de bœuf et de porc.
Le 2 juillet, on tua un grand ours blanc ; on le dépeça, et nous trouvâmes sa chair très bonne.
Cependant nous étions entre la crainte et l’espérance. Tantôt nous nous flattions que le beau temps apparaîtrait et que le capitaine Flawes nous découvrirait, ce que nous ne pouvions espérer pendant la durée des brouillards ; tantôt nous appréhendions qu’il n’eût fait aussi naufrage et que nous ne le revissions jamais. Après avoir beaucoup réfléchi sur ces motifs d’espoir et de crainte, je me déterminai à faire hausser de deux pieds les bords de la chaloupe et à la faire couvrir d’un pont, pour empêcher autant que possible l’eau d’y entrer. Je pris en même temps la résolution d’aller à voiles et à rames jusqu’en Russie.
Lorsque je fis part de mon projet aux matelots, ils en conçurent de l’ombrage. La chaloupe ne pouvait contenir que trente hommes, et ils étaient résolus à se sauver tous ou à demeurer tous ensemble. Quelques-uns même, plus alarmés de mon dessein, complotèrent de le faire échouer en mettant la chaloupe en pièces, pour courir tous la même fortune.
Les jours s’écoulaient et nous laissaient dans la plus triste perplexité. Quelques matelots proposèrent alors d’allonger la chaloupe de douze pieds, pensant qu’ainsi agrandie, elle serait suffisante pour embarquer tout l’équipage. La proposition fut examinée et débattue plus d’une fois ; mais, après avoir considéré que les matériaux et les ouvriers manquaient, qu’un aussi petit bâtiment ne pourrait jamais être assez prolongé pour contenir tout le monde, le plus grand nombre des matelots s’opposa à ce que la construction fût commencée. Ils aimaient mieux, disaient-ils, aller par terre jusqu’au canal de Weigaz, qui sépare la Nouvelle-Zemble de la Samojédie, et près duquel ils espéraient trouver des barques russes. Le péril imminent où nous nous trouvions pouvait seul inspirer cette résolution ; l’exécution en était évidemment impraticable à cause de la longueur et de la difficulté du chemin, entrecoupé de montagnes et de vallées inaccessibles, sans compter les rivières qui nous arrêteraient à chaque pas. Dans la supposition même de trouver la route praticable, nous avions trop peu de provisions de bouche pour atteindre le but de notre voyage, et de munitions pour nous défendre des bêtes féroces.
Cependant, si d’un côté je ne voyais aucune apparence de pouvoir nous sauver par terre, de l’autre il n’y avait pas moins de difficulté par mer, puisque la chaloupe, quelque travail qu’on y fît, ne pouvait contenir que trente hommes. Que deviendraient les quarante délaissés, sans provisions, dans un pays aride et presque sans espoir d’en sortir ? Ainsi la terre et la mer nous refusaient également le passage.
Je laisse à concevoir dans quelle extrémité nous nous trouvions alors, et quelle devait être l’agitation de mon esprit. Toutes mes pensées ne s’arrêtaient que sur un avenir tragique. Pour comble de malheur, le temps était si mauvais que, pendant neuf jours, nous eûmes toujours de la neige, de la pluie et un brouillard très épais.
Nous touchions à l’extrémité du désespoir, lorsque l’air s’éclaircissant dans la matinée du 8 juillet, nous découvrîmes avec une joie inexprimable la pinque du capitaine Flawes ; elle était à peu de distance du rivage. Je fis sur-le-champ allumer un grand feu ; il l’aperçut, et soupçonnant notre infortune, il se dirigea aussitôt vers nous et nous envoya ses embarcations. À peine avaient-elles abordé, que nous détruisîmes tout ce qui avait été fait à notre chaloupe ; elle fut bientôt mise à flot. Vers midi, le même jour, nous fûmes tous rendus heureusement sur le navire du capitaine Flawes. Nous laissâmes à terre tout ce qui avait été sauvé de la frégate, car nous craignions trop qu’un nouveau brouillard ne vînt encore nous surprendre. Le Prospère mit à la voile, et nous entrâmes, le 25 août, dans la Tamise, après une très bonne traversée. »
Lors de la guerre de la succession d’Espagne, l’Angleterre et la Hollande avaient embrassé la cause de l’empereur d’Autriche contre Louis XIV et Philippe V ; le prince Eugène avait battu Catinat ; Villeroi n’avait pas eu plus de chance. Les troupes françaises étaient mal nourries, mal équipées, sans munitions, rarement soldées. L’armée espagnole était dans un état plus affligeant encore ; pour mieux dire, elle n’existait pas.
Mais la France et l’Espagne attendaient de jour en jour un convoi de galions parti des Indes occidentales et chargé d’un milliard huit cents millions de réaux, sans compter les marchandises précieuses. Il était à craindre néanmoins que ce convoi ne fût capturé par la flotte anglo-hollandaise, qui bloquait soigneusement les côtes méridionales d’Espagne.
L’amiral de Château-Renault était sorti de Brest avec une escadre forte de quinze bâtiments pour aller à la rencontre des fameux galions, que guidait le comte de Velasco, et pour les escorter jusqu’à Cadix.
L’amiral français rallia le convoi à la hauteur des îles Canaries ; il conseilla vivement à l’amiral espagnol de faire voile vers un port français, l’ennemi surveillant de près la côte d’Espagne. En effet, les Anglais et les Hollandais, ayant aperçu le convoi à la hauteur du cap Saint-Vincent, mirent à sa poursuite leurs plus fins voiliers. Les Français et les Espagnols, serrés de près, côtoyèrent le Portugal et se jetèrent dans la baie de Vigo, dont ils fortifièrent en grande hâte l’entrée et les abords (22 octobre 1702).
Pendant que le combat se préparait, Velasco essayait de faire décharger son convoi ; mais l’ennemi se hâta de jeter à terre un petit corps de six cents hommes, qui s’empara de près de quatre millions de réaux en argent brut, et empêcha le déchargement des autres galions, qui se rapprochèrent de la ligne de bataille formée par les vaisseaux français. L’amiral anglais était bien décidé à agir d’une façon foudroyante et à s’emparer d’un convoi qui portait, on peut le dire, la fortune de l’Espagne.
Monté sur le Torbay, il donna le signal de l’attaque et s’élança à toutes voiles sur les chaînes qu’avait fait tendre à l’entrée de la baie l’amiral de Château-Renault. Ces chaînes, il les brisa par un choc formidable et vint se heurter contre la ligne française, tandis qu’une quinzaine de vaisseaux de haut bord s’engouffraient à sa suite dans la baie.
Château-Renault fit des prodiges de valeur ; il parvint à incendier le vaisseau anglais le Montmouth, que montait le célèbre commodore Hopson, mais, accablé par le nombre, il se transporta sur le galion Almirante, où se trouvait Velasco, et là il fut convenu qu’on coulerait bas tous les galions du convoi pour les préserver d’une capture certaine. Les galions furent sabordés et incendiés.
À diverses époques, on a essayé de repêcher les immenses richesses en or et en argent ainsi disparues dans les flots : on n’avait pu y parvenir. Durant l’automne de 1869, on annonça qu’une société s’était formée pour reprendre l’entreprise. Les appareils dont on devait se servir pour relever les galions étaient de grands cylindres en tôle qu’on coule, pleins d’eau, le long des flancs du navire, et qu’on y attache avec des chaînes passées sous la quille si l’on peut. Les cylindres sont alors, remplis de gaz et relèvent le bâtiment par leur force ascensionnelle.
Nous ajouterons à ce résumé, extrait du Bulletin de l’Association scientifique de France





























