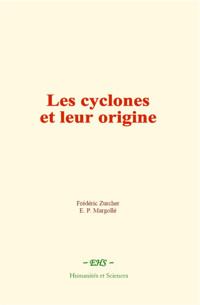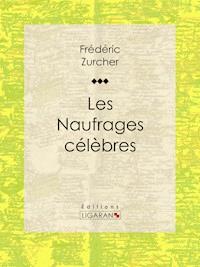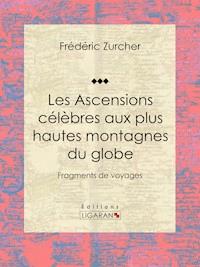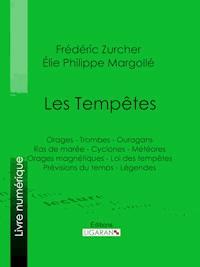
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ce livre n'est pas seulement le résumé des nombreux travaux qui ont jeté les bases d'une science des tempêtes. Nous avons aussi tenté d'y réunir les lumières éparses dans les œuvres des maîtres à qui nous devons la certitude d'un meilleur avenir, d'un constant progrès vers le bien, d'une Loi divine dominant les bouleversements de l'histoire, comme elle domine les bouleversements de la nature. "
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
… Te raconter les dangers de la mer, ses inexplicables phénomènes, les orages soudains et terribles, les éclairs qui allument l’incendie dans l’air, les noirs torrents de pluie, les nuits ténébreuses, les roulements du tonnerre qui ébranlent la terre, ce serait une entreprise difficile, que je tenterais vainement, lors même que ma voix serait une voix de fer.
CAMOENS.
Ce livre n’est pas seulement le résumé des nombreux travaux qui ont jeté les bases d’une science des tempêtes. Nous avons aussi tenté d’y réunir les lumières éparses dans les œuvres des maîtres à qui nous devons la certitude d’un meilleur avenir, d’un constant progrès vers le bien, d’une Loi divine dominant les bouleversements de l’histoire, comme elle domine les bouleversements de la nature.
F. ZURCHER.ÉLIE MARGOLLÉ.
En écrivant ce résumé, nous avons eu surtout le désir de faire mieux connaître, en la dégageant des ouvrages techniques, une des grandes découvertes de notre époque, si féconde en lumineux aperçus sur les forces mystérieuses qui président à la marche et à la formation des phénomènes de la Nature.
Un de nos plus illustres naturalistes, Et Geoffroy-Saint-Hilaire, dans ses profondes recherches sur l’unité de composition organique des types du règne animal, a donné, l’un des premiers, les preuves certaines d’une vérité exprimée déjà par Montaigne avec la plus éloquente concision : « Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu. »
Guidé par la même pensée, Gœthe, dans ses ingénieuses recherches sur l’organisation de la plante, a montré comme Geoffroy-Saint-Hilaire, dont il était l’un des fervents admirateurs, que les formes les plus bizarres de la fleur ou de la feuille se rapportent toujours à une forme typique, régulière, qui apparaît à l’observateur comme un dessein permanent de la Nature, que des circonstances particulières ont pu voiler, sans jamais en détruire la primitive harmonie.
La minéralogie, la géologie, l’astronomie, nous donnent, dans leurs plus belles démonstrations, la même preuve éclatante de l’ordre universel, au sein duquel tous les êtres vivent ou vers lequel ils tendent, et qui n’est jamais troublé que par des perturbations passagères, ou par l’effort constant de la Nature vers un équilibre plus stable, vers une harmonie plus complète, vers une beauté plus grande.
Il nous était réservé de trouver la même religieuse affirmation d’un plan divin dans les régions inconnues où des forces puissantes répandent à la surface du globe le mouvement et la vie, se manifestant par le cours majestueux et régulier des vents généraux, par la direction constante des grands courants magnétiques, ou par les bouleversements de la tempête et les terribles éclats de l’orage.
Ces phénomènes redoutables, longtemps regardés comme des signes de la colère céleste, sont aujourd’hui pour nous, grâce aux révélations de la science, une des plus remarquables confirmations des théories qui nous démontrent l’invincible tendance des forces vers l’équilibre. Nous pouvons aussi les considérer comme un violent moyen de remédier à l’insuffisance du système de circulation qui entretient et renouvelle la vie, durant la période de formation que nous traversons encore ; ou comme un agent de compensations, en rapport avec les conditions physiques de la Terre. Mais quelque soit leur origine, nous voyons toujours dans l’étude de leurs changements ou de leurs modifications à travers les siècles, et dans leur vivifiante influence, même au milieu des désastres dont ils sont trop souvent la cause, la même tendance vers le bien, la même certitude du magnifique progrès de la Nature vers un état de plus en plus favorable aux progrès de l’humanité.
Le premier état du monde, suivant toutes les cosmogonies, est le chaos, le désordre des éléments confondus, luttant dans les ténèbres, au milieu d’un espace sans bornes. – Ces ténèbres, berceau des êtres, en contenaient les principes, et renfermaient, dans le vaste sein de la nuit primitive, les germes de la vie universelle.
Les Égyptiens, symbolisant cette notion avec une profonde intelligence du sens divin de la création, avaient élevé un Temple à Vénus Ténébreuse, – Thermoutis, – la grande Mère, génératrice de l’univers.
Dans la théogonie d’Hésiode, le Chaos est le plus ancien des dieux. Il règne sur l’abîme obscur et tumultueux, où les forces opposées se livrent un perpétuel combat.
Le mythe des Titans, des géants monstrueux, premiers nés de la terre, qui se levèrent contre le ciel, et qui furent vaincus, dispersés par la foudre, indique une seconde époque, fertile encore en révolutions violentes, mais durant laquelle les éléments, commençant se séparer, formèrent des parties plus distinctes.
C’est après cette formidable lutte que paraît Typhon, l’ouragan terrible qui fait retentir la terre de ses rugissements et soulève les flots irrités. Jupiter, rassemblant toutes ses forces, le foudroie ; mais, dit Hésiode, il plonge avec douleur dans le noir Tartare le dernier des Titans.
De Typhon naquirent les tempêtes, les vents redoutables qui « se précipitent sur les sombres vagues et détruisent les brillantes moissons. »
Le doux vent de l’aube, Zéphire, qui fait éclore les fleurs ; le vent du Nord, pur et serein ; le vent du Midi, dont l’humide chaleur féconde la terre, naissent avec l’Amour qui, des profondeurs de l’Érèbe, s’élève comme un tourbillon, et plane dans la lumière du jour, soutenu sur des ailes d’or.
Ainsi, dès l’origine, apparaissent sous le voile des fables les principaux traits d’une genèse dont la science doit tour à tour nous découvrir les époques successives, et qui, par une coïncidence frappante, se retrouve dans les traditions religieuses des différents peuples, unis dans le premier culte par une commune croyance, comme ils le seront un jour par une même certitude et par une même foi.
Les forces dévastatrices du premier âge, les Titans, sont enchaînés par les Dieux sous les hautes montagnes. À jamais ensevelis dans les profondeurs de la terre, ils manifestent encore leur redoutable puissance par le cratère des chaînes volcaniques. Les éclats de la foudre répondent aux fréquentes éruptions dont tant de grands débris nous attestent la violence.
Mais à ces derniers bouleversements succède une action plus lente et plus soutenue ; les forces primitives ne sont pas détruites, elles se modifient et répandent au sein du globe, dans la nuit féconde, la bienfaisante chaleur qui développe les germes, et qui bientôt, unie à la lumière céleste, couvrira la terre de la multitude des êtres.
Seul, Typhon reparaît encore. Du fond des déserts, des régions glacées du pôle, des immenses solitudes de l’Océan, il s’élance, impétueux, formidable, obscurcissant le ciel, soulevant la mer en vagues énormes, renversant les hautes forêts. – Les mythes religieux en font une des premières personnifications du Mal, et, sous des noms divers, il rappelle à l’homme la grandeur de la mission que les Dieux lui ont confiée, la lutte incessante contre les forces destructives qu’il doit dominer ou s’assujettir, par les progrès de la Raison divine qui éclaire à la fois son cœur et son intelligence, par la science et par la concorde.
Dès son apparition sur la terre, l’homme eut à se défendre contre les injures du temps, contre les excès de la chaleur ou du froid, contre les orages et les tempêtes. Les traditions nous apprennent qu’il cherchait alors, comme les Troglodytes, un asile dans les grottes et les cavernes, disputées aux bêtes sauvages, mais qui lui offraient un sûr abri contre les rigueurs d’une nature encore inclémente, une retraite toujours ouverte devant les menaces d’un ciel fréquemment orageux.
Il dut cependant affronter, pour assurer son existence, les périls qui l’entouraient, et prendre ainsi l’habitude de résister à la tempête ou de traverser l’orage. Le désir d’atteindre des régions plus fertiles, moins exposées aux intempéries, dut aussi l’engager à tenter le passage des grands fleuves sur des troncs d’arbres ou sur des barques grossièrement construites.
Mais tout son courage, toute son énergie furent nécessaires le jour où il osa s’aventurer sur l’Océan sans limites et perdre de vue le rivage accoutumé : « Un triple chêne, un triple bronze armait le cœur du mortel qui, le premier, livra un frêle esquif aux flots menaçants et qui, ne craignant ni la furie du Notus et de l’Aquilon, ni les sinistres Hyades, osa défier le choc impétueux des vents qui se heurtent. » (Horace.)
L’antiquité mit au rang des demi-dieux les navigateurs qui osèrent entreprendre les premières expéditions lointaines. La légende des Argonautes, qui nous a conservé leurs noms, a son origine dans les récits des âges historiques les plus éloignés. – Les héros des différentes peuplades de la Grèce s’embarquent avec Jason sur l’Argo : Hercule, Thésée, Pirithoüs, Méléagre, Castor et Pollux, Euryale, Pélée, Admète, Télamon, Amphion, Orphée montent le vaisseau sacré, dont la proue, taillée dans un chêne de la forêt de Dodone, rendait des oracles.
Lyncée, à la vue pénétrante, dont les regards exercés percent la brume et l’obscurité des nuits ; Tiphys, habile à prévoir le temps et à diriger un navire en observant la marche des astres, sont au gouvernail. Orphée, par ses chants divins, anime le courage de ses vaillants compagnons et soutient leur constance sur les mers inconnues, redoutables, dont ils bravent les périls. Initié aux mystères, il connaît les signes qui présagent l’assistance ou le courroux des Dieux, et par des vœux, par des sacrifices, il leur demande de conjurer la tempête dont il prédit l’approche. Au son de sa lyre, les héros frappent ensemble les flots de leurs longues rames ; la mer écume sous leurs puissants efforts, et l’Argo trouve un abri sur le rivage propice.
Pendant l’orage qui assaillit les Argonautes peu après leur départ, on vit deux flammes briller sur les têtes de Castor et de Pollux, au moment même où la tempête s’éloignait. Depuis, on regarda ces météores, qui apparaissent souvent dans les nuits orageuses, comme des signes favorables, et les Tyndarides, implorés par les navigateurs, furent placés au rang des divinités.
Théocrite leur a consacré une de ses idylles : les Dioscures :
… Les autans déchaînés soulèvent des montagnes humides, courent en tourbillons de la poupe à la proue et précipitent les flots sur le navire, qui s’entrouvre de toutes parts ; l’antenne gémit, les voiles se déchirent, le mât brisé vole en éclats ; des torrents lancés du haut des nues augmentent l’horreur des ténèbres ; la vaste mer mugit au loin sous les coups redoublés de la grêle et des vents. C’est alors, fils de Léda, que vous arrachez les vaisseaux à l’abîme, et à la mort le pâle nautonier qui se croyait déjà descendu aux sombres bords. Soudain les vents s’apaisent, le calme renaît sur les ondes, les nuages se dispersent, les Ourses brillent et les constellations favorables promettent aux matelots une heureuse navigation.
Nous trouvons fréquemment, dans les récits des premiers historiens, la description de tempêtes ou d’orages qui, suivant les superstitions du temps, étaient presque toujours regardés comme des présages sinistres, des avertissements en rapport avec les évènements futurs, ou comme les marques d’une secrète sympathie entre la nature et l’homme. Nous reviendrons plus tard sur ces croyances, assez universelles pour attirer sérieusement l’attention.
Mais nous remarquerons, dès maintenant, que les récits dont nous parlons indiquent des perturbations de l’atmosphère probablement beaucoup plus fréquentes et plus violentes que celles de notre époque. Nous devons donc une reconnaissance plus vive encore aux intrépides navigateurs qui, malgré de si nombreux périls et l’insuffisance des moyens dont ils disposaient pour les combattre, préparèrent par leurs voyages non seulement les progrès du commerce, des relations pacifiques de peuple à peuple, mais encore le progrès des arts, de l’industrie, et, par la colonisation, l’expansion des idées civilisatrices appartenant aux groupes les plus éclairés de la société antique.
C’est à la Phénicie et à la Grèce que la navigation dut surtout ses premiers perfectionnements. Des bâtiments mieux construits, des observations météorologiques plus exactes, une connaissance moins imparfaite du mouvement des astres, permirent bientôt de quitter la Méditerranée et de s’avancer, au-delà des colonnes d’Hercule, dans les vastes régions inexplorées que les premiers navigateurs croyaient inaccessibles, à cause des épaisses ténèbres et des effroyables tempêtes qui en défendaient les approches.
Les fables antiques, qui plaçaient au milieu de ces mers redoutées la région sereine des îles Fortunées, le riant séjour des Hespérides, durent contribuer à entraîner les marins les plus résolus loin des côtes qu’ils étaient habitués à suivre, sur la mer sans bornes et sans rivages.
Poussés, comme les Argonautes, par le désir de conquérir des richesses nouvelles, et par l’heureuse tendance qui nous porte vers les peuples et les pays inconnus, les Phéniciens envoyèrent bientôt leurs navires jusqu’en Bretagne, sur l’orageuse Atlantique. Habitués au doux ciel, aux splendeurs, à l’azur de la Méditerranée, ces hardis commerçants ne reculèrent pas devant les sombres aspects, l’âpre climat et les lourdes tempêtes de la mer du Nord. Ils furent suivis par de nombreux explorateurs dont nous citerons les plus célèbres. Colœus de Samos, Hannon, Himilcon, Pythéas, Néarque, tracèrent de nouvelles routes à la navigation et lui donnèrent une puissante impulsion. Ils rendirent en même temps les plus grands services à la géographie, et, réunissant par leur science et par leur courage les contrées que la mer avait séparées, « ils ouvrirent le monde à la connaissance du genre humain. »
Au nombre des découvertes qui résultèrent du progrès de la navigation, se placent deux notions importantes, qui exercèrent sans doute la plus favorable influence sur les esprits, en montrant pour la première fois, au milieu de l’apparent désordre de la nature, une loi de succession périodique, une action régulière et continue des forces qui jusqu’alors avaient paru soumises aux caprices des divinités dont un ingénieux symbolisme avait peuplé la terre.
Tandis que sur les rivages de la Méditerranée on n’avait vu la mer se mettre en mouvement que sous l’impulsion variable des vents, on put contempler dans l’Océan le majestueux spectacle des marées, l’action puissante d’une force inconnue qui, chaque jour, entraînait la masse des eaux dans une direction constante, et qui, chaque jour prévue, donnait aux navigateurs une indication sûre, soit pour profiter des courants déterminés par le flux et le reflux des eaux, soit pour atteindre, au moment de leur élévation, les points de la côte qui leur offraient un abri.
La découverte des moussons, par Hippale, la régularité de ces vents périodiques qui soufflent sur l’Océan entre l’Afrique et l’Inde, changeant tous les six mois de direction, donna bientôt aux marins la même certitude d’une loi invariable de la nature, d’une force contenue dans certaines limites, mais ne cessant pas d’exercer son action, comme les forces analogues qui produisaient les marées.
À l’idée première de la domination des forces terribles dont l’apparition était toujours marquée par des bouleversements ou des désastres, dut alors se substituer l’idée de forces nouvelles, calmes et bienfaisantes, plus puissantes dans leur action soutenue que les forces passagères de la tempête. Une telle révélation fut sans doute liée au progrès des croyances religieuses. Déjà Pythagore avait pressenti la Loi, le nombre, l’harmonie, dans le radieux aspect des nuits étoilées. Sur la terre même, de frappants indices venaient confirmer sa croyance, et montrer l’intelligence suprême, non plus dans les sinistres lueurs de l’orage, dans l’horreur des bouleversements, mais dans la grandeur, l’ordre et la beauté des phénomènes.
Nous devons à la découverte mystérieuse qui dirige l’aiguille aimantée vers le pôle, à l’invention de la boussole, l’immense progrès de la navigation depuis le XIIIe siècle. Nous verrons plus loin les nouveaux services que le magnétisme tellurique est appelé à nous rendre par ses relations avec les phénomènes météorologiques. La conquête de l’Océan sera due à ces conquêtes de l’intelligence. Mais la gloire en revient surtout aux cœurs vaillants dont l’énergique persévérance ne recula pas devant des périls sans cesse renaissants, pour ouvrir de nouvelles routes au commerce, pour rapprocher les nations et préparer leur future alliance.
Nous n’avons pas à résumer ici la série d’audacieuses entreprises qui ouvrirent la voie à Colomb, et qui suivirent sa découverte. Nous n’accompagnerons pas ce grand navigateur dans son heureux voyage vers le nouveau monde. Favorisé par les brises et les courants, avançant rapidement vers le but entrevu, sous le beau ciel des régions équatoriales, il semblait alors conduit par un destin propice, qui entourait de splendeurs sereines l’accomplissement des généreux desseins d’une âme héroïque.
Telles ne furent pas les premières tentatives des marins normands et portugais qui s’aventurèrent dans l’Atlantique, sur les côtes de l’Afrique occidentale. Pendant assez longtemps le cap Nun, qui avait été le terme des navigateurs anciens, ne fut pas dépassé. La constance du vent d’ouest dans ces parages était un obstacle pour des bâtiments dépourvus encore des moyens de prendre le large avec sécurité. Un trafiquant vénitien qui, vers 1400, fut jeté par des vents contraires dans les attérages des Canaries, en parle comme de lieux inconnus et effrayants (luoghi incogniti e spaventosi a tutti i marinari).
Les hardis marins normands qui, suivant les vieilles chroniques irlandaises avaient, dès le IXe siècle, exploré la mer du Nord, et s’étaient d’ailleurs habitués, dans leurs grandes pêches, à tous les dangers de la navigation, furent probablement les premiers qui osèrent doubler le cap Bojador, au-delà duquel ils trouvèrent la mer navigable et la côte accessible. Les énormes profits que donnaient ces voyages, par l’échange d’objets sans valeur avec l’or et l’ivoire, poussèrent aussi les Portugais à tracer leur route comme Colomb, sur l’immensité de l’Océan, sans autre guide que l’aiguille aimantée, à braver les tempêtes loin de tout abri, à tenter la découverte et la conquête de nouvelles régions, en naviguant résolument hors de vue des terres.
Lorsque Gilianez, envoyé par le prince Henri, parvint, en 1432, au-delà du terrible cap Bojador, son action fut célébrée comme un miracle d’audace. On voyait déjà sans doute, au-delà des échanges et des gains du commerce, le résultat lointain de ces expéditions, et à chacun des nouveaux explorateurs on eût dit volontiers ce qu’un ancien chroniqueur disait de Jean de Bétancourt, après sa conquête des Canaries, que, par lui, « le monde, en ces derniers temps, a esté remply de la veue et de la cognoissance de soy-mesme. »
Bientôt (1442) Antonio Gonzalez atteignit le cap Blanc, et Denis Fernandez le cap Vert (1447). Peu après (1449), Velez Cabrai découvrait les Açores. Une légende du temps rapporte qu’on trouva dans une de ces îles, à Cuervo, une statue équestre, couverte d’un manteau, la tête nue, qui de la main gauche tenait la bride du cheval et qui montrait l’occident de la main droite. Il parut clairement, dit la légende, que le signe de la main regardait l’Amérique.
À la mort du prince Henri (1463), dont le grand savoir et le ferme caractère avaient eu une si grande influence sur ces progrès de la navigation, les explorations s’étendaient jusqu’à Sierra-Leone.
Un aventurier vénitien, Cadamosto, attaché au service du Portugal, avait découvert les îles du Cap-Vert. Aidés par les courants qui règnent dans les parages de ce cap, les Portugais s’avancèrent vers le sud, et connurent en peu d’années tout le littoral et les îles du golfe de Guinée.
Leurs conquêtes n’avaient pas été interrompues par la mort du prince Henri. Son frère, don Pedro, qui tenait la régence pour Alphonse V, était aussi versé dans les sciences et d’une grande élévation d’esprit. Des présents magnifiques qu’avait voulu lui offrir la Seigneurie de Venise, au retour d’une expédition contre les Musulmans, il n’avait accepté qu’un livre, le Voyage de Marco-Polo. Il ne put cependant favoriser comme il l’aurait voulu, à cause des querelles d’Alphonse V avec la cour de Castille, la continuation des voyages de découvertes le long des côtes d’Afrique, et pendant dix-huit ans (1463-1481), les progrès vers le sud n’allèrent pas au-delà du cap Sainte-Catherine, vers la frontière du Congo.
L’avènement de Jean II, qui connaissait par expérience les bénéfices du commerce avec la Guinée, dont il tirait la majeure partie de ses revenus tandis qu’il était infant, donna une nouvelle impulsion aux expéditions maritimes. Il s’attacha un géographe expérimenté, Martin Behaim, de Nuremberg, qui avait accompagné dans leurs courses les plus vaillants explorateurs. Il l’adjoignit aux savants qui furent chargés d’améliorer le système de navigation et qui recommandèrent l’usage de l’astrolabe, au moyen de laquelle on connaissait la position du bâtiment en latitude, tandis que la boussole indiquait la route.
En 1486, trois vaisseaux furent équipés pour aller, sous la conduite d’un chevalier de la maison royale, Bartholomé Diaz, à la recherche des États du Prêtre Jean, le mystérieux monarque chrétien de l’orient, qu’on avait cru reconnaître dans les récits de l’ambassadeur du roi de Bénin, amené en Portugal par Alfonso de Aviero. Ces récits disaient qu’un prince puissant, Ogané, régnait sur un vaste empire situé à vingt lunes (environ deux cent cinquante lieues), dans l’est du Bénin, dont les rois recevaient de lui, en signe d’investiture, une croix de cuivre de la forme des croix de Saint-Jean de Jérusalem.
Après avoir été à cent vingt lieues au-delà du point le plus éloigné reconnu dans les expéditions précédentes, Diaz se dirigea hardiment vers le sud, par la pleine mer. En avançant, il vit s’affaiblir l’ardente chaleur du golfe de Guinée, et ce changement de climat effraya ses équipages, qui reculaient devant les dangers d’une si téméraire entreprise. Une tempête jeta les trois bâtiments vers l’est, et celui que commandait le frère de Diaz disparut. Les matelots voulaient rebrousser chemin ; mais encouragés par leur chef et par son digne compagnon, Pero Infante, ils persistèrent. On continua la route à l’est, au milieu de fréquentes bourrasques. De temps à autre on débarquait, et des nègres, vêtus d’habits magnifiques, s’avançaient dans le pays pour s’informer du Prêtre Jean. L’expédition atteignit ainsi l’embouchure d’une rivière qui fut appelée Rio del Infante, aujourd’hui la grande rivière des Poissons (great fish river). Diaz s’y arrêta sans savoir qu’il avait depuis longtemps dépassé le but de ses recherches, le cap qui terminait l’Afrique au sud-ouest. Ce n’est qu’au retour, pendant une affreuse tourmente, qu’apparut enfin ce grand cap inconnu, appelé d’abord par Diaz cap des Tempêtes (cabo tormentoso), mais que le roi Jean, mieux inspiré, voulut nommer le cap de Bonne-Espérance.
Peu après on retrouva le petit bâtiment qui avait disparu et qui portait les approvisionnements.
Après sa glorieuse découverte, Diaz servit encore sous les ordres de Vasco de Gama et de Cabral. Il revenait avec ce dernier de la conquête du Brésil, lorsque son bâtiment fut englouti au milieu d’un ouragan qui l’assaillit dans les parages mêmes du cap qu’il avait le premier reconnu. Il eut ainsi pour tombeau cette mer orageuse dont il avait affronté les dangers pour ouvrir à l’Europe les portes de l’Asie, gardées, suivant la poétique fiction de Camoens, par le génie des Tempêtes.
Dix ans après la découverte du cap de Bonne-Espérance, le roi Emmanuel, successeur de Jean II, éclairé par les indications géographiques que lui donnait un célèbre voyageur portugais, Pedro de Covilham, qui, après avoir visité l’Inde et les côtes orientales de l’Afrique, était allé s’établir en Abyssinie, résolut d’envoyer une seconde expédition pour tenter encore le passage du Cap, et pour s’ouvrir, par mer, une nouvelle route vers les Indes.
On venait de voir arriver à Lisbonne (1493), Christophe Colomb qui, quelques années auparavant, avait vainement offert ses services au roi de Portugal. Emmanuel, inquiet des suites de la grande découverte des Indes occidentales, qui pouvait amoindrir les futures conquêtes de sa couronne, ne voulut pas retarder plus longtemps le départ de l’expédition. Il en confia le commandement à un gentilhomme de la cour, Vasco de Gama, excellent marin, d’un courage éprouvé, qui mit à la voile le 2 juillet 197 avec trois vaisseaux montés par cent soixante hommes. La petite flotte souffrit beaucoup du mauvais temps, mais elle put doubler le Cap sans être repoussée par les vents terribles et les courants impétueux qui avaient arrêté Barthélemy Diaz au rocher de la Cruz. À partir de ce point, un grand vent permit à Vasco de Gama de refouler le courant, et bientôt, dirigeant sa route vers le nord, il put entrer enfin dans la mer des Indes (1498).
On raconte que la mer s’étant soudainement soulevée autour de son vaisseau, pendant une belle soirée de calme, il devina la cause de ce bouleversement subit, et s’écria, pour rassurer son équipage terrifié : « La terre et la mer des Indes tremblent devant nous… Compagnons, saluons ce signe de victoire ! »
Nous nous sommes arrêtés sur la découverte du cap de Bonne-Espérance, à cause de son immense importance. Par cette route nouvelle deux mondes allaient s’unir. D’abord, dans les luttes meurtrières d’une conquête dont le principal but était l’acquisition à tout prix, par la violence autant que par l’échange, des riches produits de l’Orient ; puis bientôt, dans les premières lueurs de la plus féconde alliance, dans l’identité des croyances religieuses, dans la reconnaissance de l’unité spirituelle que la France, par un de ses plus généreux enfants, Anquetil Duperron, devait la première proclamer. C’est à la France aussi que devait un jour revenir la gloire de cimenter cette grande alliance de l’Orient et de l’Occident par une entreprise digne de son génie, le percement de l’isthme de Suez.
Et s’il nous est permis d’exprimer ici un vœu, nous voudrions que, sur le canal qui s’achève, un égal hommage fût rendu aux grands hommes qui, par l’héroïsme du cœur, par l’énergie de l’intelligence, ont ouvert aux nations les routes où, après s’être rencontrées dans la guerre, elles s’uniront dans la paix, et que le voyageur, en traversant l’isthme qui sépare les deux mondes, pût saluer la statue de Vasco de Gama à côté de celles de Barthélemy Diaz et d’Anquetil Duperron.
Après la découverte du cap de Bonne-Espérance, celle du détroit de Magellan eut la plus grande influence sur les progrès de la géographie, si étroitement liés alors au progrès des idées qui transformaient l’ancien monde, en substituant aux rêves de l’imagination, aux tristes croyances d’une sombre époque, les certitudes de l’expérience, la confiance en l’intelligence suprême dont les plans commençaient à se dévoiler.
Les dangers que présentait à Magellan le passage d’un détroit semé d’écueils, où des vents orageux et variables, de violentes rafales et des courants rapides s’opposent à la navigation, n’étaient pas moindres que ceux bravés par les Portugais devant le cap des Tempêtes. Il les surmonta avec le même courage, avec la même patiente énergie. Entré dans le détroit le 21 octobre 1520, il en sortit le 28 novembre pour faire voile dans la mer du Sud. Arrivé aux Philippines, près de quatre mois plus tard, il donna au vaste Océan, qu’il venait de traverser, sous un ciel presque toujours serein, le nom de Pacifique, frappé sans doute, comme l’avait été Colomb, de la beauté, de la lumière et de la paix des régions où le souffle toujours égal des alizés favorisait son aventureux voyage. Après la mort de Magellan, l’expédition continua sa route vers les Moluques, où elle arriva bientôt, ainsi qu’il l’avait annoncé en quittant l’Espagne.
La flottille était réduite à deux bâtiments. Le premier, qui avait été monté par l’amiral, voulut essayer de revenir vers l’Amérique par l’océan Pacifique. Il fut obligé, par suite des vents contraires et de son état de délabrement, de revenir aux Moluques, où son équipage fut fait prisonnier par les Portugais. Le second, nommé la Victoire, et commandé par un des plus vaillants compagnons de Magellan, le pilote basque Sébastien del Cano, fit route vers l’ouest et parvint à doubler le cap de Bonne-Espérance. Il arriva à San-Lucar, le 6 septembre 1522, après trois ans de voyage.
Ainsi disparurent tous les doutes qui s’élevaient encore sur la forme de la terre, et Charles-Quint, au-dessous du globe qu’il donnait pour armes à Sébastien del Cano, fit inscrire cette glorieuse devise :
Près d’un siècle plus tard (1615), un marchand hollandais, Jacques Le Maire, conduit par Cornelis Schouten, marin expérimenté, qui avait fait plusieurs fois le voyage des Indes Orientales, découvrit, au sud du détroit de Magellan, une nouvelle route vers l’océan Pacifique, et doubla, le premier, le cap Horn, après avoir lutté pendant plusieurs jours, au milieu d’épais brouillards, contre une mer énorme, sans cesse soulevée par des bourrasques mêlées de grêle et de neige.
L’aspect menaçant du ciel et des côtes rocheuses de cette région désolée, la rigueur du climat, les phénomènes météorologiques particuliers dont les grands caps sont le siège, la persistance et la violence du vent d’ouest, accompagné de furieuses rafales, firent préférer pendant longtemps les dangers du détroit de Magellan à ceux du détroit de Le Maire et de la pleine mer. Mais en descendant vers le sud, et ne craignant pas de pénétrer dans cette mer périlleuse, au milieu des froides brumes, jusqu’à la rencontre des glaces qui descendent du pôle, les navigateurs trouvèrent des courants moins forts, des vents moins orageux, une mer moins tourmentée, un ciel moins sombre, et purent lutter contre les tempêtes de ces passages redoutés.
La découverte du passage aux Indes par les deux grands caps de l’Océan austral fut vraiment la conquête du monde. Colomb avait montré la route et entraîné les esprits dans la région brillante des lointaines explorations. L’impulsion que son génie donna aux idées fut surtout favorable au progrès des sciences, malgré la part immense faite à l’intérêt commercial. D’un côté, les sciences historiques allaient être bientôt renouvelées par l’étude des traditions du monde oriental ; de l’autre, les sciences physiques et géographiques établissaient solidement leur base sur la certitude de la sphéricité de la terre. Ce n’est pas vainement que Diaz, aux portes de l’Inde, cherchait l’empire fantastique du Prêtre Jean. La Providence, par les prédications du Bouddha, avait depuis longtemps répandu dans l’Orient les enseignements de l’Évangile, et les deux peuples, sous des symboles différents, adoraient les mêmes vertus divines, et, par la beauté des croyances, appartenaient à la même communion.
En faisant le tour du globe, Sébastien del Cano donna une forme précise à la vague notion de l’humanité. Assuré de sa route, le navigateur put désormais parcourir le vaste monde qui lui était ouvert, avec la certitude d’y trouver partout des semblables, de mœurs diverses, mais au fond animés par les mêmes passions et par les mêmes sentiments.
Un âge nouveau commençait, l’âge de la science, l’âge viril des sociétés les plus éclairées, où partout déjà les pressentiments de l’avenir agitaient les grandes âmes. Aussi ne doit-on pas s’étonner des légendes qui s’attachèrent aux caps lointains dont les cimes orageuses marquaient la limite des trois océans. On disait qu’au milieu de leurs tempêtes une sorte de rugissement répandait la terreur dans les cœurs les plus intrépides. Des flammes brillantes avaient couronné pendant plusieurs jours la montagne de la Table. Au cap Horn, des feux volcaniques sillonnaient les âpres rochers couverts de neige, derniers sommets de la chaîne des Andes. Des météores traversaient la sombre nuit. Il semblait que par ces signes on voulût faire répondre, aux héroïques efforts de l’homme, les tressaillements de la nature, et qu’on entendît sa grande voix, qui jadis, aux mers de Grèce, avait annoncé la mort des dieux et la chute de l’ancien monde, présager maintenant le règne de l’homme, les victoires de la science, la majestueuse unité de l’avenir.
Une antique fable, qu’on retrouve dans la mythologie des Grecs et des Latins, représente Indra, le Jéhovah des patriarches aryens, poursuivant le Dieu dévorant, desséchant, « qui flétrit l’herbe des pâturages, » et faisant jaillir la pluie à grands flots au milieu des éclats du tonnerre : « Je chanterai la victoire d’Indra, celle qu’hier a remportée l’archer ; il a frappé Ahin, il a partagé les ondes, il a frappé la première des nuées . »
Dans une récente et remarquable étude de mythologie comparée , l’explication de ce mythe est ainsi donnée :
« La lutte des deux adversaires aux prises dans le ciel est l’orage, plus soudain, plus terrible dans les climats chauds que dans nos contrées. Les nues lumineuses qui contiennent la pluie, ce sont les vaches couleur de pourpre qu’un noir démon veut enlever ; la fécondité de la terre dépend de l’issue de la lutte. Les nuages se mettent en marche, ils s’éloignent, ils se couvrent d’ombre, ils semblent enfermés dans l’obscurité : on entend leurs sourds gémissements. L’affreux serpent dont l’haleine dessèche le monde les a enveloppés et attirés dans son antre. C’est alors que le dieu du jour, protecteur des hommes, bienfaiteur de la tribu, engage le combat, tantôt seul contre le terrible adversaire, tantôt escorté de la troupe hurlante des Marutes (les vents), tantôt suivi de tous les dieux. On entend les coups de la massue divine qui tombent sur la caverne, l’entrouvrent, et en font jaillir des flammes. Le triple dard du serpent brille dans les ténèbres. Bientôt le nuage se déforme, il est mutilé en mille endroits, il disparaît à la vue ; en même temps, les eaux qu’il retenait captives se précipitent avec fracas sur la terre, et Indra, c’est-à-dire le ciel bleu, triomphant de son ennemi, se montre dans sa splendeur. » C’est ainsi que devant les redoutables tourmentes des Alpes indiennes, le culte primitif rendait hommage au dieu de la lumière, un instant voilé par les nuées orageuses, mais qui reparaissait bientôt dans la sérénité du ciel, dans la fécondité, dans la beauté de la terre, rafraîchie et vivifiée.
La description que nous avons maintenant à faire des phénomènes désastreux que notre titre résume doit aussi voiler momentanément la lumière divine, et favoriser la triste croyance qui donnait la domination sur les vents et les météores aux esprits du mal, au « Prince de l’air, » aux ténébreuses puissances dont Typhon avait été la première personnification. Si les progrès de la raison et l’élévation du sentiment religieux n’ont pas encore suffi pour détruire entièrement cette antique interprétation des menaçantes perturbations que nous avons à combattre, nous devons espérer que les progrès de la science donneront à tous une idée plus juste et plus haute des forces mystérieuses dont la bienfaisante action ne cesse pas d’être apparente, même au milieu des plus terribles conflits. Loin de chercher à dissimuler les sinistres que ces conflits entraînent, nous emprunterons aux récits authentiques des témoins, la description des tempêtes qui ont causé le plus de ravages, afin qu’on puisse mieux juger par la grandeur du mal de la grandeur de l’effort qui sera nécessaire pour le détruire, le prévenir, ou du moins en amoindrir l’étendue.
Mais cet effort est si évidemment dans le sens de notre destinée, il nous est si visiblement commandé par les vives aspirations de notre époque vers le bien-être moral et matériel, que nous ne pouvons douter de sa puissance, et des nouvelles conquêtes qui s’offrent à notre intelligente activité.
Dans la seconde partie de notre essai nous avons résumé les tentatives partielles faites chez les nations les plus éclairées pour arriver au but que nous indiquons. Les résultats obtenus prouvent qu’il suffit de s’unir pour avoir la certitude du succès. Cette union, commencée sous de favorables auspices, embrassera certainement le globe entier dans un avenir prochain, que nous ne devons pas perdre de vue au milieu des bouleversements et des dévastations dont notre planète est encore le théâtre.
Les hautes régions de l’atmosphère sont un immense réservoir d’électricité qui s’écoule vers le sol, tantôt silencieusement, tantôt au milieu des éclats de la foudre. Le premier mode de communication se manifeste surtout en hiver. En été, quand l’air est sec, il n’est plus conducteur du fluide qui se concentre alors dans les nuages. L’équilibre des forces électriques du globe et de l’atmosphère est rompu et ne se rétablit que par les conflagrations de l’orage.