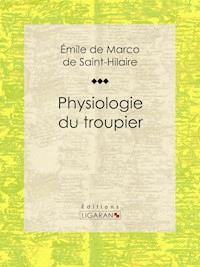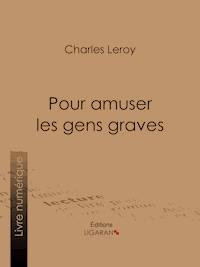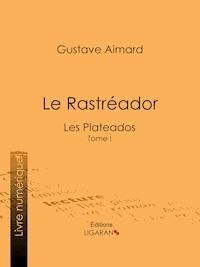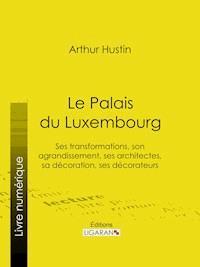Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "Je n'ai pas entreprise ce livre pour redire, dans son détail quotidien, la néfaste histoire du tribunal révolutionnaire. J'ai tenté de reconstituer l'aspect et la vie du Palais durant les mauvais jours de la Révolution, de silhouetter le petit groupe de déclassés qui, à cette époque, s'emparèrent, en intrus, de l'antique demeure du Parlement et assumèrent la tâche stigmatisante d'appliquer les lois impitoyables qu'extorqua la Terreur à la Convention Nationale."À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARANLes éditions Ligaran proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes. Ligaran propose des grands classiques dans les domaines suivants : • Livres rares• Livres libertins• Livres d'Histoire• Poésies• Première guerre mondiale• Jeunesse• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335086638
©Ligaran 2015
Fragment de l’estampe de Bouillon « le jugement de Marie-Antoinette », 1793.
Je n’ai pas entrepris ce livre pour redire, dans son détail quotidien, la néfaste histoire du tribunal révolutionnaire. J’ai tenté de reconstituer l’aspect et la vie du Palais durant les mauvais jours de la Révolution, de silhouetter le petit groupe de déclassés qui, à cette époque, s’emparèrent, en intrus, de l’antique demeure du Parlement et assumèrent la tâche stigmatisante d’appliquer les lois impitoyables qu’extorqua la Terreur à la Convention Nationale.
Je me suis appliqué, de préférence, à faire revivre les scènes et les acteurs du drame dont d’éminents historiens ont étudié, de façon définitive, les causes, les circonstances et les résultats. J’ai été conduit ainsi à réviser et à compléter le peu que l’on savait des dispositions topographiques du tribunal, trop sommairement localisé, par la tradition, dans un étroit emplacement du vaste Palais. Aucune description contemporaine des évènements ne me guidait et j’ai dû, pour conduire à bien ce travail minutieux et quelquefois décevant, puiser à maintes sources jusqu’à présent inexploitées : une ligne d’un rapport, une phrase d’un procès-verbal, un renseignement précis relevé dans une déposition, les comptes d’architectes, les devis d’entrepreneurs, et jusqu’aux mémoires des fournisseurs et des ouvriers m’ont procuré des indications se contrôlant, se complétant l’une par l’autre et dont l’ensemble constitua, en quelque sorte, une réédification.
Par bonheur, nos archives abondent en documents de ce genre ; je les ai patiemment dépouillés, afin d’évoquer, dans son décor vrai, la cohue de magistrats, de jurés, de greffiers, d’employés, d’huissiers, de gardes, de geôliers, de comparses, de subalternes de tout genre qui participèrent à l’œuvre du tribunal. Par bonheur, aussi, l’obligeance des archivistes égale leur infaillible érudition, et j’exprime ici ma reconnaissance à MM. Daumet, Gauthier, Le Grand, Schmidt et Tuetey qui, loin de me tenir rigueur de mon importune obstination, l’ont stimulée de leurs conseils et assagie de leur expérience.
Je me permets d’adresser également mes respectueux remerciements à M. le Premier Président Forichon, dont la haute bienveillance m’a autorisé à explorer certains locaux du Palais, ordinairement inaccessibles au public ; à M. Maury, inspecteur des services départementaux ; à M. Pourret, directeur de la Conciergerie, qui m’ont guidé dans ce dédale ; à MM. Boucher, conservateurs de la bibliothèque des Avocats, si riche en documents judiciaires ; à M. Pierre Chevrier, qui a bien voulu me communiquer de précieux papiers inédits : les notes personnelles de Liger de Verdigny, le courageux magistrat qui présida les quarante-cinq audiences du procès de Fouquier-Tinville.
Et si quelque lecteur, plus curieux des grandes fresques que des tableaux de genre, estimait que je me suis montré trop soucieux des détails et des menus faits, je me retrancherais derrière Descartes qui pensait juste, je crois, lorsqu’il écrivait : – « S’ils ne changent ni n’augmentent les choses pour les rendre plus dignes d’être lues, les historiens en omettent, presque toujours, les plus basses et les moins illustres, d’où vient que le reste ne paraît pas ce qu’il est. »
G.L.
Au début d’une vieille comédie, dans un décor de petite ville, certain passant aborde deux bourgeois qui flânent.
– Où se trouve le palais de Justice, s’il vous plaît ?
– Monsieur, la Justice n’a point de palais ici ; vous voulez dire la maison où l’on condamne.
À Paris, pendant la Révolution, l’antique demeure du Parlement a, semblablement, perdu son vieux nom de Palais de Justice, appellation naïvement confiante, où Justice semblait évoquée à l’égal d’une personnalité, une dame de haut rang, secourable et protectrice. En 1793 on dit communément, le Tribunal. Justice est absente ; son palais seul, – sa maison, – car il n’y a plus de palais, subsiste.
Sur la rue de la Barillerie, derrière la belle grille ouvragée et dorée qui a coûté plus de 600 000 livres, il dresse ses trois façades, encadrant la Cour du Mai ; façades toutes blanches, que le temps, la pluie et les fumées n’ont pas encore ternies. Par le haut perron, de soixante pieds de large, au bas duquel, chaque année, sous l’ancien régime, les clercs des procureurs plantaient au printemps un mai enrubanné qu’ils allaient processionnellement choisir parmi les plus beaux chênes de la forêt de Bondy, on monte à la galerie Mercière, aboutissant, sur la droite, au cœur du vieux Palais, la grande salle des Pas perdus.
Au temps du Parlement, la salle des Pas perdus était la capitale du monde judiciaire : le pourtour de l’immense galerie et la base de chacun de ses piliers étaient garnis d’échoppes que louaient, – très cher, – libraires, bijoutiers, écrivains publics, cordonniers, fourbisseurs, voire des pâtissiers et des dentellières : c’était là une sorte de foire, une cohue bruyante, un remous continu dès sept heures du matin, heure de l’ouverture des audiences. Autour du Gros Pilier, une sorte de cour, jadis, tenait ses assises : on le nommait ainsi, « non parce qu’il était plus gros que les autres, mais parce qu’il servait de rendez-vous, depuis une longue suite d’années, aux plus fameux avocats, et à des personnes distinguées par leur esprit et leurs ouvrages ». Dans l’angle nord-est de la salle des Pas perdus, derrière deux grilles, entre les statues de saint Louis et de Charlemagne, était un autel doré, sous l’invocation de saint Nicolas ; c’était la chapelle des procureurs, où, tous les matins, depuis cinq siècles, l’office divin était célébré : là avait lieu, chaque année, le lendemain de la Saint-Martin (11 novembre), la traditionnelle messe rouge.
Façades sur le quai de l’Horloge.
(D’après un dessin conservé au Musée Carnavalet.)
À l’extrémité opposée de la salle, deux portes donnaient accès à la Grand-Chambre du Parlement ; l’une, s’ouvrant directement sur la salle des Pas perdus, était réservée aux Pairs ; l’autre, percée dans l’axe de la galerie Mercière, desservait une antichambre ovale, appelée le parquet des huissiers, d’où l’on pénétrait, à gauche, dans la Grand-Chambre. Entre ces deux portes, dans la salle des Pas perdus, était le banc des huissiers, chaque jour, de midi à deux heures, « inondé du flot des significations que lui vomissaient les quatre cents études de procureurs ». Par une ouverture, en forme de fenêtre, le parquet faisait aux clercs la délivrance des arrêts expédiés : « il y avait toujours, à cette fenêtre, encombrement de plusieurs heures, causé par les lenteurs de la numération des espèces ».
La Grand-Chambre, tabernacle de la Justice, en quelque sorte, était un lieu célèbre dans le monde entier, par la majesté de son histoire et la sévère richesse de sa décoration. En raison de ses proportions, les trois hautes fenêtres, prenant jour sur une cour étroite, n’y répandaient qu’une demi-lumière, favorable au recueillement : le sol était dallé de carrés de marbre blanc et noir : de grandes pièces de velours fleurdelisé tendaient les murs au-dessus de sombres lambris, chargés de vieux ors ; de deux tribunes vitrées, dites lanternes, réservées aux étrangers de marque, les balustrades d’appui figuraient un défilé de personnages, présidents, conseillers, avocats et procureurs dans leurs costumes des siècles passés ; au-dessus de la porte, un lion de pierre dorée, accroupi, tête basse, symbolisait « la soumission des plus puissants à la Justice » ; le plafond, – la merveille du Palais, – était formé de placages de chêne, peints de bleu et d’or, entrelaçant leurs ogives et retombant en culs-de-lampe, chef-d’œuvre de Du Hanon, menuisier fameux au temps de Louis XII. Les sièges des magistrats, symétriquement rangés, suivant une hiérarchie séculaire, précédaient le parquet, haute marche, recouverte d’un tapis fleurdelisé, où se plaçait, dans l’angle du fond, opposé au côté des fenêtres, le siège occupé par le souverain, lors des lits de Justice : c’était l’endroit saint, le coin du roi ; au bas du parquet, se voyait la chaise à bras sur laquelle prenait place, aux séances de cérémonie, le chancelier de France, drapé dans une épitoge à bandes de velours rouge et tenant le sceau royal sur un tapis de velours violet, brodé de lis d’or.
Sur la tapisserie des murailles, un tableau du Crucifiement, attribué à Albert Durer ; un autre Christ dans le banc des gens du roi ; en face, près de la porte des Pairs, et adossée au mur de la salle des Pas perdus, une haute cheminée, décorée d’un bas-relief de Coustou, Louis XV entre la Vérité et la Justice ; des trophées de bronze doré l’encadraient et ces nobles décors, harmonisés par le temps avec les séculaires souvenirs et les traditions augustes, faisaient de cette Chambre un lieu vénérable, une « basilique », dont un de nos souverains disait : « En voyant de telles choses, on est fier d’être roi de France ».
Quelque aride que soit cet aperçu topographique de l’ancien Palais, il est nécessaire d’en poursuivre l’exposé sommaire, puisque ces lieux vont servir de théâtre au drame que nous entreprenons de raconter.
(D’après dessin conservé au Archives nationales (N° Seine 415e)
1. Chapelle des Procureurs.
2. Porte des Pairs.
3. Parquet des huissiers.
4. Banc des huissiers.
5. Coin du roi.
6. Cheminée, détruite en 1793.
7. Buvette des magistrats de la Grand-Chambre.
8. Couloir.
9. Cabinet du Premier Président.
10. Escalier desservant l’étage supérieur du bâtiment neuf.
11. Vestibule de la Tournelle.
12. Salle Saint-Louis.
13. La petite Tournelle.
14. Tour Bonbec, jadis salle de Torture devenue buvette publique du Parlement.
15. Escalier de la Tour Bonbec, descendant à la Conciergerie et montant à l’étage supérieur.
16. Greffe de la Tournelle.
17. Tribunal de la Connétable.
18. Perron de 4 ou 5 marches descendant à la Galerie des Prisonniers.
19. Grand degré de la Chambre des Requêtes.
20. Escalier desservant l’étage supérieur du Bâtiment vieux.
21. Escalier desservant du Bâtiment vieux.
22. Passage de plain-pied, emplacement de l’escalier improprement appelé aujourd’hui escalier de la reine.
Le pignon Nord de la Grand-Chambre, du côté de la Seine, était flanqué de deux tours, encore existantes : celle de l’Est s’appelle la tour de César, l’autre la tour d’Argent : un étroit couloir continuant une des grandes artères du vieux Palais, séparait la Grand-Chambre des salles circulaires que formait le premier étage de ces deux tours : l’une de ces salles servait de buvette aux magistrats de la Grand-Chambre, l’autre, celle de la tour d’Argent, de cabinet au Premier Président.
Afin d’agrandir les locaux du Parlement, on avait construit, vers le milieu du XVIIIe siècle, un bâtiment élevé de trois étages sur un rez-de-chaussée ancien dépendant de la Conciergerie. On l’appelait le bâtiment neuf. Là étaient ménagées, au premier étage, de niveau avec la Grand-Chambre, et communiquant directement avec elle, deux vastes pièces carrées et une plus petite prenant jour sur le préau de la Conciergerie, et réservées à la quatrième Chambre des Enquêtes. D’autres chambres du même étage servaient aux tribunaux de l’Amirauté et des Eaux et Forêts. L’entresol inférieur, d’où la vue plongeait également sur la cour de la prison, était réservé au greffe du Parlement ; des greffes encore et la secrétairerie du Procureur général occupaient l’étage supérieur, auquel on accédait par un escalier, situé au point de raccordement du bâtiment neuf, avec les anciennes constructions en bordure du quai des Lunettes.
Ce vieil édifice, entassé sans plan et sans style sur un rempart du temps de Philippe le Bel, formait un amas de masures en bois et en maçonnerie, surplombant la cour de la Conciergerie et prenant vue, d’un côté sur la prison, de l’autre sur la rivière. À l’intérieur, c’était un dédale de petites pièces entresolées, de cabinets incommodes, de couloirs obscurs, d’escaliers sur lesquels on avait dû multiplier les issues, présentant l’aspect le plus hideux et le plus misérable. Un large corridor formant dos d’âne, coupé de marches et de paliers, traversait cette bâtisse irrégulière, dont les parties supérieures tombaient en ruines. Ce couloir, prolongement de celui que nous avons rencontré au pignon de la Grand-Chambre, était le seul moyen de communication entre les différents services du Parlement : il reliait la tour de César et la tour d’Argent à la tour Bonbec, et à la salle Saint-Louis, dont cette dernière tour était une dépendance.
On se trouvait là dans la Tournelle, qui n’était autre que la Chambre criminelle du Parlement. Sur le large corridor venant de la Grand-Chambre, après l’angle qu’il formait, vers la gauche, en se heurtant à la tour Bonbec, s’embranchait une courte galerie, vestibule de la salle Saint-Louis. Celle-ci était une très vaste pièce, éclairée par cinq fenêtres ouvrant sur le quai ; une autre chambre, moins haute de plafond, était ménagée entre la salle Saint-Louis et la tour : on l’appelait la petite Tournelle ; de niveau avec ces deux salles, une troisième, de forme circulaire, pratiquée dans la tour elle-même, servait de buvette et aussi de salle de torture. C’est là qu’avait été questionné Ravaillac. Un escalier de pierre, pratiqué dans une tourelle, desservait tous les étages de la tour Bonbec, et venant des combles, descendait jusqu’à la Conciergerie. Par là étaient conduits de la prison à la Tournelle les accusés de crime capital, gardés ès-prisons du palais.
La salle Saint-Louis, réservée aux grandes audiences criminelles, était beaucoup plus sobrement décorée que la Grand-Chambre : quelques boiseries sculptées de balances, de mains de justice, de sceptres et de couronnes royales, de belles tapisseries recouvrant les murs ; rien d’autre. C’est là qu’avaient été jugés le « cadavre de Jacques Clément, l’assassin d’Henri III, en 1589 » ; Jean Chastel, cinq ans plus tard ; Ravaillac, en 1610 ; Cinq-Mars et de Thou, Fouquet, Cartouche, Mandrin, Damiens, le malheureux fou qui frappa Louis XV d’un coup de canif, les héros de l’affaire du Collier, dernier drame judiciaire dont la salle Saint-Louis fut, sous l’ancien régime, le théâtre. Elle devait en voir d’autres encore…
Si, quittant les locaux de la Tournelle que complétaient quelques salles de greffe ou de conseil, on continuait à suivre le long couloir dont il a été maintes fois fait mention, on le voyait se transformer en une sorte de galerie dite corridor des Peintres, éclairée, à gauche, par des fenêtres garnies de solides barreaux, d’où le regard plongeait sur la cour de la Conciergerie, et, percée, à droite, d’une série de portes ouvrant sur différentes chambres du Tribunal de la Connétablie, ce couloir, après un parcours total, long de plus de cent cinquante pas, débouchait enfin, par un perron de quelques marches, à la grande galerie des Prisonniers, en face du beau degré de la Chambre des Requêtes, auprès duquel s’ouvrait la porte d’un escalier étroit et sombre descendant à la Conciergerie.
Par la galerie des Prisonniers, l’une des principales rues du Palais, garnie dans toute sa longueur de deux rangs de boutiques et d’échoppes, on regagnait la galerie Mercière et le perron de la cour du Mai.
Depuis un temps immémorial, les travaux du Parlement étaient suspendus, chaque année, le 7 septembre, jusqu’au lendemain de la Saint-Martin. En l’absence de la Cour, siégeait, « pour les matières provisoires et autres qui demandent célérité », une Chambre des vacations, qui tenait audience jusqu’au 27 octobre seulement : de cette date jusqu’au 12 novembre, le Palais restait désert et silencieux.
Or, en 1790, le jour même où commençaient ordinairement les vacances, l’Assemblée constituante rendait un décret déclarant que « au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux, tous ceux actuellement existants, y compris les Parlements, étaient supprimés ». La Chambre des vacations de Paris, devait, le 15 octobre, avoir cessé tout service. Les conseillers, assidûment, siégèrent jusqu’au jour indiqué. La dernière séance consignée aux registres est celle du jeudi, 14 octobre. Ce jour-là, ces simples mots : l’audience est levée, acquéraient, du fait des circonstances, une laconique et grande éloquence : ils ne furent pas entendus sans émotion : les avocats, groupés autour des magistrats, à l’heure où se brisait, entre leurs deux corporations, une alliance de cinq siècles, « les comblaient dit l’un d’eux, de respects et de témoignages de sensibilité ». Les parlementaires quittèrent le Palais dont, pour la première fois, depuis quatre cent soixante-douze ans, les portes furent fermées.
Dès l’aube du lendemain de nombreux détachements de troupes de ligne et de gardes nationales occupèrent les cours : un poste fut placé à chacune des issues. Vers midi, un cortège parut, venant de l’hôtel de ville, devant la grille de la cour du Mai : d’abord le général Lafayette, à cheval, encadré de son état-major, puis une compagnie des gardes de la Ville, précédant la voiture de cérémonie du maire, Bailly. Suivaient onze voitures de suite, également escortées des gardes de la Ville et occupées par les membres du Corps municipal.
Descendu de son carrosse au bas du grand perron, Bailly monta les trente-cinq marches avec une gravité majestueuse, entouré de son cortège et persuadé qu’il trouverait, en haut de l’escalier, le greffier du Parlement pour lui en offrir les clefs, suivant qu’il se pratique à l’égard d’une ville réduite. Ainsi l’ordonnait, d’ailleurs, le décret du 7 septembre. Aucun greffier, cependant, ne se montra, et le maire de Paris reçut les clefs des mains du buvetier qui, après s’être fait attendre longtemps, les livra de mauvaise grâce.
Les portes s’ouvrirent enfin et le cortège se dirigea vers la Grand-Chambre. Mais, dès l’entrée, tous parurent saisis « d’une crainte religieuse. L’aspect de cette basilique, qui rappelait tant de souvenirs honorables, tant d’époques fameuses de notre histoire ; ces voûtes silencieuses qui avaient tant de fois retenti de voix éloquentes », arrêtèrent, au seuil, les municipaux. Aucun d’eux n’osa traverser le parquet, ni prendre sa place sur les sièges ; « ils restèrent debout dans la salle, gardant un morne silence et dans l’attitude de la consternation ».
Seul Bailly s’assied au banc des gens du roi : tandis que s’opère l’apposition des scellés sur les chambres, greffes et dépôts au nombre de soixante-huit, un exprès, accouru de la cour du Mai, vient dénoncer au maire la découverte d’un emblème blasonné appliqué sur le chêne des Basochiens : un arrêté est aussitôt rendu : l’emblème séditieux et l’arbre, son complice, seront à l’instant mis en pièces : quatre commissaires sont nommés pour procéder à l’exécution, et, tandis que la visite se poursuit à l’intérieur du Palais, les sapeurs de la municipalité abattent le dernier Mai, aux cris de joie de la populace, collée aux grilles.
L’opération des scellés dura tout le jour. Enfin Bailly ferma la porte de la Grand-Chambre ; cette porte qui, dans deux ans, se rouvrira devant lui, non plus solennel officiant, mais accusé, honni, promis aux plus cruels raffinements du supplice et hué par cette même foule qui délire aujourd’hui d’enthousiasme sur son passage.
Il semble bien, d’ailleurs, que là, comme en d’autres circonstances, les novateurs n’ont cédé qu’au plaisir de jouer un beau rôle, de figurer dans une scène théâtrale dont s’alimenterait quelque tragédie de l’avenir ; car il n’est pas permis d’admettre qu’un homme de simple bon sens pût croire possible d’enfermer sous scellés les papiers du Parlement, c’est-à-dire les pièces de tous les procès en cours, de toutes les enquêtes entreprises et de suspendre ainsi, d’un beau geste, dans une ville telle que Paris, le fonctionnement de la justice. Les vieux parlementaires, tous les gens de robe et de chicane, crurent certainement voir la fin du monde ; mais le cataclysme fut de courte durée ; quatre jours plus tard, les législateurs hâtifs de l’Assemblée, rendaient un décret « chargeant la municipalité de commettre un greffier et des commis greffiers pour l’expédition des arrêts du Parlement, et de procéderà la levée des scellés sur les minutes d’arrêts rendus depuis 1785 ».
Au reste les nouveaux tribunaux s’organisaient rapidement : le 24 novembre les électeurs parisiens, réunis dans la grande salle de l’archevêché, procédaient à la nomination des juges ; le scrutin dura plus d’un mois ; il fournit des résultats excellents et l’on a pu écrire, très justement, que, en cette matière si nouvelle et si délicate, « l’élite des électeurs fit choix, du premier coup, de l’élite des jurisconsultes ».
Les noms de plusieurs parlementaires étaient sortis de l’urne : Frêteau de Saint-Just, Dionis du Séjour, Clément de Blavette, Hérault de Séchelles, Le Peletier de Rosambo ; parmi les députés, Merlin de Douai, A. du Port, Thouret, Target, Chabroud, d’autres encore étaient élus magistrats : un grand nombre d’avocats, Agier, Morel de Vindé, Tronchet, Bigot de Préameneu, Minier, Recolène, Oudart, Vermeil réunissaient la majorité sur un nombre de votants, vite lassés, qui varia de 675 à 342.
Le 31 décembre, deux « enfants trouvés », amenés de l’hospice, tirèrent au sort la répartition des trente nouveaux juges et de leur vingt-quatre suppléants entre les six tribunaux parisiens. Un seul, celui du premier arrondissement, devait siéger au Palais : l’installation eut lieu, solennellement, le mercredi, 26 janvier 1791 : le local choisi était celui de la ci-devant Chambre des requêtes, dont le bel escalier à double rampe s’élevait à l’extrémité de la galerie des Prisonniers.
Le maire et les membres du Conseil général de la commune prennent place sur les sièges : les nouveaux juges sont introduits ; ils prêtent individuellement le serment de maintenir la Constitution, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi et de remplir leurs fonctions avec exactitude et impartialité. Puis ils sont invités à monter sur leurs sièges, tandis que le maire et ses conseillers descendent au parquet : les juges se couvrent ; échange de discours, saluts, félicitations, puis Bailly et son cortège regagnent l’hôtel de ville.
Le lendemain, 27 janvier, le Tribunal du premier arrondissement ouvrait sa première audience à huit heures du matin. Le Palais avait repris son animation de jadis : les anciens procureurs et les ex-avocats étaient assidus aux flâneries de la salle des Pas perdus, « comme si le Parlement était encore là ». Ils affectaient de considérer comme un jeu éphémère les opérations des tribunaux élus. – « Un peu de patience, disait l’un d’eux, un bon arrêt du Parlement nous fera raison de tous ces gredins-là. » La rumeur fut grande lorsqu’on vit qu’un avocat de renom, Berryer, consentait à plaider devant les intrus. Il s’était décidé en effet, malgré les observations de deux de ses confrères, Bonnart et Bonnet, à se présenter devant le Tribunal du premier arrondissement, au nom du Trésor public, mis en cause par un sieur Hartley. Son entrée dans la salle des Pas perdus, encombrée de procureurs au Parlement, de leurs clercs et d’autres curieux « fit l’effet de l’apparition d’un spectre ». Berryer surprit même quelques murmures dont il prit peu de souci et se dirigea rapidement vers la salle d’audience, déjà encombrée de spectateurs, tout aussi peu favorables, que la publicité des jugements, récemment décrétée, attirait.
La grande nouveauté était le costume des juges : ils parurent, sortant de leur Chambre du Conseil, en habits noirs et manteaux courts, la tête couverte d’un chapeau à la Henri IV, surmonté d’un panache noir qui leur retombait sur le front. Berryer, suivant l’ancien usage, offrit ses hommages à son adversaire, M. Perrin, et salua respectueusement M. Hartley, contre lequel il allait plaider ; disons, pour terminer, que Berryer gagna le procès, ce qui lui valut, par la suite, d’être chargé des intérêts du Trésor public.
Le nouveau costume des juges, qui touche davantage à notre sujet, fut décrété par l’Assemblée constituante à la date du 11 février 1791. L’effet fut jugé « déplora déplorable ». Les vieux habitués du Palais regrettaient la robe imposée aux ci-devant magistrats : ils faisaient valoir que « l’uniformité des vêtements déjoue, chez les uns, la vanité d’une mise recherchée, et dérobe les autres à la confusion d’un vêtement trop modeste ou trop négligé ». L’ampleur de la toge, en enveloppant tout le corps, avait, d’ailleurs, l’avantage de dissimuler les difformités corporelles, et les nouveaux juges ne furent pas longtemps sans se ressentir de l’inconvénient résultant de l’exhibition de leurs jambes : c’est, paraît-il, de cette époque que date la coutume de draper les tables des salles d’audiences de longs tapis descendant jusqu’à terre, dissimulant aux justiciables les extrémités inférieures de leurs magistrats et réparant ainsi, du mieux possible, l’imprévoyance du législateur.
À l’heure de ses premières illusions quelques purs esprits de l’Assemblée constituante s’étaient imaginé que, dans le nouvel ordre de choses, les tribunaux seraient inutiles. À quoi bon des juges ? Il n’y aura plus de procès quand l’espèce humaine sera régénérée par un code moral et régie par des lois si simples qu’elles ne pourront prêter à la discussion. Pourtant lorsque fut décrétée l’élection des juges par le peuple, l’Assemblée estima que le nouveau corps judiciaire rendrait peut-être, dans son inexpérience, des arrêts susceptibles d’être révisés : et c’est ainsi qu’elle fut amenée à voter la création d’un tribunal suprême dont la compétence ne s’étendrait que sur la violationd’une loi positive. L’organisation de ce tribunal, dit de cassation, fut promulguée le 27 novembre 1790. Les anciens locaux du ci-devant Parlement lui étaient attribués.
Depuis l’apposition des scellés, la Grand-Chambre était restée close jusqu’au jour où la répartition aux différents tribunaux du département des affaires restées en litige, avait forcé les employés en désarroi d’opérer le triage complet des sacs de procès entassés dans l’ancien greffe. Ce triage nécessitait un vaste espace et les commissaires avaient obtenu, pour mener à bien ce travail, l’autorisation de disposer de la Grand-Chambre. On leva les scellés apposés sur la porte ouvrant dans la salle des Pas perdus, puis sur celle donnant communication aux corridors intérieurs : à la première les rubans d’étoffe et le sceau de la municipalité furent aussitôt réapposés ; la seconde resta libre et l’on put, par ce moyen, empiler, sur les dalles de la vaste pièce, les sacs réclamés par les parties.
On ne les empila point longtemps : le Tribunal de cassation exigeait qu’on lui livrât le local : il y prit séance à la fin d’avril 1791 : les magistrats suprêmes étaient, pour la plupart, des jurisconsultes éminents, hommes d’âge et d’expérience ; mais ils étaient là de nouveaux venus, sans lien entre eux, sans précédents, sans traditions : « ils paraissaient des légataires lointains venant prendre possession d’un riche héritage ; ils parlaient bas, comme dans la maison d’un mort illustre, ouverte pour la première fois depuis le décès ».
Peut-être le somptueux décor du vieux prétoire des lits de justice écrasait-il, par sa majesté, l’institution nouvelle : elle le redoutait, semble-t-il ; car d’une de ses premières délibérations résulta « la suppression des lanternes existantes en la ci-devant Grand-Chambre et le remplacement des tentures chargées d’armoiries inconstitutionnelles ». Les belles draperies de velours fleurdelisé furent arrachées, les lanternes détruites ; mais ces suppressions ne suffisaient pas : le Tribunal de cassation exigea que « ce plafond de bois de chêne, tout entrelacé d’ogives qui ne sont ni ovales, ni de plein cintre, fût remplacé par un plafond lisse et sans ornements ». Les architectes, alors comme aujourd’hui, soucieux d’entreprises, ne protestèrent pas : l’admirable plafond, datant de Louis XII, fut recouvert de lattes, de plâtre et de toiles tendues. À l’époque du 10 août 1792, il ne restait rien de l’ancienne décoration de la Grand-Chambre : le lion de pierre dorée, symbole de la Force rampant devant la Justice, l’effigie de Louis XV et ses bas-reliefs, les sièges, les trophées de bronze doré, les lambris sculptés, tout avait disparu : le Tribunal de cassation avait fait choix d’ornements plus modernes et commandé au sculpteur Daujon des bas-reliefs destinés à garnir le dessus des portes, « tant dans l’intérieur de la salle comme à l’extérieur ». Il ne reste rien de ces ouvrages de sculpture ; mais c’est sans nul doute un fragment de l’œuvre de Daujon, restée inachevée, qu’on distingue au-dessus de la porte de l’ancienne Grand-Chambre, dans le tableau de Boilly, le Triomphe de Marat, que conserve le musée de Lille.
Le Tribunal de cassation s’était, du reste, mis au large : il occupait outre la Grand-Chambre, les trois salles du bâtiment neuf jadis attribuées à la Quatrième des enquêtes, abandonnant le reste de cette partie du Palais au greffe de l’ancien Parlement et aux employés chargés de se débrouiller dans les inventaires. Mais il s’était emparé de toutes les constructions délabrées situées entre la tour d’Argent et la tour Bonbec : il lui avait fallu trouver, dans ce dédale de logements, quarante et une pièces convenables, chacun des juges devant avoir son cabinet. Comme le Tribunal de cassation se divisait en deux sections, il s’était étendu jusqu’à la salle Saint-Louis, où il trouvait une seconde salle d’audience, vaste et aérée, et jusqu’aux pièces adjacentes, dépendant de l’ancienne Tournelle. Il tenait ainsi la plupart des vieux locaux du Parlement, quand fut créé, dès les premiers jours qui suivirent la chute de la royauté, le Tribunal criminel institué le 17 août 1792 pour juger les conspirateurs coupables des crimes commis contre le peuple dans la journée du 10.
Sommée par la Commune de Paris, l’Assemblée avait cédé sur tous les points, après quelques timides résistances : les juges élus dans la nuit du 17 au 18 août furent conduits à la Tournelle, le jour même, par le maire de Paris, accompagné du Conseil de la Commune, et dans un cérémonial semblable à celui qu’on a lu plus haut. C’est par la galerie Mercière et celle des Prisonniers que les nouveaux magistrats vinrent processionnellement prendre possession du prétoire qui leur était attribué. À l’extrémité de cette dernière galerie s’ouvrait, ainsi qu’on l’a vu, le corridor des Peintres, conduisant à la Chambre Saint-Louis : c’est ce corridor que suivirent les membres du Tribunal extraordinaire. Une foule de badauds les accompagnait et entra, en même temps qu’eux, dans la Tournelle : il y eut discours, prestations de serment, puis, conformément à un arrêté de la Commune, chacun des juges se présenta individuellement sur l’estrade, déclarant son nom, sa profession, sa demeure et interpella le peuple « de produire ses griefs, s’il en avait à lui opposer ». La scène, renouvelée des Grecs, fut très appréciée : le peuple accorda généreusement l’investiture à ses magistrats : aucun ne fut récusé.
Ils étaient tous gens de palais, ou, tout au moins, gens de chicane. Des présidents l’un, Pierre-Athanase-Nicolas-Pépin Desgrouette, avocat, avant la Révolution, s’était popularisé en s’érigeant entraîneur et porte-parole des Forts de la Halle ; le quartier des marchés était son domaine, il y régnait, il y était dieu. L’autre, Jean-Antoine Lavau ne nous est pas connu. Au nombre des juges étaient Louis-Marc Desvieux, homme de loi qui, président du tribunal du 3e arrondissement, devait mourir sur l’échafaud avec les partisans de Robespierre ; Aimé-Prosper Dubail des Fontaines, avocat, commissaire du district des Carmes en 1789 ; Antoine-Marie Maire, fils d’un médecin du chenil de Louis XV, ex-avocat au Parlement, membre de la municipalité en 1790 ; nous retrouverons ce personnage ; Marie-Claude Naulin, homme de loi, rue du Foin-Saint-Jacques, que nous aurons également plus tard l’occasion de rencontrer.
Au nombre des commissaires nationaux étaient Le Gangneur de Lalande sur lequel on n’est pas renseigné, et Gabriel-Toussaint Scellier, un homme de loi de Noyon qui, juge au tribunal du district de Compiègne, avait été désigné par ses collègues comme l’un des juges des six tribunaux criminels provisoires établis à Paris : il était affecté à celui du sixième arrondissement lorsqu’il fut nommé au Tribunal extraordinaire du 17 août.
Étaient également commissaires nationaux Louis-Marie Lulier et Pierre-François Réal, membre du Comité de surveillance ou de Salut public de la Commune de Paris. Parmi des directeurs du jury d’accusation figuraient Claude-Emmanuel Dobsen, ancien avocat au parlement de Champagne, devenu président du sixième tribunal criminel de Paris ; Jules-François Paré, l’ancien maître-clerc de Danton, plus tard président du district des Cordeliers ; et Guillaume Le Roy, dit Sermaize, un ancien procureur au Parlement, retiré en 1785, et fondateur d’un cabinet d’affaires rue Bertin-Poirée.
Si l’on excepte les provinciaux, tels que Dobsen et Scellier, tous ces personnages se connaissaient de longue date ; la vie du Palais, au temps du Parlement, leur avait ménagé de fréquents rapports : ce n’est pas, on peut le croire, sans quelque vanité satisfaite qu’ils se retrouvaient, après deux ans de dispersion, trônant en maîtres dans cette solennelle Tournelle, où ne siégeaient jadis que les Présidents à mortier ou Messieurs de la Grand-Chambre.
Le local, lui-même, il est vrai, se trouvait singulièrement démocratisé ; pour remplacer les tapisseries absentes on avait cloué aux murs de la grosse toile, tendue de papier uni, couleur gros bleu. Le pourtour de la salle avait gardé ses lambris de chêne : la petite Tournelle, toute voisine, également raccordée de papier gros bleu, fut réservée aux délibérations des jurés : de l’autre côté du vestibule d’accès se trouvaient deux pièces où l’on établit le greffe.
Le 21 août le Tribunal extraordinaire tint sa première audience et condamna à mort Louis-David Collenot d’Angremont, secrétaire de l’Administration de la Garde nationale. Le 24, nouvelle condamnation, celle de Arnaud Laporte, intendant de la liste civile du Roi depuis 1790. Ce même jour, 24 août, commençait le procès de Durozoy, le rédacteur de la Gazette de Paris, auquel les juges appliquèrent, le lendemain, la peine capitale.
Mais, ces trois fidèles royalistes punis, les conspirateurs de marque faisaient défaut : le tribunal, d’ailleurs, en était encore à s’organiser. Plusieurs des élus du 18 août avaient refusé de siéger : de ce nombre était Robespierre. D’autre part, il était urgent de remplacer deux directeurs du jury, les citoyens Botot et Perdry, deux juges suppléants, Le Gangneur de Lalande et Andrieux, celui-ci n’ayant point paru et les autres étant promus commissaires nationaux. L’Assemblée électorale y pourvut le 24 août et, le lendemain, les magistrats du tribunal voyaient arriver leurs nouveaux collègues, parmi lesquels était un vieux camarade du Palais, tombé dans la misère et disparu depuis neuf ans. Il s’appelait Fouquier-Tinville.
C’était un homme noir de cheveux et de sourcils qu’il avait très fournis, avec des petits yeux ronds et chatoyants ; le front bas, le visage plein, le teint blême, le nez court et grêlé, les lèvres rasées et minces, le menton volontaire. Il était de bonne taille, avec les épaules carrées et les jambes fortes.
Né de parents riches, cultivateurs du Vermandois, au village d’Hérouël à gauche du grand chemin qui va de Ham à Saint-Quentin, il avait, à treize ans, perdu son père, le sieur Eloy Fouquier de Tinville, « seigneur d’Hérouël et autres lieux ». La fortune, qui était considérable, fut partagée entre la veuve, Marie-Louise Martine et les cinq enfants. Exclusion faite de la part de chacun des héritiers, il restait encore à la mère 167 634 livres en immeubles d’exploitation agricole, désignés dans l’acte de liquidation : la « maison d’habitation, longue de 65 pieds sur 24 de large, voisine du cimetière, avec son colombier, son moulin à vent et ses vastes dépendances », et la ferme, en façade sur la grande rue, mitoyenne à l’église du village, et le bétail ; « six vaches grasses, quatre-vingts brebis chacune avec leur agneau, trente-cinq chevaux, truies, béliers, cochons de lait, etc. », opulente énumération où se révèle la plantureuse et saine existence des campagnards parmi lesquels Fouquier-Tinville vécut ses premières années.
Ses études terminées, Fouquier était, à vingt ans, clerc chez un procureur, Me Cornillier, rue du Foin-Saint-Jacques : il n’était pas riche ; le partage de l’héritage paternel n’était pas encore liquidé à cette époque ; sa mère, quoique vivant dans une grande aisance, le laissait sans ressources et presque sans vêtements. Telle était l’ordinaire insouciance des parents en ce temps-là. On se rappelle Camille Desmoulins, déjà célèbre, conjurant son père de lui envoyer un lit et une paire de draps. Fouquier, à vingt-trois ans, est plus misérable encore : il écrit alors :
À madame veuve Fouquier Detinville,
dame d’Hérouéel près Ham en Picardie, à Hérouéel.
Madame et très chère mère,
Mes frères sont tous deux arrivés en bonne santé et continuent à se bien porter jusqu’à présent ; j’ay été les recevoir à la Barrière le jour de leur arrivée : à l’égard de mon frère Quentin je l’ay laissé à la garde de M. Boucly qui l’a conduit dans la communauté de Sainte-Barbe où il reste, n’ayant pas été possible qu’on le fît entrer au Plessis ainsy qu’on vous l’avait à propos fait espérer. Quant à mon frère Louis, je l’ay conduit le même jour de son arrivée chez le procureur pour lequel je le destinais : la semaine s’est écoulée insensiblement sans qu’il eût sortit, mes occupations ne m’ayant pas permis de l’aller prendre ; mais dimanche arrivé, nous fûmes ensemble voir mon frère Quentin dont je ne peux vous dire la place ne devant être donnée que dans le cours de cette semaine et, de là, chez le cousin Vinchon où nous avons soupé : hier au moyen de ce qu’il était fête, je lui ay fait voir la comédie de laquelle il fut enchanté ; à l’égard des promenades, il ne les a pas encore vues mais cela ne tardera point, on ne peut pas tout voir à la fois ; il me paraît jusqu’à présent qu’il se fera assez à Paris, malgré la grande assiduité que notre état exige : cela ne me surprend pas à son égard, étant naturellement porté au travail : c’est ce dont je suis bien charmé pour lui ; car il n’est personne qui ne dise qu’il faut être dévoué entièrement à cet état pour faire quelques progrès.
Il m’a remis 54 livres qu’il m’a dit luy avoir été remises de votre part pour moy, mais je n’ai pas été plus surpris de voir qu’il n’était question ny de chemises, ni de robbe de chambre, ni de rhodinguotte ; cependant je crois vous avoir exposé dans ma dernière lettre que les trois chemises fines que j’ayes, deux sont totalement usées tant le corps que les manchettes et que d’ailleurs vous m’aviez promis l’année dernière de m’en envoyer deux : je ne me serais jamais attendu à ce refus : étant constant que je ne peux être sans chemise et j’y suis si bien que si vous ne m’en envoyez, je seray obligé d’en acheter et avec quoy, c’est ce que j’ignore ; à l’égard de la robbe de chambre il est également impossible que j’en passe, étant dans une place qui exige pour éviter le froid d’être en robbe de chambre et en robbe de chambre du moins non trouée telle qu’est la mienne à deffaut d’avoir de pièces pour la faire raccommoder, et d’ailleurs il n’existe plus de doublure, de façon qu’elle est hors d’état d’être mise ; cependant il faut que je sois depuis sept heures du matin jusqu’à neuf demies du soir vêtu ou non vêtu. À l’égard de la rhodingotte, si je vous l’ay demandée, c’est plutôt pour me mettre à l’abry du froid lorsque je sors, que pour la parure ; peut-être me direz-vous à cela que vous m’avez envoyé de l’argent il y a deux ans pour en acheter une : mais je crois vous avoir mandé qu’au lieu d’acheter cette rhodinguotte, j’avais acheté l’habit avec lequel j’ay été en vacances ; de façon que par ce moyen je suis sans et n’ay pour passer mon hiver que ce petit habit : de là, il est aisé de voir que c’est avec raison que je demande les objets cy-dessus et qu’il ne peut y avoir aucune difficulté de me les envoyer, du moins l’argent nécessaire pour les avoir ; car, en un mot, rien n’est plus naturel que je demande des chemises, une rhodinguotte et une robbe de chambre au moment où j’en manque : j’espère qu’il n’en sera pas de même de la présente que de ma dernière, c’est-à-dire que j’auray au moins quelque réponse d’une façon ou d’une autre : au surplus j’y suis accoutumé : néanmoins il n’est guère possible à celui qui a besoin de garder le silence ; je vous l’avoue franchement je désirerais de tout mon cœur avoir quelques ressources pour pourvoir à mes besoins ; je vous réponds que vous ne vous plaindriez pas si tost que je ne cesse de vous demander : mais encore une fois, la nécessité me force de parler. Sans ces chemises, une robbe de chambre et une rhodinguotte, je ne peux passer l’hyver ; aussi j’ose me flatter que vous voudrez bien faire attention à ce que j’ay l’honneur de vous dire et que vous adherrez à ma demande, c’est dans cette espérance que j’ay l’honneur d’être, avec le respect et la vénération la plus respectueuse.
Madame et très chère Mère, votre très humble et très soumis fils,
FOUQUIER DE TINVILLE.
Mes frères ainsy que moi vous prions de vouloir bien agréer de nos très humbles civilités et de faire bien des compliments à mes frères et à ma sœur.
À Paris, ce 10 octobre 1769.
Les cousins Vinchon vous font bien leurs compliments ainsy qu’à mes frères et à ma sœur.
Le 28 janvier 1774, Fouquier-Tinville acquérait, moyennant 32 400 livres, l’étude de son patron, Me Cornillier, procureur au Châtelet de Paris et s’installait rue du Foin-Saint-Jacques dans le local occupé par son prédécesseur, au collège de maître Gervais, local qu’il quitta bientôt pour se loger rue Pavée-Saint-Sauveur.
Fouquier était un habile homme de lois, « possédant parfaitement l’art de conduire une affaire, quelque injuste qu’elle soit, à travers toutes les tortuosités de la chicane ». En dix-huit mois il réalisa un bénéfice évalué à 15 000 livres. Voyant sa situation prospère et sur le conseil d’un oncle, chanoine en l’église cathédrale de Noyon, il épousa une cousine germaine, Dorothée Saugnier, dont le père, ancien orfèvre à Péronne, s’était retiré à Saint-Quentin. Le contrat fut passé à Paris : Dorothée Saugnier n’apportait en dot que 4 000 francs, versés en avance d’hoirie par l’oncle chanoine qui faisait, en outre, un don comptant de 2 000 livres.
Un bref papal était indispensable pour lever l’empêchement canonique résultant de la consanguinité des futurs : Pie VI l’accorda, le 12 juin 1775 et, le 19 octobre, Fouquier de Tinville et Dorothée Saugnier, « s’étant préparés au sacrement du mariage par la réception de ceux de pénitence et d’Eucharistie », furent unis dans l’église de Mont-Saint-Martin, près de Saint-Quentin.
Les deux familles Martine et Saugnier étaient très pieuses et comptaient nombre d’ecclésiastiques éminents. C’est un prêtre, l’abbé Collier de la Marlière qui fournit à Fouquier une partie des fonds nécessaires à l’acquisition de sa charge ; un prêtre, lui choisit une femme et prit soin de la doter ; la jeune Mme Fouquier avait, elle-même, un frère qui, bachelier en théologie, était chapelain des églises de Noyon et de Péronne. Cet abbé Saugnier, résidant habituellement à Paris, habitait le séminaire Saint-Firmin. Dorothée retrouvait, à Paris également, l’une de ses sœurs, Adélaïde-Isabelle, mariée à un épicier du faubourg Saint-Martin, nommé Depille.
Après deux ans passés rue Pavée-Saint-Sauveur, le ménage Fouquier s’établit dans un confortable appartement de la rue Bourbon-Villeneuve. L’étude était au premier étage, sur la cour ; le cabinet du procureur, prenait vue sur la rue, ainsi que le salon à deux fenêtres. En retour, sur la cour, était la salle à manger, puis la chambre à coucher suivie d’une garde-robe et d’une pièce où couchait la cuisinière, Françoise Darnois. Le valet de chambre, Eloy Chambertin, dit La Jeunesse, était logé au-rez-de-chaussée.
Ce fut le bon temps de Fouquier-Tinville : Dorothée, figure très effacée, n’a pas, en quelque sorte, laissé de traces de son court passage dans la vie : elle était de ces honnêtes bourgeoises dont il n’y a rien à dire : mais on peut juger ses qualités d’après la rapide prospérité du ménage. Un fils naquit dans l’été de 1776 : on le nomma Pierre-Quentin. Puis vinrent trois filles, Geneviève-Louise-Sophie, Émilie Françoise et Adélaïde. En quatre ans, Dorothée Fouquier avait donné le jour à quatre enfants.
Pour passer les dimanches de la belle saison, Fouquier avait loué à Écouen une petite campagne, dont il se lassa vite et qu’il remplaça, bientôt par une maison et un jardin sis à Charonne, endroit champêtre alors, en bon air et très fréquenté des parisiens, en raison de ses beaux ombrages et de sa proximité des barrières. Au début de 1782, naissait au ménage une fille encore, Aglaé-Joséphine et, trois mois après, la mère, épuisée, mourait. Dorothée Fouquier fut inhumée au cimetière de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, sa paroisse, le 25 avril 1782.
Il semble que, avec elle, disparut le bonheur de Fouquier-Tinville. Il resta seul dans la maison de la rue Bourbon-Villeneuve, car les enfants ne se trouvaient pas là : l’aîné, Pierre-Quentin, avait été mis en pension à Villiers-le-Bel ; les fillettes étaient en nourrice dans les environs de Saint-Quentin. L’isolement pesa lourdement sur cet homme d’un tempérament manifestement impérieux et brutal. Comment fut-il mis en relations, dès les premiers temps de son veuvage, avec une dame Gérard d’Aucourt, dont le mari, originaire de Limoges était mort à Lille trois ans auparavant ? Quelle était la situation véritable de cette dame qui ne put fournir son acte de mariage, lequel acte fut remplacé par un certificat de notoriété signé de deux amis complaisants, attestant que, lors du décès du dit Gérard d’Aucourt, le nom de sa femme a été mal indiqué ? Ce sont là des points restés obscurs.