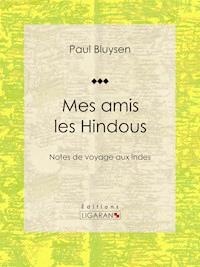
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait: "C'est le départ de Sarah Bernhardt ! dit notre camarade Fernand Bourgeat... Son affection et son optique du théâtre exagèrent; cependant il est certain que le quai de la gare P.-L.-M., sur ce coup de neuf heures moins le quart, est prodigieusement envahi devant le wagon et le sleeping où nous nous sommes répartis, cinq partants, femme, fille, soeur, neveu..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335038620
©Ligaran 2015
J’estois là ; telle chose m’avint…
29 octobre 1913.
« C’est le départ de Sarah Bernhardt ! » – dit notre camarade Fernand Bourgeat… Son affection et son optique du théâtre exagèrent ; cependant il est certain que le quai de la gare P.-L.-M. , sur ce coup de neuf heures moins le quart, est prodigieusement envahi devant le wagon et le sleeping où nous nous sommes répartis, cinq partants, femme, fille, sœur, neveu… La bousculade des derniers moments a été énorme, avec la préoccupation des 400 kilos de bagages, avec les recommandations intimes, avec le tintement ininterrompu du téléphone transmettant des adieux, des excuses, des « à tout à l’heure à la gare »…
Malgré les prières aimables de ne point se déranger, nous sommes très entourés ; des quatre coins de Paris, amis et parents ont accouru ; ils sont peut-être cent. Des petites mains de neveux nous happent au passage, tandis que nous fendons les rangs vers un arrivant nouveau, un confrère, un compatriote de l’Inde.
J’ai ordinairement la phobie de ces cérémonies attendrissantes, où mon mauvais scepticisme, peut-être, me montre trop souvent des visages indifférents ou intéressés ; mais ce soir, ces figures familières et familiales ont à mes yeux un bon sourire, un peu attristé chez quelques-uns. C’est « bête comme tout ». Combien j’ai accompagné de camarades à cette gare même ou ailleurs et, le train parti, je me rappelle que nous nous retrouvions sur le terre-plein extérieur aussi gais, ou préoccupés de nous. Bast ! la roue de la vie tourne, mais en ce moment, comme il s’agit de nous, je crois que tous ces amis diront et penseront différemment lorsque nous les aurons laissés… L’appartement parisien, plein de ce que l’on aime, le jardin de la campagne, les bureaux de travail quotidien, voire, les couloirs de la Chambre, papillotent dans mon cerveau. On ne sait que dire ; des banalités qui n’en sont pas ; les plaisanteries font du bien. « Que diable, c’est pour trois mois !… Ton premier tigre, n’est-ce pas ? Et les bayadères ? » On rit du bout des lèvres ; quelqu’un regrette de n’avoir pas apporté du magnésium… Voici des fleurs ; un bouquet de violettes, que je recommande comme cordial, en ces cas ; machinalement, selon la formule des romans, je le respire ou je le mordille. On reviendra, parbleu, et on les reverra tous !…
Sans siffler, le train glisse ; les chapeaux se lèvent, les mouchoirs s’agitent ; nous sommes réunis dans le sleeping ; on s’embrasse, ma foi ; tout est au mieux, personne n’a pleuré ! Dans le poum, poum, poum des traverses de la voie, les visions d’hier et de demain m’assaillent ; les petits faits grossissent ou se déforment. Que vais-je faire là-bas ? Il est donc enfin accompli, ce départ pour Pondichéry ? On en parlait depuis deux ans, comme d’un évènement du siècle prochain… L’obligation s’en est précisée, d’abord pour le député de l’Inde que je suis fier d’être. Des collègues, plaisantant, m’ont déclaré « que c’est imprudent » ; ils font allusion aux coutumes de la colonie d’autrefois, où le représentant ne se montrait point, les Hindous n’ayant pas fait les progrès intellectuels qui ont marqué ces temps derniers. J’ai accepté la plaisanterie de bonne grâce, puis j’ai répondu plus sérieusement, en dehors des préoccupations électorales, que je ne veux pas détenir plus longtemps un mandat dont les origines continueraient de m’être inconnues. À mon sens, le crédit d’un député colonial doit s’accroître à ce contact. On a trop médit ou souri de l’Inde. Enfin, je désire serrer des mains et des mains qui m’écrivent, depuis quatre ans, qu’elles se tendront vers moi.
D’ailleurs, j’ai été en quelque sorte élevé dans cette Inde ; ma mère y a passé son enfance, petite fille d’un fonctionnaire local et, dans notre maison française, c’était une allée et venue de créoles qui, de leurs voix douces, évoquaient à mes yeux d’enfant aventureux une grande nappe de soleil cru, des palais blanc et or, des robes de domestiques noires, rouges, vertes. Les noms de chaque vieille famille nous étaient chers ; parmi nos premiers joujoux ont figuré des ayas (femmes de chambre), des porteurs d’eau, des marchands de pains et de fruits baroques, puis des Dieux à trompe d’éléphant, aux bras multiples ; des poupées d’un fanon la pièce. Au fur et à mesure que la vie se déroulait, une nostalgie me prenait de ces êtres de rêve. Et je me réjouis de les rencontrer, face à face, de délecter mon oreille de leur parler chantant, dont j’ai retenu quelques mots, qui me hantent, à cette heure… Adieu vat ! Je ne pars pas comme Tartarin, mais comme un ami de tout ce que je veux voir et apprendre.
Tout cela, je l’écrirai. Je l’écris. Pour moi seul ? Je ne le pourrais ; je suis un incorrigible noircisseur de blanc, sous tous les climats. On sourira ? Tant de papier gâché pour – et par un député colonial, qui ne fait en somme qu’un raid vers sa circonscription ! Il se peut, mais j’ai résolu de ne pas me borner là. Je sais, d’autre part, que plusieurs livres ont été consacrés à ce voyage ; de grandes et belles fresques en ont été brossées ; de subtiles analyses des caractères et des mentalités populaires ont été faites. Je n’en relis rien, pour n’être pas ébloui par leur éclat ou gêné par leur perspicacité. J’estime qu’un peu des pensées et des incidents de chaque journée intéressera ceux qui n’iront jamais là-bas, voire ceux qui y sont allés.
Je voyage en vieux reporter et je m’amuserai et j’écrirai, n’importe quoi, au jour le jour, comme si souvent il m’advint en Afrique du Nord.
Marseille nous a fait, ce matin, la gracieuseté de se montrer sans mistral, sous le ciel très bleu. J’y suis pris à chaque arrêt vers l’Algérie ou le Maroc : dès la descente de la gare Saint-Charles, des bouffées d’ail et de safran s’échappent des bars, innombrables : « On y est ». Et c’est charmant, surtout un jour de fête comme celui-ci, la Toussaint. On goûte alors la fouie marseillaise, ses défauts et ses qualités ; parmi ces dernières, l’animation, le métallisme du verbe, le bon garçonnisme sans-gêne avec, cependant, des surprises, car j’ai assisté naguère à de terribles et courtes émeutes de grève, sous la charge des hussards et les ruées de policiers. Mais aujourd’hui, chacun ira paisiblement à la pêche, ou aux courses, ou à la corrida… Ou chacun flânera, sans plus, devant les cafés de la Cannebière qui n’en forment qu’un. Chacun suivra le chemin, l’unique, cette Cannebière, à rangs pressés, en montant et descendant, sans but autre… Autour des tramways, sur le terre-plein Saint-Louis, qu’égayent les kiosques de fleuristes, l’affluence est trépidante ; on grimpe dans les cars, à la force du poignet, sans nos numéros d’ordre parisiens ; on se case comme on peut ; c’est un circuit ininterrompu, une coulée de cars, dont le prix de trajet est très modique : pour trois sous, on fait le tour de la Corniche, aussi commodément qu’autrefois en de luxueux locatis. Sur plusieurs centaines de mille habitants, combien en reste-t-il au foyer ?
Malheureusement, la journée est courte ; il aurait fallu pouvoir donner un coup d’œil aux Puvis de Chavannes et aux moulages de Puget, du Musée ; on se contente de grimper à Notre-Dame, par le funiculaire et de pousser, en car, jusqu’au Roucas-Blanc… Voilà, tout le long, la mer, pointillée de blanc, dont nous serons peut-être le jouet demain. On commence à discuter sur les vertus des remèdes… Sauvons-nous jusqu’au vieux port, qui rapproche la vie des flots du cœur de la cité. Que Marseille le garde ! Il est un de ses joyaux, sinon le principal, Qu’il n’ait pas le sort des vieux quartiers, avoisinant l’Hôtel de Ville, que l’on commence à démolir. Nous les saluons comme de très vieux témoins de si pittoresques tournées nocturnes. Certes, ils sont peu hygiéniques et l’hygiène est de mode et de droit, – et d’une extrémité à l’autre de ce quadrilatère bordant l’eau, on se bouche le nez… Mais, comme compensation, quel fouillis d’oripeaux, de hardes rutilantes et de linges hétéroclites, plafonnant le haut des ruelles. Et là-dedans, jusqu’au milieu du ruisseau, les filles plâtrées, vernies, bariolées de fards épais, tous les types de l’Extrême-Orient, depuis le nègre cynocéphale jusqu’au Napolitain trop beau… Cela sent déjà les Indes. Maurice Rouvier, l’ancien grand Ministre, ce Marseillais de race, qui fut candidat à la députation à Pondichéry, en 1889, me disait, un jour : « La porte de votre pays, c’est la Joliette ».
Au soir, à travers la Cannebière de plus en plus invraisemblablement encombrée, nous nous rendons au restaurant où nous attend un dîner particulièrement cordial : les jeunes Hindous qui font leurs études ici ou à Aix se sont concertés et ont exigé que leur député et sa famille, fussent leurs hôtes. Ils appartiennent, originairement, à différents partis locaux, mais, en cette circonstance, un sentiment supérieur les unit : une considération affectueuse pour l’homme politique qui va vers les leurs, qui parlera d’eux au pays. C’est d’un consolant augure. Qu’ils soient remerciés, encore, de leur gentillesse.
Le Polynésien, qui nous emportera, part du cap Pinède, au diable vauvert. Course interminable qui, pourtant, a l’avantage de donner une mesure de la puissance économique de la grande Cité. Ces trois ou quatre kilomètres de quai, quoique peu actifs ce dimanche, attestent une continuité d’efforts, encore incomplets : sans être technicien, on souhaiterait que cet aboutissement du monde entier fût relié à notre pays, à notre hinterland, par une voie ferrée qui faciliterait les transits du quai aux wagons. Je sais que des projets en ont été dressés ; peut-être même, à la suite du récent voyage du Président de la République, sont-ils prêts d’aboutir ? Je signale simplement cette lacune actuelle.
Voici notre Polynésien ; après des discussions sans fin, sur le paiement d’une trop forte redevance aux cochers, les bagages sont repérés. Le globe-trotter qui me suivra notera qu’une entente conclue avec une Agence, dès la gare Saint-Charles, lui assurera un récolement rapide de ses malles ; celles-ci sont déjà, en majeure partie, placées dans les cabines ; les plus grosses demeureront dans l’entrepont, en « prévoyance », ou descendront à la cale, où il sera possible de puiser chaque jour. En quelques instants, vérification des billets de passage ; location, au personnel du bateau, de la chaise longue ou du fauteuil obligatoire pour la traversée ; quelques présentations et tout est paré. Il ne reste plus qu’à regarder les adieux, autour de soi d’abord, sur les ponts : nos jeunes amis hindous sont présents, coquets, élégants de tenue, sous leurs sombreros gris ; l’un d’eux nous a apporté des fleurs. Une cloche sonne ; il est onze heures et demie ; les ponts se déblayent et, d’un même élan, tous les passagers se portent sur le bastingage de tribord, face au quai : c’est le dernier acte des adieux. Il est autrement émouvant qu’à la gare de Lyon ; cinq cents personnes, hommes, femmes et enfants, sont rangées en une triple haie et, saluent, de la main, du chapeau, du mouchoir. Les appels de tous prénoms s’entrecroisent ; une vieille femme s’est écroulée, à genoux, au pied d’une borne et sanglote. Son fils, un sous-officier, est auprès de moi et la contemple, la face farouche, le poing crispé sur la lisse. C’est à pleurer soi-même, avec l’énervement et la fatigue accumulés. Il est temps que le quai s’efface et que le Polynésien entre en haute mer, où la houle est insignifiante. On déjeune ou on visite le bateau ; il est un des bons échantillons actuellement en service sur cette ligne d’Indo-Chine, remaniée depuis peu ; certains types plus anciens, le Sydney par exemple, ont été affectés à la ligne d’Australie.
Dans toute la mesure de ses moyens, la Compagnie s’efforce de procurer à ses passagers plus de bien-être et de les transporter plus rapidement ; ses nouveaux navires, le Paul Lecat déjà en service et l’André Lebon encore en construction, y réussissent ou réussiront efficacement. Le Polynésien, bon marcheur, est suffisamment confortable. Je copie, pour la forme, dans les notes publiées par la Compagnie à son sujet, « qu’il mesure 155 mètres et file 14 nœuds ». Son pont inférieur et son spardeck sont spacieux. Quant aux emménagements, ils peuvent supporter la comparaison avec ceux des navires étrangers. Les cabines sont, pour la plupart, bien aérées ; les salles communes sont vastes. Ce solide navire fait encore honneur à la Compagnie des Messageries Maritimes comme un ancien serviteur à une vieille maison. Même appréciation sur un autre paquebot, le Cordillière, au cours d’un second voyage ; j’y ai retrouvé urbanité parfaite chez le commandant et le commissaire ; installation agréable et prévenances du personnel. Ce sont, avec la cuisine, universellement réputée, les raisons de subsister de notre navigation française.
« Les heures couleront… Ce sera un repos ».
Oui, à la condition que l’esprit ne continue pas de battre la chamade vers la France. À la condition plutôt qu’il conserve quelque occupation coutumière. Les habitudes sont terriblement fortes : au réveil, c’est la nostalgie du journal quotidien, le besoin de ses titres et sous-titres qui résument l’univers. Nous avons, nouveauté, la T.S.F. ; par Palerme, elle nous a transmis le compte rendu du Conseil des Ministres, de la rentrée des Chambres. L’emprunt, 140 millions, pour le Maroc. Et me voilà reparti pour Rabat, Fez, pour le bureau de la commission des Affaires Extérieures où les camarades rompent des lances… Est-ce un emprunt de liquidation militaire ? Se décide-t-on à modifier, à compléter le précédent ? J’aurais dit à la Chambre… Eh ! je suis sur le Polynésien ; je ne dirai rien et mieux vaudra peut-être, pour ne pas achever de me brouiller avec des amis marocains, impatients de mon franc-parler. Aussi bien, la T.S.F. est muette dès que Palerme s’est éloigné ; elle se borne à jeter sur ses ondes nos télégrammes personnels, jusqu’au poste terrestre le plus proche, d’où ils seront acheminés, par fil mais on ne peut en user qu’avec mesure, parce que les tarifs sont élevés. Nous ignorerons, maintenant, les évènements jusqu’à Djibouti ou Colombo ; notre journal n’a qu’un numéro ! Alors on se résigne et la crise du quotidien s’apaise, forcément…
Les heures ne coulent cependant pas et il faut, quand même, s’intéresser à n’importe quoi, mâchonner de vieux sujets d’articles ajournés ; en bâtir d’autres ; préparer des discours qui ne seront point prononcés. La machine cérébrale ne stoppe point, à volonté. Que le touriste de demain se le tienne pour dit.
D’autres passagers sont visiblement mieux partagés ; les femmes, d’abord, ont la ressource des ouvrages d’aiguille, du chemin de table qui n’est jamais terminé ; les officiers qui rejoignent leur poste n’ont que des soucis de carrière ; ingénieurs, commerçants, de même. Pour eux, l’existence du bord peut donc être ce repos promis ? Ils goûtent à la bonne franquette, selon l’heure, les distractions à leur portée. Essayons ; les voici :
Table ;
Conversation ;
Lecture ;
Danses et musique.
À table. – C’est là qu’on s’est compté, observé, critiqué, assemblé, dès le premier soir. Nous sommes cent vingt passagers de première classe ; nous n’apercevons les autres, ceux de seconde, que rarement, quand quelques-uns risquent une petite promenade jusque sur nos ponts, ou quand nous allons jusqu’à la proue, en dérangeant de malheureuses femmes pantelantes, sur des pliants, dans une atmosphère de feu et d’huile chaude, à deux pas de l’étable et des cages à poules.
Sur nos 120 reclus, il y a 40 officiers avec leurs familles, des tout petits au biberon qui ont déjà des airs étiolés. La traversée sera « bourgeoise », m’explique-t-on ; pas de fêtes, avec ces passagers militaires ; ils ont en général bonne façon, simple, française, mais le nombre des galons les égaille.
L’épreuve de ce premier dîner est celle-ci : « S’habillera-t-on ? » C’est de tradition ; on doit revêtir une robe plus ou moins riche, endosser un smoking, qui sera bientôt blanc (les Anglais portent un amusant petit veston, à queue pointue).
D’aucuns estiment que c’est une corvée ; en tout cas, elle absorbe une demi-heure et fournit l’occasion de boule verser des malles qui ont été composées sans expérience et qui renferment des effets, dits coloniaux, dont l’usage montrera les défauts : cols de sport trop chauds ; cravates de tissus trop épais, étouffantes… On bouscule, on remballe la garde-robe déjà froissée et on descend vers la salle à manger. Tout le Polynésien s’habille, à peu près. Et c’est un joli spectacle, avec les lumières, les fleurs, les mines compassées des gens qui cherchent contact, qui se tâtent…
Les places ont été réservées par dix, avec une longue table centrale, dès la montée à bord, au hasard, et elles seront conservées durant la traversée entière. Un échange de salière contre un seau de glace, et la connaissance est ébauchée. On sera presque des amis, pour vingt jours, peut-être encore plus tard ?… Les repas sont, d’ailleurs, vite servis, très abondants ; on choisit trois ou quatre plats. Les coloniaux qui ont avalé sur tous points du globe, des mixtures exotiques, font des descriptions malicieuses de ce qui attend les débutants. Ici, « les heures coulent » dans un grand brouhaha de vaisselles et de propos. Avec le thé de quatre heures et celui de neuf heures, on tue deux heures et demie sur vingt-quatre.
Sieste ou conversation ? – Si on dormait ? La sieste alourdit ; on cause donc et cela vaut ce que l’interlocuteur peut vous apprendre que vous ne sachiez. À cet égard, les officiers de marine, d’aimables jeunes enseignes, sont précieux ; ils disent leur amour du métier, leur fatigue récente, qu’ils ne regrettent pas, en des manœuvres surmenantes ; leur joie de voir le Parlement et l’opinion revenir à la Marine et la choyer ; ils disent, aussi, sans insister, la modicité de leur solde, la lenteur de l’avancement, l’encombrement des cadres. On sent, en eux, un regain d’espoir, si l’aide publique leur est intelligemment continuée.
Les officiers d’infanterie coloniale ont moins « d’allant », mais ils ne justifient à certains égards aucune des critiques qui ont été formulées trop souvent contre leur corps : ni jeux coûteux, ni absinthes répétées ; pour compagnes, des femmes d’aspect modeste, tenant leur rang ; mais on comprend, à entendre ces officiers de fortune, que leur sort est loin de les satisfaire : « Le corps souffre d’un défaut d’encouragement ; il est en l’air ; la répartition des garnisons à terre et aux colonies est mal faite ; les cadres subalternes n’existent plus que sur le papier ; les hommes sont éreintés ; ils rembarquent trop tôt et leur santé s’en ressent, comme celle des chefs, également surchargés de campagnes ». Ce ne sont pas des plaintes, à proprement dire ; l’esprit du corps reste bon ; il y aurait lieu de l’utiliser par une réforme complète, bienveillante. Il me semble que quelques-uns, consultés, ne sont pas hostiles à certaines dispositions, au moins, des projets parlementaires qui élargiraient la carrière, lèseraient peut-être des intérêts actuels, mais assureraient l’avenir ? En tout cas, il ne faudrait pas laisser notre infanterie coloniale affaiblie ainsi qu’elle est : son histoire plaide pour elle…
Voici, maintenant, dans le train-train des entretiens quotidiens, quelques-uns des sujets traités avec une uniformité désespérante…
PAGES ARRACHÉES D’UN LEXIQUE ANGLO-FRANÇAIS :
Le point : « Où sommes-nous ? Une carte marine est affichée sur le pont et un petit drapeau y indique la place du paquebot. Tant de milles parcourus ; tant encore jusqu’à Port-Saïd ou Djibouti… »
Que m’importe ? L’accalmie s’accomplit et je me laisse mener. Trois mois sont sacrifiés…
La nuit : « Avez-vous bien dormi ? Comme il faisait chaud dans les cabines ! Je dormirai dorénavant sur le pont… On a le droit de s’y installer en pyjama et robe de chambre, jusqu’à neuf heures du matin et à partir de neuf heures du soir… Je me relèverai pour voir le Stromboli, Messine, et le reste, où nous passerons de nuit… On fermera les hublots ce soir ; la mer fraîchit… »
Au demeurant, jusqu’à Port-Saïd, en cette saison, qui est la bonne, le thermomètre a marqué de 25 à 29° ; en mer Rouge, il a varié entre 29 et 33°, sous les tentes du pont. On n’en souffre pas trop.
La mer – C’est l’inquiétude, obsédante, À Paris, que de conseils ! Combien de remèdes, dont certains expérimentés, du reste, avec succès, Souvenirs angoissants des traversées de la Méditerranée, vers Alger. On la regarde, cette mer, avec des yeux d’amour et de crainte, presque de respect. Elle est d’abord un passe-temps, dont il semble qu’on ne se fatiguera pas ; des littératures mal digérées en font une amie ; de tous les instants ; elles la disent « variée à l’infini ». En effet, au début, les petites barques marseillaises, les balancelles siciliennes, plus rares, les cargos anglais, assez fréquents, trouent de la proue un bleu « admirable ». Accoudé à la lisse, on s’en délecte ; on voudrait enclore ces luisances métalliques sous les paupières inlassées, puis on le prend en dédain, ce bleu perpétuel ; il pèse sur vous ; il est trop bleu, trop lui-même ; il est, de plus, trop grand, jusqu’au ciel et on souhaite y distinguer une « variante », un objet quelconque. Des bandes de poissons volants, heureusement, deux ou trois fois jaillissent comme des flèches d’argent on signale des ébats de marsouins ; un ou deux cargos encore, – mais c’est si vite passé ! Et on la déteste presque, la grande amie des poètes. Que ne se fâche-t-elle, pour nous ramener à Elle ? Attendez… Le vent du Sud s’élève ; on boucle les cabines ; des franges blanches se montrent dans le lointain. C’est le « coup de chien » avec l’odeur fade des éthers, des potions chloroformées, iodées, etc., le raac sinistre des malades étendus sur leurs couchettes… La mer est redevenue la Traîtresse.
Le bridge. – « Faites-vous un bridge ? Je joue peu ; très mal ; pas longtemps. Pour vous être agréable ; sans gros enjeux ».
Escarmouches. Avant longtemps, on compte quatre ou cinq tables, occupées durant tout l’après-midi et la soirée. Quelle infériorité, pour un Français, de ne pouvoir faire un quatrième ! Honteusement je vais quérir un livre.
La lecture. – Il existe une bibliothèque de trois cents volumes, à bord ; on s’y abonne pour 3 francs ; elle n’est pas ridicule, ancestrale. Elle mêle le Bourget, le Loti à Huysmans et aux Goncourt, – sans comprendre, toutefois, des ouvrages sur les pays vers lesquels nous voguons.
Rien n’est plus amusant à observer que l’embarras de chacun, de nous-même, devant le choix à faire. Et c’est là qu’on juge ce que pèse, au vrai, le renom littéraire moderne. Pourquoi prendre celui-là plutôt que tel autre ? On voit des passagers compulsant le catalogue durant de longs moments ; ils ont l’air de déchiffrer une liste nécrologique qui leur vaut autant de découvertes qu’une visite au Père-Lachaise ; ils s’arrêtent à un nom, disparaissent et vont consulter quelqu’un, qui a fait, avant eux, l’épreuve de cette lecture. Une consultation de ce genre sur Henri de Régnier m’a rempli de gaîté, puis de confusion personnelle ; il fut mon collaborateur au Journal des Débats et je ne me souviens pas nettement de son œuvre, qui est, il est vrai, fort étendu… Vanité des Lettres ou des Journalistes ?…
Enfin, voici le bon livre choisi ; il va nous consoler de la monotonie de la mer ? Il est intéressant, certes ; l’adjectif y est net et précis ; la phrase claire… Pourquoi ce chef-d’œuvre me tombe-t-il des mains ? Les lignes imprimées dansent ; la folle du logis baguenaude tout autour, vers un groupe de gosses piaillards, vers une champignonnière de casques, groupés, tels de petits dômes de mosquées, autour d’une chaise longue. On flirte ? Humblement, je feuillette l’Illustrated London News, The Sphere et des Annuaires illustrés. Le repos n’est pas encore dans le chef-d’œuvre ! La danse. – Le salon de musique possède un piano ; tout de suite après le dîner (il est sept heures et demie) on l’essaie ; il est déclaré détestable ; je m’y attendais ; il répand sur le pont les sons grêles d’une valse cahotante ; des couples se forment et tournent, classiquement, mais l’un d’eux exécute soudain un plongeon en avant, puis un en arrière… Tango… Tango… Des Parisiens savent le tango et les variétés du boston… C’est à qui, dès lors, n’aura pas l’humiliation du provincialisme. Une dame minaude qu’à Vichy elle ne dansait que le tango et elle plonge en pingouin. Pourquoi Vichy ? Parce que, pour des coloniaux, Vichy est une nécessité, un rite et un luxe… Donc on tangue, à bord, avec des allégresses montmartroises, auxquelles répond de plus en plus mal la malingre sonorité du piano. Aussi, voici qu’un soir, un nasillement significatif me fait tressauter : un passager possède un phonographe et le met en marche. On l’entoure respectueusement ; il est le succès du bord ; il lance une polka cuivreuse où le piston assène des ta-ra-ta-ta décisifs. Des enragés tanguent, là-dessus.
Ô la mode ! je somnole et je me crois transporté à Joinville, au bal Convers… Ta-ra-ta-ta… Ou plutôt, je passe une soirée de 14 juillet au carrefour de la rue du Rocher : c’est la polka des écrasés, sauf l’appel des pieds sur l’asphalte et l’odeur des Parigots. Le tango, ici, chahute sans bruit et le paquebot fleure les sauces rousses d’après dîner. Ta-ra-ta-ta…
Cette persistance de relents de cuisine est une des plaies du bord, la principale ; les mets, plutôt agréables, bien préparés, sont noyés dans cette mixture bien connue des hôtels Palaces, de Moscou à Bombay, l’espagnole, qui dore, brunit, verdit, retape, glace les vieilles soles et les côtes de veau frigorifiées. La naissance du mal de mer est là… Au fait, à Paris, la cuisine souffle aussi des odeurs de pommes frites ? Mektoub, disent, en Algérie, mes amis arabes !…
Mektoub également, quand retentissent des roulades sur l’avant, du côté des secondes ou, plus près, dans notre salon de musique. Je retrouve la tradition coloniale ; nous transportons une forte chanteuse et une diseuse à voix ; elles se rendent en Indo-Chine, avec un fox-terrier qui, naturellement, joue à la balle. Et ces dames, naguère jolies, par des roulades entretiennent leur organe vocal, mais elles n’ont jamais (ceci est traditionnel aussi) les partitions qui leur conviennent. Alors, à défaut de concerts professionnels, des amateurs se dévouent ; ils ont de la bonne volonté. Je cherche avec curiosité ce qu’ils importent en Indo-Chine : ils ont, avec les tangos déjà nommés, la Blonde, le Cœur de Marguerite et tout le gratin montmartrois. Voudrais-je qu’ils eussent du Chopin ? Ce regret aurait bien terminé ces notes et je rêve d’un concert nocturne et littéraire où le contralto d’une passagère langoureuse lancerait à Sirius, qui brille si puissamment, des trilles enivrants. D’autres eurent cette chance ? Prosaïquement, avant qu’à onze heures le garçon de pont éteigne les lampes, ma fille est au piano et égrène ce qu’elle sait. J’y goûte un plaisir paternel et incompétent. Allah soit loué ! Mektoub.
Incontestablement, ils sont très beaux et très variés. C’est tout ce que, si j’étais raisonnable et que ne m’aveuglât point ma passion pour le papier noirci, c’est tout ce que j’en devrais noter. Mais comment résister ?… J’ai une réminiscence persistante : dans un déjà si vieil article de mon camarade Jacques de Biez, critique d’art d’avant-garde, figurait cette phrase dont la « sonorité picturale » m’a toujours plu : « Delacroix, ivre de pourpre et de sinople… » Je n’affirme pas avoir eu le temps d’apprendre ce qu’est le sinople, mais je suis certain qu’il y en a, avec de l’ivresse, de la pourpre, et combien d’admirables et inexprimables effets lumineux, dans les couchers de chaque soir ! Aucun ne se ressemble ; ils n’ont qu’un point commun, c’est qu’à leur sujet on réclame régulièrement « le rayon vert », et nous sommes las de chercher ce rayon, de longue date. À part lui, les dix minutes qu’on passe vers cinq heures, avec les coudes sur la lisse, la tête entre les mains, sont exquises. De la Méditerranée, rien à dire qui ne soit connu ; dans le Sud-Oranais, voire en France, dans le Pas-de-Calais, – eh oui, à Berck, pays de luminosité souveraine, à Berck-Plage, Septembre nous offre ce plouf du rond sanguinolent, dévoré, au bas, par la gueule d’un dragon invisible. Et, autour, s’enroulent des volutes de feu, s’accrochent des écharpes d’améthyste sur un fond rose. Sincèrement encore, c’est beau, mais non incomparable. Ce qui l’est, ici, et jusqu’au bout de l’Inde, c’est le très court laps qui précède le sommeil du ciel : à six heures, l’or pâle, l’or vert, l’or fin, l’or liquide remplace les fantasmagories volcaniques qui nous sont familières ; il est doux, reposant, presque rafraîchissant ; il souffle sur nos yeux et enveloppe délicatement nos visages qui m’apparaissent plus calmes. Je pense, sans trop de Lettres, ingénument, aux fonds dorés de tableaux anciens, avec des vierges aux têtes penchées, que j’ai vus au Louvre, ou en Hollande, ou ailleurs, – je ne sais plus.
Cet or-là est la paix du voyage.
Le Polynésien possède, comme tout paquebot, quelques Jaunes, Annamites, Chinois, Japonais. Ceux qui sont employés par la Compagnie aux basses besognes du bord, à la cuisine, sur l’avant, échappent à notre observation, mais nous en coudoyons qui sont au service des passagers. Ils sont partis d’Extrême-Orient et ils y retournent avec leurs maîtres ; ou ils se sont engagés, à Marseille, en échange du passage de domestique auquel ont droit certains fonctionnaires ou officiers. Telle une Chinoise, obèse, à la figure lisse et mafflue, qui ballotte, sur ses moignons sautillants, bancrochards, un torse énorme. Elle est de manières très calmes on lui a confié, à l’improviste, un bébé colonial, aux yeux cerclés de noir par la chaleur, qui pleurotte, sourit tristement. La Chinoise le veille avec soin, presque avec tendresse ; elle le tient dans ses bras, comme une nounou française, tandis que d’autres enfants sont promenés par d’autres Jaunes, des Annamites surtout, à califourchon sur la hanche.
Dans l’ensemble, ces Jaunes ont un aspect soumis, attentif à leurs besognes qui sont multiples ; on leur demande n’importe quoi, sans souci de leur sexe, qui demeure indécis ; on les appelle pour serrer les lacets d’un corset ou pour laver des linges intimes, car on ne lave pas, à bord, pendant la traversée ; un sac spécial, dans chaque cabine, enferme les dessous salis…
Je cherche, sans prétentions psychologiques, à lire quelque impression fugitive dans ces yeux obliques et ces bouches toujours ouvertes sur des dents noires, mais la paupière épaisse recouvre constamment le regard et l’ouverture des lèvres n’est ni un sourire, ni une colère.
Les Jaunes, quand ils n’ont rien à faire, demeurent immobiles, assis sur des malles auprès des cabines, ou groupés sur la plage d’arrière ; ils causent avec des petites voix qui imitent des cris d’oiselets ou des sonorités de vielles auvergnates ils farnientent, en apparence résignés… Cependant, ils m’inquiètent, quand la voix du maître, un officier, retentit comme à la manœuvre et lance une corvée désagréable ; ils se remettent alors au travail, en marche, d’une façon automatique qui, est peut-être une protestation, inaperçue de ceux qui ont l’accoutumance de cette race énigmatique pour moi et qui la traitent avec une brusquerie toujours surprenante.
« Ce ne sont pas des hommes ? » En est-on sûr ? Un petit fait m’a frappé : c’est aux bains qu’il s’est produit. Le bain doit être classé au premier plan des passe-temps du bord ; on a, dès Marseille, l’idée fixe de s’assurer un bain quotidien, à son heure. Luxe de traversée, ou des colonies. Pour y satisfaire, le Polynésien possède quatre cabines d’hommes et autant de dames ; du côté masculin, un poussah chinois est chargé de répondre à d’innombrables et instantes sollicitations ; à demi-nu, il court, ruisselant de sueur, dans l’atmosphère embuée des cabines et il offre à tout venant le mystère de sa face plate, coupée par un perpétuel rictus. Il est poli, indifférent, également obligeant.
Ce matin, c’était « mon heure », très tôt. J’interpelle le Chinois et je lui demande mon bain, avec une courte phrase, sur notre ton parisien ; il ne détourne pas la tête et disparaît dans la cabine ; c’est prêt… Je dis, presque machinalement, « merci ». Le boy a entendu et il me semble qu’il m’a souri. Je sors au moment où éclate une grosse voix de commandement : « Boy, mon bain. Et ne me brûle pas animal, comme hier ». Le Chinois me regarde à cet instant et je perçois nettement qu’il grommelle ; – quelque injure sans doute. – Sa face n’a pas pourtant bronché, mais il est furieux…
Conclure ? C’est difficile. J’en parle à des compagnons de voyage, mais d’une manière prudente, pour ne pas avoir de grands airs de naïf, d’idéologue, ou de réformateur, – d’après cet incident minuscule, – un Chinois qui vide les baignoires ! Personne n’est disposé à me comprendre, même à demi-mot. C’est ainsi : le Jaune, on le tutoie. Belle affaire ! C’est adéquat à ses mœurs et à son idiome, dit-on ; on le rudoie, on le gifle, on lui botte le bas des reins. Voudriez-vous prendre des gants avec lui ? Non, mais si humble, si fermé et inférieur qu’il soit, visiblement il ne nous aime pas. Et je regrette que nous n’y tendions point.





























