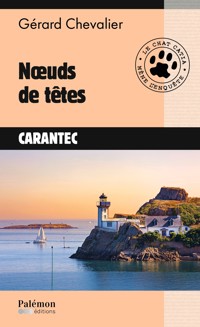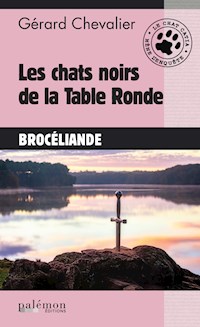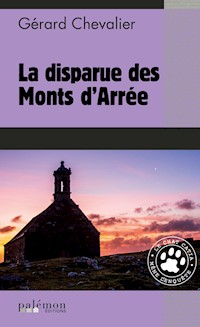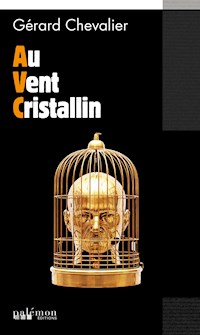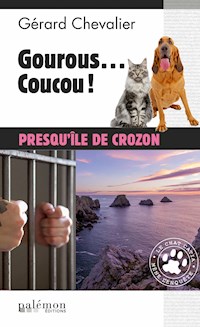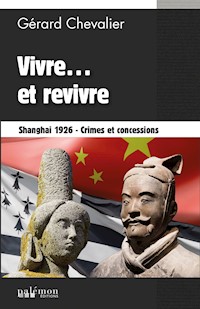Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Fils d’ouvrier… petit-fils d’ouvrier… bourgeois moi-même… Cette blague, qui pourrait être de Desproges, je veux bien me l’approprier pour caractériser mes mémoires, donc ma vie. Mon passage sur terre comporte suffisamment de moments amusants (quelques fois carrément cocasses aux côtés de mon ami Coluche) pour ne retenir que ceux-là et constituer un recueil d’anecdotes survenues dans ma vie privée ou professionnelle.
Issu de souche paysanne franc-comtoise d'un côté, héritier d’une lignée de bourgeois alsaciens de l'autre, je suis né le cul entre deux chaises ! Ce qui me donne la chance de considérer les événements de deux points de vue différents. Deux valeurs ont accompagné constamment mon parcours souvent désigné comme atypique : l’amour et la liberté. Devenu breton d’adoption, je m’efforce de perpétuer ces notions dans ce pays exceptionnel, qui me conforte dans mon nouveau métier d’écrivain…
À PROPOS DE L'AUTEUR
À la suite d’une longue carrière au cinéma et à la télévision commencée à 30 ans, Gérard Chevalier s’est lancé dans la littérature avec une affinité pour le genre policier et à suspense.
Après avoir tenu à la télévision des rôles populaires dans des séries Le 16 à Kerbriant, Les Gens de Mogador, Arsène Lupin, Vidocq, La Cloche Tibétaine et dans des téléfilms, il écrit et monte ses spectacles au café-théâtre puis de vraies pièces, comme Coup de pompe, dont il partage la distribution avec Annie Savarin et Bernard Carat.
Aujourd'hui, auteur de romans policiers et de thrillers, il s'est installé en Bretagne, sa terre d'inspiration inépuisable, terre qu'il affectionne tout particulièrement et à laquelle il rend un vibrant hommage à travers ses écrits.
Son premier ouvrage, "Ici finit la terre paru" en 2009, a été largement salué par la critique et a remporté de nombreux prix littéraires : le grand prix du roman Produit en Bretagne, le prix du livre insulaire à Ouessant et le 2e prix du Goéland Masqué. "L'ombre de la brume", paru en 2010, "la magie des nuages" en 2011, "Vague scélérate" en 2013, "Miaou, bordel!", "Ron-ron, ça tourne!", Plumes... Et emplumés" et "Carnage... en coloriage!" rencontrent également un véritable succès mettant une nouvelle fois la Bretagne à l'honneur.
Retrouvez Gérard Chevalier sur son site http://gerard-chevalier.com/
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
PREMIÈRE PARTIE
L’année 1937, année riche d’événements importants, le 5 mai à 8 h 25 arrive au monde : MOI ! C’est le jour anniversaire de la mort de Napoléon Ier et, forcément, il m’en est resté quelque chose ! Ce serait bien de savoir quoi…
Peut-être la mémoire (l’Empereur en possédait une phénoménale), car très vite, vers deux ans et demi, des images de mon quotidien se fixent quelque part dans ma tête et n’en sortiront plus. Comme ce petit garçon nommé Alex dans un jardin municipal de Saint-Cloud où je vis qui prononce le mot de Cambronne. Je l’utiliserai maintes fois au cours de mon existence, tel le bon Français que je suis. Ma mère est stupéfaite, et scandalisée, quand je le répète quelques heures plus tard. Je ne me souviens pas exactement de sa réprimande n’ayant gardé en mémoire que les moments drôles de ma vie, ceux que je m’efforce de raconter pour vous, chers lecteurs. À part certaines de mon entourage ou celles de personnages particulièrement réussies (celles de Jean Failler, Vauban par le colonel Pujol, Victor Hugo par Alain Decaux, Napoléon III par Raphaël Dargent) les biographies m’emm… copieusement. D’ailleurs, les maisons d’édition précisent bien aux auteurs qui veulent déposer un manuscrit : « Nous n’acceptons pas les biographies. »
Donc je vais vous confier uniquement ces anecdotes que je me repasse en esprit à volonté dans des moments inattendus, me suscitant des rires ou des sourires alors que parfois je suis en compagnie de gens qui se demandent quel en est le motif.
Les premières dignes d’être relatées se situent vers 1940. Je me promène dans le beau jardin de la maison que mon grand-père, Georges Meyer, l’aventurier journaliste de souche alsacienne a fait construire au Val d’Or, quartier de Saint-Cloud bourgade proche de Paris. J’ai dû y dormir car je suis en robe de chambre avec une compagne imaginaire que je nomme « ma fräulein » ! Il y a des bruits de bottes qui ne m’ont pas échappé, ce qui est normal vu les conversations autour de moi. Les adultes ne peuvent imaginer que ce petit garçon qui joue innocemment près d’eux enregistre tout ce qui se dit ! Les bruits de bottes se concrétisent puisque nous partons en exode pour fuir ceux qui les produisent. C’est le début pour moi d’une aventure extraordinaire.
Ma mère possède son permis de conduire depuis peu. Notre voiture est une 402 Peugeot dans laquelle je prends place avec ma Mémé-chérie, un tas de valises, et, évidemment, mon tigre en peluche qui me suit partout. Derrière, dans une autre voiture, des cousines dont une qui a au moins huit ans.
Quel spectacle ! Des gens avec des charrettes, des camions, des cyclistes, d’autres véhicules bien sûr et des soldats à pied ou motorisés. Un fouillis invraisemblable qui me ravit ! Ça crie, ça s’engueule, ça s’emmêle et surtout ça n’avance pas ! Ma mère est stoïque à son volant et moi je regarde, fasciné, ce spectacle insolite. Complètement stupide aussi, mais compréhensible à l’époque. Premier épisode sérieux : des avions de chasse italiens arrivent au-dessus de nous et les gens comprennent qu’il faut se mettre à l’abri. Ça tombe bien, nous traversons une forêt. La colonne de fuyards s’arrête et tout le monde court pour se dissimuler sous les arbres. Heureuse initiative car les avions font demi-tour et, en descendant à basse altitude, mitraillent tout ce qui se trouve sur la route. C’est alors que Mémé-chérie a envie de boire son café. C’est l’heure. Elle retourne à la voiture chercher son bol, de l’eau et le moulin pour broyer les grains (le moulin est sur mon bureau encore aujourd’hui). Les gens affolés lui crient : « Restez, madame, vous allez vous faire tuer ! » Sans même les regarder, elle leur répond : « J’ai déjà vécu la guerre 14, alors ce ne sont pas les “macaronis” qui vont me faire peur ! » Tranquillement, à découvert, elle récupère ses ustensiles et revient toute souriante. On lui fait de sévères reproches dont elle n’a cure, et moi je suis très fier ! Ma Mémé est indestructible. On reprend la route quelques minutes plus tard. Pas pour très longtemps. Un pont avant Vierzon vient d’être bombardé ! Il faut s’arrêter là. Mais là où ? Nous cherchons une ferme dans la campagne, et juste avant la nuit, de braves paysans nous accueillent en nous offrant leur grange pour dormir. Après un frugal repas, nous nous allongeons dans le foin fraîchement récolté. Mon rêve ! Qu’est-ce que c’est bien l’exode ! De plus, je m’endors dans les bras de la grande de huit ans ! Ah là là, les femmes ! Au réveil, comme on ne peut pas aller plus loin, on revient à Paris ! Pas tout le monde, si bien que les encombrements sont moindres. Les soldats, eux, descendent vers le sud. Les chefs ont fichu le camp bien avant, donc ils font pareil, ça leur évitera aussi de se battre contre les « Chleuhs ».
À peine rentrés dans notre appartement quai Carnot à Saint-Cloud (la grande maison de grand-père Meyer est inhabitée, allez savoir pourquoi), grand-mère chérie et moi – ma mère n’étant pas présente – recevons la visite surprise d’un officier de la Wehrmacht, tellement élégant que je le vois encore dans mes souvenirs. Grand, bien rasé, ses gants à la main, il salue ma grand-mère respectueusement en enlevant sa casquette. L’accueil est assez glacial de la part de la vieille dame. Mon grand-père Chevalier est mort en héros à la Première Guerre mondiale et elle a élevé péniblement ma mère et mon oncle. Les « boches », elle n’aime pas ! Mais l’envahisseur a reçu des ordres : il faut être poli avec la population française qui va devenir allemande dans les rêves du führer. Le commandant allemand donc se renseigne sur notre situation. Où est passé le journaliste qui écrivait il n’y a pas si longtemps des articles dans son journal sur Adolf le tueur ? Notre journal, c’est-à-dire L’Événement, créé dans sa jeunesse par Victor Hugo, qui l’a transmis à Émile Zola, lequel l’a donné à mon grand-père en lui recommandant d’en faire « quelque chose ». Mission accomplie, Géo – il s’appelle Georges, mais on l’a baptisé Géo pour le distinguer de son fils qui porte le même prénom –, en tire sa fortune entre les deux guerres. À Berlin, on a bien noté le ton libre et même parfois insolent du canard qui tire sans retenue dans ses articles sur le troisième Reich. Grand-mère chérie ne se laisse pas impressionner. Son gendre est à la guerre, quelque part on ne sait où, alors qu’elle sait pertinemment qu’il est prisonnier, comme beaucoup d’officiers de réserve. Elle fait quand même attention parce que mon père a laissé inconsidérément un pistolet dans son étui, caché dans le lustre en albâtre au-dessus de… la tête du Teuton ! Lequel, fatigué par cette bonne femme hostile, s’assoit, me prend sur ses genoux et entame une conversation en espérant que le garçonnet qui lui rappelle son fils sera plus aimable. Je réponds volontiers à ses questions jusqu’au moment où il a la malencontreuse idée de me demander de lui chanter une chanson. Et je lui balance La Marseillaise, obéissant probablement à un ordre télépathique de Mémé-chérie. Il accuse le coup. « C’est bien, tu es un bon Français », me déclare-t-il en se levant. Il part cette fois-ci en claquant les talons, mais sans faire le salut nazi. Il a dû réaliser que l’Occupation ne serait peut-être pas une partie de plaisir, malgré les cire-bottes de Vichy.
L’année 1943 fête mes six ans, date à laquelle ma mère et moi rejoignons mon père en zone dite libre (les troupes allemandes n’y sont pas encore), à Saint-Tropez. Il est dans ce village de la Côte d’Azur après sa première évasion en tant qu’officier de réserve. Je ne l’ai pas vu depuis plus de trois ans et nous ne nous connaissons pas bien. Mais à cet âge-là, les contacts sont faciles, surtout en famille.
Mon père, ce héros… c’est presque ça. Il a reçu l’ordre, je ne saurai jamais de qui (un officier des forces de la Résistance, c’est sûr), de récupérer une centaine de survivants du corps expéditionnaire d’Indochine, lequel s’est fait étriper par le maréchal Rommel en Cyrénaïque, l’actuelle Lybie. Ils étaient environ trois mille au départ, je crois, et se sont battus comme des lions à nos côtés sous les ordres du maréchal Koenig.
Or mon géniteur héberge clandestinement une femme malgache et ses deux petites filles, car elle a eu la mauvaise idée d’épouser un Italien, par définition notre ennemi à cette époque. Nous, les trois enfants, nous retrouvons d’un coup avec cent papas dans le parc du Latitude 43, demeure d’un milliardaire enfui aux États-Unis, parce que mon père a réquisitionné pour abriter ses soldats en déroute. Nous habitons au sommet du vaste bâtiment en forme de paquebot, au milieu de cette merveille de nature soigneusement entretenue.
Les Indochinois (on ne dit pas encore Vietnamiens) n’ont pas vu leurs enfants, pour ceux qui en ont, depuis quatre ans. Le fils du chef, moi en l’occurrence, et mes deux copines sont adoptés immédiatement par ces hommes en mal d’affection. Ils campent dans de grandes tentes et sont nourris, habillés, blanchis par ce Français débrouillard qui les a recueillis, et qui, de plus, les entretient dans une discipline militaire en leur faisant saluer le drapeau bleu-blanc-rouge tous les matins, ce qui nous ravit, nous les mômes. Très vite, nous les apprivoisons, surtout moi, et ils ne savent pas quoi faire… pour nous faire plaisir !
J’hérite d’une nounou sous la forme d’un jeune homme qui se nomme Dao. Petit, souriant, très courtois, mon père l’a choisi avec soin pour s’occuper de son fils.
Mes parents ont une vie mondaine agitée car ce lieu déjà célèbre pour le show-business sert de refuge à tous ceux qui n’acceptent pas de jouer la comédie pour les nazis. Et pas des moindres. Pierre Brasseur (mon idole future), Pierre Dac, Tino Rossi et Mireille Balin ainsi que d’autres sont invités à la maison. Ils sont même d’accord pour donner un spectacle au profit des Tropéziens à l’initiative de ce mécène du Latitude 43 qui les traite si bien. Mireille Balin, compagne de Tino Rossi, est une très jolie femme. C’est le coup de foudre entre nous pour des raisons différentes : j’aime (déjà) la beauté chez les femmes et elle me trouve amusant du haut de mes six ans. Si bien que j’ai droit à des bisous qui me remplissent de fierté. J’en aurai davantage plus tard en l’évoquant, de la fierté, et je ne l’ai, elle non plus, jamais oubliée. Pierre Dac fait beaucoup rire mon père, mais je n’ai, hélas, pas encore les moyens intellectuels d’apprécier ses blagues. Je me rattraperai bien sûr avec délice pendant des années. Dans ma bibliothèque trône un exemplaire de L’Os à moelle, sa fameuse revue, offerte par mon ami le professeur Chaussin. Une annonce loufoque me vient souvent à l’improviste : « À vendre dolmen, état neuf, cause double emploi. » De même le sketch avec Francis Blanche, dans lequel, déguisé en fakir, il délire, pas très à jeun, est un morceau d’anthologie comique. Pour moi, car je me pose des questions sur l’appréciation de l’humour par les jeunes générations aujourd’hui.
Pierre Brasseur me fait peur, surtout ce matin où, ayant forcé sur la divine bouteille, il apostrophe ma mère, une jolie femme elle aussi, sur le port de Saint-Tropez avec sa formidable voix légèrement éraillée. Nous nous enfuyons et j’entends encore sa phrase :
— Mais je ne vais pas vous manger, tous les deux !
Donc, quand il y a une réception avec ces célébrités, je me retrouve en compagnie de Dao, qui me fait dîner et me met en pyjama (tourné vers le mur car nous sommes tous les deux très pudiques). Il est attentif, étant donné le respect qu’il voue à mes parents, et il ne faudrait pas qu’il arrive un événement fâcheux à ce sale gosse que je suis. Mais si, je suis un sale gosse qui abuse de sa situation privilégiée ! Le pauvre Dao, je lui en fais voir de toutes les couleurs, et il mobilise toute son intelligence pour dominer la morgue de ce petit Blanc infernal. Malgré tout, je ne suis pas un monstre et je finis par percevoir son affection et son dévouement. En fin diplomate, il négocie ma mise au lit pour laquelle je suis réticent, évidemment. Comme il ne sait pas lire en français, il a une idée géniale ! Pour me faire rire, il imite… Hitler ! Je n’en crois pas mes yeux ni mes oreilles : c’est fabuleux ! Je me tords convulsivement dans mon lit tellement c’est drôle. Seulement il vient de se fabriquer son propre piège. Dorénavant, il devra exécuter son numéro tous les soirs ! Sinon pas dodo ! Je le revois quatre-vingts ans plus tard, avec une grande émotion attendrie. Que n’ai-je essayé de retrouver sa trace quand cela était encore possible…
Avec mes deux copines, qui attendent respectueusement tous les matins que leur macho en herbe s’éveille, nous sommes respectivement : blanc, en ce qui me concerne ; d’une belle peau brune pour elles héritée de leur mère malgache, cela le matin. Or, lâchés sans surveillance dans ce parc somptueux à l’intérieur duquel rien ne peut nous arriver de grave, nous jouons à différentes choses dont l’élaboration en cuisine du lapin à la sauce tomate. Les lapins, que les écologistes me pardonnent, ce sont des escargots, et la sauce tomate est fabriquée à base de brique pilée. Ajoutez un peu d’eau pour que ce soit onctueux, remuez énergiquement, servez sur des assiettes en carton, saupoudrez d’herbes, et faites semblant de déguster en émettant des « Que c’est bon ! » pour manifester votre satisfaction. Tout cela serait bien innocent si, pour des raisons inexplicables, vers dix-huit heures nos peaux sont entièrement rouges, à tous les trois ! Nos mères nous contemplent, hagardes, nous distinguant surtout par nos tailles, et avec répugnance nous ordonnent d’aller sous la douche sans nous toucher. Dao reçoit donc la charge de me rendre une apparence décente. Pour peu de temps puisque nous recommencerons souvent cette recette qui nous enchante, allez savoir pourquoi !
Ce jour-là, je suis seul, exceptionnellement. J’inspecte, à l’instar de mon père, les soldats sur le seuil de leur tente. Certains travaillent à l’entretien du parc, mais beaucoup d’entre eux sont inoccupés. Comme celui-là qui fume tranquillement sa pipe, assis par terre en tailleur. Il me salue, souriant, et se demande pourquoi je le fixe sans rien dire. Il va le savoir très vite. Je tends la main vers sa pipe.
— Donne-la-moi !
Le pauvre soldat est bien ennuyé, je suis le fils du chef.
— Non, ça pas bon pour toi !
— Allez ! Donne-la-moi !
— Non !
— Si !
Il regarde à droite, à gauche, et me la tend en disant :
— Toi fumer juste une fois !
Sitôt en sa possession, je tire une grande bouffée et m’enfuis avec. Le temps qu’il me rattrape, j’en ai aspiré deux autres. Il me l’enlève de force, très inquiet.
— Ça pas bien ! Pas gentil !
M’en fous ! Telle est ma réplique mentale. Je parcours quelques mètres, et tout à coup, cette saleté de planète se met à tourner sans me prévenir. Je me dépêche de rentrer chez moi, me demandant d’ailleurs si je vais y arriver ! Je dois être très pâle car ma mère s’affole en me voyant :
— Oh, mon Dieu ! Tu n’es pas bien ? Tu as mal ?
— Euh… J’ai mal au cœur…
— Allonge-toi tout de suite, je vais appeler le docteur. Dao ! Venez !
Ma nounou obéit, et par précaution, me met une cuvette sous le nez. Excellente initiative qui remplit son office sans tarder. Quand ma mère revient, il la lui montre avec cette précision :
— Ça sortir du ventre.
Le docteur, qui est voisin, m’ausculte rapidement, et visiblement demeure perplexe.
— Tout est normal. Rien de grave. Il a peut-être eu une petite insolation. Laissez-le se reposer.
Il s’en va, et je suis soulagé que personne n’ait soupçonné quoi que ce soit. C’est compter sans Dao qui, resté seul avec moi, s’approche, me renifle de très près, hoche la tête en souriant et sort de la pièce. Lui a compris. En effet, je dois puer le tabac, mais ma mère n’a rien senti et le praticien non plus. À partir de ce jour-là, une totale complicité s’installe entre nous, celle des vrais hommes qui ne trahissent pas leur frère, n’eut-il que six ans. Un beau dimanche matin, dans mon souvenir le temps était toujours superbe sur la Côte d’Azur, Dao annonce à mes parents la visite inopinée d’un monsieur. Et quel monsieur. Mes parents très impressionnés voient apparaître… Charles Vanel, le grand acteur, seul de sa profession à être resté célèbre au temps du cinéma muet comme de celui du parlant. Charles est un homme pragmatique et sage, je le découvrirai bien plus tard. Il cache chez lui, une maison voisine, deux petites nièces juives. Et il a besoin de ce lait, introuvable à Saint-Tropez, pour elles. Donc sans s’énerver ni tricher pour avoir des tickets de rationnement supplémentaires, il achète une vache ! Qu’il trait tous les jours matin et soir ! Pratique, non ? Mais la brave bête, sans être une championne, donne environ dix litres de son précieux liquide. Beaucoup trop pour les besoins des petites filles. Alors il vient proposer le surplus de sa production pour les enfants qu’il doit entendre rire de chez lui, et surtout pour les soldats. Mes parents n’en reviennent pas de la simplicité, de la gentillesse de cet homme connu du monde entier. Très discret, car je ne le verrai pas reparaître dans les soirées prestigieuses offertes par mes parents.
Il y a sur le port de Saint-Tropez un bistrot où l’on prend régulièrement l’apéritif. Je dis « on » parce qu’on m’y emmène souvent boire un jus de fruits, servi évidemment à côté du pastis traditionnel. Le bistrot se nomme Sénéquier et reçoit les quelques pêcheurs locaux, avec bien sûr des habitués, dont mon père qui ne boude pas l’alcool, sans en abuser trop fréquemment. C’est un épicurien, à l’abord sympathique. Il discute volontiers avec tous ceux qui le veulent bien. Ce midi-là, il y a eu une distribution généreuse de la fameuse boisson anisée. S’engage un dialogue animé avec un des pêcheurs que mes parents taquinent selon leur habitude. Surtout ma mère qui, ce jour-là, est particulièrement en forme.
— Vous n’allez pas me faire croire que votre métier de pêcheur est si dur que ça, avec le climat ici !
— Ah, ben té, je voudrais bien vous y voir, vous !
— Moi, je trempe mon fil dans l’eau, et hop ! J’ai un poisson.
L’interpellé ne le prend pas bien.
— Arrêtez avec vos galéjades ! Mon bateau est devant, vous voulez essayer ?
— Allez, on y va ! dit ma mère, très provocatrice.
Le pêcheur ricane, mais ne perd pas le sens des affaires.
— D’accord ! On parie quoi si vous ne prenez rien ?
— Une caisse de bon vin, avance mon père en riant.
— Tenu ! On reste une heure en mer.
Et les voilà partis, sans moi, resté à la garde de la patronne du bistrot. Évidemment le pêcheur prépare la canne de sa taquineuse qui continue à l’asticoter.
— Voilà ! Montrez-moi votre savoir-faire, ma petite dame. Elle lance maladroitement sa ligne, provoquant immédiatement l’ironie.
— Ah, on voit bien que vous vous y connaissez, pardi !
Le bouchon ne reste pas vingt secondes en surface qu’il disparaît. Elle tire, toujours avec maladresse, mais avec effort : en effet un gros loup (un bar en Bretagne) est accroché, qu’elle remonte difficilement dans le pointu, nom du bateau sur la Côte.
— Et voilà ! fait-elle sans modestie. Ce n’est pas difficile !
Le pauvre homme ne sait plus quoi dire.
— Ah, ben ça alors… Ça alors… Boudiou… Pas possible, ça…
La suite de l’expédition a été forcément bien arrosée, mais le pauvre pêcheur a rabâché sa mésaventure pendant longtemps, d’une manière moins drôle que ma mère qui, bien des années plus tard, s’en régalait encore.
Je découvre la mer en allant à la plage pour la première fois. Rien n’est aménagé et elle est peu fréquentée. J’ignore le nom de cet endroit, mais d’après ce que j’ai constaté trente ans après, et ce que j’ai aperçu à la télévision souvent, tout a été bouleversé. Parmi le peu de monde se trouvent des relations, des voisins. Toute la population ou presque connaît mes parents. Profitant de la présence de gens cordiaux, ils vont se baigner, laissant leur progéniture discuter avec eux. Il a la langue bien pendue, selon l’expression populaire, le gamin. Comme ils se renseignent sur mon emploi du temps surchargé, inspiré par une entité malveillante, je leur relate que nous avons reçu une malle… magique !
— Ah bon ? Qu’y avait-il dedans ?
Sans hésiter, je leur en décris le contenu : des poules, des lapins (morts bien sûr), du beurre, de l’huile, des gâteaux, que sais-je encore. Ils m’écoutent, un peu hallucinés en ces temps de vache très maigre. Lorsque mes parents reviennent de leur baignade, madame Moyé (ou Moyi, excusez-moi, je peux avoir des trous de mémoire des décennies après) fait un grand sourire diplomatique à ces veinards.
— Votre petit garçon nous a raconté ce qui vous arrive ! C’est vraiment agréable.
— Oui ? dit ma mère. Qu’a-t-il dit ?
La dame jette un coup d’œil alentour pour s’assurer que personne n’écoute, et malgré tout baisse la voix.
— Eh bien, la malle…
— La malle ?
— Oui, avec toutes ces victuailles dedans ! Des poulets, des lapins, du beurre, des gâteaux…
Et elle ajoute gentiment :
— Vous auriez pu nous inviter.
— Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Nous n’avons reçu aucune malle contenant tout ça ! Il a tout inventé.
Le ton change brutalement.
— Je ne le crois pas, voyez-vous. Un petit garçon de cet âge-là ne peut pas inventer un tel événement. Surtout en ce moment. Et les Moyé ou Moyi s’en vont, furieux. Mes parents me regardent, médusés. Eh oui, ce n’est qu’un début ! Faudra vous y faire, c’est comme ça… Quand même, les Moyé ou Moyi étaient vraiment naïfs !
Un beau matin, si, les matins sont beaux quand on a six ans et qu’on vous aime, un beau matin donc, papa et maman ont décidé de visiter la région avec leur rejeton. On prend le car Citroën, fameux engin qui dessert pratiquement toutes les régions de France en ce temps-là, parce que nous n’avons pas de voiture. Le trajet ne dure pas longtemps. Une demi-heure environ. L’engin nous dépose en pleine campagne provençale, celle de Marcel Pagnol, que j’ai adorée avant sa destruction par le tourisme et l’urbanisme débridés. Il fait très chaud et nous marchons sous un soleil satisfait de nous canarder. Mon père, je l’ai déjà dit, est un épicurien, amateur de bonne cuisine et de bons vins. Il m’a au moins légué ce qui fait encore notre réputation à l’étranger (pour combien de temps ?). D’excellente humeur et devant la fatigue de ses troupes, il commence la description d’un fantasme destiné à nous faire supporter l’épreuve et nous donner du courage.
— Alors, dans peu de temps, on va arriver dans un village superbe. Il y aura une place avec un grand arbre, sous lequel un restaurant est installé. Et tenez-vous bien : sur le pas de la porte, il y aura le patron avec une trogne rouge, la toque blanche sur la tête, qui nous servira à boire bien sûr, et surtout un bon gueuleton !
Le public applaudit, enthousiaste, mais tout de même un peu dubitatif. Encore deux kilomètres et nous entrons dans un village. Au détour d’une rue en pente, nous nous arrêtons, stupéfaits : un grand olivier sur une place abrite en effet un restaurant avec tables et chaises dehors. En nous approchant, la prophétie se concrétise. Le chef est bien là sur le seuil de l’auberge avec une belle trogne rouge et sa toque sur la tête ! Il nous accueille chaleureusement, et le repas sera à la hauteur de nos espérances !
Je précise que mon père n’avait jamais mis les pieds à… Ramatuelle !
Nous sommes revenus péniblement, et heureusement en car. Je ne pense pas qu’un contrôle d’alcoolémie du futur eût été négatif. À part sur ma personne. Rassurez-vous, je me suis rattrapé par la suite.
Noël arrive, attendu avec impatience surtout par les enfants. Enfin ceux qui, comme moi, croient au père Noël. Remarquez bien que j’y crois toujours. Avec plus d’objectivité, vous comprendrez plus tard en lisant des anecdotes particulières que j’ai vécues. Comme prévu, le père Noël est généreux avec moi. J’ai préparé la veille au soir mes souliers devant le grand sapin richement décoré, et en me précipitant au réveil, je constate que le miracle s’est réalisé.
Deux ou trois semaines après, mes parents m’avertissent qu’une fête se produit encore pour les enfants. Ah bon ? Oui, mais pas chez nous.
À Saint-Tropez, il y a une salle de cinéma dotée d’une estrade importante. Comme beaucoup d’autres établissements, car à l’époque, il y a des attractions à l’entracte. Des prestidigitateurs, des numéros d’artistes divers, dont des exercices de force que mon père apprécie beaucoup. Cette soirée-là, la municipalité, de connivence avec mon paternel, a organisé un spectacle.
Nous ne savons rien excepté l’annonce d’une fête spéciale. Nous pénétrons, les « petiots » locaux et moi, dans la salle, exprimant un état d’excitation extrême. Lorsque le rideau s’ouvre, le silence s’établit surtout par notre stupéfaction : un décor inconnu a été construit, fait de lampions rouges, de toits découpés et peints dont les angles sont recourbés, et des masques très colorés aux yeux bridés sont accrochés sur des branches de sapin. Les lumières bien réglées accentuent une atmosphère étrange. À peine avons-nous eu le temps de détailler l’ensemble qu’un coup de gong explose et un monstre de papier multicolore bondit sur la scène ouvrant une gueule béante. Il a au moins six paires de jambes telle une chenille énorme. Nous sommes tellement étonnés que nous ne retenons pas le fait de voir des jambes humaines. Le dragon, car il s’agit bien de cela, saute, se tortille, ouvre et ferme sa gueule au son des coups de gong (des cymbales dans les coulisses) et rugit avec férocité. Ensuite, des hommes apparaissent qui font des gestes bizarres. Ils sont vêtus de costumes brillants, superbement faits, et miment des bagarres, quelques acrobaties bien synchrones, et même des danses. Mais là, au milieu, qu’est-ce que je vois… Dao, ma nounou ! Et les autres alors ? Mais oui, ce sont nos Indochinois ! La surprise ne s’arrête pas là. Leur spectacle achevé, ils descendent de scène et nous offrent des cadeaux ! Dans des boîtes en carton toujours décorées, il y a des animaux faits de toutes sortes de matériaux : des oiseaux avec des pommes de pin, des voitures découpées dans des boîtes de conserve, des poupées dont la tête en bois est sculptée ; tout est beau, adroitement bricolé. Ces hommes qui n’ont rien nous donnent ce qu’ils ont de plus précieux : leur cœur. Mon père me dira qu’ils ont tenu à célébrer leur fête traditionnelle dite du Têt, spécialement pour ces petits Français qui leur rappellent leurs enfants, absents de leur vie depuis quatre ans. Je ne me souviens plus si je l’ai eu à cette occasion, mais j’ai près de mon bureau la poignée du sabre que Dao m’avait fabriqué dans un morceau de caisse en sapin, fièrement exposée sur un présentoir. Forcément, en combattant avec, j’ai cassé cette arme. Elle me sert aujourd’hui à combattre l’oubli.
Toute chose a une fin, surtout quand elle est heureuse car on ne voit pas le temps passer.
Nous quittons Saint-Tropez pour aller à Sainte-Maxime d’abord, Saint-Raphaël ensuite. Les adieux avec mes copines italo-malgaches sont bien sûr déchirants. Notre ménage à trois n’aura duré que six mois.
À Saint-Raphaël, c’est grandeur et décadence : nous vivons en appartement ! Quelle horreur. Cela ne m’arrivera que douze ans dans ma vie, douze ans de trop par rapport à mon goût d’indépendance, de liberté. Mes parents ont décidé de m’apprendre à lire, n’étant pas scolarisé. Ils repèrent je ne sais comment deux vieilles demoiselles, nommées Buisson, enseignantes à la retraite. En compagnie de quelques mômes inconnus, elles s’évertuent à nous faire déchiffrer la langue française. C’est pour moi une corvée ennuyeuse. Je ne m’intéresse pas du tout à leur pédagogie. Enfin, pas vraiment. Au bout de deux semaines, il y a une entrevue pénible en ma présence avec ma mère et mes institutrices. Le bilan tombe comme une guillotine : je compte les mouches en regardant par la fenêtre ! Il est question de petits garçons incultes qui finissent très mal leur existence. Je ne sais quels arguments ont été employés, mais je suis, il faut bien l’admettre, mortifié.
Inconsidérément, à quelques jours de là, mes parents sortent en ville en me laissant tout seul. Par malheur, je me réveille, et constatant leur absence, je suis pris de panique. J’enfile mes habits par-dessus mon pyjama, me coiffe d’un passe-montagne, allez savoir pourquoi, peut-être parce que nous sommes en hiver et qu’il ne faut pas prendre froid comme le répète inlassablement ma mère couveuse, et me voilà dans la rue. À quelques mètres se situe un bistrot dont, le cœur battant la chamade, je pousse la porte. Deux consommateurs se retournent, m’aperçoivent, et l’un des deux s’écrie :
— Oh, regarde, le petit mendigot !
C’est pire qu’une insulte ! Je m’enfuis, me sentant laminé socialement, moi qui régnais sur une armée dans un parc somptueux ! Je remonte en catastrophe dans l’appartement dont miraculeusement la porte ne s’est pas verrouillée. Je me déshabille, me mets au lit et empoigne ce petit livre de géographie si bien illustré que les demoiselles Buisson s’efforcent de me faire comprendre. Mes parents reviennent (ils ont dû prendre un verre avec des amis) et tout de suite s’aperçoivent que j’ai fait une bêtise : le volet de la cheminée est baissé et le feu ronfle dangereusement. Et puis j’ai laissé mes vêtements en désordre. Affolés, ils me demandent ce qui s’est passé. En guise de réponse, fin diplomate, je me mets à lire sans hésiter mon bouquin, ce qui évacue pour quelques instants un règlement de comptes, tant leur surprise est grande. Eh oui, j’ai assimilé l’enseignement des vieilles dames, sans le leur dire, et commence pour moi ce qui va conditionner toute ma vie : la lecture ! Et bien plus tard l’écriture.
Un événement curieux se produit. Les ennemis arrivent en zone libre. À savoir les Allemands en premier dont j’admire, ce matin-là en me promenant, une batterie de DCA qu’ils terminent de monter. Je suis fasciné par l’allure de ce canon antiaérien rutilant. Ma mère beaucoup moins, surtout que les soldats la reluquent ouvertement. Nous déguerpissons sous des quolibets incompréhensibles.
Seconde apparition, les « bersagliers », troupe d’élite italienne qui a deux particularités : ils circulent à vélo, avec même des musiciens qui soufflent dans leurs cors de chasse ou leurs trompettes, et ils portent de drôles de chapeaux avec des plumes de coq foncées. Ça ne fait pas sérieux du tout ! Contrairement aux Allemands toujours impeccables, ils sont mal rasés et leur alignement est anarchique. Rapidement, les Provençaux les tournent en ridicule, ce qu’ils n’oseraient pas faire avec les Teutons ; on ne joue pas avec le feu. Si bien qu’au cours d’une promenade suivante nous tombons sur un large mur crépi en blanc sur lequel un facétieux a écrit en grandes lettres noires :
VOUS ÊTES VENUS EN CONQUÉRANTS LA PLUME AU VENT, VOUS REPARTIREZ VAINCUS LA PLUME DANS LE CUL !
Je crois que le message a été transmis à toute la région !
De Saint-Raphaël, mon résistant de père nous emmène à Draguignan, pour intégrer les maquisards locaux afin de remplir je ne sais quelle mission. Officiellement, monsieur l’avocat du barreau de Paris est… bûcheron. C’est plus pratique pour saboter des lignes de chemin de fer ou des routes, de préférence la nuit. Mais pour moi, le cauchemar continue : je suis encore en appartement ! Je lorgne avec envie par la fenêtre de ma chambre un beau jardin où une grand-mère joue au Nain jaune1 avec son petit-fils. Ils n’arrêtent pas de s’accuser mutuellement de tricher, ce qui me met en joie. Rien que leur accent est déjà réjouissant.
Un grondement puissant nous précipite ce jour-là à une autre fenêtre, donnant sur la rue. Ébahi, je vois passer un char, un blindé, suivi des bersagliers, ce qui est en soi surprenant comme mélange. Forcément, le convoi roule doucement.
Deux minutes plus tard, même apparition, je suis impressionné par ces engins qui me semblent monstrueux.
Et ça continue ! Tout à coup, un éclat de rire se répand d’une maison à l’autre. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu’à l’explication donnée par mon père. Il me montre une tache blanche sur le char, me disant : « Regarde bien. » Oui, et alors ? Alors la tache réapparaît sur le suivant ! Un plaisantin, se doutant de quelque chose, a lancé un petit sac de farine sur le blindé, et… c’est le même qui tourne depuis une heure, voulant faire croire à la présence d’une division ! Les Italiens sont définitivement discrédités, opinion encore renforcée le dimanche d’après. Un officier en grande tenue se rend dans la meilleure pâtisserie de Draguignan où il achète plusieurs gâteaux à la crème. On respecte quand même ce personnage bardé de médailles, et très élégant. Hélas, en sortant, sur le seuil de la boutique, il se tord le pied et s’écroule lamentablement, les gâteaux maculant son bel uniforme. C’est un fou rire inextinguible qui fait le tour de la bourgade instantanément, surtout que l’officier horriblement vexé a abandonné sans un mot la bouillie de ses friandises par terre !
Un soir, avec des airs de conspirateurs, mes géniteurs m’avertissent que je vais découvrir une chose extraordinaire. « C’est quoi, dis ? » « Tu verras bien ! »
Nous partons à pied, bien sûr, et deux minutes après on entre dans la vaste cour d’un bâtiment. Des chaises sont alignées devant un grand drap blanc, très tendu. Comme je suis encore petit, nous nous installons au premier rang pour que je puisse bien voir. Que va-t-il se passer ? Je n’en ai aucune idée. Les lumières de la cour s’éteignent alors que le drap, lui, s’illumine. Des images apparaissent avec des lettres que maintenant je sais lire. Des noms d’abord : Louis Jouvet, Harry Baur, Charles Dullin, Jacqueline Delubac, Fernand Ledoux… Le titre… je ne le mémorise pas, pas plus que les noms, mais j’assiste à ce qui va devenir mon métier : un film de cinéma ! Et quel film ! Un chef-d’œuvre qui ne se démodera jamais. Comment ? Mais si, c’est mon avis, et je le partage ! Quel choc ! Nous sortons, je sors de la cour la tête dans les étoiles… et suis brutalement attrapé par mon père. Un bruit de bottes caractéristique martèle la rue pavée, une cinquantaine de mètres plus loin. Une patrouille allemande ! Nous sommes dehors alors que le couvre-feu est établi vers vingt et une heures. On se réfugie dans une encoignure de portail, et par précaution, on me met une main sur la bouche. Qu’est-ce qu’ils croient, mes vieux ? Que je vais encore chanter La Marseillaise ? J’ai bien réalisé ce qui se passe, et moi aussi j’ai peur. Mais le danger s’éloigne et nous rentrons, riches d’émotions diverses. Le film restera (est toujours) dans ma tête. Je le retrouverai par hasard au petit cinéma des Champs-Élysées dix ou onze ans plus tard : Volpone, des metteurs en scène Maurice Tourneur et Jacques de Baroncelli, sorti en 1941.
En attendant, c’est la disette. Plus grand-chose à manger dans les magasins. Les tickets de rationnement font rage, même au marché noir. Maître Georget-bûcheron rapporte rarement un lapin de garenne à la maison. Aussi, ce soir-là, il affiche un sourire de triomphe en posant sur la table un gros paquet enrobé d’un torchon. Tra-la-la, tsoin-tsoin : il enlève le torchon et apparaît un jambon cru entier ! Mais dessus grouillent des asticots ! Ma mère hurle d’horreur et affirme que jamais son fils ni elle ne mangeront cette cochonnerie.
L’avocat hurle, lui aussi, sa plaidoirie consistant à démontrer qu’une fois bien bouillie la chose extrêmement rare sera parfaitement comestible. Dont acte. Cela se terminera par un dîner avec des amis affamés qui confirmeront le verdict. On en donnera même une tranche au petit.
Mais le ténor du barreau a commis une grosse erreur. Nous habitons un appartement dans lequel est décédée une femme atteinte de tuberculose. Elle a laissé traîner des bacilles de Koch qui contaminent le petit plus dramatiquement que les asticots. Les effets se font sentir bientôt et il faut rentrer en urgence en zone occupée où des spécialistes chevronnés vont examiner mon cas. Mémé-chérie est à la fois heureuse de revoir son « Numéro 1 », c’est ainsi qu’elle m’a baptisé, et affolée de son état. Un grand professeur annonce doctement que j’ai une « primo-infection », terme élégant pour désigner une légère atteinte de tuberculose, une sorte de vaccin si vous préférez. Son remède : un an au lit sans effort, avec comme médicament des sulfamides ! Faut faire avec, Alexander Fleming n’a pas encore inventé la pénicilline. Même aujourd’hui, il faut plusieurs antibiotiques à prendre en même temps à la suite d’un antibiogramme comme traitement pour cette maladie. Ce n’est pas une partie de rigolade… Pour moi, si ! Mon lit se situe dans une vieille maison de la Brie, dans un village d’une centaine d’habitants : Montbrieux. Mes parents la louent depuis ma naissance comme demeure de vacances ; ils y viennent pour goûter avant l’heure les charmes du week-end sans embouteillage. Nous sommes à soixante-cinq kilomètres de Saint-Cloud, une broutille pour la 11 Traction Citroën qui précède la 402 Peugeot. Laquelle vient d’être vendue. Le besoin d’argent doit se faire sentir. Si bien que pour aller à Paris, nous sommes tributaires d’un horrible bonhomme, le boucher du village, qui nous emmène à la gare en carriole bâchée, en tapant sur sa mule squelettique. « Fffutt, fffutt, saleté ! » J’entends encore son sifflement haineux contre sa pauvre bête.
Cette vieille maison est devenue la résidence principale de Mémé-chérie et la nôtre jusqu’à la fin de la guerre. Je les adore toutes les deux, bien que différemment. La vue est magnifique sur la vallée du Grand Morin, rivière pas encore polluée. Nous dominons le village de Guérard, plus peuplé et pourvu de commerçants. Mais pour le moment, ma résidence principale est : mon lit ! J’y pratique deux activités débordantes : la peinture à l’aquarelle d’abord, à la gouache ensuite. « On » découvre que j’ai du talent, le sens des couleurs et une certaine habileté pour dessiner. Je finirai par le croire et déciderai d’être artiste-peintre, activité que j’exercerai jusqu’à vingt-cinq ans.
Ensuite la lecture ! Mon père, même de loin, dirige le choix de mes livres. Je commence par la bibliothèque verte. Fabuleux ! Croc-Blanc de James-Oliver Curwood ; Le Fils du loup de Kazan ; L’Appel de la forêt de Jack London… Je m’évade merveilleusement, mon plumard n’existe plus.
Il y a bien des intermèdes pour manger toujours la même chose, car j’ai de « l’acétone » et beaucoup d’aliments me rendent malade, comme si ça ne suffisait pas. Il faut dormir aussi, avec au réveil le bruit extraordinaire des ronds de la grosse cuisinière noire bardée d’acier que Mémé-chérie remet en place après avoir démarré le feu. Et hop, mon livre ! Voilà Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas ; L’Ami Fritz avec le duo Erckmann-Chatrian (des pays) ; Ouapousk, roi du pôle d’Albert Verse (complètement oublié) et tellement d’autres. Je suis insatiable. Ah, si, j’allais oublier aussi un ouvrage qui m’a beaucoup marqué : Un bon petit diable de la comtesse de Ségur (née Rostopchine). Cette histoire m’émoustille à plusieurs titres. Le diable m’évoque littérairement des sensations beaucoup plus attirantes que le bon Dieu. Sur le plan de ma sensualité presque inexistante, il y a des passages que je ressens comme coquins, en tout cas suggestifs. Bref, mon imagination est excitée. Sur le plan créatif, je me lance dans un roman de… quatre pages, illustrées, s’il vous plaît. Je l’ai conservé très longtemps. D’ailleurs il est peut-être dissimulé dans le vaste foutoir de mon bureau. L’image du diable occupe toute une page, dessinée au crayon de couleur, et suivra une collection de masques à son effigie sur des feuilles cartonnées, découpés et adaptés sur mon visage avec un élastique.
Surgissent tout à coup des albums magiques : Les Aventures de Mickey illustrées et contées par un certain Walt Disney. C’est notre vieille voisine, tante Sine (diminutif d’Alphonsine), qui me les apporte. Elle vit en face de chez nous, vient nous rendre visite régulièrement, et se prend d’affection pour cette espèce de gamin dont le genre est inconnu dans sa propre famille. Bavard, sachant tout sur tout, n’acceptant pas qu’on le contredise, et ayant toujours le dernier mot. Les albums de tante Sine ont déjà quelques années, mais elle les a conservés précieusement. Je découvre également Félix le chat ! Personnage féerique qui me laissera peut-être une trace indélébile inconsciente, préfigurant les enquêtes de Catia, personnage de ma série humoristique soixante-quinze ans dans le futur.
Bref, je suis overbooké. L’hiver 1943 est froid, très froid. M’en fous… Miracle ! J’aperçois par la fenêtre des flocons de neige voltigeant devant les carreaux ! C’est la première fois que je vois de la vraie neige. Je l’ai bien distinguée dans Mickey détective, mais là, c’est tout autre chose. Que faire sinon me désespérer car il n’est pas question de sortir. Heureusement « on » m’aime, et ma mère m’apporte toute fière d’elle-même une cuvette remplie de cette matière incroyable. Je pétris la neige, incrédule de sa consistance, fasciné aussi par le paysage qui revêt un manteau blanc immaculé, là-bas, derrière les vitres. Quel spectacle ! Forcément, c’est l’époque, puisque Noël se pointe encore. Noël au lit, c’est pas terrible. Faut faire avec. Mes deux protectrices rivalisent d’imagination. Je sens que le père Noël va les suivre. Dans ma chambre au premier étage, la cheminée flambe du matin au soir. On dispose devant les braises mes chaussons. J’ai vaguement émis des désirs sur une lettre que j’ai envoyée au bonhomme deux semaines auparavant, mais allez savoir, en période de guerre, hein ? Le sommeil tarde à venir. Et si tout allait de travers…
J’ouvre les yeux… D’un bond, je sors du lit, ce n’est pas possible ! Je n’ai rien entendu !
Un sapin énorme avec des lampions allumés, des boules de verre, du coton pour la neige, des paquets multicolores tout autour… Quelle émotion ! Il s’est dépassé le père Noël ! Quel brave homme ! La journée sera belle pour tout le monde, bien que n’ayant pas droit à la bûche, ou si peu, je me farcirai l’éternelle pomme râpée, en forme de cœur quand même.
Avant l’arrivée du printemps, mon état s’est nettement amélioré. Le carcan se desserre et je suis autorisé à descendre dans la cuisine, toujours bien chauffée par cette merveille noire, énorme, aux multiples portes, dont la surface dûment astiquée brille constamment. Sur le côté il y a le « bain-marie », espace destiné à conserver les aliments ou la cafetière à bonne température pour une durée indéterminée. Le café, c’est pratiquement toute la journée, surtout en hiver. Il est moulu, parfois par mes soins, mélangé avec de la chicorée et filtré par un tissu au-dessus de la cafetière. Dans la grande pièce, la mesquinerie du mot « kitchenette » est encore inconnue, trône sur une étagère une radio « superhétérodyne », LE sommet en termes de qualité sonore. Elle possède un « œil » vert magique qui permet de régler parfaitement la fréquence en devenant uniformément vert quand on est pile dessus. Je m’amuse beaucoup en tournant le bouton adéquat. Nous écoutons des émissions destinées à un large public. Par exemple Les Douze Travaux d’Hercule sont un chef-d’œuvre radiophonique qui m’emporte dans le rêve de la mythologie. Il y a aussi une émission de variétés qui se nomme Pêle-mêle Cadoricin présentée par Jean-Jacques Vital, dont sa fille deviendra mon amie des décennies plus tard. Un soir, nous restons « scotchés » en écoutant un jeune chanteur à la voix très particulière. Bourvil entre dans ma vie, avec son immense talent, sa sensibilité, sa drôlerie. Le superbe film Fortunat d’Alex Joffé, avec Michèle Morgan, est pour moi son plus beau rôle, qui m’a profondément ému.
Il y a également de brefs communiqués qui m’intriguent. D’abord parce qu’on les écoute en baissant le son. Deux séries de gongs bizarres les annoncent : Pan, pan, pan, pan ! « Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. » « Le renard est de couleur rousse ! Je répète : le renard est de couleur rousse… » Jusqu’au fameux : « Les sanglots longs des violons de l’automne bercent mon cœur d’une langueur monotone… » Ces vers de Verlaine qui annoncent le débarquement des Alliés le 6 juin 1944. Mon imaginaire les associe aux aventures mystérieuses vécues par mon père, je ne sais où, mais là où c’est dangereux, c’est une certitude.
En ces temps troublés, il y a une corporation qui ne l’est pas beaucoup : celle des curés. Peut-être les troupes d’Occupation ont-elles pensé qu’ils seraient utiles pour convertir les Français au nazisme et ainsi les laissent tranquilles. Si bien que beaucoup d’ecclésiastiques aident les combattants clandestins. D’autres pas du tout, mais ils ne sont pas les seuls chez les représentants de la chrétienté, la collaboration avec l’ennemi peut rapporter gros.
La paroisse de Guérard a, à sa tête, un prêtre qui possède une qualité appréciée de la gent féminine : il est beau ! Et intelligent. Il me repère je ne sais comment, peut-être par la tante Sine. Si bien que ma mère l’introduit dans ma chambre sans me prévenir, un jour quelconque (je déteste l’expression : un beau jour). Nous nous jaugeons pendant un moment anormalement long. Il se trouve que je suis un croyant spontané. Entendez par là que, peu de temps auparavant, je rentrais seul dans une église faire une petite prière à ma sauce naïve, après avoir demandé l’autorisation à mes parents. Mon père, athée convaincu, me donnait sa bénédiction si j’ose dire – et j’ose –, affirmant ainsi sa tolérance, son indépendance d’esprit dont la liberté m’a influencé a posteriori. Donc le beau curé commence par me parler d’une histoire charmante, avec un paradis, un casting d’enfer (pardonnez-moi) avec Jésus, la Vierge Marie, Notre Père qui surveille tout, les apôtres… Je n’ai que des bribes d’information sur le sujet, les circonstances ne s’y sont pas prêtées jusqu’à présent. ET il me sort de sa grande poche de soutane des exemplaires d’une brochure, La Miche de pain. Mais c’est pas mal du tout sa BD ! Bien coloriée, bien rédigée, j’ai un bon a priori. Content de lui, l’homme d’Église s’en va, me promettant de revenir bientôt afin de recueillir mes appréciations. Pourquoi pas, ma foi. J’ai été baptisé dans cette maison avant la guerre, ce qui me procure un passeport pour la suite : enfant de chœur, communion, confirmation, scouts, mariage, et… je préfère ne pas y penser.
Quand il revient, son sourire ne dure pas devant les questions que j’ai préparées à son intention.
— Dieu est bon ? Alors pourquoi il y a la guerre ?
— Il a fait l’homme à son image… alors il est moche ?
— Pourquoi t’es pas marié ?
— Je peux recommencer n’importe quelle bêtise une fois que je me suis confessé ?
Le pauvre homme n’en croit pas ses oreilles ! Sur quel petit démon est-il tombé ? S’ensuivent alors des « discussions » philosophico-religieuses dont il a du mal à se sortir. Qu’importe, il en résultera une solide affection réciproque qui durera des années.
Un fait saugrenu à son sujet me revient en mémoire. Je suis dans la cuisine avec Mémé-chérie. Elle voit l’homme en soutane qui passe, se précipite, ouvre la fenêtre et crie :
— Monsieur le curé !
Il revient sur ses pas, tout souriant.
— Oui, madame Chevalier ?
— J’aime pas les curés !
Et elle referme la fenêtre !
Fin de journée en ce beau mois d’avril 1944. Il fait chaud et je suis accoudé à la fenêtre donnant sur la rue. Elle est à ma hauteur, ce qui est bien agréable. Mémé-chérie s’affaire derrière moi pour préparer le dîner. Je ne sais pas où se trouve ma mère. Soudain, une somptueuse Mercedes suivie d’un véhicule moins voyant se gare devant chez la tante Sine, c’est-à-dire en face de chez moi. Le chauffeur, un soldat allemand, en jaillit et se précipite pour ouvrir la portière arrière à un officier sorti directement du musée de la mode Wehrmacht-spéciale réception. Très impressionnant, d’autant qu’il est grand avec un visage noble et avenant. Le chauffeur lui met une cape noire doublée de rouge sur les épaules tandis qu’il coiffe sa casquette d’un geste élégant. M’apercevant, il sourit, traverse la rue et vient me dire bonsoir. Je suis intimidé, surpris, et lui réponds bien sûr. Le fait qu’il est mon ennemi ne doit pas occulter la politesse. Il fouille dans une poche de son uniforme et… me tend une plaque de chocolat, du vrai provenant de Suisse ou d’ailleurs. L’équivalent sur le marché noir d’un petit rôti de bœuf ou d’une douzaine d’œufs. Puis il se dirige avec deux autres officiers chez mon voisin, monsieur P., artiste-peintre connu ayant reçu le prix de Rome, chez qui, vu son accoutrement et l’heure, il va dîner. Mémé-chérie a suivi la rencontre de loin, ne voulant pas manifester sa hargne contre l’envahisseur, qui lui a tué son mari autrefois, ce qui pourrait être dangereux pour son Numéro 1. Mais à peine les Teutons ont-ils disparu qu’elle ferme la fenêtre, m’arrache des mains la succulente tablette, et d’un geste rageur, la jette dans le feu de la cuisinière.
— Hors de question qu’on mange du chocolat boche !
Pas de commentaires… Si, au sujet de monsieur P. : mon père, qui l’a fréquenté par la suite, pensait que, diplomatiquement, en recevant ce haut gradé admiratif de sa peinture, il avait obtenu des renseignements très utiles aux combattants de l’ombre. Ce qui n’a pas empêché qu’on lui colle une étiquette de collaborateur, provisoire, grâce à mon paternel.
Tiens, justement le voilà ! Qui ? Un inconnu barbu en pleine nuit ! Il me prend dans ses bras, je deviens hagard, et on me dit qu’il s’agit de mon père ! Pas possible ! L’avocat-bûcheron s’est évadé pour la deuxième fois d’une prison de la Nièvre, évasion rocambolesque. Il a roulé de nuit sur un vélo volé, dormant le jour caché dans des buissons. Et, fait inimaginable, il a trouvé pour son fils une imposante et magnifique locomotive qui fonctionne avec un ressort qu’on remonte et qui roule en imitant le bruit d’une vraie ! Il l’a rapportée ficelée sur le porte-bagages de sa bicyclette.
Du coup, même si je ne reconnais pas mon père, le contact en est grandement facilité. Il y a une telle atmosphère dans la maison que je reste éveillé, imaginant à travers ma locomotive un périple menaçant extraordinaire. Ce qui est la vérité. J’ai depuis le début de ce récit pris le parti de ne raconter que des anecdotes drôles, mais l’évasion de maître Georget mérite d’être rapportée.
Il est dans une ferme près de Nevers avec ses résistants, ferme tenue par un ami de mon grand-père. Reniflant un danger, il fait évacuer ses hommes. Alors qu’il s’apprête à faire de même, le lendemain, à l’aube, une compagnie allemande accompagnée d’un blindé envahit les lieux.
L’officier qui commande l’opération lui adresse la parole en anglais ! Mon père a un réflexe formidable. « Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ? Je ne comprends pas l’allemand. » Il a été dénoncé par une bonne Française du village comme parachutiste anglais. Embarqué à la grande prison locale, il est tabassé, on lui fait des piqûres expérimentales, et pour faire joli, des exécutions ont lieu tous les jours, quelquefois réelles, quelquefois avec des balles à blanc. Malgré cette tactique destinée à démolir le moral des prisonniers, l’avocat continue sa résistance… cette fois en organisant des combats de gladiateurs fictifs dans sa cellule avec ses copains, à l’aide d’un presse-purée sur la tête et d’une louche pour le rétiaire, d’un tabouret et d’une écumoire pour le mirmillon. Même les fridolins-matons n’en reviennent pas. Mais ça ne va pas terrible pour les armées du troisième Reich sur le front est. Si bien qu’un feldgrau (adjudant) passe ce jour-là dans les cellules pour demander : « Qui a son permis poids lourd ? » Papa saisit tout de suite que des chauffeurs de camion manquent quelque part. Il lève la main, donnant un coup de coude à ses deux voisins, lesquels comprennent aussi immédiatement. Ils n’ont bien entendu aucun permis de cette catégorie, mais c’est l’occasion de sortir de la prison. L’un d’eux est le célèbre architecte Guillaume Gillet pour lequel je ferai un jour dans l’avenir la maquette de la porte Maillot. Les voilà sur les quais de la gare de Nevers attendant un train qui doit les emmener vers l’Allemagne. Train de marchandises, cela va de soi. Mais quand le convoi arrive, il y a au milieu un wagon de voyageurs qui s’arrête pratiquement devant eux. Sort d’un compartiment une superbe paire de jambes supportant une non moins belle créature. Les soldats, galants et sevrés de ce genre de spectacle, se précipitent pour l’aider à descendre. Tout se joue en une fraction de seconde. Toujours en communiquant avec ses coudes, mon père plonge sous le train, imité par ses deux compagnons. Il m’affirmera que le dicton « la peur donne des ailes » est parfaitement exact. Nevers est aussi une gare de triage. Ils passent sous les wagons en stationnement à une incroyable vitesse, entendant derrière eux des cris, des coups de sifflet, mais heureusement pas de chiens. Au bout de vingt minutes, ils réalisent qu’on ne les poursuit plus. Alors ils se séparent car, en effet, il est plus difficile de repérer des hommes seuls. Mon héros vole un vélo et… vous connaissez la suite.
Retour à cette nuit festive. Je finis par m’endormir, rassuré malgré tout d’avoir récupéré un papa, denrée rare à cette période.
Mais qu’est-ce que c’est que ce bonhomme ! Il intègre aussitôt le réseau de la résistance locale : le groupe « Vengeance », dont j’ai gardé évidemment et la carte et l’emblème.
Si bien qu’il dort le jour et sort la nuit ! Pas vrai ça… Enfin, pas tous les jours. Comme cela va de plus en plus mal pour nos envahisseurs, le camp d’aviation de Coulommiers, juste en face de la maison à une dizaine de kilomètres, est régulièrement bombardé. Nous assistons à des feux sans artifice, très bruyants, qui me terrifient. Devant la menace d’un largage de bombes hasardeux, mon père se fait un devoir de creuser un abri pour sa famille dans le jardin. Il a de l’expérience dans ce domaine, car bientôt la fosse est assez profonde pour nous loger, recouverte d’une couche épaisse constituée de troncs d’arbre et de terre. Ce faisant, il a creusé dans une strate d’argile pure. S’ébauche alors ma carrière de sculpteur ! Je malaxe avec délice cette matière verte avec laquelle je forme des animaux, des avions (j’ai une passion pour les avions), des armes, des pistolets, des bombes, des épées et même des gens. Tout le monde s’émerveille devant le petit génie touche-à-tout qui fait ce qu’il veut de ses mains. C’est une aptitude que j’ai revendiquée jusqu’à… il n’y a pas si longtemps.
Mes sept ans, ce 5 mai 1944, doivent se fêter plus que dignement. C’est « l’âge de raison », dit Mémé-chérie inconsidérément. Je crois en effet que quatre-vingts ans après, soit aujourd’hui, je ne suis pas sûr de l’avoir jamais atteint. Malgré tout, on prépare royalement l’événement avec les moyens du bord et du marché noir. C’est-à-dire hors-d’œuvre culinaires soigneusement élaborés, poulet rôti (le poulet à cette époque est considéré comme un plat royal) et un gâteau spécial-petit-génie-malade. D’ailleurs il n’est plus si malade que ça, le mouflet, puisqu’il est à table dans la salle à manger – ça change de la cuisine –, et dévore avec appétit ce qu’on lui sert.
La bonne humeur règne, ce qui n’est pas toujours le cas étant donné les caractères en présence. Après le dessert, je monte sur les genoux de Mémé-chérie. C’est l’heure de son petit verre de rhum. Allez savoir pourquoi, je le prends pour le sentir et… lui en verse quelques gouttes sur la tête. Elle le prend mal et fulmine contre ce petit mal élevé qui ne respecte pas son ancêtre. Mes parents minimisent la chose, ce qui renforce son irritation. Alors, encouragé par mes supporters, je lui fais remarquer qu’elle a des taches de nourriture sur sa robe. C’est l’explosion !
— Ah, j’ai des taches ? Mais moi, j’aime ça, les taches !
Elle attrape un morceau de pain, le trempe dans la saucière restée sur la table et macule sa robe en se frappant la poitrine. Je descends de ses genoux, et elle s’en va en vitupérant dans le jardin. J’irai un peu honteux lui demander pardon.
Alors (bruits de cymbales, orchestre symphonique, chants majestueux de la grande chorale), entre dans ma vie… KINOU ! Il fait très beau, chaud, et je dors dans le salon-salle à manger pour bénéficier de la porte-fenêtre qui donne sur le perron du jardin. Laquelle est restée ouverte cette nuit. Quel n’est pas mon ahurissement de me réveiller avec une présence sur mon lit : un chat ! Ou plus exactement une chatte, qui n’est pas seule : cinq minuscules créatures la tètent avidement ! Mes parents, aussi étonnés que moi, contemplent ce magnifique tableau. Ils adorent les animaux, sentiment qu’ils m’ont intégralement transmis. Il y a conciliabule, secret bien sûr. Le lendemain, il n’y a plus qu’un seul téteur. J’imagine la répugnance de mon père à éliminer ces pauvres innocents. Avalant des explications abracadabrantes, je fixe mon attention sur celui qui va m’accompagner pendant… quatorze ans. Son nom ? Ma mère est douée pour baptiser les animaux : ce sera Kinou ! La chatte restera deux mois sur mon lit, le temps de lui inculquer les bonnes manières, puis disparaîtra à jamais.
Entre Kinou et moi, c’est… fusionnel, comme on dit aujourd’hui chez les intellectuels. Je regarde et parle avec le félin, notant ses longs poils qui poussent, et le caressant inlassablement. Il me témoigne très tôt une affection totale, confortée par le fait que je dois le nourrir, c’est désormais mon cahier des charges. Au début en préparant le « mou », nom des poumons divers provenant du boucher rapportés par mes parents, que je découpe avec un ciseau, ensuite j’irai moi-même m’approvisionner. Mon destin est scellé avec les chats.
Je vais de mieux en mieux, la preuve en est que je fais pousser des salades, des romaines pour faire plaisir à ma mère, dans un coin du jardin spécialement réservé au « petit ». Le temps est radieux ; le soleil rayonne juste ce qu’il faut, pas de vent, et j’ai la sensation d’une vibration magique qui se nomme le bonheur. Je commence à arroser mes plantations quand un vacarme titanesque retentit, suivi par un avion de chasse volant en rase-mottes au-dessus du toit de ma maison. La cocarde tricolore est bien visible près de la carlingue dont je distingue parfaitement le pilote. Mû par un réflexe instinctif, je le salue en agitant la main, et… incroyable : il me voit et me répond ! Ton salut, mon cher aviateur, ne s’est jamais effacé de ma vision, restant un souvenir exceptionnel. Tu allais en reconnaissance des effectifs allemands près de Coulommiers, préfigurant la libération qui n’allait pas tarder. J’espère que tu as eu une belle vie.
Peu après, gambadant dans MON jardin, inventant toutes sortes de jeux dans ce décor fabuleux de l’enfance, je suis assis près de la grille donnant sur la « grimpette », nom du raccourci qui permet de descendre à Guérard sans emprunter la route. C’est un petit chemin sauvage, à peine praticable. Je fume un cigare, comprenez par là que j’ai enroulé du foin avec du papier toilette et que j’ai enflammé l’extrémité avec une allumette. Probablement pour imiter le paternel qui roule ses cigarettes dans une boîte spéciale où l’on presse le tabac dans une feuille de papier « Job » ; en fermant le couvercle, la cigarette sort, toute prête, par une ouverture. Il n’y a plus qu’un coup de langue pour coller la feuille. Dire que je suis satisfait de mon cigare relèverait d’une affirmation honteuse. Je crache la fumée un peu dégoûté, lorsqu’un objet bizarre surgit au coin de la grille, au ras du sol. Hein ? L’objet avance lentement, un tube métallique noir tenu par celui qui vient d’apparaître en rampant, noir également sous son casque kaki. Nous restons aussi surpris l’un que l’autre. Alors, dans ce visage où seulement deux yeux montrent du blanc, un rire formidable m’éblouit de ses dents parfaites. Il fouille précipitamment dans sa poche et en sort un petit paquet qu’il me tend. Je le prends et lui donne en échange mon cigare qu’il s’empresse de caler dans sa bouche. Et d’un salut du doigt sur son casque, il continue sa progression. Je me rue vers la cave où se trouve mon père dans la journée par peur d’une visite indésirable. Je lui montre mon cadeau, lui raconte ma rencontre du premier type. Il devient pâle, m’ordonne de poser le paquet tout doucement et… je prends une claque ! C’est la manière de mon père d’exprimer sa peur pour son fils. (J’en ai reçu trois en seize ans, pas de quoi faire un martyr.)
« Pourquoi ? » pleuré-je, éberlué. Il se calme, examine la petite plaque qu’il a prise pour un explosif, et réalise qu’il n’y a pas d’homme à la peau noire dans la Wehrmacht, à plus forte raison dans la Gestapo. C’est un GI, un Américain, donc un libérateur ! La plaque est du chewing-gum ! On passe du drame à la comédie, comme souvent chez moi, et exultant de joie, j’ai droit cette fois à un baiser, baiser d’ailleurs aussi rare que les claques. Le rire du soldat noir américain partira avec moi, là où l’on ne doit plus jamais vous empêcher de rire.