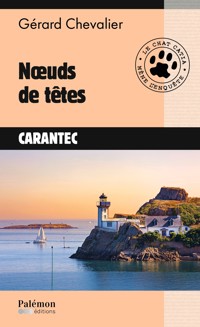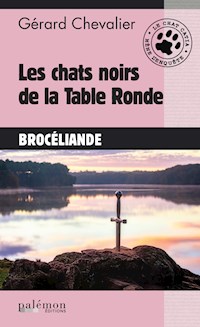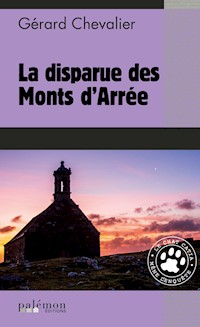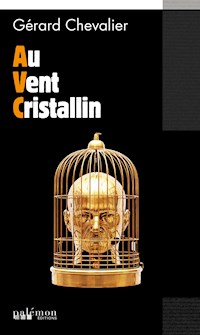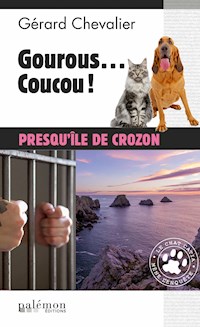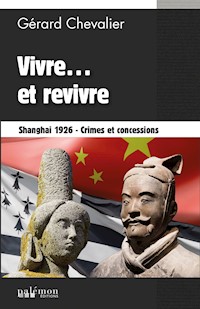Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Ouessant, si sereine pourtant...
Ouessant. Ile sauvage et magnifique. Dernier bout de terre Française à l’ouest du pays. Un cadre de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, la D.C.R.I., natif du lieu, termine sa dernière année de missions intermittentes au service de la République. Un noyé vient s’échouer sur la côte de l’île. Un Russe semble-t-il, avec une mallette attachée à son poignet.
Les documents découverts à l’intérieur et récupérés par la gendarmerie sont terribles. L’affaire prend tout de suite des proportions effrayantes, telle une vague scélérate balayant tout sur son passage. Curieusement les faits sont une copie de l’opération « Viande hachée » imaginée par les anglais, qui a permis de vaincre les nazis et de duper Hitler.
Mais, nous ne sommes pas en guerre et les services secrets français sont en ébullition. En plus des trafics monstrueux dénoncés, les documents du noyé indiquent qu’une « taupe » s’est infiltrée au plus haut niveau de la Direction Générale de la Sûreté Extérieure (D.G.S.E.), autre service secret français. Entre la sérénité de la belle Ouessant et le monde impitoyable du crime organisé, une stupéfiante machination s’enclenche pour débusquer l’ennemi invisible. Un seul impératif : l’île Ouessant doit être épargnée !
Un thriller entre espionnage, crime organisé et Seconde Guerre mondiale qui vous laissera sans voix !
EXTRAIT
La vie s’appropriait la mort. Le phénoménal ballet des bactéries suivait l’immuable chorégraphie de la transformation au cœur des chairs putrides.
Des gaz gonflaient des poches immondes. Une invraisemblable alchimie, inventée par un Dieu très savant, perpétuait le cycle des origines du vivant en s’amusant cyniquement.
Le cadavre était remonté des profondeurs et flottait en contemplant le ciel menaçant. Les traits du visage, gommés, n’exprimaient qu’une indifférence incongrue à l’égard des éléments en colère. Ballotté, recouvert parfois par une vague plus insolente, le corps se dirigeait lentement vers une étendue de sable encastrée dans des rochers, à la pointe est de l’île d’Ouessant.
La faible lumière du jour capitulait devant les ténèbres envahissantes, ponctuées vers l’horizon de monstrueuses écumes blanches, à la surface d’un chaudron infernal.
Lassées de jouer avec leur proie inanimée, les vagues déposèrent le noyé sur la minuscule grève en lui témoignant un peu plus de respect.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Une histoire parfaitement documentée qui vous conduira aux premières lueurs de l'aube si vous ne jetez pas un oeil à votre réveil de temps en temps. - France 3 Bretagne
À PROPOS DE L’AUTEUR
Après avoir tenu à la télévision des rôles populaires dans des séries comme Arsène Lupin et dans des téléfilms, Gérard Chevalier écrit et monte ses spectacles au café-théâtre puis de vraies pièces, comme Coup de pompe, dont il partage la distribution avec Annie Savarin et Bernard Carat.
Aujourd'hui, auteur de romans policiers et de thrillers, il s'est installé en Bretagne, sa terre d'inspiration inépuisable, terre qu'il affectionne tout particulièrement et à laquelle il rend un vibrant hommage à travers ses écrits. Son premier ouvrage, Ici finit la terre paru en 2009, a été largement salué par la critique et a remporté de nombreux prix. L'ombre de la brume, paru en 2010, La magie des nuages en 2011, Vague scélérate en 2013, Miaou, bordel! et Ron-ron, ça tourne! rencontrent également un véritable succès mettant une nouvelle fois la Bretagne à l'honneur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GÉRARD CHEVALIER
Vague scélérate
éditions du Palémon
AVIS AUX LECTEURS
VAGUE SCÉLERATE est une histoire dans laquelle les services secrets français sont impliqués. Je tiens à préciser que je ne connais pas ces services, ni de près, ni de loin. Le peu que je cite est puisé dans des ouvrages disponibles en librairies. Les véritables secrets doivent le rester, et ce que j’ai écrit n’est destiné qu’à l’amusement du lecteur, inventant des personnages qui n’ont rien à voir avec la réalité, dont j’ignore le fonctionnement.
En revanche l’opération Viande hachée a bien eu lieu et demeure dans les annales de l’Histoire un chef-d’œuvre des services secrets anglais.
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d’Exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands Augustins - 75 006 PARIS - Tél. 01 44 07 47 70/
Retrouvez tous les ouvrages des Éditions du Palémon sur :
PERSONNAGES PRINCIPAUX
ÎLE D’OUESSANT
Jean Le Goff, médecin.
Jean-Pierre Karadec, maire de Ouessant.
Yann Favier, fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, en semi-retraite.
Catherine, sa maîtresse, boulangère.
Hervé et Marie-Jeanne Lhostis, retraités; Hervé, ancien Capitaine de frégate.
Mathieu Créac’h, maçon retraité.
Commandant Tanguy Créac’h, son petit-fils, commando de marine.
LES GENDARMES, Compagnie de Brest
Adjudant-chef Cartier.
Maréchal des logis-chef Antoine Kastler.
Capitaine Pradier.
Colonel Garoust.
Général Dessailly.
Madame Berrieux-Mauclair, ministre de l’Intérieur.
Général Gautlot, retraité de la D.R.M.
(Direction du renseignement militaire)
La DGSE,Direction générale de la sécurité extérieure
François de Brincourt, directeur général. De son vrai nom Georges Talaïev.
Léon Grimbert, directeur du renseignement.
Jean Ragueneau, colonel du G.I.G.N., directeur du service Action.
Soufflot, directeur du service Stratégie.
Claude Leblanc, correspondant à l’ambassade de France, à Moscou.
Michel Vitré, correspondant, gérant du restaurant chez Georges, à Moscou.
LES RUSSES
Madame veuve Nadia TALAÏEV, à Paris.
Fédor Talaïev, son beau-père, émigré en 1917 à Paris, embauché au ministère de l’Intérieur.
Igor-Yvanovitch Lemeniev, directeur des Archives à la mairie de Moscou.
Anouchka Snéguérine, sa secrétaire.
Commandant Passersky et madame Snéguerine, les parents d’Anouchka.
Sergueï Kabarov, maire adjoint à la mairie de Moscou.
LES DÉLINQUANTS
Mohamed Aramis, jeune mécanicien.
Alfredo Scorci, voyou du grand banditisme.
Marcel et Jeannine, agriculteurs.
André, marin pêcheur.
LES GITANS
À Serge Belluco, qui est parti avant d’avoir pu lire mon histoire. Je lui raconterai dans quelques années, là où nous pourrons évoquer tous ces bons bouts de vie passés ensemble, en envisageant joyeusement la suite sans aucune notion de temps.
Tout cela descendait et montait comme une vague
Ou s’élançait en pétillant.
La vie s’appropriait la mort. Le phénoménal ballet des bactéries suivait l’immuable chorégraphie de la transformation au cœur des chairs putrides.
Des gaz gonflaient des poches immondes. Une invraisemblable alchimie, inventée par un Dieu très savant, perpétuait le cycle des origines du vivant en s’amusant cyniquement.
Le cadavre était remonté des profondeurs et flottait en contemplant le ciel menaçant. Les traits du visage, gommés, n’exprimaient qu’une indifférence incongrue à l’égard des éléments en colère. Ballotté, recouvert parfois par une vague plus insolente, le corps se dirigeait lentement vers une étendue de sable encastrée dans des rochers, à la pointe est de l’île d’Ouessant.
La faible lumière du jour capitulait devant les ténèbres envahissantes, ponctuées vers l’horizon de monstrueuses écumes blanches, à la surface d’un chaudron infernal.
Lassées de jouer avec leur proie inanimée, les vagues déposèrent le noyé sur la minuscule grève en lui témoignant un peu plus de respect.
La mer se retirait avec la marée descendante et les vêtements exsudèrent doucement l’eau qui les imbibait, accompagnée d’humeurs indétectables.
La quiétude de la forme immobile contrastait dramatiquement avec la furie mugissante de l’océan.
oOo
Le pilote du Cessna Caravan de la compagnie Finist’Air ne décolérait pas, à sa manière. C’est-à-dire sans manifester la moindre nervosité. Un vent de travers, violent, l’assaillait constamment depuis le décollage de l’aéroport à Guipavas.
L’avion dévia brutalement de sa trajectoire, secouant les six passagers, heureusement des habitués de ce vol quotidien. La grande fiabilité de l’appareil dans ces conditions difficiles permettait néanmoins un vol en toute sécurité.
Seuls les nerfs étaient désagréablement sollicités. Mais cela ne durait que quinze minutes, temps nécessaire pour atteindre Ouessant.
Lorsque la piste fut en vue entre les deux petites anses de Porz Ligoudou et Porz An Dour, le pilote se concentra sur les manœuvres d’atterrissage. Son œil exercé transmit à son cerveau un message d’alerte : un homme était allongé sur la bande de sable entre les rochers de la côte. Pas de bateau en vue. À cette heure matinale ce ne pouvait être qu’un drame. Il n’accorda que deux secondes à son observation et se posa un moment plus tard avec toute la maîtrise requise pour contrer les perturbations.
Il attendit que ses passagers débarquent avant de prendre son téléphone portable. L’absence de commentaires prouvait que personne n’avait vu la forme humaine insolite. Avant d’aller accueillir ses nouveaux voyageurs pour le vol en sens inverse, prévu quinze minutes plus tard, il appela la mairie de Lampaul et signala sa découverte. Il imagina sans peine les répercussions immédiates dans la communauté ouessantine très solidaire, et efficace dans la mise en œuvre des secours.
En revanche, il ne pouvait évaluer l’ampleur des événements dont il venait de déclencher le tout début.
oOo
Louis Le Coz, le chef des pompiers bénévoles, aidé de son ami Yvon Berthelé, le responsable du sauvetage en mer, et de leurs trois grands fils, placèrent avec précaution le noyé sur le brancard. C’était un homme âgé d’une cinquantaine d’années, entièrement vêtu de noir à part la chemise blanche au col fermé par une cravate, nœud impeccablement noué. À son poignet gauche une chaîne fixée sur une menotte le reliait à une mallette en cuir, noire elle aussi. La facture en était luxueuse. Un système de chiffres à molette bloquait son ouverture.
Louis la saisit par un coin de sa main gantée et la coinça entre le bras et le corps du cadavre. Le lieutenant Boyer de la compagnie de gendarmerie de Brest, averti par téléphone, lui avait bien recommandé de ne pas laisser d’empreintes digitales sur l’objet. L’expérience lui avait appris que lorsque l’océan rejette un corps on pouvait s’attendre à tout. En revanche, il n’y avait pas de scène de crime au sens classique du terme puisque l’homme avait péri en mer. Louis était formel sur ce point, ayant hélas accompli plusieurs fois la triste besogne de repêcher des morts par noyade.
Ils remontaient péniblement le brancard jusqu’à l’ambulance quand Jean Le Goff, le médecin de l’île, arriva.
— Ce n’était pas la peine de te déplacer ! lui lança Louis. Il n’y a plus rien à faire !
— Bonjour Yvon, bonjour Louis. Salut les enfants. Que je constate le décès ici ou ailleurs, il faut bien le faire. Et puis ça me fait gagner du temps, car avec ce froid le tiers des petits de l’île est malade.
— C’est vrai, t’auras la visite de ma fille. Mon petit-fils Erwan a une de ces bronchites ! renchérit Yvon alors que le médecin se penchait pour examiner l’homme en noir.
Sa première certitude, à part le fait qu’il était bien décédé, fut qu’il s’agissait d’un étranger. Malgré la boursouflure de la peau, le visage restait bien typé. Un Libanais ou un Egyptien pensa Le Goff qui était passé en touriste dans ces deux pays.
Il signa son certificat de décès et le tendit à Le Coz, pressé de quitter les lieux.
— Tiens, tu le donneras aux gendarmes. Pour le permis d’inhumer ce ne sera pas moi. Et l’enterrement ne se fera pas ici, crois-moi !
Le Coz, Berthelé et les garçons regardèrent leur médecin avec respect. Respect pour sa personne bienveillante et compétente, respect pour ses années d’étude, respect pour l’enfant de l’île avec lequel ils avaient grandi et qui avait choisi d’exercer son art au service de sa population. Il était le garant de leur santé et le dépositaire de bien des secrets de famille. Tandis que Le Goff regagnait sa voiture les hommes mirent le brancard dans l’ambulance.
Arrivés à Lampaul, capitale vitale de ce bout de terre flottant au large du continent, ils installèrent une bâche plastique sur une table dans un local voisin du poste de gendarmerie, encore inoccupé en cette fin de mars.
Le mort placé dans cette morgue improvisée, il ne restait plus qu’à attendre l’équipe des forces de l’ordre.
La nouvelle de l’étranger noyé, trouvé près de l’aérodrome, se transmettait verbalement à une vitesse surprenante. Les faits divers étaient rares dans ce microcosme. Ils prenaient une importance inversement proportionnelle aux dimensions du territoire. L’invasion des touristes n’étant pas encore en cours, les suppositions les plus insensées s’échangeaient quant à la provenance du cadavre.
— Il est sûrement tombé d’un bateau !
— Ou d’un avion ! Ça s’est déjà vu !
— À moins qu’il vienne d’un port du continent.
— On l’aurait poussé à l’eau ?
— Va savoir. C’est peut-être pas un accident.
— Le fils à Berthelé m’a dit qu’il avait un bagage ficelé à la main.
— Tu veux dire un attaché-case ?
— Oui. Ça veut dire qu’on ne l’a pas volé…
— Donc c’est un accident !
Le bruit puissant de l’Eurocopter 135 transportant les gendarmes mit fin aux conversations. Sans se concerter les Ouessantins disponibles se dirigèrent vers le poste des militaires.
L’hélicoptère tout neuf, fierté de la compagnie de Brest, attirait à lui seul la moitié des curieux, essentiellement des jeunes.
Étant en vacances ce samedi matin, ils profitaient de leur liberté pour rêver devant cet engin mythique duxxiesiècle, l’instrument essentiel du secours et des prises de vues cinématographiques aériennes.
L’adjudant-chef Cartier et deux maréchaux des logis-chefs descendirent de l’appareil, laissant le pilote le garder. Cartier venait d’être muté à Brest trois mois auparavant. Trente-cinq ans, sportif sans excès, il suivait des cours pour s’intégrer dans une équipe de recherche scientifique, discipline qu’il avait découverte au cours des enquêtes auxquelles il avait participé.
Le message transmis au réceptionniste de garde deux heures plus tôt ne spécifiait rien qui puisse mobiliser une attention particulière. Il s’agissait de la découverte d’un homme noyé, déposé par les courants marins sur une côte d’Ouessant. Triste, mais banal, hélas !
Lorsqu’il découvrit le corps son instinct le mit immédiatement en tension. L’acquis de ses cours lui fit comprendre qu’il n’était justement pas en présence d’un fait divers banal. Il enfila des gants en latex, tout en pensant qu’il avait peu de chance de trouver des empreintes après un séjour de quelques jours dans l’eau de mer.
Dans les poches du mort il n’y avait qu’un portefeuille, deux tickets pour une salle de cinéma, le Grand Rex à Paris, ainsi que quelques euros en monnaie.
Avec précaution il chercha une pièce d’identité. Au milieu du portefeuille, simplement coincé, se trouvait un passeport. Il n’ouvrit qu’à moitié la page d’identification, le document était trop détrempé pour être examiné. On pouvait détériorer les visas éventuels en les décollant.
Il ne put lire qu’une partie du nom : Dimitri Tcherk… Les caractères imprimés en cyrillique ne laissaient aucun doute quant à la nationalité du personnage. C’était un Russe, contrairement à son apparence méditerranéenne, ou moyen-orientale.
— On va l’emmener au labo, dit Cartier à ses adjoints. Il faudra faire sécher les documents au plus vite.
Il ajouta, après avoir hésité :
— Paul, tu coupes la chaînette de la mallette en partageant sa longueur.
Une fois l’attaché-case désolidarisé du poignet, il le glissa dans un grand sac plastique.
Alors qu’on enfermait le Russe dans une housse, le maire arriva tout essoufflé.
— Pardonnez-moi de n’avoir pu vous accueillir. J’étais en train de régler un problème compliqué avec un emmerdeur qui fait chier tout le monde !
Seul, l’adjudant-chef Cartier fut surpris. Ses hommes avaient déjà rencontré Jean-Pierre Karadec, premier citoyen de l’île, au langage fleuri. Quand on connaissait l’énergumène, on ne pouvait pas s’en offusquer. Luttant sans relâche pour les intérêts de son « caillou », généreux de son temps et de sa personne, son dévouement était salué même par ses adversaires politiques.
Quand un fonctionnaire du continent devait le rencontrer, ses collègues arboraient un air réjoui.
— Ah, tu vas voir Karadec ! On prévient le SAMU !
Le maire serra la main des militaires. Cartier se présenta.
— Soyez le bienvenu à Ouessant, monsieur… euh… adjudant-chef ! Je vous offre un café avant de repartir ?
— Avec plaisir, monsieur le maire, mais rapidement.
C’était la première visite du sous-officier sur l’île et il ne voulait pas déroger à la qualité des rapports que la gendarmerie et Ouessant avaient établis.
Ils étaient pressés et Karadec le comprenait très bien. Il les raccompagna jusqu’à l’hélicoptère où ils embarquèrent leur funèbre chargement.
Après un dernier salut l’engin décolla, projetant un souffle puissant vers le sol. Le maire le suivit des yeux pendant un moment en se demandant comment un citoyen russe avait pu se noyer et échouer sur la côte de son « caillou ».
Yann Favier étira son corps dans tous les sens avant de regarder sa montre. Dix heures ! Il eut un sourire de bien-être en pensant égoïstement à Catherine qui, elle, était dans sa boulangerie depuis sept heures. Qu’importe. Il s’était levé très tôt toute sa vie, et bien souvent des heures de veille dans des conditions pénibles l’avaient empêché de dormir. Alors, le temps de la retraite venu, il profitait pleinement de sa nouvelle vie. Et de Catherine. Une onde de désir le parcourut encore. Pourtant il aurait dû être rassasié. Leur envie mutuelle les avait emmenés dans une orchestration de caresses raffinées, plusieurs fois au cours de la nuit. C’était miraculeux après toutes ces années qui ne les réunissaient que par intermittence. Probablement était-ce le secret de ce désir qui se perpétuait. Ils en avaient conscience. Alors qu’aujourd’hui ils pouvaient vivre ensemble, ils possédaient chacun un logement où ils s’invitaient au gré de leur fantaisie, ayant soin de toujours laisser quelques jours avant de refaire le plein d’amour.
Catherine et Yann se connaissaient depuis leur petite enfance. Claude Favier, le père de Yann avait épousé une Ouessantine. Il avait quitté Le Conquet pour vivre avec sa femme dans la petite maison que Yann occupait maintenant. Catherine était la fille des boulangers qui fournissaient Lampaul depuis trois générations.
Ils avaient toujours été amoureux l’un de l’autre. Mais la vie avait passé son temps à les contrarier. Yann, brillant élève, quittait l’île pour ses études secondaires. Un métier inattendu le happait dès sa sortie de la faculté de droit.
Passionné, il découvrait le monde et sa complexité. Catherine, désespérée, le voyait de moins en moins. Une mauvaise conjoncture envoyait son amoureux dans une mission en Orient, d’où il ne donnait plus de nouvelles. Une volée de prétendants s’étaient mis à tourner autour de la belle fille qui captait l’attention de tous les mâles du bourg. C’était facile de la voir puisqu’elle aidait ses parents à la boulangerie.
En achetant son pain, on avait en prime l’image de ses formes généreuses et l’éclat de ses yeux. Un solide fils de pêcheur sut un jour attirer son attention, pas seulement par sa stature et son charme physique.
Yann n’étant pas réapparu, ils se marièrent et n’eurent aucun enfant.
Catherine comprit, après quelques mois, que son union était un échec, que personne ne pourrait remplacer celui qui l’avait abandonnée. Le divorce fut un scandale, alimentant les ragots pendant un bon moment. Le fils de pêcheur quitta Ouessant et Catherine subit la rancœur du clan de son mari, ainsi que l’humeur détestable de ses parents, humiliés par cette situation.
Puis, la succession des années estompa les ressentiments.
Yann ressurgit à l’occasion d’une fête de famille, alors que personne ne pensait à lui, Catherine encore moins que les autres. Quand elle le vit, elle ressentit ce que tous ceux qui s’aiment perçoivent après une longue absence. Malgré sa volonté première de le rejeter, elle fut incapable de lui résister. La vie avait sculpté des traits bien marqués sur le visage de Yann. Il était de taille moyenne, mais un entraînement sportif intense lui donnait un rayonnement de puissance. Ses yeux gris sombre, ayant déjà contemplé l’indicible, exprimaient des sentiments forts dont le vulgaire était exclu.
Ils se retrouvèrent tous deux dans une sensualité explosive, dont ils n’avaient pas soupçonné l’existence dans leurs premiers ébats Leur maturité scella définitivement leur destin. Yann refusa de lui expliquer en quoi consistait exactement son travail. Il était fonctionnaire. Où ? Au ministère de l’Intérieur Voilà. C’est tout. Il apparaissait et disparaissait Tantôt exténué, tantôt déprimé. Mais à chaque fois, leurs retrouvailles les galvanisaient. Ils accumulaient l’énergie qui leur permettait d’attendre la prochaine rencontre. Et la vie s’écoulait.
— La vie passe vite, ricana Yann en se levant.
Il s’habilla rapidement, impatient de se faire un café chez lui. Il sortit par l’arrière de la boulangerie en espérant ne rencontrer personne. Pourtant personne n’ignorait leur liaison, tellement ancienne. Mais c’était ainsi. Yann restait un personnage un peu mystérieux qui ne pouvait être comparé à aucun habitant de l’île. Il avait ses manies. On le respectait. Il entendit le frère de Catherine, Paul, qui ouvrait la porte du four. Le fils aîné succédait au vieux père, c’était dans l’ordre traditionnel de cette famille. Avant qu’il ne l’aperçoive, il se faufila dans la cour.
La température très basse le sortit de sa torpeur rêveuse. Il n’avait pas six cents mètres à parcourir pour regagner son logis. Cela lui fit quand même du bien. Faire du sport, parfait ! Mais après le café du matin.
Il s’assit, tenant le bol brûlant de ses deux mains dans le vieux club de son père, face à la fenêtre qui donnait sur le petit jardin clos. Les murs, indispensables contre le vent permanent de l’île, protégeaient de leurs pierres non crépies quelques camélias rabougris et des touffes d’asters vivaces, refusant obstinément de disparaître dans cet endroit peu propice à la végétation neuf mois sur douze.
Il régnait une agréable chaleur dans la maison dont la seule modernité était une installation de chauffage au fioul que Yann pouvait déclencher ou éteindre par téléphone. Car il lui arrivait encore de se déplacer, mais bien plus rarement qu’autrefois et pour quelques jours seulement. Son caractère économe lui faisait couper la chaudière en hiver lors de ses absences.
Après une toilette minutieuse, il enfila un blouson molletonné sur un jogging et sortit faire une promenade.L’île était son second grand amour. Il la connaissait par cœur et pourtant la découvrait sans cesse. Durant sa vie mouvementée il n’avait jamais imaginé qu’il puisse la quitter définitivement. Maintenant seule la mort l’y obligerait. Il choisit d’aller d’abord au phare du Creac’h. Il remonterait ensuite au nord vers les îlots du You’chmeur observer les oiseaux migrateurs qui n’allaient pas tarder à reprendre leur périple. Passant par le bourg de Lampaul, chemin incontournable quand on habitait comme lui le village de Toull al Lann, il fut surpris de rencontrer des groupes d’îliens tenant des conversations animées.
— Bonjour, Jean-Marie. Que se passe-t-il ?
— Ah, salut, Yann. Figure-toi qu’on a repêché un macchabée !
— Quelqu’un de chez nous ?
Jean-Marie se signa vivement.
— Dieu merci, non. Un étranger.
— Un pêcheur ?
— Non, un véritable étranger. Un Russe qu’y paraît.
— Ah ! C’est pas courant ça.
— Non… Les gendarmes l’ont emmené.
— Logique. Bien, Jean-Marie. Je vais faire un petit tour. Bonne journée.
— Allez, kenavo, Yann.
— Kenavo.
Jean-Marie regarda son interlocuteur s’éloigner, déçu et surpris d’une conversation avortée par le manque d’intérêt évident que Yann Favier portait au sujet.
oOo
L’adjudant-chef Cartier, dans son bureau du 15 rue de l’Harteloire à Brest, terminait de remplir une fastidieuse paperasse. Il avait laissé le cadavre du Russe dans le local du funérarium à l’hôpital Morvan qui servait d’institut médico-légal. Le légiste de service n’étant pas débordé, son rapport devait parvenir sous peu. Lundi après-midi peut-être.
Un de ses deux adjoints entra, portant la mallette noire et le portefeuille du mort.
— Voilà, chef. C’est sec. J’ai fini au sèche-cheveux, le radiateur soufflant a cramé !
— Zut ! Tu fais le nécessaire pour le remplacer au plus vite. Cet engin est trop pratique pour s’en passer.
— Oui. L’économat va encore hurler qu’on le ruine !
— Tu l’as déjà vu aimable quand on lui demande de fournir quelque chose ?
— Non. On croirait qu’on les détrousse de leurs biens personnels… Tiens, on a forcé les serrures chiffrées. C’était du solide.
Il disposa l’attaché-case ouvert devant son supérieur, ainsi que le contenu rangé dans des chemises en carton, des sacs plastiques, et le portefeuille avec le passeport. Cartier appréciait son jeune subalterne, motivé, méthodique, au caractère stable et souriant. Il considérait Antoine Kastler comme une excellente recrue.
— Pas besoin de mettre des gants : on a relevé les empreintes sur tous les documents. Rien sur la mallette, quelques-unes dans le portefeuille et le passeport. Ce sont en grande majorité celles de Dimitri Tcherkaïev qu’on avait relevées ce matin. Impossible de lire l’écriture cyrillique. Il va falloir tout faire traduire.
Cartier examina en premier le passeport.
Seul le nom était compréhensible car écrit en double version.
Un détail attirait l’attention : en bas de la première page un tampon rouge portait l’inscription :voïeni attache. Kastler comprit l’intérêt de son chef.
— Ça veut dire attaché militaire.
— Quoi ! Comment…
— On a appelé l’ambassade à Paris, coupa Antoine, assez fier de lui.
— « On » ou « j’ai » appelé…
Le jeune gendarme avait encore l’âge de rougir. Ce qu’il fit spontanément.
— J’ai appelé…
— Mais c’est très bien. Pas besoin d’être aussi modeste.
Cartier tourna les pages du document.
— Oh, là, là ! Que de visas !
— Oui, il a beaucoup voyagé ces derniers temps. On a aussi demandé à l’ambassade de nous confirmer son identité. On aura la réponse la semaine prochaine.
Le jeune homme avait décidément l’esprit d’équipe. Il faudrait le noter avantageusement à l’occasion de sa future promotion.
Les chemises cartonnées contenaient quelques dizaines de feuilles, dont certaines à l’en-tête de l’aigle bicéphale. Dans les sacs étaient rangés des sous-vêtements, deux chemises repassées, un livre à la couverture angoissante, un roman policier sans doute, une photo sous plastique représentant une jolie femme entourée de deux adolescents, et une lettre manuscrite datée de la semaine passée.
Cartier soupira à l’idée que cette famille allait apprendre bientôt la disparition.
Restaient les deux tickets pour le cinéma le Grand Rex. L’homme était allé, ou avait été emmené au spectacle en compagnie d’une connaissance. Homme ou femme ? Ami, maîtresse, relation ?
— Kastler, vous envoyez la photo de Tcherkaïev au Grand Rex. Ça m’étonnerait qu’on se souvienne de lui, mais on aura la conscience tranquille. Reste le problème du traducteur.
— On a un prof de russe à Saint-Brieuc. Il est d’accord pour faire le travail. Il y en avait bien un à Brest, mais il a refusé.
Le chef en resta muet de satisfaction. Bien sûr c’était normal comme comportement, mais anticiper, prendre des initiatives aussi rapidement, n’était pas le cas de tous les jeunes gendarmes qu’il avait eus sous ses ordres.
— Il peut également se déplacer si vous ne voulez pas que les documents sortent d’ici.
Voilà une tête qui fonctionnait bien.
— Parfait. On va le faire venir durant une journée, pour commencer. Si Tcherkaïev est un représentant en matériel militaire, on refilera le dossier au ministère. De toute façon, le dossier sera remis à notre direction. Le domaine militaire est par définition secret. Il y a des petits et des grands secrets ! Je ne pense pas que ces documents soient d’une importance capitale. Mais on ne sait jamais.
C’était une très sage réflexion.
oOo
— Allez, se dit Mathieu à lui-même, encore un effort, vieux feignant.
Ses rhumatismes le faisaient particulièrement souffrir par ce temps humide et froid. Rien d’exceptionnel à quatre-vingt-six ans, dont cinquante passés en efforts physiques. Mais, dans la famille, le travail représentait la base de la vie.
Le père disparu en mer, comme tant d’autres à Ouessant, la mère assumait la charge du foyer, acceptant tous les travaux pénibles : lessive, couture, ménage, et cultivant son potager avec acharnement. Beaucoup d’îliens l’avaient aidée comme ils le pouvaient, elle et ses quatre enfants qui grandissaient dans la pauvreté mais dans la dignité. Aussi, dès qu’ils furent en âge de travailler, c’est-à-dire vers quinze ans, la fille et les trois garçons se démenèrent et firent bloc avec leur mère pour adoucir sa vie et la soulager de ses pénibles tâches. Elle était partie près de trente ans auparavant. Pourtant Mathieu pensait à elle presque tous les jours. Il conservait tous ses objets, souvenirs, meubles, dans sa maison qu’il avait réussi à acheter. Il faisait promettre régulièrement à ses enfants et petits enfants de conserver intact le patrimoine maternel. Sans grande illusion, car il voyait bien l’évolution du monde et sa mentalité mercantile, dévastatrice. Même sur l’île.
Il entra dans la boulangerie, sa visite et son plaisir quotidiens. Plaisir de l’odeur formidable du pain, aliment principal de sa jeunesse, accompagné de saindoux ou de pâté Hénaf f ; plaisir aussi du coup d’œil à la belle fille qui le servait. Il l’avait vu grandir la Catherine, et lorsqu’il s’était retrouvé veuf, des phantasmes le poursuivaient malgré lui, en évoquant la beauté sensuelle de cette femme. À cinquante ans son charme séduisait toujours, comme son corps qui semblait parfaitement conservé.
— Une baguette bien cuite pour Mathieu, lui lança-t-elle gaiement en guise de bonjour.
Elle se retourna pour prendre le pain, sachant que Mathieu l’enveloppait de son regard. Rien de salace avec cet homme-là, de l’admiration sincère uniquement. Elle l’aimait bien ce robuste bonhomme devenu vieux. Depuis des décennies, il lui témoignait ce sentiment ancestral qu’un mâle éprouve vis-à-vis de la femelle qu’il convoite.
Seulement il n’avait jamais eu un geste ou une parole déplacée. Le regard assurait seul la communication, et Catherine se sentait fière de provoquer encore une émotion chez un homme qui la respectait affectueusement.
— Et puis une tarte aux pommes, ajouta-t-il lorsqu’elle lui tendit la baguette. Loïc et Jeanne viennent déjeuner avec les petits.
— C’est bien. Tu dois être heureux de les voir.
— Oh, oui. Ils sont gentils avec moi. Ils font ce qu’ils peuvent. Ça fait une trotte pour venir sur l’île.
En servant les autres clients, elle le regarda par intermittence quitter la boutique et marcher doucement dans la rue. Avec un petit pincement au cœur. Combien de temps encore le servirait-elle ? Il faisait tellement partie de… de sa vie, oui. Comme sa boulangerie, son frère, son île, Yann. L’évocation de son amant chassa sa nostalgie.
— Mais non, Catherine, tu sais bien que je ne prends jamais de baguette. Tu es dans la lune ?
Madame Le Gall la contemplait, l’air réjoui. Catherine eut un rire un peu crispé.
— Excuse-moi. Je me demandais si je n’avais pas éteint le gaz sous un plat en train de mijoter.
Argument tout à fait mensonger mais plausible pour madame Le Gall qui acquiesça souriante.
Yann ne quittait jamais ses pensées.
Après la nuit passée auprès de lui, elle se sentait pleinement vivante. Peu importait s’il faisait froid, gris, pluvieux, elle était joyeuse, comme chaque fois qu’ils partageaient ce que la vie leur avait donné. Ses absences étaient plus rares maintenant, même si ces derniers temps une fréquence inhabituelle se remarquait. Elle savait qu’il l’aimait, qu’il la désirait tel un jeune homme avec sa nouvelle amoureuse, et c’était maintenant l’apothéose de ce qu’elle souhaitait. Finies les grandes inquiétudes, les doutes misérables. Place aux certitudes, aux belles années qu’il lui restait sur son Île avec l’amour pour horizon. Elle irait le voir ce soir encore, et pensait qu’elle serait la bienvenue. Son instinct le lui affirmait.
oOo
Le lundi 23 mars en fin d’après-midi, le maréchal des logis-chef, Antoine Kastler, vint voir son supérieur. Cartier rédigeait un rapport sur une affaire de cambriolage et ne leva pas le nez de son ordinateur.
— Oui, Kastler ?
— Chef, si je te dérange, je peux revenir.
— Non, non, dis-moi ce que tu veux.
— Le légiste de l’hôpital Morvan tient le rapport sur le Russe à notre disposition.
— Il ne l’envoie pas ?
— Non, il préfère nous le remettre en main propre.
— Ah !
Cartier consulta sa montre, objet de l’éternelle plaisanterie : « c’est une montre Cartier ».
— Eh bien, allons-y, ce n’est pas loin. Préviens-le qu’on arrive, le temps que je sauvegarde mon rapport.
Vingt minutes plus tard ils se trouvaient dans le bureau du praticien à l’allure surprenante pour sa profession. Grand, bronzé, une chevelure brune abondante, un sourire découvrant une dentition étincelante, on le prenait, soit pour un acteur, soit pour un mannequin, car il était habillé élégamment. Les yeux exprimaient un sentiment de curiosité, soutenue par une vive intelligence.
Les deux gendarmes ne l’avaient jamais vu. Ils essayèrent de masquer leur surprise. Après les présentations, le légiste étala des radiographies à côté de son rapport, sur le bureau.
— Je vous ai fait venir car j’ai des doutes. Doutes que j’ai esquissés dans mon rapport. Mais je préfère vous en parler, vous allez comprendre pourquoi…
Il se concentra, et son visage curieusement devint austère. Il fit son exposé, sans les regarder.
— Le corps de Dimitri Tcherkaïev présente, dans son ensemble, des stigmates de déficience. C’est quelqu’un qui a souffert de malnutrition dans les mois qui ont précédé sa mort. Je vous fais grâce des termes techniques, reproduits de toute façon là-dedans.
Il indiqua les feuilles imprimées.
— De plus, il y avait bien de l’eau de mer dans ses poumons, comme chez tout noyé dans l’océan qui se respecte, mais… mais une trace plus que suspecte dans l’arrière-gorge me donne à croire qu’elle n’est pas venue naturellement.
— C’est-à-dire ? fit Cartier.
— Eh bien, je pense qu’avec un tuyau flexible on a injecté le liquide dans les alvéoles pulmonaires.
— Mais ce n’est pas possible ! Il faudrait le faire sous échographie.
— Exact ! Le point suivant c’est qu’il y avait bien de l’eau jusqu’à la base des poumons, ce qui ne peut se faire que lorsque l’homme aspire l’eau, vivant, au moment de se noyer…
Les deux militaires restaient abasourdis, cherchant automatiquement la réponse à l’énigme. Le légiste continua.
— La seule réponse logique est que cet homme est mort de pleurésie. Ce qui explique la présence d’eau dans les alvéoles inférieures. En pratiquant la dissection des poumons, j’ai forcément mélangé l’eau de mer avec le résiduel pleural. Et il est resté trop longtemps immergé pour que je détecte formellement la pathologie. Il n’avait pas de tumeur de la plèvre. Les cultures bactériennes sont en cours, mais je crois qu’elles ne donneront pas grand-chose. En revanche, il est possible que ce monsieur ait souffert d’un lupus érythémateux. Une maladie rhumatismale, susceptible de provoquer une pleurésie. Au microscope le liquide pleural n’est pas caractéristique de la maladie car, comme je vous l’ai dit, il est mélangé à l’eau de mer. Voilà, beaucoup de doutes, peu de certitudes.
Cartier resta silencieux un moment. Kastler, posa la question qu’il retournait déjà pendant le discours du médecin.
— Docteur, que pensez-vous exactement au sujet de la mort du noyé ?
— Qu’il ne s’est pas noyé ! Il était déjà mort quand il est tombé à l’eau, ou quand on l’y a jeté, après lui avoir mis de l’eau de mer dans les poumons. C’est rocambolesque ! Mais c’est mon sentiment.
Cartier s’ébroua.
— Peut-on penser qu’il a été assassiné ?
Le beau légiste afficha son sourire éblouissant.
— Sûrement pas ! Ça, c’est une certitude.
oOo
Les dossiers s’amoncelaient sur le bureau du maire. Leur prolifération s’apparentait à un système de génération spontanée, tellement les piles de chemises cartonnées doublaient d’un jour à l’autre. Jean-Pierre Karadec fulminait contre le contenu des dossiers dont les deux tiers étaient inutiles. Qui pouvait bien approuver et appliquer ces décisions obsolètes ou carrément stupides ?
Karadec imaginait, tapis dans les méandres de l’administration, des esprits malfaisants, bornés, qui, pour justifier un salaire ridicule, pondaient des rapports interminables, ou proposaient des extensions de règlements avec une verve aussi prolixe que dénuée de sens.
S’ajoutait à son humeur exécrable du jour l’emploi de son ordinateur. Il avait bien fallu s’y atteler à cette foutue machine. Qui rendait de précieux services, c’était indéniable, mais dont le langage compliqué, et souvent en anglais, le mettait hors de lui. Ce qui était facile !
Les login et les mots de passe demandés constamment l’exaspéraient et le conduisaient, comme tout le monde, à mettre le même partout. Ce qui pouvait être dangereux si un hacker le trouvait.
— Ces gens, sans culture générale, pensait-il, ont inventé un langage qui détourne le sens des mots. C’est pitoyable. Ce sont les « diafoirus » du vingt-et- unième siècle. À cause de leur connerie on n’utilise pas le centième des possibilités de l’ordinateur.
À plus de cinquante ans, il avait pris des cours d’informatique, qu’il avait abandonnés lorsque l’essentiel pour sa fonction s’était inscrit dans sa mémoire. Et puis, il se trouvait toujours un jeune pour l’aider quand une difficulté insoluble se présentait. Comment les jeunes générations devinaient-elles aussi facilement ? Car rien ne lui semblait logique dans ce foutoir. À commencer par « cliquer », un mot que Karadec abhorrait, sur « démarrer » pour éteindre.
— Ce n’est pas la pollution, le réchauffement climatique qui nous tueront : c’est la bêtise !
Dans ces phases de révolte, il omettait volontairement la joie d’envoyer et de recevoir des e-mails, non, des lettres adressées à, et venant des Bretons de l’autre bout du monde.
Et il n’en manquait pas de ces aventuriers courageux, installés un peu partout, montant des entreprises de toutes sortes. Mais leurs liens avec la Bretagne ne se rompaient jamais et le recours aux e-mails était simplement merveilleux.
Trois petits coups sur la porte annoncèrent la secrétaire de la mairie qui apportait les journaux, acheminés quotidiennement par la compagnie maritime Penn Ar Bed, comme le courrier. En première page de Ouest France un titre accrochait l’attention : « Un citoyen russe noyé à Ouessant ». Même annonce dans Le Monde, pourtant peu enclin à ce genre de fait divers, surtout à la une. Le Figaro, Libération, Les Echos, reprenaient aussi l’information. À l’évidence, l’Agence France-Presse s’en était mêlée. Mais d’où venait la « source » ?
— Il n’y a pas que Le Coz et les gendarmes qui ont pu savoir que c’était un Russe, lança Karadec, vexé qu’ils ne lui aient rien dit. Je trouve bizarre que tous les journaux en parlent. Ouest France, d’accord, mais les autres !...
— Il s’agit peut-être d’un homme important ?… Tiens Jean-Pierre, j’ai relevé ça dans le courrier.
Elle posa une lettre de la Préfecture devant le maire.
À plus de deux mille kilomètres de Ouessant, au même moment, Igor Yvanovitch Lemeniev prit l’enveloppe ouverte que le planton lui tendait. Elle venait de l’ambassade de Russie à Paris. Il mit la cigarette à demi-consumée qu’il tenait de sa main droite dans le cendrier, et retira la lettre. On demandait de prévenir la famille d’un certain Dimitri Tcherkaïev de son décès. Résidant à Moscou, attaché militaire, il fallait également avertir sa hiérarchie, et confirmer son identité.
Afin de renforcer sa réflexion, Lemeniev reprit sa cigarette et aspira lentement l’équivalent d’un cumulonimbus de fumée. Il jeta un coup d’œil à travers la fenêtre sur la statue du prince Dolgorouki qui, indiscutablement, le narguait.
Ce n’est pas parce qu’on est le fondateur de la ville de Moscou qu’il est permis de se moquer d’un fonctionnaire de mairie. Cela durait depuis le jour de sa nomination à ce service, douze ans auparavant.
Igor Yvanovitch soupira, continuant à inhaler et rejeter l’énorme bouffée de tabac au rythme de sa respiration. Sa place au KGB était autrement plus intéressante. Quand on lui confiait un interrogatoire, il pouvait libérer ses pulsions, particulièrement avec les femmes. Son autorité faisait d’autant plus peur que son visage restait inexpressif. Comme sa voix sans aucune inflexion.
Après le grand bouleversement, on s’était débarrassé de lui en le nommant aux Archives. Avec une médaille, quand même. Sa seule satisfaction consistait à monnayer, de temps en temps, un dossier compromettant. En se le faisant remettre le « client » croyait en avoir fini avec la malédiction attachée à son passé. Au contraire, il entrait dans un cycle infernal, car Lemeniev, grâce à la démarche de l’intéressé, ayant tous les détails afférents au document, le faisait chanter sans aucun scrupule. Il conservait des copies de tous les dossiers qu’il « marchandait ».
Si la victime chantait faux ses deux associés réglaient la mélodie calamiteuse. Et il le faisait savoir par la rumeur, technique efficace pour calmer les récalcitrants.
Sa cigarette lui brûlant les doigts, il en alluma une autre avec le mégot. Il replaça la lettre dans son enveloppe, la tapota pensivement sur son sous-main, et finalement la jeta dans le grand tiroir de droite, où elle rejoignit d’autres correspondances.
Il adressa un sourire méprisant au prince Dolgorovski. Ici, c’était lui le chef. Une missive qui ne rapportait pas d’argent devait attendre patiemment son tour. Ce n’est pas un impérialiste de l’ancien temps qui allait lui dicter ses ordres. Surtout à travers la fenêtre.
oOo
Le maréchal des logis-chef Antoine Kastler guettait le professeur de russe sur le quai de la gare de Brest. Il était en tenue, et son invité ne pouvait pas le manquer. Alors qu’il s’attendait à voir un monsieur sérieux en costume cravate, tenant une serviette en cuir à la main, un jeune homme goguenard se matérialisa devant lui. Il était habillé en jean, veste et pantalon, une casquette Nike sur la tête, un journal sous le bras, et chaussé de baskets énormes.
— C’est moi le prof de russe. Salut.
— Salut… euh… bonjour. Maréchal des logis-chef Kastler.
Il se retint in extremis de le saluer militairement.
— Valerio Pavlov. C’est ma mère qui est russe. Pour lui faire plaisir, et comme ça me plaisait aussi, j’ai passé ma licence à Languezo.
— Je ne connais pas…
— Mais si : Langues orientales !
— Ah, bien sûr…
— Et après j’ai fait mon Capes.
— Oui, oui, fit Kastler tout en cherchant à quoi l’acronyme correspondait. Et vous avez beaucoup d’élèves à Saint-Brieuc ?
— Cent soixante-quatorze répartis en quatre classes ! Plus des élèves qui viennent prendre des cours privés chez moi.
Devant le Peugeot Partner tagué gendarmerie, ce fut au tour du jeune professeur de retenir un geste de refus pour monter dans le véhicule. Le militaire s’en aperçut.
— Ne vous inquiétez pas, je ne vous passerai pas les menottes.
— Excusez-moi, c’est un réflexe idiot. Mais…
Quand Kastler eut démarré la voiture, il reprit le dialogue.
— Vous avez eu un problème avec nous ?
— Oui, c’était il y a… une douzaine d’années…
— Que s’est-il passé ?
— On a… J’ai manifesté avec les copains pour faire réintégrer un élève renvoyé injustement de l’université. On s’est échauffé et vous êtes, et les gendarmes sont intervenus pour nous virer de l’établissement. Comme je vous ai traité… comme j’ai insulté un gradé, on m’a embarqué. Voilà pourquoi…
— … Vous ne voulez pas monter dans ma voiture, enchaîna Kastler. Très bien ! Je vous dépose dans un taxi, ou on continue ?
Valério Pavlov, qui appréciait l’humour du militaire, répliqua sur le même ton.
— On continue, mais vous me passez le volant et je mets la sirène ? J’adore ça !
— Désolé, je n’ai qu’un klaxon qui couine !
En arrivant à la compagnie, ils en étaient presque au tutoiement.
Après avoir bu un café, ils rejoignirent l’adjudant-chef Cartier. Les militaires installèrent Pavlov en lui étalant les documents russes sur une grande table. Ils s’assirent en face de lui, et attendirent sagement les premiers résultats de la lecture. Très vite le visage du professeur devint grave. Il releva la tête.
— Vous avez une idée de… du contenu de tout ça ?
— Non, dit Cartier. On ne sait strictement rien ! De quoi s’agit-il ?
— J’aimerais… Je ne voudrais pas avoir d’ennuis… d’être mêlé à ce qui ne me regarde pas…
— Je vous donne ma parole d’honneur que vous ne serez inquiété en rien ! Vous êtes notre traducteur, il n’y a aucun problème…
Le jeune homme hésitait à reprendre sa lecture.
— Oui… mais ce qu’il y a là-dedans est… c’est terrible !
— Ah, bon ? Dans ce cas, je vous demanderai par écrit de ne rien divulguer.
L’argument ne semblait pas le convaincre.
— J’aimerais aussi que vous ne parliez pas de moi comme traducteur.
— On n’a pas l’habitude de raconter à tout le monde les détails de nos journées, s’impatienta Cartier. Avant de les écrire, lisez-nous les textes russes… On jugera ensuite ce qu’il faut faire. De toute façon, je vous le répète, vous ne risquez rien.
Quelques heures plus tard, les trois hommes eurent l’impression qu’une bombe avait éclaté dans leur cerveau, l’éparpillant dans tous les sens.
oOo
Le général Dessailly attendait bien sagement dans l’antichambre du bureau du ministre de l’Intérieur. Il était en avance sur l’horaire de l’audience qu’il avait sollicitée en urgence.
En regardant l’agitation qui régnait dans les locaux, il se disait que le dossier enfermé dans sa serviette de cuir allait peut-être en augmenter l’intensité.
— Mais non, suis-je bête, corrigea-t-il. Personne n’en sera au courant.
Il récapitula brièvement tous les hommes qui « savaient » maintenant. Les sous-officiers, deux ; leur lieutenant, trois ; le commandant de compagnie, quatre ; le colonel commandant de région, cinq ; le traducteur, six et lui, commandant de région, sept. C’était beaucoup trop. Mais comment éviter le processus impératif du règlement hiérachique ? Impossible. Un des chaînons l’eût-il fait que les sanctions s’abattaient sur lui aussitôt.
— N’empêche que…
Il s’interdit de formuler sa pensée. Dans quelques instants il remettrait les documents au ministre, après lui avoir bien sûr fait une synthèse, la plus claire possible, du contenu.
— Et après… terminé !
Il serait bien surprenant que, dans une affaire comme celle-là, on requière ses services. Pour faire quoi ? Son contrôle sur la région Bretagne lui suffisait amplement.
Il perçut du coin de l’œil l’huissier qui se dirigeait vers lui et comprit que le ministre l’attendait. Enfin… La ministre.
À cinquante-sept ans, le général n’aurait jamais pu imaginer qu’un jour une femme serait à la tête du ministère de l’ Intérieur. Une révolution en soi. Non une évolution, tout simplement, lui souffla une petite voix au fond de sa conscience.
Il était temps qu’après des millénaires d’esclavage machiste, ces dames prennent leur revanche. Seraient-elles capables un jour d’infliger à leurs anciens maîtres les mêmes humiliations ? Pourquoi pas ?
Christine Berrieux-Mauclair lui tendait la main.
— Bonjour, général. Comment vont la Bretagne et vous-même ?
Elle était presque aussi grande que lui. Une femme exceptionnelle. Plus que belle : séduisante. Une autorité naturelle et tranquille, qui avait construit une carrière politique exemplaire. Tout d’abord député-maire, conseillère générale, secrétaire d’État, elle passait à la tête de trois ministères avant d’être nommée à l’Intérieur. Pas de scandale, pas d’erreurs non plus dans ses engagements. Une vie stable, un travail régulier, des compétences reconnues de tous, parfois avec jalousie.
Elle regagna son siège en tournant le dos au général qui put ainsi profiter de la vue sur ses jambes, lesquelles redonnaient le goût de vivre aux suicidaires. Comme toutes les femmes conscientes de leurs avantages physiques, elle ne se privait pas de les montrer en portant une jupe au-dessus du genou.
— Asseyez-vous, général… Alors, quel est le motif de votre visite dans l’urgence ?
Dessailly connaissait sa ministre pour l’avoir rencontrée quelques fois lors de cérémonies officielles. Mais il ne s’était jamais entretenu avec elle en tête-à-tête. Il ressentit soudain une timidité qui le contraria vivement. Il se força à une concentration maximale.
— Madame, je suis navré de vous apporter de mauvaises nouvelles.
Et il se lança dans sa synthèse, quittant le beau regard inquisiteur de son interlocutrice pour mieux s’exprimer.
Quand il eut fini, il la dévisagea à nouveau, et un long silence s’établit.
— Merci d’avoir insisté pour me voir aujourd’hui, dit-elle en se levant.
Elle fit quelques pas en direction de la grande fenêtre derrière le bureau, et se retourna vers le militaire.
— Vous aviez raison, général. Ce sont vraiment de mauvaises nouvelles. Qui ne sont pas sans nous rappeler quelque chose, n’est-ce pas ?
oOo
Force sept prédisait la météo marine, ce qui s’avérait juste après le lever du jour. Des masses furieuses se jetaient sur tout ce qui avait l’impudence de leur barrer la route. Avec des panaches prodigieux de milliards de gouttes devenues blanches, accaparant le peu de lumière que le ciel daignait répandre ce matin-là.
Fascinés par ce spectacle, des peintres depuis quelques siècles immortalisaient des scènes de naufrage, traduisant le tragique de la condition des hommes face à la nature en phase de violence.
Yann, le dos contre un muret, était capable de rester des heures à scruter l’épreuve de force entre le solide et le liquide, combat sans fin aux multiples nuances. Le dieu Eole, responsable de ce fabuleux désordre, exprimait des sentiments que seuls des spécialistes de la météorologie pouvaient expliquer.
Après une ultime gerbe de mer giflant le phare de la Jument dans toute sa hauteur, Yann s’arracha de sa contemplation. Il prit le chemin de Feunteun Velen où Hervé Lhostis, son ami d’enfance, l’avait convié pour l’apéritif. Peut-être resterait-il déjeuner si Marie-Jeanne, son épouse, l’invitait. Il fallait que tous les trois en eussent envie, ce qui arrivait au gré de leur humeur. Le temps des obligations, des contraintes, était révolu.
Hervé, marin de la Royale, avait occupé, en fin de carrière, le poste de capitaine de frégate, escortant des unités civiles ou militaires dans le golfe Persique. Il s’était distingué par ses capacités à détecter la moindre bizarrerie dans le flot d’informations déferlant sur cette région depuis l’invasion du Koweït par Saddam Hussein.
Grâce à son intuition et sa vigilance, des catastrophes avaient été évitées. Ce dont le monde marin lui gardait une reconnaissance témoignée chaque fois qu’il prenait contact avec ce milieu où la fidélité, le respect des valeurs humaines, l’honneur de servir son pays préservaient de la dégradation générale.
Quant à sa vie familiale, elle se passait dans la plus pure tradition ouessantine : Marie-Jeanne avait élevé leurs trois enfants et tenu la maison pendant ses nombreuses absences. Aujourd’hui, enfin réunis, c’était à leur tour d’attendre la présence de leur descendance, dont un des fils continuait le destin maritime.
Yann ressentait une amitié rare envers ce couple. Il distinguait sur leurs visages les traits toujours présents depuis la maternelle, privilège précieux de ceux qui ne se quittent jamais de la naissance à leur disparition.
Indépendamment de leur attachement, osmose particulière de leurs caractères réciproques, ils partageaient le goût d’une réserve de comportement, qualifiée par certains de culture du secret. Pourtant, à la moindre allusion, ils savaient exactement quel en était le sujet.
Ce fut Marie-Jeanne qui lui ouvrit la porte.
Si les anthropologues avaient défini la morphologie des natives de l’île, elle devait en être l’archétype de leur description. De taille moyenne, solidement bâtie, l’âge n’affaiblissait pas son énergie. Sur son visage carré, aux pommettes hautes, habité de deux yeux bleus qui cillaient rarement, une expression souriante et bienveillante s’était installée en permanence. Elle donnait l’impression de jauger son vis-à-vis, tout en étant attentive à ce qu’il disait. On se sentait bien avec celle qui participait activement à la vie de l’île, s’efforçant d’apporter des solutions concrètes aux problèmes locaux, évitant toute polémique d’ordre électoral. Ce que parfois des tordus lui reprochaient, ne sachant pas de quel « côté » elle était. Quand ils allaient trop loin dans leurs insinuations, elle leur déclarait qu’elle se trouvait du côté de ceux qui en éprouvaient le besoin impérieux : les vieux, les enfants en difficulté, les femmes seules, la liste n’étant pas exhaustive comme celle d’un scrutin. Ce qui ne se comprenait pas à chaque fois, l’étiquetage systématique étant devenu essentiel pour le monde dit évolué.
— Voilà le plus beau ! Tu arrives à tenir debout sur la côte ?
Marie-Jeanne plaqua deux baisers sonores sur ses joues glacées. Puis Yann eut droit à une poignée de main vigoureuse accompagnée d’une bourrade.
— Donne-moi ta veste, gamin.
Hervé, de deux ans son aîné, usait de cette appellation affectueuse qui procurait une sensation curieuse au « cadet ». Il remontait soudainement le temps, et retrouvait en une seconde fulgurante le souvenir du « grand » Hervé protégeant le « petit » Yann contre les méchants gamins qui voulaient le chahuter. Méchants gamins devenus ses familiers dans la communauté de l’île. À part ceux déjà embarqués pour la traversée sans retour.
— Vous devriez vous promener, ça en vaut la peine !
Le visiteur s’assit, heureux de retrouver la chaude ambiance de ce foyer.
— Oui, on ira après le déjeuner. Tu restes avec nous pour le repas ?
— Si vous m’invitez, d’accord.
— On ne t’invite pas, tu t’imposes !
— Dans ce cas, je dînerai aussi. Et demain, qu’est-ce tu as prévu au menu ?
— Si tu es là, ce sera une biscotte et un verre d’eau.
— De l’eau… pétillante ?
— Et puis quoi encore ! Tiens, bois ça en attendant.
Hervé servit trois verres de vieux Porto, leur boisson favorite, dans des verres très anciens que Marie-Jeanne avait hérités de sa grand-mère.
Ils trinquèrent délicatement, et la cuisinière les quitta aussitôt, rappelée à l’ordre par la sonnerie de sa minuterie.
— Tu as vu dans le journal, ce matin on parle encore du noyé, dit Hervé.
— Oui.
— Le journaliste suppose un règlement de comptes de la mafia russe.
— Peut-être, pourquoi pas.
— Il paraît que la mallette attachée à son poignet contenait des papiers compromettants. Comment il pouvait être au courant ? Il y a eu des fuites ?
— Va savoir. J’ai lu l’article aussi. Il invente pour faire monter la sauce, c’est courant. Avec des « si », des « peut-être », des questions sans réponses, je peux raconter n’importe quoi sur n’importe qui. Les journalistes savent très bien faire ça.
— De là, à inventer le contenu d’un dossier, il y a une sacrée marge !… Tu ne penses pas que des informations ont été volontairement communiquées ?
— Je ne sais pas. C’est possible.
— La question est de savoir par qui et pourquoi… Je pense que, comme moi, tu as déjà eu ce genre de situation à gérer ?
— Oui, mais maintenant c’est fini.
Ils sirotèrent leur Porto en évoquant, chacun de leur côté, les affaires d’intoxication de l’information auxquelles ils avaient été confrontés. Cependant Hervé nota, une fois de plus, que Yann n’avait jamais abordé la question, ni donné la moindre indication sur ses activités.
— Comme moi d’ailleurs, ajouta-t-il en pensée. Ce qui le fit sourire.
— À table les garçons ! lança la maîtresse de maison.
oOo
« On prend l’habitude des responsabilités, comme on prend l’habitude de faire du bon pain ! »
Cette maxime de monsieur Berrieux père tournait dans la tête de Berrieux-Mauclair fille, Mauclair étant le nom de jeune fille de sa mère bien-aimée. Son géniteur avait été chef d’entreprise et non pas ministre. Directeur d’une entreprise importante certes, mais dont les avatars n’entraînaient pas une cascade de graves répercussions comme celles qui se produiraient si elle n’intervenait pas en force dans cette vilaine affaire. Elle avait une haute idée de l’image de la France. Elle ne supportait pas qu’on puisse la trahir, l’affaiblir par des corruptions dans les services de la République.
— Monsieur François de Brincourt est arrivé, madame, annonça l’huissier.
— Faites-le entrer, s’il vous plaît.
Elle décida de le recevoir assise derrière son bureau, manière un peu mesquine de lui signifier son poste subalterne. Monsieur de Brincourt, directeur général de la DGSE1, chef incontesté et incontournable des services secrets, personnage qu’elle n’aimait pas mais indispensable à son ministère. Lors de leur première rencontre, elle avait senti qu’il ne supportait pas d’avoir une femme comme patron. En étudiant son dossier, elle avait admis qu’il avait quelques raisons de détester les femmes. Abandonné par sa mère à l’âge de quatre ans, une belle-mère surgissait un peu plus tard et déversait sur lui une haine violente. À l’âge d’homme, il s’était mal marié et, lors de son divorce, une harpie qui lui servait d’épouse, non seulement l’empêchait de voir ses deux enfants, mais les dressait avec soin contre lui. Il se vengeait en détruisant des hommes par le pouvoir obscur qu’il avait conquis, et vouait à la société le trop-plein de haine qu’on lui avait transmis. Intelligent, intuitif, ne craignant ni Dieu ni Diable, doué pour l’organisation aussi bien que pour l’action, il était devenu dans ses fonctions un homme redoutable et efficace, accomplissant des tâches peu reluisantes, inéluctables dans le fonctionnement d’un pays. Mais aussi des opérations magnifiquement réussies dont ce même pays lui devait une grande reconnaissance, dans la plus parfaite ignorance de la part des citoyens. Seuls quelques parlementaires soupçonnaient son rôle dans ces situations délicates où tout se joue dans l’ombre avec acharnement.
Madame Berrieux-Mauclair soupira. Il fallait bien composer avec lui. La double porte capitonnée s’ouvrit. Monsieur « Tout-le-monde » entra.
— Comment un individu aussi quelconque peut devenir ce qu’il est aujourd’hui ? se demanda-t-elle, comme chaque fois qu’elle le voyait. Elle se reprocha aussitôt cette pensée stupide car, justement, à son poste, c’était un atout formidable. Il ne faisait pas peur et n’en était que plus dangereux.
— Bonjour, madame le ministre.
Elle lui tendit la main en se soulevant à peine de son siège.
— Bonjour, monsieur le directeur. Asseyez-vous, je vous prie.
Elle afficha un sourire crispé, s’efforçant à une attitude austère pour mieux conforter l’importance de l’entrevue. Lui, au contraire, arborait un air décontracté, comme si les positions étaient inversées. En détaillant son visage rond, sa calvitie prononcée, la ministre comparait sa physionomie avec celle de l’acteur Gérard Jugnot, l’humanité et l’éclair de malice dans l’œil en moins.
— Que me vaut l’urgence de votre convocation, madame ?
— On vous a peut-être signalé la présence d’un Russe noyé sur la côte de l’île d’Ouessant ?
— Non, euh… si, je l’ai lu dans le journal en effet. J’aurais dû m’en inquiéter ?
— Le général Dessailly est venu m’apporter hier des documents, avec leur traduction, que ce monsieur détenait dans un attaché-case fixé à son poignet par une chaînette. J’ai aussi les rapports de la gendarmerie de Brest et celui du légiste de l’hôpital établissant les circonstances de la mort.
Elle marqua une pause afin d’obtenir une attention plus soutenue de la part de Brincourt qui semblait se moquer éperdument du fait divers.
Sans succès. Elle enchaîna son récit.
— Ce qui est troublant dans le compte rendu du légiste est le fait que l’homme ne soit pas mort de noyade mais de pleurésie, vraisemblablement.
— Il y a un doute ? demande Brincourt, plus par politesse que par intérêt.
— Je ne crois pas, il est certain qu’on lui a introduit de l’eau de mer dans les poumons pour accréditer la thèse de la noyade.
Subitement, le directeur de la DGSE s’éveilla.
Rien de tel qu’une invraisemblance, une démarche inhabituelle ou un début d’énigme pour mobiliser son esprit. Son changement d’attitude fut assez sensible pour que madame Berrieux-Mauclair s’en aperçût. Elle continua.
— Ce Russe, monsieur Dimitri Tcherkaïev, était attaché militaire et venait de Moscou. On a trouvé sur lui une lettre de sa femme, une photo où elle apparaît avec ses enfants, son passeport et deux cartes, une de crédit de la Kommerzbank, l’autre d’un club de tir, ainsi que deux tickets de cinéma pour une séance au Grand Rex à Paris.
À nouveau, elle interrompit son exposé. Mais cette fois, Brincourt ne la quittait pas des yeux.
— Vous verrez, dit-elle, dans le rapport du légiste, une autre curiosité : d’après lui Tcherkaïev aurait souffert de malnutrition. Ce qui ne cadre pas avec son statut d’attaché militaire… Venons-en maintenant aux documents de la mallette…
Enfin, son spectateur était harponné, elle pouvait ménager ses effets. Elle ouvrit la chemise devant elle et fit semblant de revoir ce qu’elle savait maintenant par cœur. En relevant la tête, elle constata la réussite de cette vieille technique issue du cabotinage théâtral.
— Un premier document décrit, à mots couverts, des livraisons de marchandises dans des petits ports des côtes normandes et bretonnes, avec des relais par voitures rapides pour acheminer ces marchandises sur des aéroports civils, perdus au fond de la campagne, ou des trajets directs vers l’étranger. Il est certain qu’un code est employé pour désigner les hommes et les moyens. La brigade de recherche qui a étudié les documents, ainsi que les gendarmes qui ont lu le texte traduit sont formels : il s’agit d’un énorme trafic de drogue, non seulement en France mais aussi en divers pays d’Europe. Deux autres documents, dans le même style, relatent, eux, des livraisons d’armement. Des armes de guerre aussi bien lourdes que légères. Les pays concernés vont de l’Estonie à l’Irak. Les flux des trafics, eux, dans tous les sens avec deux points importants mentionnés : les ports du Havre et de Brest. Tous ces textes ont été traduits du russe, évidemment. Une des questions qui se pose concerne la connaissance ou la complicité de membres du ministère de la Guerre russe. À moins que Tcherkaïev, travaillant seul, profitât de son statut privilégié pour corrompre les magasiniers de l’armée, ou traiter directement avec les fabricants d’armes.
Elle s’arrêta, laissant à Brincourt l’initiative d’une réaction. Ce fut un incroyable éclat de rire. Elle resta abasourdie, le temps qu’il reprenne son souffle.
— Pardonnez-moi, dit-elle sèchement, j’ai dû faire une plaisanterie sans m’en apercevoir.
Il eut encore un ou deux soubresauts hilares.
— Excusez-moi… Effectivement, je pense que vous avez raconté une plaisanterie sans vous en rendre compte…
— Ah, bon ? J’aimerais bien que vous précisiez…
La colère était perceptible dans le ton employé. Et elle fut perçue.
— Ne vous irritez pas, Madame. C’était plus fort que moi… Cette histoire est exactement celle que les Anglais ont inventée en 1943 pour faire croire aux Nazis que les alliés allaient débarquer sur les côtes de Sardaigne et de Grèce. Tout y est. Le pauvre bougre clochard mort de pleurésie dans un hôpital, déguisé en agent du Gouvernement, les faux papiers d’identité, les photos de la fausse famille, jusqu’aux tickets du cinéma qui, dans la version originale, était à Londres. Il y avait aussi cette mallette attachée au poignet gauche renfermant des documents secrets magnifiquement falsifiés… Le piège avait parfaitement fonctionné puisqu’Hitler avait déplacé ses divisions, dégarnissant inconsidérément les zones où le débarquement a réellement eu lieu…
Elle le fixa agressivement dans les yeux.
— Croyez-vous, monsieur, que je suis assez niaise ou inculte pour ne pas l’avoir compris ?
François de Brincourt réalisa sa bourde. Toute trace de rire disparut de son visage.
— Je vous prie de m’excuser, c’est…
— Je n’ai pas fini de « raconter », comme vous dites, coupa-t-elle. Effectivement, le cadavre et sa mallette, déposés par un sous-marin en 1943 sur les côtes d’Espagne, ont bien atteint leur but. Donc je voulais vous demander, si vous êtes en mesure d’apprécier la situation, quelles sont les erreurs auxquelles on veut nous induire ? Là est l’essentiel.
Elle devenait cinglante, et le chef des services secrets fut bien forcé d’admettre qu’il l’avait mérité.
—