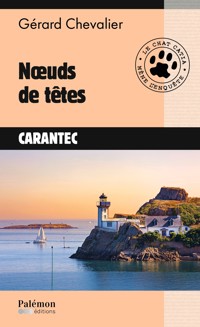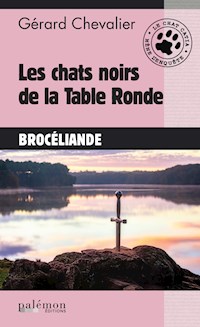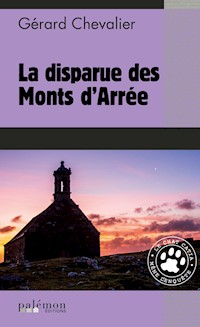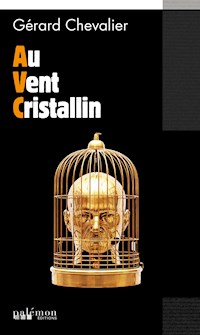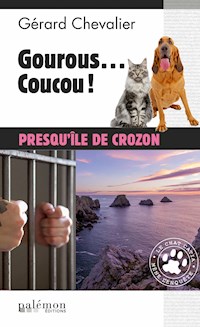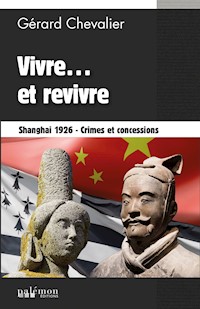Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le Commandant Garnier vit dans un paradis de nature au cœur de la Normandie, auquel il voue aussi ses loisirs entre rénovation de bâtiments anciens, parties de pêche et observation de la gent ailée. L’activité de son commissariat d’Argentan, dans l’Orne, reste plutôt calme.
Aussi lorsqu’une personnalité locale est assassinée dans le parc de sa belle demeure, les remous ravagent la tranquillité ambiante. En binôme avec la capitaine Fougère, également sa belle maîtresse épisodique, Garnier commence une enquête dans ce milieu provincial où la population réticente ne se livre pas volontiers.
Alors que Garnier prend une semaine de vacances en Bretagne à Roscoff chez son beau-frère marin-pêcheur, il est rappelé d’urgence : le meurtrier a de nouveau sévi. Il n’existe pourtant aucun lien entre les victimes.
Les investigations de Garnier et Fougère vont les plonger dans le monde impitoyable de l’édition littéraire, à la poursuite d’un tueur insaisissable…
Avec ce nouveau polar drôle et sensible, Gérard Chevalier lève le voile sur une part de lui-même, nous laissant découvrir son amour pour la France profonde, sa campagne, ses animaux, son patrimoine… Un vrai petit bijou !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Influencé toute sa vie par ses deux grands-pères, l’un, directeur du journal L’évènement fondé par Victor Hugo, l’autre, héros de la guerre 14-18, Gérard Chevalier va être artiste peintre, décorateur, maquettiste, acteur, metteur en scène, scénariste. Il devient auteur de romans policiers en 2008. Son premier ouvrage Ici finit la terre a remporté le Grand Prix du Livre Produit en Bretagne, le Prix du Roman Policier Insulaire à Ouessant, le 2e prix du Goéland Masqué. Suivent L’ombre de la brume, La magie des nuages, Vague scélérate et la série humoristique Le chat Catia mène l’enquête qui rencontre également un véritable succès. Vivre…et revivre est le neuvième roman de Gérard Chevalier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Meurtre en pleine page
En buvant mon bol de café, tout en caressant d’une main ma belle table de ferme en merisier, j’aperçois, au travers de la porte-fenêtre de ma cuisine, un pic mar sur la pelouse. C’est une vision qui va me donner du courage pour ma médiocre journée. Ma maison… mes maisons – j’en ai trois perdues dans la nature – sont le grand réconfort de ma vie. Je passe mon temps libre à les restaurer, plus exactement à les sauver. Ce qui remplace avantageusement le sport que je n’aime plus. Je les ai achetées peu après mon mariage pour une somme dérisoire aujourd’hui. Elles étaient au bord de la ruine, mais belles quand même, et l’endroit m’apparaissait magique au fond de son impasse, au milieu des champs et des bois. Cadeau suprême : un petit étang envasé, habité par quelques carpes. Je l’ai fait curer en même temps que mes premiers travaux. Étant un adepte inconditionnel de la pêche à la ligne, je suis allé tremper mon bouchon partout autour de moi pour rapporter le plus d’espèces de poissons vivants possibles pour le repeupler. Je me suis même rendu à Paris avec ma vieille camionnette pour acheter des écrevisses chez un marchand spécialisé. Quatre cent cinquante kilomètres aller-retour. Je les ai transportées dans des bassines emplies d’eau avec des serpillières dessus pour maintenir le liquide. C’était un 22 décembre et, à onze heures du soir, j’ai tout d’abord échangé, à l’aide d’une louche, l’eau de l’étang avec celle des bassines pour ne pas choquer les bestioles. Quatre mois plus tard, j’observais des bébés écrevisses nager entre les plantes aquatiques naissantes. Une récompense plus importante que l’augmentation de mon salaire. Oui, je sais, je suis « allumé », comme disent mes collègues. Mes collègues flics, et j’en suis devenu un aussi… Après mon bac, je voulais devenir pilote de chasse.
Depuis l’école communale, les avions me faisaient rêver. Je les connaissais tous, ceux de Ader, Blériot, Mermoz, Saint-Exupéry, jusqu’aux Rafales, F-15 ou 16, MiG-29, et autre Sukhoï. Mes grands-parents m’offraient toutes les reproductions qu’ils trouvaient, parfois difficilement, comme le Messerschmitt ou le Spitfire. Et puis, dès le premier examen, j’ai été refusé par l’armée de l’Air : la vision de mon œil gauche était deux dixièmes en dessous de la norme. Rédhibitoire. Ça ne m’empêche pas de mettre cinq balles au cœur de la cible à cinquante mètres, en visant de l’œil droit. Que l’armée de l’Air aille se faire mettre.
Je finis tranquillement mon café. Le pic mar s’est envolé, mais ma petite cabane en bois plantée sur un piquet a des clients. Je l’ai placée près de mon vieux poirier, dans l’axe de la porte et, grâce aux graines dont je la pourvoie, la gent ailée – mésanges, moineaux, fauvettes, verdiers, ou sittelles torchepots qui dégringolent du tronc la tête en bas – vient picorer, les individus se chassant les uns les autres. Je les observe et les photographie en oubliant tout.
Tout, c’est-à-dire essentiellement ma vie personnelle un peu ratée, et ma vie professionnelle limitée. Ma femme vient me voir quand elle en a envie, une fois tous les quinze jours, quelquefois plus. Nous n’avons pas d’enfant.
Quant à mon boulot… Mon divisionnaire ne m’apprécie que par intermittence. Il ne sait pas très bien qui je suis, dit-il. Moi non plus ! Mes seules certitudes sont d’aimer mon métier, à condition qu’on me fiche la paix, et de ne pas avoir d’ambition. Je ne suis bien que sur le terrain, et j’ai horreur de tout ce qui est paperasse et réunion. Moi qui déteste la chasse aux animaux, je suis un enragé de la chasse à l’homme. De tous les salopards. Et ils ne manquent pas. Quand je suis lâché sur une piste, rien ne peut me faire abandonner. Pas même un ordre. Ce qui m’a valu quelques mises à pied. Jamais graves. Cela m’a permis de refaire le toit de ma plus vieille maison. Un petit baron anglais l’a construite en 1440, pendant la guerre de cent ans. La façade sur la cour est un peu de guingois, mais avec des linteaux sculptés magnifiques. L’autre, qui donne sur l’étang, a été refaite entièrement, au siècle dernier je pense. Un four à pain intact qui se charge en bois par une porte dans la cheminée au dessus du foyer. On en faisait encore après la guerre, jusqu’aux années 60, date de sa cessation d’activité. Quand j’ai commencé à restaurer, j’ai trouvé parmi des fagots des caisses de munitions allemandes, trace de l’occupation. Vides bien sûr. Le tout trempé par la pluie qui passait par les trous des tuiles effondrées.
Si cette maison existe, c’est grâce à la source d’eau pure qui sourd sur son pignon est, et alimente l’étang. Au XVe siècle, une source privée était vitale. Cela pourrait bien le redevenir avec tout le saccage exercé par des gens inconscients et stupides.
Le baron vivait dans une pièce (celle de la cheminée du four) avec sa famille. Six mètres sur six. L’autre, avec aussi une cheminée, était occupée par les gardes, les soldats, ou je ne sais qui. Dans la pièce noble, le foyer possède deux colonnes sous le linteau monumental : celle de gauche indique son grade, celle de droite sa lignée, selon le code héraldique anglais de l’époque. Je peux confondre la droite et la gauche, n’ayant été renseigné qu’oralement, et je n’ai rien noté.
Je rince mon bol dans l’auge à cochon que j’ai transformée en évier, avec des petits carrelages anciens dans le fond. Ceux que j’ai démontés du grenier, maintenant aménagé avec deux chambres et une salle de bains.
Autrefois, les grains de blé, le fourrage, avaient plus de valeur que les occupants des lieux. On carrelait proprement l’étage à la chaux sur une épaisse couche de boue mélangée avec de la paille, le tout sur du plancher de chêne reposant sur les solives. Le sol du rez-de-chaussée se couvrait de terre battue, bien lissée. D’où l’utilisation, afin de ne pas trop l’abîmer, de chaussons de feutre enfilés dans des sabots de bois pour aller à l’extérieur.
Huit heures. Je ferme la maison. En montant mon chemin pour entrer dans la voiture, je longe le garage en bois, plein de ce que j’amasse continuellement : vieilles poutres, ferrailles, vieux outils. Plus le tracteur-tondeuse. Donc, pas de place pour ma Renault. Tant pis. Elle a l’habitude. L’hiver, la température peut descendre à moins vingt degrés, pas longtemps. En ce cas, je couvre le capot d’une épaisse couverture avec quatre briques dessus pour la maintenir.
En ouvrant la portière, le bruit fait fuir une grosse buse variable, perchée au sommet du poteau de la ligne téléphonique.
Salut ma belle, bonne journée !
Je file sur Argentan : dix-neuf kilomètres. Belle petite ville. Les entreprises côtoient les commerces. Il fait bon vivre ici. Les Normands sont courageux, entreprenants, tout en gardant la notion du bien-être et des traditions. Je déteste les grandes villes. On y perd tout, les repères de qualité de vie, le sens des valeurs et de la solidarité, et surtout le temps, gaspillé en contraintes diverses : transports, attentes dans les administrations, files interminables pour les spectacles à succès, les expositions d’artistes célèbres, ou les caisses des magasins incontournables.
Un tracteur surgit devant moi dans un virage sur la petite route du Mont Dufour. Coup de klaxon. Il se range sur le bas-côté. Je m’arrête à sa hauteur.
— Salut, Raymond ! On empêche les gens de passer ?
— Ben oui ! Surtout vous !
— Mais c’est carrément de la provocation ! Ça peut vous coûter cher !
— C’est sûr ! Au moins un p’tit jaune quand vous rentrerez !
— Non, deux ! Bonne journée !
— À c’soir !
Mon cher Raymond, mon ami depuis que je suis là. On n’arrive pas à se tutoyer, mais notre relation n’a pas besoin de cette particularité. La confiance et l’estime nous unissent. Son accent du terroir me met en joie, bien que parfois mon incompréhension lui fasse répéter sa phrase. On a toujours quelque chose à se dire en buvant notre Pastis, Pastis chez lui, Ricard chez moi. Il a mes clefs au cas où je m’absenterais longtemps. Il faut tondre ma pelouse, et je tiens à ce que le jardin soit toujours bien entretenu. Je pourrais lui confier mes finances, le soin de ma vieille mère, tout ce qui régente ma vie, sans aucune crainte. Raymond incarne l’honnêteté, la morale, la probité d’une époque révolue. Avec cependant un caractère bien affirmé. Il est vieux garçon. Je ne me suis jamais permis de lui en demander la raison. La réponse je la connais :
— C’est comme ça !
Circulez ! Il ne vous reste plus qu’à boire !
Je débouche sur la D916, direction Rânes. La bourgade où je fais mes courses pour mon approvisionnement de base. Le « 8 à Huit », et son excellent rayon boucherie, le boulanger et sa tarte aux pommes, la pharmacie avec le sourire de l’aimable praticienne.
Rânes connaît une augmentation de douze pour cent du nombre de ses habitants. Peut-être commence-t-on à comprendre, tout au moins dans cette région, où se trouve la qualité du quotidien.
Un homme sur le passage piéton traverse devant ma voiture en me saluant. Monsieur Dugrais, mon garagiste-carrossier. Du genre qu’on ne fait plus. Sachant tout réparer, ou presque.
D924. Au rond-point avant Écouché, je prends la voie express qui me conduit jusqu’à la ville, et le lieu de mon boulot. Le commissariat est situé au 36 de la rue Saint-Martin, numéro clin d’œil à celui du quai des Orfèvres, face à la superbe église du même nom, laquelle a mis deux siècles pour se construire, du XVe au XVIIe. Son style est un pur gothique flamboyant. Elle est bâtie sur pilotis car la zone était marécageuse. Les marécages aujourd’hui ne sont plus qu’humains. Le quartier est très agréable, bien aménagé avec des arbres, et des rues entrecoupées de lignes de pavés modernes, plats et bien jointoyés.
Sur le plan esthétique, le lieu me convient. Sur le plan relationnel, ce n’est pas la même chose. Certains disent que je suis ingérable, d’autres que je ferais un excellent charpentier ; heureusement, Colette est là. Ma coéquipière, comme dans les films. Non, bien plus que ça.
Quand je pousse la porte, en biais sur la rue Saint-Martin et l’allée Goupil-de-Préfeln, un vent de folie me décoiffe. Ça crie, ça court, et le planton ne me regarde même pas, accaparé par son téléphone. Je gagne mon bureau désert en attendant qu’on veuille bien me renseigner sur la panique ambiante, à cette heure matinale. Je ne suis pas en retard, il est huit heures trente-deux. Je vais pour sortir du classeur mon dernier dossier en cours, lorsque la sonnerie de l’appareil antique posé à côté m’intime l’ordre de décrocher.
— Commandant Garnier, j’écoute.
— Tout de suite dans mon bureau !
Clac ! C’est clair, mais très irritant. Je prends tout mon temps pour parcourir les quelques mètres qui me séparent du grand patron, le commissaire divisionnaire Peltier.
En ouvrant la porte, je la cogne sur un collègue ! Le local est saturé de tout le personnel de l’établissement. Un événement important est arrivé, à l’évidence, mais « on » a oublié de me prévenir. Ce qui me met immédiatement en colère.
— Ah ! Garnier. Apparemment, vous n’êtes pas au courant : monsieur de La Raitière a été assassiné tôt ce matin. Et…
— Pourquoi ne m’a-t-on pas averti ?
Le patron me fusille de ses yeux globuleux.
— On verra ça plus tard ! beugle-t-il. Tessier, résume-nous ton intervention.
Tessier, évidemment. S’il pouvait me rouler dessus avec son Ford 4x4 sans être inquiété, il n’hésiterait pas une fraction de seconde. Il ne m’adresse la parole que lorsqu’il y est absolument obligé. Alors transmettre une information…
— Monsieur de La Raitière habite un manoir près de Silly-en-Gouffern. C’est une résidence secondaire, la principale étant à Paris. Il est insomniaque, et se promène dans son parc tôt le matin. Sa femme, ne le voyant pas venir pour prendre son petit-déjeuner, est allée à sa recherche et l’a trouvé allongé dans l’herbe, inanimé, un trou au milieu du front. Elle nous a appelés, sur le point de s’évanouir, ce qu’elle a fait durant notre conversation téléphonique. Nous sommes partis, Leterrier et moi, et avons découvert madame de La Raitière en compagnie du docteur Thirion qu’elle avait joint. Sur ses indications, nous nous sommes rendus auprès du cadavre de monsieur de La Raitière. Nous avons constaté en effet un trou dans le front, provoqué par une arme de petit calibre, du 22 certainement. Ni dégradation, ni vol de quoi que ce soit. Madame de La Raitière nous a assuré qu’aucun litige ou conflit quelconque ne les opposait à quiconque. Son mari est général d’infanterie à la retraite, fils d’une grande famille, sans histoires. Ils vivent confortablement, sont épicuriens, et intéressés par les domaines artistiques et littéraires. Leurs deux enfants, deux fils, des hommes d’affaires, viennent les voir souvent lorsqu’ils sont ici, avec femmes et enfants, ce qui les réjouit. On les a prévenus, ils sont en route. Il n’y a pour le moment aucune piste à suivre. La P.T.S1 passera dès qu’elle le peut. J’ai laissé Hugo garder le corps. On a tout de même extrait la balle pour l’envoyer tout de suite à l’analyse.
Un silence méditatif suit son récit.
— Merci, Jacques. J’ajouterai que je connais personnellement le général de La Raitière, que je fréquente notamment lors de parties de chasse dont il est amateur. C’est un homme… C’était quelqu’un de très agréable, loin du cliché de l’ancien militaire rigide et sans humour. Cette histoire va faire du bruit dans tous les milieux, y compris politiques, étant donné sa responsabilité à la tête des troupes qui ont combattu en Afrique contre divers troubles au Tchad, au Rwanda, et au Mali. Il a toujours été bien vu par nos gouvernements successifs. Je n’aime pas ce genre d’affaire qui va nous contraindre à fouiller partout, à remuer éventuellement des trucs pas propres. D’abord, enquête de voisinage à Silly-en-Gouffern, et à Paris rue de Babylone où se situe leur appartement. Ça, c’est le plus facile. Ensuite, les mains dans le cambouis. Mais attention ! Avec diplomatie, on n’est pas dans le 9-3. Alors, Jacques, tu es toujours sur le braquage du Leclerc ? Rien de nouveau ?
— Non, mais je peux…
— Tu vas rester dessus. Garnier, tu n’es pas débordé, tu vas te charger de l’enquête avec…
— Je peux quand même…
— Non ! Je ne préfère pas ! Garnier et Fougère, vous prenez le cadeau.
— Patron, ce n’est pas…
— Suffit, Tessier, tu obéis !
Je suis avec les anges en train de lui faire une aile d’honneur. Si seulement il pouvait exploser de rage devant tout le monde !
— Vous deux, vous restez avec moi. Fin de la réunion. Vous pouvez disposer.
Hypocritement, nous ne nous regardons pas, Colette Fougère et moi. Toute la boîte est au courant de notre affection réciproque, et de notre bonne entente professionnelle. Elle est mariée à un proviseur de lycée. Ils ont un grand fils qui veut devenir violoncelliste. Je les connais tous les deux. Deux personnalités… spéciales. En revanche, eux ne savent pas que des liens plus qu’intimes nous unissent, Colette et moi, par intermittence, en toute liberté. Nos collègues supposent cette relation, mais en restent au stade d’allusions supportables.
— Ce que je voulais vous communiquer, dit le boss, une fois tout le monde sorti, ce sont mes recommandations. Soyez polis, discrets, ne choquez pas la famille avec une quelconque agressivité de langage. Il va falloir les faire parler beaucoup pour dénicher un début de piste. Essayez de vous inclure dans leur monde. Je suis à peu près sûr que l’enquête de voisinage ne donnera rien, mais bien entendu, vous devez la faire. Vous avez carte blanche pour vos déplacements, à condition de ne pas vous offrir des hôtels 4 étoiles !
— Ah bon ? risque Colette, sentant le patron de bonne humeur.
Elle a raison, sa remarque l’amuse.
— Enfin si, mais à vos frais ! Allez ! Je compte sur vous. Vous pouvez jouer la carte de ma tristesse d’avoir perdu quelqu’un que j’estimais beaucoup… Ah, et puis… faites un effort vestimentaire, surtout à Paris.
— Je peux m’acheter un tailleur Chanel, patron !
— Uniquement Tati. Au boulot !
Nous sortons ragaillardis du bureau directorial. Il est réconfortant de se retrouver sur une affaire. Cela ne nous est pas arrivé depuis quatre mois. Ce n’est que dans ma voiture, alors que je sors d’Argentan, que nous échangeons un rapide baiser… sur les lèvres.
Cela fait quatre ans que nous vivons une histoire d’amour en pointillé, quand le volcan de nos phéromones se réveille, après une phase d’oubli. C’est alors, à chaque fois, une explosion de sensualité qui demande du temps pour rassasier nos envies. Raymond dirait : « Eh oui ! Y a pas d’mal à s’faire du bien ! »
Claude Peltier, mon chef (il y a également un commissaire adjoint qui est mon supérieur direct), se doute aussi de notre connivence privée, mais fait semblant de l’ignorer. C’est un homme intelligent, intuitif, qui dirige son équipe avec maestria. Manipulateur, quelquefois sournois, d’un autoritarisme paternaliste, il sait se faire respecter et obtenir de nous le maximum, même de moi qu’il considère comme un OVNI au sein de la police. Notre binôme le satisfait car il sait, quels que soient nos rapports en mission, que nous lui donnerons un bon résultat. C’est la seule chose qui compte. Il s’est passé pas mal de temps avant que je comprenne qui il est vraiment. Il faut dire que son physique est à l’inverse de ses capacités. Assez grand, les cheveux courts, sa corpulence est importante. Curieusement, son embonpoint généreux présente une harmonie : tout est rond chez lui, y compris sa tête, supportée par une encolure de taureau, dont il a le tempérament. Mieux vaut ne pas être devant lui quand il fonce. Même s’il sait très bien se maîtriser, quand la hargne le submerge, sa dialectique étincelante démolit instantanément l’interlocuteur qui l’a provoqué. Ses yeux bleu clair perforent littéralement le pauvre vis-à-vis qui s’effondre dans son silence. C’est un homme cultivé, à la mémoire exceptionnelle, qui aime la vie. Il n’a jamais mélangé le privé et le professionnel, et sa discrétion ne nous permet pas de connaître quoi que ce soit de lui dès qu’il sort du commissariat. Sinon qu’il fréquente des gens haut placés, aussi bien dans l’Orne, notre département, qu’à la capitale. Mais ça, tout le monde le sait. Je le soupçonne également de dissimuler soigneusement ses sentiments. Je n’ai jamais su s’il éprouvait de la peine, de l’enthousiasme ou de l’empathie pour quelque chose ou quelqu’un. À peine devine-t-on s’il est de bonne ou mauvaise humeur, en ayant conscience qu’il peut jouer la comédie pour tirer avantage de la situation. Enfifré, va ! Je ne sais pas moi-même si j’ai de l’estime ou de la déconsidération pour lui. Vraisemblablement l’un ou l’autre, en alternance.
— Arrête-toi ! lance Colette.
— Ah ? Pourquoi ?
— Tu verras bien.
Me doutant de ce qui va se passer, je choisis un petit chemin avec un bosquet d’arbres. Sitôt le frein à main serré, elle m’attrape en m’embrassant comme si nous venions de voir un film classé X. Je réagis spontanément et essaie, après plusieurs secondes, de la repousser.
— Tu n’as pas envie ?
— À ton avis ? J’ai l’air dégoûté ?
Et nous nous dévorons encore un peu.
— Oui, je sais, ce n’est pas le moment. Tu veux bien me déposer chez moi ?
— Mais…
— Il faut que je me change pour aller au manoir, autrement qu’en tenue « poulet fermier ».
Elle a raison. Vêtue d’un pantalon informe et d’un anorak usagé, elle a l’allure d’une cliente de l’Armée du Salut. Quand on connaît ce que ces frusques recouvrent…
— C’est vrai. On y va.
J’opère un demi-tour, avec l’impression que je vais passer ma journée à attendre le moment de lui sauter dessus. Impression qui devient certitude quand elle ressort de chez elle en tailleur à la jupe courte, sous un manteau trois-quarts bien coupé. Un chemisier blanc s’entrouvre sur une gorge que je sais parfaite. Des bas noirs et des escarpins à hauts talons finissent l’ensemble qui va faire de moi un obsédé. Que ne suis-je moine cistercien en train de cultiver mon potager… Mon expression hallucinée n’est pas pour lui déplaire, mais elle ne m’embrasse pas en cours de route car elle s’est maquillée et ne voudrait pas que je me présente barbouillé de rouge à lèvres. J’ai juste le droit de vérifier avec ma main libre à quelle hauteur s’arrête la dentelle élastique de ses bas. Je décide de cesser mon investigation avant que la Renault sorte de la route toute seule.
Le manoir des De La Raitière, baptisé « La Galière », est situé, comme beaucoup de bâtisses de ce genre, au bout d’une allée flanquée de hêtres implantés dans un grand terrain bordé de bois. Un étang bucolique, de taille respectable, sommeille sur la partie ouest de la propriété. La construction date du XVIIe siècle. Elle n’est pas très longue, avec une tour carrée abritant l’escalier à vis qui dessert l’étage et les combles. L’ensemble est sobre, bien proportionné, et invite à la vie sereine. Un petit bassin, avec une statue au milieu, occupe l’esplanade gravillonnée de la façade principale. Une belle roseraie, entourée de massifs de buis taillés bas, agrémente l’espace de la façade arrière.
Une dame âgée, habillée d’une robe noire recouverte d’un tablier bleu à fleurs, vient à notre rencontre, alertée par le bruit de mon véhicule. Instinctivement, je me suis garé sur le côté de la cour, pour ne pas gâcher la vue de cet édifice raffiné avec l’anachronisme de mon vulgaire carrosse.
— Bonjour. Z’êtes le monsieur et la dame de la police ?
— Oui. Bonjour, madame. Commandant Garnier, capitaine Fougère.
— Madame vous attend dans le salon.
Elle a l’accent des natifs du coin, comme je l’aime, mais que je ne comprends pas toujours. N’est-ce pas, Raymond ? Anne-Marie de La Raitière est debout devant un piano demi-queue, appuyée sur une canne au pommeau en ivoire. Elle est élégante dans sa robe de grand couturier, bien qu’elle ne soit pas récente. C’est une belle septuagénaire, aux traits aristocratiques, cependant ravagés par le choc douloureux qu’elle vient de subir.
Nous nous présentons, et je sidère Colette en faisant un baisemain à notre hôte, le plus distingué possible. La dernière fois, il y a vingt-cinq ans, c’était en hiver, j’avais la goutte au nez, et je l’avais déposée sur la main que la femme me présentait.
— Asseyez-vous, je vous prie. Puis-je vous offrir un café ou un thé ? J’en prendrais un volontiers.
Nous acquiesçons, et la servante sort pour nous préparer nos boissons. Colette me laisse l’initiative de l’entretien.
— Le commissaire Peltier vous présente ses condoléances, et me fait dire qu’il viendra vous voir dans la soirée. Nous vous présentons également les nôtres, en imaginant aisément votre peine après tant d’années de vie commune heureuses. Je vais utiliser un cliché rabâché : nous allons tout faire pour arrêter l’assassin de votre mari. Croyez-moi, nous sommes déterminés, ma collègue et moi. Nous allons vous poser quelques questions, si vous êtes d’accord. Sinon, nous reviendrons ultérieurement.
— Non, non, ce n’est pas la peine. Malheureusement je ne sais rien, ne comprends rien à ce drame… je…
Elle a un spasme nerveux, et nous attendons, gênés, qu’elle reprenne possession d’elle-même.
— Vos… collaborateurs tout à l’heure semblaient irrités du peu d’informations dont je disposais. J’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur aussi.
Tessier ! Encore lui ! Je devine aisément ses manières grossières envers cette pauvre femme meurtrie. Je ne sais pas comment, mais je vais te le faire payer, minable !
— Rassurez-vous, madame. Nous vous demandons de nous répéter vos propos de ce matin, mais surtout de nous décrire votre contexte d’amis, de relations, votre façon de vivre afin, peut-être, de découvrir un petit détail qui vous paraît anodin, mais que nous jugerons intéressant, de par notre expérience.
Colette a pris le relais avec tact.
La veuve approuve d’un hochement de tête, tandis que la servante revient avec nos cafés. Entre deux gorgées d’un délicieux filtre maison – ça change du robot –, Colette continue l’interrogatoire. Comme annoncé, madame de La Raitière ne sait rien, ne comprend rien, et nous l’orientons rapidement sur la description de son entourage. Cela lui fait du bien de parler de sa famille, de ses amis, de ses petits-enfants qui vont arriver. Mais rien dans ce qu’elle nous relate ne recèle le moindre événement, le moindre conflit pouvant constituer un élément « à creuser », comme nous, les flics, disons dans nos expressions de métier. Mon amie s’investit de plus en plus dans son questionnement, je commence en inversion proportionnelle à m’ennuyer. Je jette quelques coups d’œil sur les jambes qui me narguent, ayant de mon fauteuil Louis XV une perspective intéressante, dévoilée par la jupe relevée de Colette. Je dois faire un effort considérable pour réintégrer notre enquête.
— C’était mérité, mais c’est une histoire ancienne, achève de dire la générale.
Zut, j’ai raté une information. Heureusement, Colette demande des précisions.
— Cela s’est passé il y a combien de temps ?
— Une quinzaine d’années environ, à la fin de notre séjour au Tchad.
— Et vous n’avez plus jamais entendu parler de ce monsieur ?
— Non. Il a dû finir son engagement, et partir en retraite.
— Le montant de sa retraite a été diminué, compte tenu de sa destitution, je suppose.
— Peut-être. Je ne suis pas au courant des règlements militaires. Il me souvient simplement que mon mari était furieux contre cet homme qui avait manqué gravement à son devoir. Surtout envers un membre de notre famille.
— C’est compréhensible. Avez-vous retenu son nom ?
— Pas du tout. Mais dans les archives de l’Armée, au château de Vincennes, vous retrouverez facilement la trace de cette histoire. Nous avons un ami qui va souvent dans ce service, il vous aidera. Je vais vous donner ses coordonnées.
Je me maudis d’avoir décroché mon attention. Ce n’est pourtant pas mon habitude. Tandis que madame de La Raitière va chercher l’adresse de leur ami, Colette me regarde bizarrement. Elle me connaît bien, et s’est rendu compte de mon absence. Probablement.
Lorsque nous sommes en possession de la carte de visite du colonel Taillebois à Paris, qui nous introduira aux archives de Vincennes, nous prenons congé de la générale, et nous dirigeons vers l’endroit où son mari a été abattu. Tessier a laissé en place notre jeune gardien de la paix, Hugo. Il a gelé la scène avec les rubalises, les cordons de sécurité délimitant l’espace. Nous la repérons de loin.
— Tu étais où pour avoir raté un début de piste ? me demande Colette en cours de chemin.
— Je n’ose pas te le préciser. Peux-tu combler mon vide, s’il te plaît ?
Elle secoue la tête en haussant les sourcils.
C’est bon de se faire gronder ! Quelle va être ma punition ?
— Une nuit au Tchad, dans une zone dangereuse, une sentinelle, qui gardait le campement en poste avancé, s’est endormie. C’était un adjudant-chef de carrière. Des rebelles se sont introduits entre les tentes et ont volé des armes. Une autre sentinelle a ouvert le feu et s’est fait descendre en riposte. Elle a été sérieusement blessée, et est décédée peu après. C’était un cousin des De La Raitière. Les assaillants ont pris la fuite. Quand le général a appris les faits, il a traduit l’adjudant en cour martiale et l’a fait destituer. Il aurait pu être bien plus sévèrement condamné, mais c’était un bon élément, décoré plusieurs fois pour actes héroïques. Il n’a pas admis le jugement dont il a rendu le général de La Raitière seul responsable. Voilà ce que tu as manqué. Je n’en reviens pas.
— Ouais ! C’est ça. Mais tu étais là, ma chérie, pour pallier mes déficits mentaux.
— Arrête !
— Oui, chef !
Son sourire est une atteinte à la pudeur. Mais nous sommes arrivés à bon port et le métier reprend le dessus.
En parcourant des yeux le paysage sur trois cent soixante degrés, je me rends compte qu’il n’est pas très difficile de se dissimuler derrière les nombreux grands chênes. D’après la position du corps dans l’herbe, sachant que la victime a reçu une balle tirée face à lui, on obtient comme emplacement du tueur un bouquet d’arbres compact, lieu idéal pour ajuster le tir. Le général regarde le ciel, possédant maintenant la sérénité éternelle. Nous nous dirigeons vers les arbres, et examinons minutieusement le sol, ce que Tessier a déjà dû faire. L’herbe haute est particulièrement piétinée derrière un gros tronc. Sans aucun doute le tireur devait être posté à cet endroit, à cent mètres de sa cible. D’autres rubalises entourent le fût. Nous nous enfonçons dans le bois, en essayant de garder en vision les herbes couchées par le déplacement du meurtrier. Ce qui nous amène à un large layon coupant le bois dans sa longueur. Comme la terre est très sèche, on ne peut constater aucune trace de pneu récente. Moto ou voiture, l’assassin s’est enfui par là sans difficulté.
Lors de notre retour vers la scène du crime, je profite d’être à couvert pour attraper Colette, la plaquer contre un arbre, et assouvir provisoirement par une exploration in situ ce désir qui m’empêche de penser librement. Je suis conforté dans mon action par une acceptation qui déborde largement le cadre d’un simple consentement.
Un peu plus tard, sur la route du retour vers Argentan, ayant récupéré mes facultés de raisonnement, je propose à mon équipière de nous rendre à Paris le lendemain.
— Ce n’est pas absolument nécessaire, me répond-elle. On pourrait obtenir des informations par téléphone.
— Oui, mais ça nous permettrait de passer une nuit ensemble, ce qui n’est pas arrivé depuis des siècles. Et puis, avec un peu de chance, de remonter une piste possible.
Elle médite un instant, affichant ce sourire qui me liquéfie.
— En effet, ce sous-officier a peut-être gardé une rancune tenace envers l’homme qui a détruit sa fin de vie.
Comme elle n’ajoute rien, je caresse délicatement son genou.
— Et… C’est tout ?
— Enfin, voyons, commandant ! Je suis en service.
— Ah, je vois…
Elle éclate de rire. Je lui prends une main et l’embrasse, laissant à nouveau mon imagination vagabonder. Ce qui dure très peu, notre trajet n’étant pas long. Et puis, mon instinct assoupi de chasseur d’homme sort de sa torpeur. Ce crime n’est pas aussi banal qu’il en a l’air, me dit ma conscience, alors que je ne lui ai rien demandé. Il va falloir parler avec les enfants, demander aux quelques voisins s’ils n’ont rien remarqué, dès que nous reviendrons des archives militaires.
Alain, le policier de l’accueil, nous précise que le patron nous attend. C’est un exploit, car il est douze heures trente-deux, et il devrait déjà être parti déjeuner chez son restaurateur attitré.
— Alors ? demande-t-il sans préambule, dès la porte de son bureau franchie.
Nous lui dressons le tableau classique de la veuve éplorée par un meurtre qu’elle ne comprend pas, qu’elle n’admet pas. Avec quand même la possibilité d’une vengeance, à laquelle elle ne croit pas. Nous terminons en lui proposant d’aller vérifier si l’ex-adjudant s’est déplacé cette nuit, en allant d’abord l’identifier à Vincennes avec l’aide d’une relation de la générale. Sa décision est vite prise.
— N’attendez pas demain. Partez tout de suite. Téléphonez à l’officier pour lui dire que vous arrivez. S’il s’agit du coupable, vous le coincez ce soir, avec l’aide du commissariat local. Vous me téléphonez à ce moment-là et je vous appuierai. Je garde mon portable allumé. Ah ! Voilà le rapport de la balistique. J’ai mis la pression à tout le monde pour l’avoir. Ce n’est pas commun.
Il me tend le document, et nous nous rapprochons pour le lire. C’est bien un petit calibre, du 22 long rifle, tiré avec vraisemblablement une carabine, copie de l’USM1 de l’armée américaine, équipée d’une lunette de visée étant donné la distance. La munition est de marque Remington, en cuivre. La portée du tir va jusqu’à un kilomètre cinq cent. Une arme assez employée, en vente libre. Obligation est faite de la déclarer à la gendarmerie proche de son propriétaire.
— Allez déjeuner et prenez la route après.
Devant nos mines un peu étonnées, il ajoute :
— Oui, bien sûr, prenez quand même un sac de voyage. Tenez-moi au courant.
Il se lève, va chercher son éternel chapeau au portemanteau alors que nous sortons.
— Attendez !
Il fouille dans son portefeuille dont il sort une carte qu’il nous tend.
— On ne sait jamais. Voilà la carte de Michel Guillerm, mon camarade de promo. Il est commissaire dans le IXe arrondissement de Paris. Si besoin, vous l’appelez. Ah, oui, j’oubliais : passez au 8 rue de Babylone dans le VIIe. Vous fouinerez chez les voisins des De La Raitière. Bonne chance !
Il nous quitte avec une vitesse surprenante pour sa masse corporelle.
— La faim justifie les moyens ! commente Colette, mezzo voce.
Je n’aurais pas osé.
Tessier est invisible, ce qui vaut mieux pour lui. Mon ressentiment à son égard pourrait s’exprimer de manière violente. Malgré moi, alors que je déteste les violents, je peux le devenir. Cela m’a valu, je l’ai déjà dit, une ou deux mises à pied. Trois même. La mauvaise foi, la méchanceté gratuite, me font déborder de cette maîtrise personnelle acquise si péniblement.
Nous avalons un bon sandwich, un ballon de côtes-du-rhône et un café dans notre bistrot favori près du tribunal, autre lieu que nous connaissons bien. Je commence par aller chez Colette. Je ne l’attends pas plus de quinze minutes dans la voiture, avant qu’elle ne revienne avec un grand sac en cuir, ayant organisé ses obligations familiales. Elle ne s’est pas changée, sûrement pour me faire plaisir. Elle connaît mes goûts en matière de vêtements féminins. Il faut ressentir de puissantes pulsions sensuelles pour avoir envie de filles habillées comme des ouvriers du bâtiment, alors qu’elles sont sorties en soirée.
Direction La Chaux, ma tanière. À moi de m’équiper pour notre mission. Colette n’y vient que très rarement. Ici tout se sait. Il y a toujours un œil au coin d’une haie, d’une prairie, ou en haut d’un tracteur. Ou un regard par la fenêtre quand on passe devant, à pied ou en voiture. Normal. Il n’arrive pas grand-chose quand on est cinquante habitants dans un village qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Les naissances, les communions, les mariages, les accidents, les enterrements. Les incendies aussi, les meurtres. Donc on scrute, on épie… Comme tout le monde connaît tout le monde… même ceux qu’on ne connaît que par ouï-dire… les rumeurs circulent vite !
Mon bagage est rapidement fait. C’est une petite valise à roulettes calibrée pour être admise même chez Ryanair, la compagnie la plus pingre au monde. Colette revisite la maison, rêve un peu devant l’étang. Elle m’embrasse délicieusement avant de sortir, alors que j’ai fermé la porte et les fenêtres de la cuisine. Nous partons à regret.
On est tellement bien dans ce vaisseau de pierre qui vogue à travers le temps, depuis peu avant la Révolution. Ses blocs de granit ont été superbement taillés à la main, assemblés au mortier de terre. Des linteaux monumentaux ont été soulevés par des hommes qui aimaient l’effort et le travail bien fait. Et qui en plus avaient la notion des belles proportions, et savaient tenir compte de l’orientation. Il y a déjà eu des esquisses de règlements obligatoires pour enrober ces merveilles de matériaux isolants ignobles, afin d’économiser l’énergie ! Alors qu’on construit toujours avec des parpaings bruts !
Un dernier coup de pied pour fermer le volet récalcitrant de l’entrée principale, une dernière brutalité pour boucler le portail en bois que j’ai fabriqué, et l’expédition commence. Joué-du-Bois, Carrouges, Sées, Mortagne, Verneuil, Dreux, Paris. Avec toujours, depuis plus de cinquante ans, les embouteillages dans les deux sens pour traverser Saint-Rémy-sur-Avre. Je n’étais pas né. Il faut des décennies dans notre beau pays pour parer à l’urgence. Rester immobile, coincé dans ma voiture, me rend fou. Je prends n’importe quel chemin à droite ou à gauche pour m’extraire de ce bourbier.
J’ai téléphoné au colonel Taillebois avant de partir. Lorsque nous arrivons au Château de Vincennes, il a laissé des ordres, et nous sommes introduits très vite dans son vaste bureau qu’il partage avec trois autres militaires en activité, alors que Taillebois est en retraite. Mais, d’après ce que j’ai compris, il a consacré une grande partie de sa vie à ce service.
L’accueil est chaleureux. Le bonhomme est à l’opposé du genre : grand, un peu voûté, les cheveux en bataille, il ressemble plus à un artiste peintre qu’à un officier, même en retraite, impression renforcée par une pipe de bruyère qui exhale le parfum musclé du tabac Amsterdamer. Il l’enlève de sa bouche pour nous saluer.