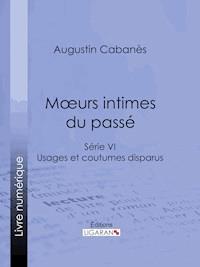
Extrait : "Quand on remonte à l'origine des pratiques médicales, plusieurs points d'interrogation se dressent : D'où vient la purgation ? - Qui a donné l'idée du clystère ? - À qui restituer l'invention de la saignée ? Autant de questions qui attendent leur solution..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Dans un traité de médecine sociale, la saignée devrait tenir une grande place. »
Docteur J.-M. GUARDIA.
Quand on remonte à l’origine des pratiques médicales, plusieurs points d’interrogation se dressent : D’où vient la purgation ? – Qui a donné l’idée du clystère ? – À qui restituer l’invention de la saignée ? Autant de questions qui attendent leur solution ; car, vraiment, on ne peut tenir pour sérieux le propos d’ELIEN, contant que la purgation fut indiquée aux Égyptiens par les chiens, qui se font vomir en mangeant du chiendent ; ou celui de GALIEN, qui fait remonter à l’ibis l’emploi du clystère.
Pour la saignée, plusieurs opinions ont été émises, dont la moins singulière n’est pas celle de CICÉRON, assurant que l’homme tient de l’hippopotame l’usage de cette médication ! Vous vous demandez comment l’hippopotame… Le bon PARÉ, qui est la crédulité même, va nous aider à vous répondre.
L’hippopotame, écrit le plus grand chirurgien du XVIe siècle, l’hippopotame (qui est un cheval de la rivière du Nil), nous a enseigné la phlébotomie, lequel estant de nature, gourmand et glout (pour glouton), se sentant aggravé de plénitude de sang, se frotte contre les roseaux rompus les plus piquants, et s’ouvre une veine de la cuisse, pour se décharger tant que besoin lui est, puis se vautrant dedans la fange, s’estanche le sang.
LOYS GUYON, praticien réputé en son temps, prétend que c’est aux sangsues que doit être reporté le mérite de la saignée : « comme on n’en pouvait trouver en hiver, les médecins y suppléèrent au moyen de la phlébotomie » .
Après la légende, consultons l’histoire. À croire le géographe Étienne de Byzance, la saignée aurait été inconnue de la haute antiquité. PODALIRE, fils d’Esculape, se serait, le premier, avisé de tirer du sang à son semblable, dans le but de le soulager.
Au retour de la guerre de Troie, Podalire avait été jeté, par une tempête, sur les côtes de Carie (Asie Mineure) ; à peine avait-il mis pied à terre, qu’un envoyé du roi venait le prendre, pour le conduire auprès de la fille du monarque, qui, en se laissant choir du toit du palais, s’était blessée grièvement. Podalire l’examine et, sans plus attendre, la saigne aux deux bras ; heureuse inspiration, car la malade, dont l’état semblait désespéré, revint presque instantanément à la vie. Le narrateur ajoute que, pour reconnaître un pareil service, le roi ne trouva, pour le sauveur de sa fille, de meilleure récompense que de la lui donner pour femme .
Il ne semble pas que cette cure, pourtant remarquable, ait mis la saignée plus en faveur qu’elle ne l’était auparavant. La seule citation à relever chez les Grecs est la suivante : THÉMISTOCLE aimait si éperdument une de ses esclaves que, lorsqu’on la saignait, il se lavait le visage avec le sang qui coulait des veines de sa bien-aimée.
Faut-il en induire que la saignée était, à l’époque de Thémistocle, très répandue à Athènes ? Ce serait hâtivement conclure : ce qui est positif, c’est qu’il ne se trouve point mention de cette opération dans l’Écriture .
Dans l’histoire romaine, un seul fait à relever et il n’est pas très démonstratif : au dire d’Aulu-Gelle, l’usage d’ouvrir une veine et de tirer du sang aux soldats qu’on voulait frapper d’une peine infamante, remonterait à la plus lointaine antiquité . « Je n’en trouve pas, dit-il, la raison dans les anciens écrits que j’ai pu me procurer, mais je pense que ce fut d’abord moins un châtiment qu’un remède, pour les soldats dont l’intelligence était troublée et l’activité engourdie.
Dans la suite, la saignée devint un châtiment , et on prit l’habitude de punir ainsi différentes fautes, sans doute dans l’idée que celui qui commet une faute est un malade . »
Cette idée d’appliquer la phlébotomie comme châtiment, nous la retrouvons au Moyen Âge.
Le Ménagier de Paris (écrit en 1393) rapporte qu’un bourgeois, mécontent de sa femme, manda un barbier pour la saigner. On commença par faire chauffer le bras droit de la patiente, pour y attirer le sang, puis le barbier exécuta son office ; sans doute le mari voulait-il par là calmer la « frénésie » de son épouse : traitement à la fois barbare et ironique !
À cette époque, la saignée est partout en honneur ; lus qu’un remède, c’est une panacée à tous les maux.
Au treizième siècle, le Livre des Métiers la cite parmi les causes qui dispensaient bourgeois et ouvriers de s’astreindre au service du guet. On se faisait saigner à propos de rien et à propos de tout ; parfois, pour mêler son sang à celui d’un ami, gage d’une profonde et éternelle affection .
Les règles monastiques la prescrivent à des périodes déterminées : les Chartreux s’y soumettent cinq fois l’an ; les Prémontrés, quatre fois. Il y a des jours fixés, dans chaque couvent, pour cette opération : on les désigne par l’expression de « jours malades » ou « de minution » ; l’opérateur est qualifié de minutor. Car tous les jours ne sont pas bons pour la saignée : il faut éviter les mardi, mercredi et vendredi, surtout pendant la canicule.
Les Normands disent :
Le minutor était le plus souvent un moine, car les moines étaient depuis longtemps initiés à la pratique de l’art médical. Des règlements furent même édictés, sinon par des moines, du moins par des ecclésiastiques . Vers le septième siècle, un archevêque de Cantorbéry prescrit de ne pas saigner pendant le premier quartier de la lune, et tous se conforment à la prescription. Dom Calmet fait observer que « ce n’était pas là une mortification puisque, au contraire, c’était une sorte de délassement, et que l’habitude prise, on ne pouvait plus s’en passer . »
L’opération avait lieu en été, après none ; en hiver, après vêpres. Pendant les trois jours qui suivaient, la nourriture de la communauté était un peu augmentée, les religieux restaient assis et couverts durant les offices, et se recouchaient après matines .
Le pouvoir civil avait établi, lui aussi, des règles, mais c’était pour enrayer les abus nés d’une trop grande licence. De fortes amendes étaient infligées au phlébotomiste maladroit, ou à celui qui opérait en dehors du père, de la mère, du frère, du fils, de l’oncle, ou d’un proche du malade l’opération de la saignée étant livrée au premier venu, il convenait de s’entourer de quelques précautions.
L’enseignement de l’école fixait les conditions d’âge, de constitution du patient, le choix de l’endroit où il devait être placé : ni trop humide, ni trop sec.
La saison n’était pas non plus indifférente : en dehors des saignées dites de nécessité, que les circonstances imposaient, il y avait des mois, des heures propices . Une fois la saignée terminée, certaines précautions restaient à prendre : ni trop manger, ni trop boire, et surtout rejeter loin de soi la tentation dont saint Antoine eut tant de peine à se défendre. Les Salernitains, qui nous donnent ces indications, vont jusqu’à formuler le régime alimentaire convenable : tels légumes, tels fruits sont interdits, tels autres autorisés. Éprouve-t-on quelque répugnance pour l’opération, ils ont tôt fait de rassurer et d’encourager les pusillanimes : la saignée ne rend-elle pas joyeux les tristes, et ne fait-elle pas que « les amoureux ne soient plus amoureux ? »
Exhilarat tristes… amantes
Ne sint amantes phlebotomia facit.
Mais le manuel opératoire ne sera précisément indiqué que plus tard, dans l’ouvrage du plus célèbre chirurgien du quatorzième siècle, GUY DE CHAULIAC.
Voici le portrait, que nous donne le grand praticien, du médecin appelé à exercer la cérémonie de la saignée, – car le rite en était soigneusement réglé.
« Le saigneur doit être jeune, habile, clairvoyant et accoutumé à saigner et qu’il soit muni de bonnes lancettes à diverses pointes. » Puisqu’il est incidemment question de lancettes, ouvrons une parenthèse.
(D’après une miniature d’ancien manuscrit, le Galien, de Dresde.)
Les uns en ont attribué l’invention aux Italiens, les autres aux Français. Guy de Chauliac est-il le premier à en avoir parlé ? Le fait est possible, mais il paraît avéré que les Romains s’en servaient déjà ; car on a découvert, dans les fouilles d’Herculanum, deux instruments en bronze, dont la forme répond assez bien à celle d’une lancette ; plus tard, on a exhumé du même endroit un phlébotome à lame d’argent. L’Arabe ALBUCASIS a employé des lancettes à lame étroite, à lame myrtiforme et à lame olivaire ; ce petit problème de priorité est donc assez malaisé à élucider.
Pour en revenir à la pratique du médecin moyenâgeux, voyons comment il s’y prenait pour ouvrir la veine.
… Ayant frotté la partie liée d’en haut avec une bandelette, la veine bien avisée et trouvée, avec le bout de l’indice (index), tenant sa lancette avec deux ou trois doigts, il l’ouvre doucement, non en perçant du tout ainsi en relevant aucunement, afin que l’artère et le nerf ne soient blessés. Et quand suffisante évacuation est faite, le membre délié, la plaie soit diligemment fermée avec coton et la ligature.
L’ouverture faite, le patient doit tenir – recommandation importante – un bâton et remuer les doigts. Il aura eu soin, au préalable, « d’ôter les pierres (s’il en porte dans sa bourse ou en anneaux) qui ont vertu d’arrêter le sang ».
Il serait oiseux d’énumérer les veines que l’on soumettait à la saignée. Signalons toutefois l’humérale externe, à laquelle l’imagination de nos ancêtres attribuait des propriétés spéciales contre les maladies de la tête : d’où son nom de céphalique ; l’axillaire ou humérale interne, dénommée basilique, en raison de l’importance de son rôle ; enfin, la salvatelle, qui prend son origine entre les bases des doigts auriculaire et annulaire : la saignée de la salvatelle assurait le salut des malades atteints d’affections du foie, de la rate, des poumons, des reins, etc.
Nous avons dit que, sauf les cas d’urgence, il fallait choisir la saison pour la saignée de telle ou telle veine.
En hyver, on ouvre les veines senestres et en été les dextres, parce que les humeurs que nous cherchons de vuider en ce temps-là sont plus situez ès dites parties, dont il y a un vers :
On sait quelle influence exercèrent les astres en médecine durant plusieurs siècles. Après avoir attribué à cette influence l’aggravation ou l’amélioration de l’état des malades, on lui subordonna la pratique des émissions sanguines.
La saignée n’était jamais plus salutaire que dans le second quartier de la lune, parce que la lumière de notre satellite brillant alors de tout son éclat, la force de cet astre est plus prononcée : c’est l’opinion de Pierre d’ABANO ; quant à ARNAULD DE VILLENEUVE, il place dans le milieu du troisième quartier le moment le plus favorable.
Parmi les signes du Zodiaque, le Taureau, les Gémeaux, le Lion, la Vierge, le Capricorne, sont tenus pour moins favorables que les autres ; et comme chacun de ces signes est en rapport avec l’une des parties du corps, il se trouve des médecins qui refusent de saigner d’un membre, au moment où la lune parcourt le signe correspondant . Dans certaines villes, les statuts. prescrivaient aux barbiers de ne saigner qu’en bonne lune .
Au Moyen Âge la saignée est la base à peu près unique de la thérapeutique. Pour les médecins de ce temps, s’il existe trop d’humeurs, la pléthore se produit et le sang est infecté par voie de conséquence. Il y a donc presque toujours lieu de purifier les humeurs, par l’évacuation de ce sang plus ou moins vicié.
La saignée ne saurait être, en raison de cette théorie, que parfaitement légitime, dans la majorité des maladies, aussi est-elle efficace à peu près dans toutes ; on peut même l’appliquer pour provoquer une diversion : saigner à gauche, par exemple quand il existe un apostème (tumeur ou abcès) à droite, etc.
Et c’est une médication si commode à régler.
Pour Guy de Chauliac, la saignée doit être préférée à n’importe quel médicament, et la raison qu’il en donne est simple : « La saignée, dit-il, est arrêtée quand on le veut, tandis qu’il est impossible d’arrêter l’effet d’un médicament ingéré. » D’ailleurs, elle n’est jamais nuisible, en vertu de ce dilemme, en cours à l’époque : « Si le sang que vous retirez est mauvais, tant mieux qu’il soit sorti ; s’il est bon, celui qui reste est encore meilleur. » Ce que nous traduirions aujourd’hui avec une non moindre élégance : si cela ne fait pas de bien, cela ne peut faire aucun mal.
Nous avons fait connaître les préjugés plus ou moins illusoires, qui se liaient à la pratique des évacuations sanguines, dans la période plusieurs fois séculaire que nous venons de parcourir. Mais cette médication, dont si grande est la place dans les antidotaires du Moyen Âge, qui avait le privilège de l’appliquer ? Ce ne sont point, comme on pourrait le croire, les chirurgiens ou les maîtres en médecine, mais de plus infimes servants de notre art, les barbiers ; or, non seulement les barbiers ne connaissaient rien en fait de médecine, mais ils étaient à ce point dépourvus d’éducation, que certains auteurs leur recommandent de ne pas opérer en état d’ébriété, ou dans la fatigue qui suit l’abus des plaisirs charnels (sic).
On sait que la corporation des barbiers était placée sous la direction du premier barbier, valet de chambre du roi. Sans doute n’y était pas admis qui voulait : il fallait avoir subi des épreuves avant de se servir du rasoir ou de la lancette, mais ces épreuves n’étaient guère redoutables ; d’autant que les chirurgiens de Saint-Côme, trouvant indignes d’eux les opérations que nous désignons aujourd’hui sous le nom de petite chirurgie, telles que la scarification, la pose des ventouses, la saignée, les abandonnaient aux barbiers. Ce n’est que vers la fin du quinzième siècle que la Faculté imposera à ces derniers de suivre un cours de chirurgie.
Grâce à leur entente, les barbiers avaient conquis peu à peu des privilèges notables. Ils avaient été dispensés du guet cinq ans avant les chirurgiens de Saint-Côme ; dès 1731, ils obtenaient leurs statuts, qui leur étaient confirmés douze ans plus tard. Ces statuts leur permettaient de saigner dimanches et fêtes, mais ils défendaient au barbier d’exercer son métier, « au cas qu’il sera réputé et notoirement dyffamé » de tenir et avoir « hostel de bordelerie et maquerelerie » ; défense leur était signifiée de raser et de saigner les lépreux ; injonction leur était faite que « le sang qu’ils aront en escueilles de chaux « qu’ils aront sainié la matinée soit mis hors de leurs maisons et enfoui en terre dedans leurre de midi, sous peine d’amende » .
Entre autres règlements curieux de la même époque, il en est un que nous devons mentionner à cette place, en ce qu’il se rapporte aux barbiers et à la saignée. Le Ban des Barbiers de Douai ne permettait pas que l’on se fît raser le dimanche ; voici la formule textuelle de cette interdiction :
Que nuls barbieurs ou barbieresses ne rasent le dimanche, si ce n’est nouveau prestre ou nouvelle couronne ( ?) ou enfant nouveau-né ou personne par nécessité commandant de le faire.
Qu’ils ne soient si hardis barbyers ou barbieresses de jeter dans l’eau ou rivière de cette ville le sang des saignées par eux faites, mais le portent dans les champs avec les chaviaulx (cheveux) et rasures qu’ils auront, le plus loin de la ville qu’il sera possible, et qu’ils les enfouissent ou fassent enfouir, à peine de dix livres d’amende et de bannissement de la ville .
(D’après une gravure de 1519.)
Dans quelques villes, l’on s’est efforcé de restreindre, d’empêcher même, pendant certaines heures du jour, la circulation des porcs : un règlement de Malines va jusqu’à menacer de confiscation ceux de ces animaux que l’on trouvera dans l’église ou au cimetière ; et le motif de cette mesure, c’est qu’on redoutait particulièrement que les barbiers ne leur jetassent le sang humain qu’ils tiraient à leurs clients : aussi leur défendait-on de tenir de ces animaux et de déverser le sang dans un endroit accessible. À Bruges, par surcroît de précaution, le couvent de Saint-André fit donation à la ville d’un terrain destiné à recevoir le précieux liquide, que l’on entourait d’une sorte de respect superstitieux .
En dehors de la porte Saint-Honoré, l’endroit où commence aujourd’hui la rue Molière, il y avait jadis un terrain consacré, un lieu bénit, qu’on appelait la Place du Sang : c’est là que chirurgiens et barbiers de Paris étaient tenus de venir jeter le sang provenant des saignées ou d’autres opérations faites par eux.
La méthode des émissions sanguines générales, déclare un historiographe de la saignée , porte les traces de l’influence exercée sur la médecine par l’action rénovatrice de la Renaissance. Dès avant cette époque, l’étude des auteurs grecs originaux s’est substituée à l’enseignement des Arabes. Un fait à l’appui : au printemps de 1514, de nombreux cas de pleurésie s’étaient manifestés dans les environs de Paris ; un médecin du nom de BRISSOT rompt nettement avec la tradition, qui commandait d’ouvrir la veine du côté opposé au mal : Brissot saigne, contrairement à l’enseignement des maîtres, du côté de la douleur. Cela n’alla pas sans discussions, où partisans comme adversaires de la nouvelle méthode se chamaillèrent non sans vivacité.
(D’après un bois de 1520.)
En dépit de ces divergences, la saignée compte un nombre de plus en plus grand de fanatiques. À entendre ces derniers, elle donne issue à toutes les humeurs, guérit les fièvres continues, la méningite et la parotidite, l’hépatite et la splénite, la néphrite et la métrite, voire même les arthrites !
Il n’est pas de meilleur moyen préparatoire à la cure de la lues venerea par le gaïac, etc. Mais, avares ou prodigues du sang de leurs semblables, les médecins, quels qu’ils soient, assignent une limite à la saignée, en précisent les indications.
Nul n’a encore osé ériger en méthode universelle la phlébotomie. Cette audace, un Italien va l’avoir.
Leonardo BOTALLI, honoré de la confiance de deux rois, Charles IX et Henri II, venu du Piémont en France, à la suite de Catherine de Médicis, profite de sa situation privilégiée, de la faveur dont il jouit tant à la Cour qu’à la ville, pour vulgariser son système. Femmes ou enfants, jeunes gens et vieillards, tout le monde est, d’après lui, justiciable de la lancette.
Le sang récent étant toujours meilleur que l’ancien, pourquoi hésiter ? La grossesse elle-même ne saurait être une contre-indication : Botal, du moins, l’affirme et prétend le prouver, en citant le cas d’une de ses clientes, qui a subi avec succès, étant enceinte, onze saignées qui, pour la plupart, ont retiré presque une livre de sang à chaque coup.
On devra donc saigner dans l’épilepsie et l’hystérie ; on saignera dans la phtisie et les hydropisies : Botal n’établit point de distinction, plus ou moins subtile, entre ces diverses affections. Quant à la veine dont on fera choix, il faut qu’elle soit suffisamment large : on ne tire jamais trop de sang.
La syncope elle-même ne doit pas arrêter le saigneur. Il y a des patients qui faiblissent, quand on leur a retiré seulement six onces ; ira-t-on s’effrayer pour si peu ? Un homme, d’après Botal, peut, sans compromettre sa vie, perdre en un jour, par la saignée, de 6 à 9 livres de sang et supporter, dans le mois qui suit cette évacuation, une saignée nouvelle. Avec un pareil apôtre , tous les excès étaient à craindre. Aussi quelle fureur sanguinaire anima ses disciples !
En 1609, le médecin LE MOYNE avoue – il se vante sans doute – qu’il a, en quinze mois, tiré douze cents palettes de sang à une jeune fille : la palette de Paris représentait trois onces au moins . Le Moyne enleva donc 225 livres de sang à sa cliente, qui, d’après la théorie alors admise, aurait renouvelé entièrement son sang plus de neuf fois en quinze mois. Louis XIII, que son médecin BOUVARD fit saigner quarante-sept fois en un an , n’avait donc pas le droit de se plaindre. Rappelons, à ce propos, que l’enfant-roi avait été saigné pour la première fois, à la basilique du bras droit, par Ménard, chirurgien de la reine mère .
Les esprits les plus pondérés sacrifiaient à cette mode funeste. Ambroise Paré rapporte qu’il saigna vingt-sept fois, en quatre jours, un jeune homme de vingt-huit ans. Riolan établit que chaque malade peut perdre sans péril la moitié de son sang. « Les Allemands et les Flamands, ajoutait-il, en ont trente livres ; les Français n’en ont que vingt. » D’après ces données, les premiers peuvent en perdre impunément quinze livres, en quinze ou vingt saignées, il est vrai ; mais il fait grâce à ses compatriotes et les tient quittes pour dix .
Le jour de la Saint-Barthélemy, l’impitoyable Tavannes criait dans les rues : Saignez, saignez ; les médecins disent que la saignée est aussi bonne en ce mois d’août comme en mai ! Mais Tavannes avait ses raisons, tandis que les médecins n’avaient d’autre prétexte à leur prurit sanguinaire que la mode, la tyrannique mode, dont on pourrait dire ce que Mme Roland disait de la Liberté, au pied de l’échafaud révolutionnaire : « Que de crimes on commet en ton nom ! »
Il faut voir avec quelle inconscience les saigneurs à outrance parlent de leur offensive manie. « Il ne se passe de jour à Paris, écrit Gui PATIN, que nous ne fassions saigner plusieurs enfants à la mamelle… Toutes les fois que l’on ouvre les petits enfants morts de la petite vérole, on ne manque jamais de leur trouver quelque chose de mal dans le poumon… Le grand remède à tout cela, c’est de les saigner de bonne heure et même plusieurs fois . »
Une fille de Louis XIV ayant succombé en bas âge, à la suite d’une saignée pratiquée par les médecins de la Cour, Gui Patin, tout à la joie de dauber sur ses confrères, les accuse de l’avoir saignée mal à propos .
Cet usage de saigner les enfants était nouveau, si l’on en croit Mme de Sévigné . « De mon temps, écrit-elle, on ne savait ce que c’était que de saigner un enfant. »
La correspondance de Gui Patin abonde en détails relatifs à la saignée : on n’a qu’à l’ouvrir au hasard.
Un M. MANTEL tombe malade d’une fièvre continue : il en réchappe, malgré trente-deux saignées.
(D’après une estampe de 1536.)
Un ami du satirique, un de ses correspondants habituels, BELIN, ayant quelques accès d’une tierce mal réglée, est saigné quatre fois ; puis sept ou huit accès extrêmement rudes étant survenus, huit nouvelles saignées sont pratiquées ; et, par surcroît, il est purgé à outrance ; enfin, le malheureux à bout de forces et toujours tourmenté par la fièvre, part pour Troyes, où il arrive dans l’état le plus misérable.
Le fils aîné de Gui Patin tombe malade d’une fièvre continue : son impitoyable père le tire de ce mauvais pas, par le moyen de « vingt bonnes saignées des bras et du pied » ; avec, en plus, une douzaine de bonnes médecines. Cela ne l’empêcha point de mourir phtisique à l’âge de quarante et un ans ; il n’est pas douteux que les « bonnes saignées », prescrites par son entêté de père, ont été la cause de cet épuisement et de sa mort. Mieux encore : un des petits-fils de Gui Patin, âgé de trois mois, prend froid et contracte une bronchite : « deux saignées et force lavements le garantissent. »
Gui Patin lui-même se fait saigner sept fois, pour « un méchant rhume ». D’ailleurs, toute la famille y passe, jusqu’au beau-père, à qui son terrible gendre fait tirer neuf onces de sang, « quoi qu’il ait quatre-vingts ans ».
(D’après une gravure du XVIIe siècle.)
Gui Patin traitait même le mal de dents par la saignée ; il écrivait, le 19 juin 1661, à son ami Falconet :
J’eus hier une grande douleur de dents, laquelle m’obligea de me faire saigner du côté même : la douleur s’arrêta tout à coup, comme par une espèce d’enchantement. J’ai dormi toute la nuit. Ce matin la douleur m’a un peu repris, j’ai fait piquer l’autre bras, j’en ai été guéri aussitôt .
Au temps du Grand Roi , nul n’était à l’abri de la lancette des chirurgiens. C’était un engouement pour la phlébotomie, comme, en d’autres temps, pour la purgation ou le clystère.
En 1658, le roi tombe malade. M. du Sausoy est d’avis que S.M. doit être saignée : Vallot s’y oppose ; M. du Sausoy lui répond :
Monsieur, je vous connais bien ; le roi a besoin d’être saigné, et le doit être ; si vous ne trouvez pas bon mon avis, je ne m’en soucie pas, non plus que je ne vous tiens point capable de juger le différend.
Le roi fut saigné. « On l’a saigné neuf fois en tout », s’écrie triomphalement Gui Patin.
Louis XIV apportait un soin particulier au choix de son phlébotomiste ; à partir de 1703, la saignée royale fit partie des attributions du premier chirurgien. Le 5 mai 1704, Georges Mareschal débutait dans ses fonctions et saignait le roi pour la première fois. Il s’y prit, au dire des chroniqueurs, fort adroitement.
Comme tout ce qui concernait le roi, la saignée donnait lieu à un cérémonial minutieusement réglé.
Au chevet du lit, le premier médecin, une bougie à la main, éclairait le bras de Sa Majesté. Près de lui, l’apothicaire « de quartier » tenait la première « palette » ; un aide, muni de plusieurs autres vases, suivant la quantité de sang que l’ordonnance médicale prescrivait de faire couler, devait successivement les tendre à l’apothicaire. Quand tout était préparé, le chirurgien-opérateur possédait un privilège spécial : il pouvait faire sortir de la chambre royale ceux des spectateurs qui lui déplaisaient.
Après la saignée, le premier chirurgien bandait soigneusement le bras du roi, et demeurait près de son lit jusqu’au moment du lever ; quand les officiers de la chambre aidaient Sa Majesté à revêtir ses habits, il veillait à ce que le pansement ne fût pas déplacé. À partir de 1711, Louis XIV remit à Georges Mareschal lui-même le soin de l’habiller aux jours de saignée.
D’après les « États de la France », les saignées royales étaient payées « par ordonnance » au chirurgien qui les pratiquait : il avait droit à six cents livres (soit deux mille cinq cents francs) pour chaque opération, et les draps qui lui servaient devenaient sa propriété.
Louis XIV avait de la répugnance pour la saignée, parce que cette opération « lui causait des vapeurs ». Mais chaque année, quand venait le printemps, Fagon lui adressait de telles remontrances, que le roi se résignait à subir, par précaution, la lancette de son premier chirurgien.
En 1705, la saignée de Sa Majesté fut retardée par une longue attaque de goutte ; pour l’obtenir, Fagon dut vaincre « la répugnance que le roi témoignait à se laisser saigner » .
Monsieur, frère de Louis XIV, avait une véritable aversion pour la saignée. En 1701, il eut des saignements de nez, qu’il cachait aux médecins, crainte qu’ils ne le fissent saigner. Étant un jour à Marly, à table avec le roi, il lui prit un saignement de nez si considérable, que toute l’assemblée fut alarmée. On envoie chercher Fagon, premier médecin, à qui une longue expérience avait acquis le droit de parler aux princes avec une dureté salutaire. Il lui dit, après l’avoir examiné : « Vous êtes menacé d’apoplexie et vous ne sauriez vous faire saigner trop promptement. » Le roi se joignit à diverses reprises au médecin, pour vaincre la résistance que son frère opposait à la saignée ; mais n’ayant jamais pu l’obtenir, il lui dit à la fin : « Vous verrez ce que votre opiniâtreté vous coûtera ; on nous éveillera une de ces nuits pour nous dire que vous êtes mort. »
(D’après une estampe du temps.)
La prédiction ne s’accomplit que trop exactement ; car, au bout de quelque temps, après avoir soupé gaiement à Saint-Cloud, Monsieur était sur le point de se retirer, lorsqu’il tomba mort, en demandant à M. de Ventadour, qui était auprès de lui, d’une liqueur que le duc de Savoie lui avait envoyée .
Louis XV, comme son prédécesseur, dut se soumettre à la tyrannie de la lancette. En 1720, à la suite d’une chute sur la tête, il eut une bosse au front, une écorchure sous l’un des yeux et quelques meurtrissures : les médecins étaient généralement d’avis de le saigner, suivant la coutume ; mais, devant l’opinion contraire de Mareschal, le précepteur de l’enfant-roi s’y opposa, et l’on se contenta d’une application de compresses ; sept jours plus tard, Louis XV tombait de son lit et se blessait légèrement : cette fois, on lui tira quelques gouttes de sang, « plutôt, imprime la Gazette, pour l’empêcher d’aller pendant quelques jours à la chasse, que par nécessité. »
L’année suivante, une petite vérole volante donne des inquiétudes aux médecins ; ils la traitent cependant sans saignée ni émétique ; ce n’est qu’en 1732 que, pour une attaque d’oreillons, la Faculté prescrivit d’ouvrir la veine à deux reprises.
On sait que, faute d’une saignée, Louis XV faillit succomber sous le fer d’un assassin : l’anecdote vaut la peine d’être rappelée.
Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1757, se présentait à l’hôtel de Lannion, à Versailles (actuellement 25, rue Satory), un individu de tournure assez louche, qui déclara s’appeler Lefèvre. On lui donna une chambre et on lui servit à manger et à boire. Le lendemain, il réclamait un chirurgien, pour se faire saigner. L’hôtesse, trouvant la demande ridicule, de la part d’un homme qui n’avait nullement l’air souffrant, n’y attacha aucune importance.
L’individu se rendit alors au château, rôda pendant plusieurs heures dans les cours et sous la voûte, du côté de la chapelle ; enfin, vers 6 heures du soir, au moment où le roi, sortant de chez Mesdames, se disposait à monter en carrosse, le promeneur solitaire s’approchait de lui et le frappait violemment au côté, d’un coup de canif. Damiens – car Lefèvre, c’était lui – était aussitôt appréhendé et mis à la geôle ; on connaît le reste de l’histoire.
Ainsi, ce criminel fou, qui avait besoin d’être saigné tous les quinze jours, n’aurait peut-être pas commis son crime, si la dame Fortier, la patronne de l’auberge où il était descendu, lui avait procuré le chirurgien qu’il réclamait. À quoi tiennent les évènements !
Il fut un temps où le respect et l’observation des formes réglaient tous les actes de la vie extérieure ; dans la maladie même, l’étiquette conservait ses droits : ouvrez la correspondance de Mme de Sévigné et vous serez édifié.
Mme de Sévigné, qui venait de perdre le chevalier de Grignan, mort de la petite vérole, écrivait le 10 février 1672 : « Il a été rudement saigné : il résista à la dernière qui fut la onzième ; mais les médecins l’emportèrent. » Pouvait-il en être autrement ?
« Dans ce pays-ci, écrivait dans le même temps un Italien , de passage en France, on saigne pour le moindre mal, et jusqu’aux enfants d’un an… On prétend que l’influence du climat change en sang la majeure partie de la nourriture ». Et il nomme un de ses compatriotes qui, tombé malade à Paris, dut subir 22 saignées, 110 lavements, « un le matin et un le soir », et qu’on mit à la diète tant que dura la fièvre, ce qui n’était pas si déraisonnable.
Certains médecins jugeaient que la saignée était non seulement inutile, mais nuisible ; à la vérité, ils étaient le petit nombre.
Songez qu’à cette époque bénie des barbiers , on était persuadé qu’il n’était point moyen meilleur, pour une femme, de se conserver belle, que de se faire piquer la veine de temps à autre.
(D’après une gravure d’ABRAHAM BOSSE : Bibliothèque nationale, Estampes.)
Le voyageur, dont nous avons tout à l’heure emprunté la relation, remarque l’étonnante blancheur de teint des Françaises, blancheur qu’elles conservent « en s’abstenant de vin, en buvant beaucoup de lait, en usant de saignées très fréquentes, de lavements, et d’autres moyens encore. » Aussi leurs joues sont-elles de roses et leur teint de lis. « Les dames étudient l’art de se rendre pâles », écrivait le cavalier Marini, parlant des Parisiennes ; et c’est, ajoute-t-il, parce qu’elles se font souvent saigner.
Pour l’opération elle-même, c’était une mise en scène savamment réglée, que nous révèlent maintes estampes, dont celle d’Abraham Bosse est la plus connue.
Remarquez la petite palette que tient le jeune page, et dans laquelle il recueille le sang de la belle malade. Ces palettes étaient de petites écuelles d’étain ou d’argent, d’une capacité rigoureusement fixée. Dans les inventaires du grand siècle, elles sont toujours, chez les gens de qualité s’entend, en métal fin. Il n’en était pas de même aux premiers temps de la monarchie. Dans le principe, elles étaient en pierre. Un passage de la Chronique rimée





























