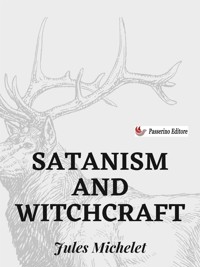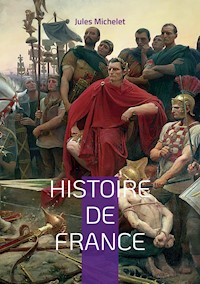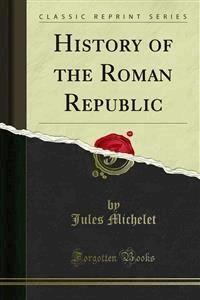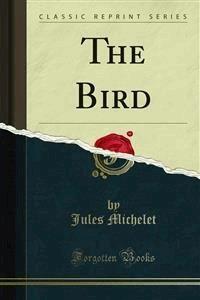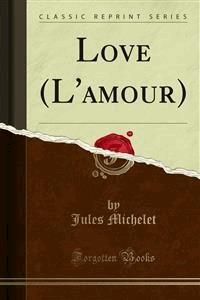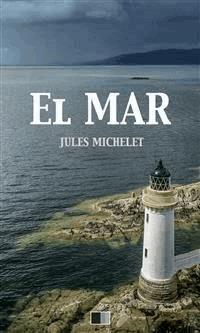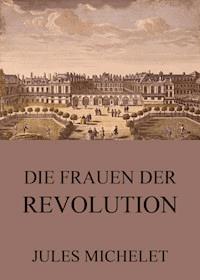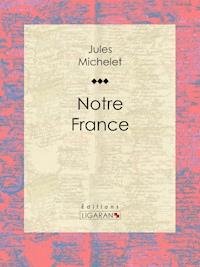
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
"""Notre France"" est un ouvrage incontournable de l'historien et écrivain français Jules Michelet. Publié pour la première fois en 1855, ce livre offre une vision passionnée et engagée de l'histoire de la France, de l'époque préhistorique jusqu'au règne de Louis XI. Michelet y dresse le portrait d'une nation riche de son passé, de ses traditions et de son peuple, et met en lumière les événements et les figures marquantes qui ont façonné l'identité française. À travers une plume vibrante et poétique, l'auteur nous invite à redécouvrir notre pays, à en explorer les racines et à en comprendre les enjeux. ""Notre France"" est un véritable hymne à la patrie, un témoignage intemporel qui continue d'inspirer les lecteurs et de susciter l'admiration pour la grandeur et la diversité de la France.
Extrait : ""Ce que contient le livre [...] c'est Notre France, non dans son unité actuelle qui a effacé toute trace des divisions et subdivisions de la vieille France féodale, mais s'exprimant, au contraire, par la forte personnalité de chaque province séparée encore du centre monarchique et vivant de sa vie indépendante."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001112
©Ligaran 2014
J’étais absorbée dans la composition du second volume des Souvenirs de M. Michelet, quand mon attention fut tirée d’un autre côté par la venue, presque simultanée, d’une demi-douzaine de lettres de professeurs et d’instituteurs qui me faisaient, en termes à peu près identiques, cette même question :
« Pourquoi ne complétez-vous pas les Précis de l’Histoire de France par la Géographie que Michelet a mise en tête de sa France du Moyen Âge ? La description d’un pays étant, en un sens, la clef de son histoire, il nous semble que c’est par là que vous auriez dû, logiquement, commencer. »
Ces observations me venaient mal à propos ; mais enfin elles étaient justes ; il fallait bien en tenir compte.
Au même moment, comme s’il y avait entente entre les universitaires, le directeur de l’enseignement supérieur, M. Dumont, en me remerciant d’un exemplaire que je lui avais offert, m’écrivait ceci :
« C’est cette intensité de flamme pour les choses de l’intelligence et du cœur qu’il faudrait donner à nos enfants. Sans cela, nous n’aurons rien fait, malgré les sacrifices de l’État et tant de bon vouloir de tous les côtés. Nous vous sommes donc très reconnaissants de tout ce que vous faites de si effectif, de si réel pour le progrès de l’instruction et de l’éducation. À vrai dire, éducation et instruction sont une même chose en notre pays... »
Cette lettre, qui sanctionnait la valeur pédagogique de mes travaux m’invitait, plus loin, à les continuer. Venant d’un homme de si grande valeur, – hélas depuis nous l’avons perdu, – cette invitation était presque un ordre.
Je me décidai donc à différer la publication du volume des Souvenirs pour faire droit aux légitimes réclamations de ceux qui m’écrivaient encore : « Travaillez pour nous qui avons si grand besoin de nous retremper, de recevoir l’aliment moral que nous donnons, à notre tour, à la jeunesse. »
À vrai dire, ma besogne eût été facile si je m’étais bornée à la réimpression pure et simple du Tableau de la France. Mais j’avais pour l’étendre et le compléter des matériaux laissés par M. Michelet dans ses cartons : il eut été grand dommage de ne pas les utiliser.
Parmi ces notes, il en est une qui devait me servir de guide dans mon travail parce qu’elle expose, à merveille, la méthode que M. Michelet eût suivie lui-même pour développer sa première esquisse trop rapide et trop brève :
« Je voyais, dit-il, si vivement les lieux et les hommes que je mettais en scène, que j’ai fait cela sans tâtonnements, tout d’un trait, sans reprendre haleine, juste le temps nécessaire pour l’écrire. C’est, en réalité, un voyage immense, à tire d’aile, dans l’espace et dans le temps... Je savais bien que cette vive silhouette géographique était insuffisante pour celui qui ignore, mais l’essentiel serait obtenu si le lecteur, dès la première page, prenait intérêt à me suivre dans le long pèlerinage que j’allais accomplir à travers les siècles de l’histoire. Chemin faisant, celle-ci, reprenant ma description trop sommaire, en élargirait les horizons et ferait circuler dans les paysages trop concentrés plus d’air et de lumière... »
L’Histoire générale a repris, en effet, chaque province à l’heure ou, sortant de l’indistinction confuse », elle entre en scène et devient un des acteurs du drame ou de l’épopée nationale.
Ce qui seulement échappait aux prévisions de l’historien, c’est que tout le monde ne lit pas sa grande Histoire, – les élèves de nos lycées, par exemple, même ceux des classes avancées, – ce qui est regrettable. Les professeurs s’en servent quand on la leur donne ; mais souvent, pressés par l’heure, ils n’ont pas toujours le temps de rechercher dans des milliers de pages ce qui peut intéresser l’objet de leur enseignement. Lorsque surtout ce ne sont que des lignes ou des lambeaux de phrases jetés au courant du récit, une lecture rapide peut facilement s’en distraire. Et pourtant ces lignes, ces phrases, reprises et mises à leur vraie place, dans le Tableau de la France, en augmentent singulièrement la valeur pratique.
J’avais encore une précieuse ressource dont M. Michelet ne parle pas : son Journal de voyage. Quand notre historien publia sa Géographie (1833), il n’avait vu de la France qu’une partie des Ardennes – le pays de sa mère – et la Bretagne. Ce fut seulement en 1835 que M. Michelet, chargé par l’État de rechercher dans les archives laïques et ecclésiastiques de la province tout ce qui pouvait accroître les richesses de nos Archives nationales, entreprit, en compagnie de son élève et ami, M. Victor Duruy, sa grande tournée dans le sud-ouest, le midi et le centre de la France.
Ce voyage se fit à petites journées, le plus, souvent par la bonne diligence qui vous menait de ville en ville en musant beaucoup sur la route. Il semblait alors que voyageurs et postillons eussent du temps à perdre. Cette lenteur, comparée à la rapidité vertigineuse de nos chemins de fer, était presque une halte dans le mouvement. Elle laissait tout loisir d’étudier la contrée, d’observer les hommes et les choses. Que faire encore dans les longues montées, les longs relais, sinon esquisser le paysage ?...
Il y avait dans le Tableau de la France, tel que nous l’a donné Michelet, beaucoup moins de géographie que d’histoire. Grâce à l’appoint de son Journal de voyage, riche en descriptions, l’équilibre se rétablit. Je préviens néanmoins le lecteur qu’il ne trouvera pas là ce que donnent les manuels, je veux dire la sèche énumération des montagnes, des fleuves, des rivières, etc. Cette nomenclature aride, qui ne dit rien à l’imagination de la physionomie spéciale d’un pays, n’eût point été à sa place dans une géographie historique.
Ce que contient le livre que je suis à la veille de publier, c’est Notre France, non dans son unité actuelle qui a effacé toute trace des divisions et subdivisions de la vieille France féodale, mais s’exprimant, au contraire, par la forte personnalité de chaque province séparée encore du centre monarchique et vivant de sa vie indépendante.
Ces individualités provinciales ont été mises en relief par M. Michelet avec une telle vigueur, qu’on les voit, au bout de tant de siècles, vivre, agir, s’agiter, combattre, tourbillonner dans la mêlée des intérêts et des passions qui les armèrent les unes contre les autres sans grâce ni merci. Parfois, une page qui ne dépasse pas la mesure de l’in-12 contient dans ce cadre étroit toute la France d’une époque : les hommes, l’action, le paysage.
Si vous voulez un exemple du merveilleux secours que la géographie – venant même de profil – peut prêter à l’histoire, lisez comment se fit la rencontre du Midi et du Nord au commencement du quinzième siècle. Un seul coup de pinceau suffit à l’historien-géographe pour faire le portrait des provinces d’où partent les combattants ; un mot suffira également au moraliste pour marquer l’influence que chaque milieu a dû exercer sur le caractère des races.
Ce sont les Béarnais et les Armagnacs – deux types de Gascons qu’il ne faut pas confondre – qui se mettent en marche pour aller reprendre, disent-ils, le Nord sur les Anglais, mais, en réalité, pour le piller à leur tour.
« Or, nous dit Michelet, ces gens du Midi faisaient horreur à ceux du Nord. » Et, pour nous livrer le secret de cette aversion, tout de suite il met les deux partis aux prises.
Ce n’est d’abord qu’une mêlée confuse :
« La campagne, à la voir de loin, était toute noire de ces bandes fourmillantes : gueux ou soldats, on n’eût pu le dire ; qui à pied, qui à cheval, à âne ; bêtes et gens maigres et avides à faire frémir, comme les sept vaches dévorantes du songe de Pharaon. »
La lumière se fait pourtant dans cette cohue tumultueuse ; les Méridionaux sont les premiers qu’elle frappe. Nous allons donc voir ces barbares, ces brigands », les Armagnacs :
« Quoique le caractère ait peu changé, nous ne devons pas nous les figurer comme nous les voyons et les comprenons aujourd’hui. Tout autres ils apparurent à nos gens du quinzième siècle, lorsque les oppositions provinciales étaient si rudement contrastées et encore exagérées par l’ignorance mutuelle : la brutalité provençale, capricieuse et violente comme son climat ; l’âpreté gasconne du rude pays d’Armagnac, sans pitié, sans cœur, faisant le mal pour en rire ; les durs et intraitables montagnards du Rouergue et des Cévennes, les sauvages Bretons aux cheveux pendants – race de silex et de caillou, – tout cela dans la saleté primitive, baragouinant, maugréant dans vingt langues que ceux du Nord croyaient espagnoles ou mauresques. Cette diversité de langues était une terrible barrière entre les hommes, une des causes pour lesquelles ils se haïssaient sans savoir pourquoi. Elle rendait la guerre plus cruelle qu’on ne peut se le figurer. Nul moyen de s’entendre, de se rapprocher. Le vaincu qui ne peut parler se trouve sans ressource ; le prisonnier, sans moyen d’adoucir son maître. L’homme à terre voudrait en vain s’adresser à celui qui va l’égorger. L’un dit : Grâce !... L’autre répond : Mort ! »
Suivez maintenant une méthode toute contraire à celle-ci ; séparez ces deux sœurs qui se tiennent par la main ; enseignez la géographie d’un côté, l’histoire de l’autre, et, ce tableau, d’une réalité saisissante, n’existe plus. En outre, privé des moyens de faire saisir sur le vif et d’une façon rapide la relation qui existe presque toujours entre la nature des lieux et la physionomie d’un peuple, vous n’avez plus qu’une faible prise sur celui qui vous lit ou vous écoute. S’il s’agit d’une leçon, elle est à moitié perdue.
On m’a raconté qu’un écolier auquel on n’avait donné à apprendre que la géographie physique, récitant un jour imperturbablement sa nomenclature de fleuves ou de montagnes, fut interrompu par cette apostrophe de l’examinateur impatienté de sa trop longue litanie : « Et le sol, la terre, que vous ont-ils dit ? – La terre, le sol, répond l’élève tout surpris ; mais ils ne m’ont rien dit du tout. » Si, plus rationnellement, on eût mêlé l’histoire à la géographie, l’écolier, ayant senti le sol national vibrer, à chaque pas, d’un vivant souvenir, ne se fût point mépris sur le sens de la question que lui faisait le maître.
Une bonne Géographie historique est donc à la fois un livre d’instruction et de patriotisme. Rien de meilleur pour rattacher les Français à la France, cette France à laquelle, ingrats que nous sommes, nous tournons invariablement le dos quand reviennent les beaux jours. Semblables aux moutons de Panurge, nous passons par troupeaux la frontière, nous allons chez nos voisins en quête de paysages bien souvent inférieurs en beauté à ceux que nous offre la France. Où trouver, dites-moi, un air plus pur que celui de nos montagnes ? Hautes-Alpes, Cévennes, Jura, Vosges, Auvergne, Pyrénées, nous n’avons que l’embarras du choix. Ces hautes solitudes, la plupart encore inexplorées, nous réservent un champ immense d’excursions et de découvertes.
Toute autre nation serait fière de réunir sur son territoire ce que les autres pays ne peuvent offrir que séparément : variété de sites, de climats, tous les genres de beauté qui sont dans la nature. Mais, hélas ! c’est une maladie de la France de se déprécier, d’aller chercher ailleurs ce qu’elle a chez elle. Nous courons au Mont-Blanc, à la Via Mala... Qui de nous connaît, dans les Cévennes, les Étroits du Tarn, dans le Dauphiné, les Grands Goulets du Vercors ? Qui a seulement entrevu, dans les Hautes-Alpes, les fantastiques visions des glaciers du Pelvoux ?...
Mais nous sommes loin de la saison des voyages :
L’hiver nous enveloppe de ses tristesses ; aux jours courts et brumeux succèdent les longues veillées. Ce qu’il faut pour tromper l’immobilité de la réclusion, ce sont des livres qui remettent l’imagination en mouvement et fassent voyager notre esprit, des livres que la famille, réunie autour de la table de travail, puisse lire ensemble à haute voix.
Notre France par sa forme narrative et descriptive, attrayante dans le détail et dans l’ensemble, pourra être mise au nombre des livres récréatifs qui instruisent le lecteur en l’amusant. Personne ne se plaindra, j’en suis sûre, de trouver dans celui-ci des paysages vrais, de l’histoire réelle, des héros qui ont vécu, dont les noms sont bons à retenir, car ce sont nos saints, les saints de la patrie !
Maintenant, est-il nécessaire que je dise pourquoi je n’ai pas conservé le titre que M. Michelet avait donné à sa Géographie ? Lui-même, parlant de ce beau travail, s’exprime ainsi : « Des éléments épars de la France, pieusement recueillis sur la route des siècles, je lui ai refait un corps et une âme toute française. » Ainsi ce n’est pas seulement le Tableau de la France qu’il entendait faire, c’était aussi la vie de la nation qu’il voulait ressusciter. Ce vœu qu’il avait fait dans sa jeunesse : « Je voudrais que dans tout ouvrage d’éducation circulât une chaude idée de la patrie », ce vœu, il l’accomplissait lui-même. Mais ce n’est pas seulement l’idée de la patrie qui circule dans ces pages ; c’est le souffle, c’est l’âme, l’âme immortelle de la France ; elle rayonne, réchauffe, vivifie tout.
Il fallait donc trouver un titre mieux approprié, plus personnel, plus chaud surtout. Celui-ci s’est offert tout naturellement : Notre France. Il n’est pas de cœur vraiment français qui ne me remercie de l’avoir préféré.
Mme J. MICHELET.
Février 1886
Sa lutte au Moyen Âge pour conquérir son unité géographique et morale.
On ne doit donner la géographie d’un pays qu’au moment où ce pays se caractérise. Dans le premier âge il n’y a pas de France, il y a la Gaule, sur laquelle les races viennent se déposer l’une sur l’autre : Galls, Kymris, Bol ; d’autre part Ibères ; d’autres encore, Grecs, Romains, par-dessus les Celtes ; enfin les Germains, les derniers venus du monde.
Au Midi ont apparu les Ibères de Ligurie et des Pyrénées, avec la dureté et la ruse de l’esprit montagnard, puis les colonies phéniciennes ; longtemps après viendront les Sarrasins.
Au Nord, les Kymry, ancêtres de nos Bretons, les Bols ; l’ouragan traverse la Gaule, l’Allemagne, la Grèce, l’Asie-Mineure ; les Galls suivent, la Gaule déborde par le monde.
Au second âge, la fusion des races commence et la société cherche à s’asseoir. La France naissante, – par le travail intérieur qu’elle a toujours fait sur elle-même, – voudrait déjà devenir un monde social ; mais l’organisation d’un tel monde suppose la fixité et l’ordre. Or, il ne peut y avoir ni fixité, ni ordre, ni propriété, tant que les immigrations des races nouvelles poussent devant elles ou entraînent dans leur tourbillon les populations qui commençaient à devenir stables. Ce n’est qu’à la chute de la dynastie carlovingienne que cesse ce grand mouvement des peuples, et c’est vers le milieu du dixième siècle que les diverses parties de la France, jusque-là confondues dans une obscure et vague unité, se caractérisent chacune par une dynastie féodale.
À l’avènement des Capets (987), les populations si longtemps flottantes se sont enfin fixées et assises ; nous savons où les prendre, et en même temps qu’elles existent et agissent à part, elles prennent peu à peu une voix ; chacune a son histoire, chacune se raconte elle-même.
L’histoire de France commence un peu plus tôt, au moment où apparaît la langue française. La langue est le signe principal d’une nationalité. Le premier monument de la nôtre est le serment de fidélité dicté au bord du Rhin, – sur la limite des deux peuples, – par Charles le Chauve, à son frère, au traité de Verdun (843).
Avant de poursuivre, énumérons rapidement la succession des pouvoirs en France. Sous la première race de nos rois le pouvoir appartient à l’église, seule, elle règne sur le pays. Saint Martin, de Tours, est l’oracle des barbares, ce que Delphes était pour la Grèce, – l’ombilicus terram.
Ce fut le clergé des Gaules qui appela les Francs contre les Goths, haïs pour avoir rapporté de l’Orient l’arianisme grec. Ces Francs, un mélange de toutes les tribus allemandes, n’ayant dès lors aucune originalité de race, étaient établis depuis un siècle dans les marais de la Batavie et dans la Belgique. L’Église fit leur fortune. Jamais leurs faibles bandes n’auraient détruit les Goths, humilié les Bourguignons, repoussé les Allemands, s’ils n’eussent trouvé dans le clergé un ardent auxiliaire qui guida, éclaira leur marche, leur gagna d’avance les populations.
On sait les victoires de Clovis, le chef qui commandait à ces barbares, et sa conversion au culte de la Gaule romaine.
Sous la seconde race, l’Église reste dominante, mais Reims hérite de Tours et devient la puissance épiscopale par excellence. Elle étendait sa juridiction en Austrasie, Neustrie, Bourgogne, au pays de Marseille, Rouergue, Gévaudan, Touraine, Poitou, Limousin, c’est-à-dire sur la plus grande partie de la France.
Sur le reste du territoire, les villes n’étaient rien, à moins qu’elles ne fussent cités épiscopales. Les abbayes étaient des centres d’attraction, autour d’elles s’étendaient des villes ou des bourgades. Les plus riches étaient Saint-Médard, de Soissons ; Saint-Denis, fondation de Dagobert, berceau de la monarchie et tombe de nos rois.
Charlemagne, fils, petit-fils, neveu des évêques, et des saints, étendit encore les privilèges de l’Église ; ses descendants y ajoutèrent à leur tour, en sorte que sous Charles le Chauve, l’archevêque de Reims, Hincmar, se trouvait être le vrai roi, le vrai pape de France. Charles n’avait pu devenir roi qu’appuyé des évêques. Ils nourrissaient, soutenaient les souverains qu’ils avaient faits, ils leur permettaient de lever des soldats parmi leurs hommes, en un mot, ils gouvernaient les choses de la guerre comme celles de la paix. Évêques, magistrats, grands propriétaires, ils commandaient à ce triple titre.
Il pourrait sembler à un observateur superficiel que sous ce double règne laïque et ecclésiastique, il y a déjà une France. Non. L’unité qui semble avoir été obtenue est toute extérieure. Elle cache un désordre profond, la discorde obstinée d’éléments hétérogènes qui se trouvent réunis par une force tyrannique et qui ne tendent qu’à la dispersion. Diversité de races, de langues et d’esprit, ignorance mutuelle, antipathies instinctives. Aussi, avant même que le vieil Empereur ne meure, l’ouvrage de la conquête se défait. Déjà, au-dehors, l’Empire a faibli, il a heurté en vain contre le Bénévent, contre Venise. En Germanie, il a dû reculer de l’Oder à l’Elbe et partager avec les Slaves. Cette ceinture de barbares que Charlemagne croyait simple et qu’il rompit d’abord, dans un élan de force et de jeunesse, elle se doubla, se tripla, et quand les bras lui tombèrent de lassitude, il vit roder autour de son empire d’autres ennemis, les flottes danoises, grecques, sarrasines comme le vautour sur le mourant qui promet un cadavre...
Nous sommes en 941, l’Empereur est mort. Maintenant, par tous les fleuves, et par tous les rivages arrivent ces pirates du Nord, les Northmans, bien autrement sauvages que les Germains qui les ont précédés. Ils se sont faits rois de la mer parce que la terre leur a manqué. Loups furieux, ils abordaient seuls, sans famille. Dès que leurs dragons, leurs serpents sillonnaient les fleuves ; dès que le cor d’ivoire retentissait sur les rives, personne ne regardait derrière soi. Tous fuyaient à la ville, à l’abbaye voisine, chassant vite leurs troupeaux ; ils se blottissaient aux autels, sous les reliques des saints, mais les reliques n’arrêtaient pas les barbares. Ils semblaient, au contraire, acharnés à violer les sanctuaires les plus révérés.
Que faisaient cependant les souverains de la contrée, les abbés, les évêques ? Ils fuyaient, emportant les ossements des saints ; ils abandonnaient les peuples sans défense, sans asile.
Il fallut bien que l’Église impuissante à rallier la France, à l’aider à se défendre, résignât, au moins en partie, le pouvoir temporel à des mains plus mâles et plus guerrières.
Charles le Chauve, l’année même de sa mort, fait les seigneurs ses légitimes héritiers ; il signe l’hérédité des comtés dont la possession était disputée jusque-là. Il confirme le legs royal fait à ces comtes et barons, en mariant ses filles aux plus vaillants d’entre eux, à ceux de Bretagne et de Flandre. C’est la substitution du pouvoir féodal au pouvoir ecclésiastique.
Ces comtes et ces barons occuperont les défilés des montagnes, les passes des fleuves, ils dresseront leurs forts, ils s’y maintiendront à la fois contre les barbares et contre le prince qui, de temps en temps, aura la tentation de ressaisir le pouvoir qu’il abandonne à regret.
Les peuples qui sentent la double impuissance de l’Église et de la vieille dynastie, se serrent autour de leurs défenseurs naturels, autour des seigneurs et comtes. Rien de plus populaire que la féodalité à sa naissance.
Le premier et le plus puissant de ces fondateurs de la féodalité laïque, est Boson, le beau-frère même de Charles le Chauve. Il prend le titre de roi de Provence ou Bourgogne Cisjurane, tandis que Rodolf Wolf prend la Bourgogne Transjurane dont il fait aussi un royaume. Voilà la barrière de la France au Sud-Est. À l’Est, le comte de Hainaut, Reinier (renard) disputera la Lorraine aux Allemands. Au Midi, au pied des Pyrénées, le duché de Gascogne est rétabli par les familles d’Hunald et de Guaifer, si maltraitées par les Carlovingiens et qui le leur rendirent à Roncevaux. Dans l’Aquitaine, s’élèvent les puissantes familles de Gothie (Narbonne, Roussillon, Barcelone), de Poitiers, de Toulouse.
Au Nord, la France prend pour défenseurs contre les Belges et les Allemands, les comtes de Flandre et de Vermandois. Mais, à ce moment, la grande lutte est à l’Ouest vers la Normandie et la Bretagne. De ce côté, c’est Allan Barbetorte qui délivrera le pays des Northmans.
Ainsi, la féodalité, à son principe, contient une harmonie forte et réelle. La variété infinie du monde féodal, la multiplicité d’objets par laquelle il fatigue d’abord la vue et l’attention, n’en est pas moins la révélation de la France. Loin qu’il y ait, comme on l’a dit, confusion et chaos, c’est un ordre, une régularité inévitable et fatale. Chose bizarre ! nos quatre-vingt-six départements répondent, à peu de chose près, aux quatre-vingt-six districts des capitulaires d’où sont sortis la plupart des souverainetés féodales, et la Révolution, qui venait donner le dernier coup à la féodalité, l’a imitée malgré elle.
Ces comtes et ces barons, en s’opposant aux immigrations de races nouvelles, permirent à la France de se fixer, de devenir un monde social. Sur toutes les frontières une foule de châteaux forts s’élèvent comme autant d’avant-postes ; partout les seigneurs arment leurs hommes.
Ainsi protégé, le pays prendra consistance et se caractérisera peu à peu. Les Northmans eux-mêmes y aideront. Rencontrant de tous côtés des obstacles, ils se découragent à la fin, et se résignent au repos. Ils renoncent au brigandage et demandent des terres. Ceux de la Loire repoussés de l’Angleterre et ne se souciant pas de mourir comme leur héros, Regnard Lodbrog, dans un tonneau de vipères, aiment mieux s’établir sur la belle Loire et la fermer aux invasions nouvelles, comme tout à l’heure Rodolphe ou Rollon va fermer la Seine sur laquelle il s’établit du consentement du roi de France (911).
Cette date marque aussi le terme de la domination allemande et l’avènement de la nationalité française. Au dixième siècle, nous l’avons déjà dit, le vent emporte le vain brouillard dont l’empire avait tout obscurci, le pays se dessine pour la première fois dans sa forme géographique, par ses montagnes, ses rivières, ses diversités locales. À cette première heure, la nature s’essaye, et sur l’empire en dissolution, trace à grands traits les royaumes. Il y en aura quatre : ceux de Seine-et-Loire, de la Meuse, de la Saône et du Rhône.
Mais que nous sommes loin encore, de la forte unité qui fera de la France une personne. Les grandes divisions, bientôt se subdivisent à l’infini et deviennent autant de dynasties féodales. Chaque point de l’espace semble ne retrouver quelque sécurité intérieure que par la formation de ces puissances locales qui sont la destruction de son unité.
Si l’idée d’un rapprochement, – nous l’avons vu poindre dès le second âge de la France, – peut être reprise, ce ne sera pas par les hommes de la frontière. Ceux-ci, tout occupés de la défense du pays, aiment mieux leur indépendance. Il faudra donc que le chef autour duquel se ralliera la nation, sorte des provinces du centre. Le centre du monde Mérovingien, a été l’Église de Tours. Celui des Carlovingiens est aussi la Loire, mais plus à l’Occident sur la marche de Bretagne.
Dans l’Anjou et la Touraine, deux familles, précisément s’élèvent, tige des Capets et des Plantagenets, des rois de France et des rois d’Angleterre. Toutes deux sortent de chefs obscurs. Les Capets semblent avoir été des chefs saxons au service de Charles le Chauve. Bientôt ils s’illustrent par leur lutte héroïque contre les Normands : Robert le Fort, entre la Seine et la Loire ; son fils Eudes, au siège de Paris ; ils forcent les pirates à désarmer. Eudes est élu roi ou plutôt chef, par la nation qui dédaigne d’obéir plus longtemps à la branche allemande de la dynastie Carlovingienne, que représente Charles le Gros. Elle veut un Français pour gouverner la France.
D’Eudes en Hugues le Grand, d’Hugues le Grand en Hugues Capet, nous arrivons à l’avènement de la troisième race, c’est-à-dire à la substitution d’une royauté nationale au gouvernement de la conquête. La royauté n’était plus qu’un nom, qu’un souvenir bien près d’être éteint. Transférée aux Capets, ce fut une espérance.
Et pourtant, il était perdu, ce pauvre petit roi, entre les vastes dominations de ses vassaux, seigneurs puissants par la vaillance, l’énergie, la richesse. Qu’était-ce qu’un Philippe Ier ou même le brave Louis VI, le gros homme pâle, entre les rouges, Guillaume d’Angleterre et de Normandie, les Robert de Flandre, conquérants et pirates, les opulents Raymond de Toulouse, les Guillaume de Poitiers et les Foulques d’Anjou, troubadours et historiens, enfin, les Godefroi de Lorraine, intrépides antagonistes des empereurs, sanctifiés devant la chrétienté par la vie et la mort de Godefroi de Bouillon ?
La toute petite royauté contenue entre l’Île-de-France et l’Orléanais n’eût pas tenu tête à ses nombreux rivaux, sans la jalousie de la Flandre et de l’Anjou contre la puissante féodalité Normande. Le roi s’efforçait, avec les comtes de Blois et de Champagne, de mettre un peu de sécurité entre la Loire, la Seine et la Marne, petit cercle resserré entre les grandes masses féodales. La Flandre s’avançait jusqu’à la Somme.
Le cercle compris entre ces grands fiefs fut la première arène de la royauté, le théâtre de son histoire héroïque. Nos champs prosaïques de Brie et de Hurepoix ont eu leurs iliades. Les Montfort, les Garlande soutenaient souvent le roi ; les Coucy, les seigneurs de Rochefort, du Puiset surtout, étaient contre lui ; tous les environs étaient infestés de leurs brigandages. On pouvait aller encore avec quelque sûreté de Paris à Saint-Denis ; mais au-delà, on ne chevauchait plus que la lance sur la cuisse ; c’était la sombre et malencontreuse forêt de Montmorency.
De l’autre côté, la terre de Montlhéry exigeait un péage. Le roi ne pouvait voyager qu’avec une armée de sa ville d’Orléans à sa ville de Paris. La noblesse commençait à devenir un danger pour la France.
On put croire un moment que la croisade lointaine d’Orient serait le salut. Elle mobilisait la lourde féodalité, la déracinait de la terre. Les barons allaient et venaient sur les grandes routes entre la France et Jérusalem. Ils vendaient parfois leurs terres avant de partir. C’était faire la fortune du roi et celle du royaume plus grande, chaque jour, par ces abandons. Beaucoup ne revenaient pas. L’extinction des mâles fut rapide dans ces guerres ; tout fief sans héritier revenait à la couronne comme à sa source.
La mort frappait aussi plus près. Le plus riche souverain du pays, le comte de Poitiers et d’Aquitaine la sentant venir, ne crut pouvoir mieux placer sa fille Éléonore et ses États qu’en les donnant au fils de Louis VI qui allait succéder à son père. Les États du roi de France se trouvaient triplés par ce mariage.
La seconde croisade changea tout ; elle déplaça la prépondérance de l’Occident qui appartint désormais à l’Angleterre. Louis VII était parti pour la Terre Sainte avec l’empereur d’Allemagne. Son retour fut honteux. La fière et violente Éléonore, qui l’avait suivi, en prit prétexte pour demander le divorce au concile de Beaugency et porter aux Anglais les vastes provinces qui étaient son douaire. Henri Plantagenêt, duc d’Anjou, et bientôt roi d’Angleterre, en épousant Éléonore, épousait avec elle la France de l’ouest, – de la Flandre aux Pyrénées. – Ce ne fut pas tout, il prit à son frère l’Anjou, le Maine, la Touraine et le laissa, en dédommagement, se faire duc de Bretagne. Étendant encore ses conquêtes, il enleva le Quercy au comte de Toulouse ; il aurait pris Toulouse elle-même si le roi de France ne s’était jeté dans la ville pour la défendre.
Au centre, il réduisit le Berry, le Limousin, l’Auvergne ; il acheta la Marche du comte qui, partant pour Jérusalem, ne savait que faire de sa terre. Il eut même le secret de détacher les comtes de Champagne de l’alliance du roi.
Prenant ainsi de tous côtés, à sa mort, il possédait les pays qui répondent à nos quarante-sept départements, tandis que le roi de France n’en avait plus que vingt. Chose plus grave, le Midi se trouvant brusquement isolé du Nord, on put croire que l’unité du royaume était rompue à jamais.
Dans cet abaissement de la royauté, les grands vassaux apparaissent plus puissants. La féodalité est encore respectée, aimée de ceux mêmes sur qui elle pèse, parce qu’elle est encore profondément naturelle. La famille seigneuriale née de la terre, vivait d’une même vie, elle était pour ainsi dire le genuis loci. C’était elle, le plus souvent, qui avait fait en quelque sorte la terre y bâtissant des murs, un asile contre les pirates du Nord, où l’agriculture pouvait se retirer avec ses troupeaux. Les champs avaient été défrichés, cultivés aussi loin qu’on pouvait voir la tour. La terre était fille de la seigneurie et le seigneur était fils de la terre ; il en savait la langue et les usages, il en connaissait les habitants, il était des leurs. Son fils, grandissant parmi eux, était l’enfant de la contrée. Le blason d’une telle famille devait être non seulement révéré, mais compris du moindre paysan.
Ce champ héraldique était visiblement le champ, la terre, le fief ; ces tours étaient celles que le premier ancêtre avait bâties contre les Normands ; ces besants, ces têtes de mores qu’on avait ajouté, étaient un souvenir de la fameuse croisade (la première), où le seigneur avait mené ses hommes et qui faisait à jamais l’entretien du pays.
Mais cette solidarité entre le seigneur et le paysan ne pouvait rien pour la centralisation de la France. C’était un gage de protection réciproque mais toute locale. Chaque donjon vivait encore isolé. Celui-ci perche avec l’aigle, l’autre se retranche derrière le torrent. Aucun lien ne rapproche cette agglomération de puissances féodales. La France reste démembrée, le secours doit lui venir d’ailleurs.
De même qu’au onzième siècle, il fallut que l’Europe se vit en face de l’Asie pour se croire une et la devenir ; de même, pour que l’unité se refasse en France, trois siècles plus tard, au moins dans les volontés, il faudra la guerre avec les Anglais, l’envahissement du territoire. Le danger commun forcera tous les Français à s’unir pour le salut du pays. Cette guerre, malgré ses calamités, nous rendit un immense service qu’on ne peut méconnaître. La France jusque-là était féodale avant d’être française. L’Angleterre, en la refoulant durement sur elle-même, la força de rentrer en soi. Elle dut à son ennemie de se connaître comme nation. Dès lors, elle se resserra, ramassa en elle ses forces pour faire front à l’étranger, le refouler à son tour.
C’est la France du quatorzième siècle qui se lève. Ses États généraux, ceux du Nord et du Midi, les États des trois ordres : Clergé, Noblesse et Bourgeoisie des villes, les États de France en un mot, convoqués pour la première fois, par Philippe le Bel, sont l’ère nationale de la France, son acte de naissance politique (1302).
Nous sommes maintenant au milieu du siècle. La chevalerie française, disons-le à son honneur, vient se faire tuer sur les champs de bataille de Crécy et de Poitiers. Mais ce n’est plus la respectable féodalité que nous avons vue immobilisée sur son roc. Les croisades en déracinant la noblesse l’ont habituée, peu à peu, à vivre loin de ses châteaux, à séjourner à grands frais près du roi. Elle devient chaque jour plus avide. Il faut la payer pour combattre, pour défendre ses terres des ravages des Anglais. Sous Philippe de Valois, le chevalier se contentait de dix sous par jour. Sous le roi Jean, il en exige vingt et le seigneur banneret en veut quarante.