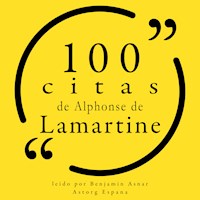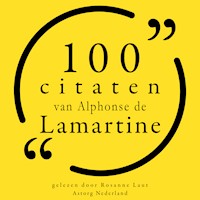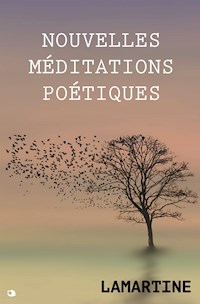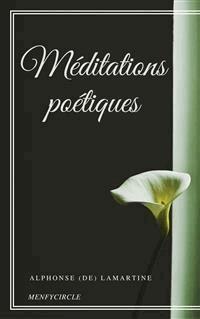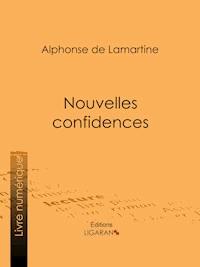
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je vécus de cette vie de campagne et de famille qui me rafraîchissait ma douleur, comme l'air froid rafraîchit une brûlure à la main, jusqu'à l'automne. La monotonie recueillie, voluptueuse de ma vie n'était interrompue que par une correspondance rare, mais intime et palpitante, que j'avais avec Saluce. Saluce était le nom d'un ami dont je n'ai pas encore parlé. Voici comment nous nous étions connus et aimés."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je vécus de cette vie de campagne et de famille qui me rafraîchissait ma douleur, comme l’air froid rafraîchit une brûlure à la main, jusqu’à l’automne. La monotonie recueillie, voluptueuse de ma vie n’était interrompue que par une correspondance rare, mais intime et palpitante, que j’avais avec Saluce. Saluce était le nom d’un ami dont je n’ai pas encore parlé. Voici comment nous nous étions connus et aimés.
Il y avait, dans le corps de la maison militaire du roi, où mon père m’avait fait servir quelques années, un jeune Breton dont la beauté, la jeunesse et la cordialité forte et naïve, caractère de cette noble race, m’avaient attiré. Il s’était senti de même attiré instinctivement vers moi. Nous étions tous deux à cette époque de la vie où les amitiés se font vite ; on ne raisonne pas ses attraits. On se voit, on se plaît, on se parle, on se confie réciproquement ses pensées ; si elles sont conformes, on s’isole ensemble dans la foule, on se quitte avec peine, on se retrouve avec bonheur, on se cherche, on s’attache, on est deux. C’est ainsi que je m’étais lié fraternellement avec ce camarade de vie. Nous avions les mêmes goûts militaires et littéraires, le même sentiment de la poésie, les mêmes entraînements vers le peu de solitude que nous permettait la vie de garnison en province ou de caserne à Paris, les mêmes habitudes de famille, les mêmes opinions de naissance. Il me parlait de sa mer, je lui parlais de mes montagnes. En sortant de la manœuvre, nous faisions ensemble de longues promenades rêveuses dans les vallées vertes, ombragées et monotones de la triviale Picardie. En quelques mois nous étions frères ; il savait tous mes secrets, moi tous les siens. Je n’aurais pas été étranger dans sa famille si j’avais été conduit par le hasard à sa porte ; il aurait reconnu mon père, ma mère et toutes mes sœurs, aux portraits que j’avais faits de notre maison.
Le père de Saluce avait émigré en Angleterre avec sa femme, son fils et sa fille au berceau, après les premiers revers de la Vendée. Ses biens avaient été confisqués. Un grand-oncle ecclésiastique, âgé, riche et pourvu d’un emploi important à Rome dans la chancellerie du Vatican, avait appelé en Italie le père de Saluce et sa famille. Ils s’étaient établis à Rome. Le grand-oncle y était mort laissant son palais, une villa près d’Albano et une fortune considérable en argent à son neveu. Ce neveu, père de mon ami, s’était ainsi complètement dénationalisé : il était devenu Romain. Au moment de la rentrée des Bourbons en France, il s’était mis en route pour venir y revendiquer sa patrie, son titre et la récompense de son exil. Il avait laissé à Rome sa femme et sa fille ; il avait amené à Paris son fils et l’avait placé dans le même corps où j’avais été placé moi-même par mon père. De là, il était allé en Bretagne, il avait récupéré des bois non vendus, et racheté à bas prix, d’un acquéreur qui ne se considérait que comme dépositaire, le vieux manoir de ses pères. La mort l’attendait au lieu de son berceau. En chassant avec d’anciens amis dans ses bois paternels si heureusement recouvrés, son cheval s’était abattu et l’avait précipité contre un des chênes de son avenue. Saluce était allé rendre les derniers devoirs à son père, prendre possession de la moitié de son héritage ; puis il était revenu me dire adieu à Beauvais, et il était parti de là pour rejoindre sa mère et sa sœur à Rome. Son départ m’avait laissé profondément triste, et ce fut une des causes qui me firent bientôt après quitter ce métier de soldat ennuyeux en temps de paix. Mais comme j’avais été sa première amitié avec un jeune homme de sa patrie, cette amitié avait jeté une profonde racine dans son cœur. Mon souvenir faisait désormais partie de sa vie. Nous entretenions une correspondance intarissable ; nous vivions véritablement en deux endroits à la fois, lui où j’étais, moi à Rome avec lui. Cette correspondance formerait un volume, et elle dévoilerait dans ce jeune homme, mélange de Breton et de Romain, une de ces natures mixtes curieuses à étudier, héroïque et sauvage par le cœur, artiste et contemplative par l’imagination ; ses deux patries incarnées dans un même homme. C’est ce contraste qui m’attachait tant à lui, car j’en retrouvais un faible reflet en moi-même. Les grandes natures comme la sienne sont doubles. Donnez deux patries à un enfant, vous lui donnerez deux natures. On en jugera par les fragments des lettres de Saluce qui ont échappé aux hasards des années et que j’ai retrouvées classées dans la vieille armoire de la bibliothèque de mon oncle, où je les jetais après les avoir lues et relues.
Tout ceci était nécessaire à dire pour faire comprendre une des courses les plus inattendues et une des disparitions les plus mystérieuses de ma jeunesse. Folie ou dévouement, peu importe ; ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit. Les confidences sont les confessions de l’amitié, et c’est à l’amitié aussi de les absoudre.
Un soir des derniers jours du mois de juillet, en rentrant à cheval, mon fusil en bandoulière sur mon épaule, dans la grande pelouse déserte qui s’étend entre deux quinconces de tilleuls devant la porte du château de mon oncle, je fus très étonné de trouver un postillon de la poste voisine du Pont-de-Pany, qui me remit une lettre très pressée, écrite de l’auberge du village, en me demandant une réponse.
Sans descendre de cheval j’ouvris la lettre et je lus. La lettre était en italien, langue que mon long séjour en Italie m’avait rendue aussi familière que ma langue maternelle. En voici la traduction :
« Deux dames venant de Rome, informées par le comte Saluce de *** que son ami est au château d’Urcy, le prient de vouloir bien se rendre à la poste du Pont-de-Pany, où elles l’attendent à l’auberge, n’ayant d’espoir qu’en lui. Leur nom ne lui est peut-être pas inconnu, mais elles sont convaincues que leur qualité d’étrangères et de fugitives suffirait pour leur assurer son intérêt et sa bonté.
Comtesse LIVIA D ***.
Et sa fille, princesse RÉGINA C ***. »
Je reconnus de suite les deux noms qui remplissaient les lettres de Saluce. Seulement je ne me rendais pas compte de leur arrivée en France, de leur séjour dans une auberge de campagne, sur une route indirecte de Bourgogne, et enfin de ce titre de fugitives qu’elles ajoutaient à leur signature. Mon oncle, que les grelots du cheval du postillon avaient attiré sur le perron du vestibule, souriait d’un air de finesse et de bonté à ma physionomie étonnée et à l’attention avec laquelle je lisais et relisais cette lettre.
« Pas de mystère avec moi, me dit-il en me raillant de l’œil ; les héros de romans ont toujours besoin d’un confident. J’ai connu dans mon temps les deux rôles. Je ne pense pas que ce soit le premier que ces merveilleuses beautés errantes, dont le postillon a parlé en buvant son verre de vin, viennent m’offrir ; mais tu peux me donner le second, je serai discret, c’est la vertu de l’indulgence.
– Je vous jure, lui dis-je, qu’il n’y a, dans ce message, aucun mystère qui me concerne. Vous me reprochez souvent ma mélancolie et vous en savez la cause. Mon cœur est incapable de se reprendre à aucun charme ici-bas. » Il me montra du doigt le tilleul énorme et touffu, sous l’ombre duquel j’avais arrêté mon cheval.
« Tu vois bien ce tilleul, me dit-il, il est plus vieux que toi, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Eh bien, je l’ai déjà coupé cinq fois en vingt ans, et il a plus de sève et de branches que quand j’arrivai ici.
– Oui, lui répondis-je tristement, mais c’est un arbre, et je suis un homme. Essayez de lui fendre l’écorce et de lui brûler la moelle, et vous verrez s’il refleurira ! »
Nous rentrâmes en causant et en badinant ainsi, lui gaiement, moi gravement. Je renvoyai le postillon avec un billet, disant que le nom de mon ami Saluce était un talisman pour moi, et que je descendrais presque aussi vite que le messager au Pont-de-Pany. Je ne pris que le temps de remonter à cheval, et je galopai par un sentier dans les bois qui abrégeait de moitié la route, pour arriver avant la nuit au Pont-de-Pany.
Je descendis de cheval. Un courrier italien, en magnifique livrée, me conduisit à travers la cour vers un petit pavillon isolé donnant sur les prés et qui faisait partie de l’auberge. Il y avait deux ou trois chambres pour les voyageurs de distinction que la nuit surprenait souvent à cette poste, au pied de la montagne de Sombernon, où l’on n’aimait pas à s’aventurer dans les ténèbres. Le courrier m’annonça à une femme de chambre ou nourrice en costume des paysannes de Tivoli, costume qui me fit battre le cœur, parce qu’il me rappelait Graziella. Cette femme, très âgée, m’ouvrit la porte de l’appartement de ses maîtresses, et j’entrai.
Je crus, en entrant et en apercevant la foudroyante beauté de la jeune princesse qui se leva pour venir au-devant de moi, que mon oncle avait raison, et que, si le cœur créait quelquefois la beauté, la beauté aussi était capable de créer un nouveau cœur dans celui qu’elle enveloppait d’un tel rayon. Il faut que je tente au moins de décrire la scène, qui ne s’est jamais effacée depuis de mon regard.
La chambre était vaste, meublée, comme une chambre d’auberge de village, de deux grands lits à rideaux bleu de ciel, de caissons de voiture, de vaches, de châles et de manteaux de voyage couverts de poussière et jetés sur les chaises ou sur le tapis. Une seule fenêtre ouvrait sur une large vallée de prairies ; les derniers rayons du soleil éclairaient la chambre et les figures de cette lueur poudreuse et chaude qui ressemble à une pluie d’or sur le sommet des arbres et des horizons. Cette lueur tombait, à travers le rideau bleu entrouvert, en diadème rayonnant sur le sommet de la tête, sur le cou et sur les épaules de la jeune fille. Elle était grande, svelte, élancée, mais sans aucune de ces fragilités trop délicates et de ces maigreurs grêles qui dépouillent de leur carnation les jeunes filles de seize à dix-huit ans dans nos climats tardifs du Nord. Sa taille, ses bras, ses épaules, son cou, ses joues étaient revêtues de cette rondeur du marbre qui dessine la plénitude de vie dans la statue de Psyché de Canova. Rien ne fléchissait, quoique tout fût léger et aérien dans sa taille. C’était l’aplomb, sur un orteil, de la danseuse qui relève ses bras pour jouer des castagnettes sur le sable de Castellamare. Elle était vêtue de soie noire, comme toutes les Italiennes de ce temps. Elle n’avait, sur cette simple robe, ni châle ni fichu qui cachassent ses épaules ou qui empêchassent le tissu serré de soie de dessiner, comme un vêtement mouillé, les contours du corps. La robe était très courte, comme si celle qui la portait eût grandi depuis qu’elle était faite ; elle laissait se dessiner et se poser sur le tapis deux pieds un peu plus grands et un peu moins sveltes que ceux des Françaises. Ces pieds ne portaient point de souliers ; ils flottaient en liberté dans deux pantoufles de maroquin jaune, revêtues de paillettes d’acier et brodées de lisérés de diverses couleurs. Son cou était entièrement nu ; un gros camée, retenu par un ruban de velours noir, relevait seul son éclatante blancheur. Soit effet de soleil effleurant son front par le haut de la fenêtre, soit effet de l’émotion et de la pudeur dont la présence d’un inconnu et ce qu’elle avait à me dire l’agitaient d’avance, soit nature inondée de vie, toute la coloration de sa personne semblait s’être concentrée dans son visage.
Quant à l’expression de ses yeux, d’un bleu aussi foncé que les eaux de Tivoli dans leur abîme, de sa bouche, dont les plis graves et un peu lourds semblaient à la fois envelopper et dérouler son âme, de cette douceur qui s’élançait, et de cette majesté naturelle qui se retenait dans son élan vers moi, je n’essayerai jamais de la décrire. On ne décrit pas la lumière, on la sent. Une résille de soie cramoisie, comme les femmes du Midi en mettent sur leur tête en voyage ou à la maison, enveloppait ses cheveux. Mais les larges mailles du réseau, déchirées en plusieurs endroits par le frottement de la voiture, en laissaient échapper des boucles touffues çà et là, et laissaient voir leur masse, leur souplesse et leur couleur. Ces cheveux étaient blonds, mais de cette teinte de blond qui rappelle le tuyau de la paille de froment calciné et bronzé par le mois de la canicule dans les plaines de la campagne de Rome ; blond qui est un reflet de feu sur les chevelures du Midi, comme il est un reflet de glace sur les chevelures du Nord. Ses cheveux, à leur extrémité, changeaient de couleur comme ceux des enfants ; noués au sommet de sa tête sous la résille par un ruban de feu, ils formaient une espèce de diadème naturel sur lequel brillait le soleil.
Telle s’avançait vers moi la princesse Régina. Je ne savais s’il y avait plus d’éblouissement que d’attendrissement dans ses traits. Je restais immobile et comme asphyxié d’admiration.
À côté d’elle, sur un matelas étendu à terre et recouvert d’une fourrure blanche tigrée de noir, reposait, la tête appuyée sur son coude, une femme âgée enveloppée d’un manteau de velours noir. Son visage, quoique affaissé et plissé à grandes rides sur les joues et vers le double menton, conservait l’empreinte d’une grande beauté disparue, mais qui a laissé sa place visible encore sur la figure. Un nez modelé comme par le ciseau du statuaire ; des yeux noirs largement fendus sous les arcades des sourcils ; une bouche fléchissant aux deux bords, mais dont les lèvres gardaient de grands plis de grâce et de force ; des dents de nacre ; un front large et mat, divisé par la seule ride de la pensée au milieu ; des boucles de cheveux noirs, à peine veinées de blanc, sortant à grandes ondes d’une résille brune, et enroulées comme des couleuvres sur le creux de ses tempes ; un air languissant et maladif dans les teintes de la peau, dans la langueur des poses et dans le timbre creux et cassé de l’accent : telle était la comtesse Livia D***, grand-mère de la jeune femme.
Elle se souleva avec effort sur le coude à mon apparition dans la chambre ; elle suivait de l’œil la physionomie et les mouvements de sa petite-fille, comme si l’une eût été la pensée, l’autre le geste et la voix de cette scène. On voyait que toute l’âme de la mère n’était plus-en elle, mais dans son enfant.
« Monsieur, me dit en italien la jeune femme avec une voix qui tremblait un peu et avec un timbre si sonore et si perlé qu’on croyait, en l’écoutant, entendre couler des perles sur un bassin, je suis la princesse Régina, et voilà la comtesse Livia, ma grand-mère. Je sais par celui qui est votre ami et qui est pour moi tout…, que ce nom de Saluce suffit pour toute introduction de vous à nous et de nous à vous ; il est le nœud de notre cœur et du vôtre. Vous savez notre vie par ses lettres ; nous vous connaissons par les vôtres ; il n’a pas de secrets pour nous, vous n’en avez pas pour lui. Nous vous connaissons donc, quoique nous ne nous soyons jamais vus, comme si j’étais Saluce et comme si vous étiez moi-même. Supprimons donc le temps et les cérémonies entre nous, ajouta-t-elle en s’approchant vivement de moi comme si elle eût été ma sœur, et en me prenant la main dans ses belles mains tremblantes. Soyons amis en une heure comme nous le serions en dix ans. Que sert le temps, dit-elle encore avec une petite moue d’impatience où éclatait l’énergie de sa volonté, que sert le temps s’il ne sert pas à s’aimer plus vite ? »
En disant cela, elle rougit comme un charbon sur lequel l’haleine vient de souffler dans le foyer qui couve. Je souris, je m’inclinai, je balbutiai quelques mots de bonheur, de dévouement, de services à toute épreuve, d’amitié pour Saluce, qui avait eu raison de voir en moi un autre lui-même.
La vieille femme faisait, à tout ce que disait sa fille et à tout ce que je répondais, des gestes de tête d’assentiment et des exclamations approbatives. Régina se plaça à ses pieds, sur le bord du matelas, et je pris une chaise sur laquelle je m’assis à une certaine distance de cet admirable groupe.
« Eh bien, nous allons tout vous dire en deux paroles, s’écria Régina en levant ses beaux yeux humides sur mon visage, comme pour m’interroger ou me fléchir. Mais d’abord, reprit-elle en s’interrompant, comme si elle eût commis une étourderie, folle que je suis ! dit-elle, j’ai une lettre pour vous, et je ne vous la donne pas ! »
En disant cela, elle tira de son sein une feuille de papier plié en cœur, et me la remit toute chaude encore de la chaleur de sa robe. Le papier n’était pas cacheté, je l’ouvris. Je reconnus la main de Saluce et je lus :
« Château fort de ***, États romains.
Celle qui te remettra ce papier est plus que ma vie. Je suis prisonnier ; mais je me sentirai libre si elle est libre au moins, elle. Elle va en France cacher son existence et son nom. Je ne puis l’adresser qu’à toi ; cache-moi mon trésor, et sois pour elle ce que j’aurais été pour celle que tu as aimée.
SALUCE. »
Je ne fus nullement surpris de cette lettre et de la prison d’État d’où elle était datée. Les lettres précédentes de Saluce m’avaient assez préparé à quelque catastrophe de ce genre. Cependant je fis une exclamation de douleur plus que d’étonnement.
« Hélas ! oui, dit la vieille femme, en nous sauvant il s’est perdu, lui ! Mais, patience ! le procès se jugera ; j’ai des amis encore dans les juges. La justice triomphera, je n’en doute pas.
– Et l’amour ! » s’écria la jeune fille en baisant un portrait qui était incrusté dans un bracelet au bras de la comtesse et dans lequel je reconnus le portrait de Saluce.
Alors elles me racontèrent tour à tour, et souvent toutes deux à la fois, le dénouement d’une passion dont je connaissais déjà toutes les phases par la correspondance de mon ami. Des torrents de larmes furent versés pendant ce récit par les deux étrangères. Je retenais à peine les miennes. Elles finirent par implorer mes conseils, ma direction et mon appui pendant l’exil auquel les condamnait leur infortune. Si l’amitié et la pitié n’avaient pas suffi pour me commander le plus absolu dévouement à leur sort, la merveilleuse beauté de Régina ne m’aurait pas laissé la faculté même d’hésiter. Son regard, sa voix, son sourire, ses larmes, le tourbillon d’attraction dans lequel elle entraînait et subjuguait tout ce qui l’approchait, ne me faisaient sentir que le bonheur de me dévouer à la fois à un devoir et à un entraînement. Je n’étais pas amoureux ; l’état de mon âme, mon devoir envers mon ami captif, m’auraient fait un crime de la seule pensée de l’aimer. Mais j’étais bien plus qu’amoureux. Ses regards avaient absorbé ma volonté. Je m’étais senti pénétrer dans cette atmosphère de rayons, de langueur, de feu, de larmes, de splendeur et de mélancolie, d’éclat et d’ombre, qui enveloppait cette magicienne de vingt ans. Je l’aurais suivie involontairement, comme la feuille morte suit le vent qui court. Un ami, un sauveur, un frère, un complaisant, un esclave, un martyr, une victime volontaire, elle pouvait faire tout de moi, tout, excepté un amant !
Elle le voulut et elle le fit.
Je dînai avec les deux étrangères, je restai longtemps encore après à la fenêtre sur les prés qu’éclairait une belle lune, à causer à voix basse avec Régina de son amour et de mon malheureux ami. Sa grand-mère, malade et toujours couchée sur le matelas, gémissait et soupirait dans l’ombre de la chambre sur l’horrible perspective de mourir à l’étranger, en laissant sa petite-fille à la merci de l’exil ou de la tyrannie qui voulait opprimer son cœur ! Je la consolais par l’espérance de la liberté sans doute bientôt rendue à Saluce, et par mes protestations de dévouement à leur infortune passagère. Nous roulions différentes idées dans nos-esprits sans nous arrêter à aucune. Enfin je les engageai à se reposer toute la matinée du lendemain au Pont-de-Pany, pour que ce repos rendît des forces à la comtesse ; je lui promis de revenir le soir du jour suivant me mettre à leurs ordres pour les suivre là où elles auraient décidé d’aller s’établir. Je dis à la grand-mère de me regarder comme un fils, à Régina de se fier à moi comme à un frère. En retrouvant dans ma bouche les mots et l’accent de leur patrie que j’avais conservé depuis mes longs séjours à Rome, elles croyaient retrouver leur ciel et leur nature. Je pris congé d’elles et je remontai lentement, les yeux tout éblouis, l’oreille toute sonnante, le cœur tout troublé, les gorges creuses et sinistres qui serpentent du Pont-de-Pany au château d’Urcy. Mon oncle dormait depuis longtemps.