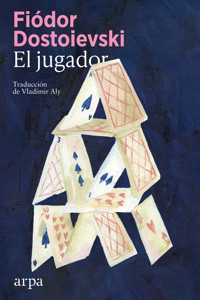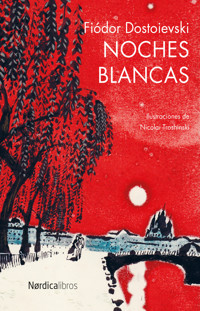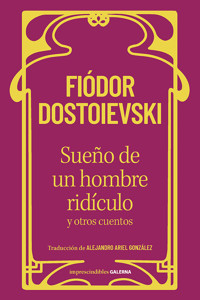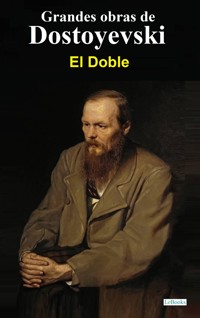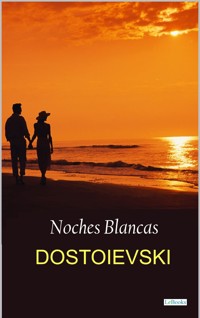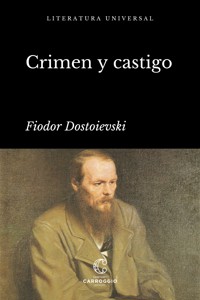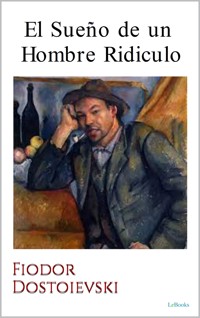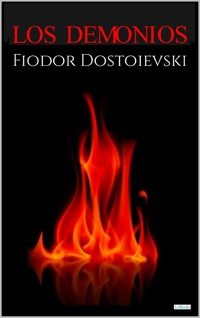Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Hier j'ai été heureux, excessivement heureux, on ne peut pas plus heureux ! Une fois, du moins, dans votre vie, entêtée, vous m'avez écouté. Le soir, à huit heures, je m'éveille (vous savez, matotchka, que j'aime à dormir une couple d'heures quand je suis revenu du bureau), je m'étais procuré une bougie, j'apprête mon premier, je taille ma plume ; soudain, par hasard, je lève les yeux, – vraiment, mon cœur s'est mis à sauter si fort ! Ainsi, vous avez..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335096842
©Ligaran 2015
« Honneur et gloire nu jeune poète dont la muse aime les locataires des mansardes et des caves, et dit d’eux aux habitants des palais dorés : Ce sont aussi des hommes, ce sont vos frères ! » C’est en ces termes que Biélinsky saluait en 1846 l’apparition des Pauvres Gens, et certes l’enthousiasme du grand critique russe n’avait rien que de légitime : pour son début, Dostoïevsky venait de s’affirmer comme un maître ; à vingt-cinq ans, à l’âge où tant d’écrivains, même heureusement doués, se cherchent encore, il s’était soudain révélé, sinon dans toute la plénitude de sa puissante personnalité, du moins avec ce qui devait en rester toujours le trait le plus significatif : son ardente et contagieuse sympathie pour les obscurs vaincus de la vie, ceux que lui-même a appelés plus tord les « humiliés » et les « offensés ».
N’exagérons rien toutefois, et que notre admiration pour Dostoïevsky ne nous rende pas injustes à l’égard de son précurseur, car il en eut un. Quelque originalité qui éclate dans les Pauvres Gens, on ne peut dire de ce livre : proles sine matre creata ! C’est Gogol, il ne faut pas l’oublier, qui, par son immortelle création d’Akakii Akakiévitch, a le premier appelé l’intérêt sur le petit tchinovnik, et montré un être humain dans ce grotesque voué exclusivement jusqu’alors aux sarcasmes des écrivains humoristiques. Œuvre éminemment suggestive, le Manteau a exercé une influence considérable sur le mouvement de la littérature russe ; nombre de romanciers y ont puisé des inspirations, et il est visible que le souvenir de cette nouvelle a hanté avec persistance l’imagination de Dostoïevsky pendant qu’il écrivait ses Pauvres Gens.
Mais combien notre auteur a élargi, amplifié, idéalisé, la vision de son devancier ! Commencée dans Gogol par la souffrance, la réhabilitation de l’employé s’achève dans Dostoïevsky par le dévouement. Akakii Akakiévitch est une figure assez insignifiante en somme ; il n’a d’intéressant que son infortune et serait profondément ridicule s’il n’était profondément malheureux. Sans doute Makar Diévouchkine, le héros des Pauvres Gens, est à plaindre aussi ; mais en même temps qu’on le plaint, on l’admire, car cet être si chétif, si dénué, offre dans son humble personne comme un résumé de toute la bonté humaine. Charitable jusqu’à l’abnégation, on le voit en toute occasion se priver du nécessaire pour venir en aide à de plus besogneux que lui. La misère, trop souvent cause et excuse de l’égoïsme, n’a fait que surexciter dans cette nature exceptionnelle l’essor des sentiments altruistes.
L’élévation morale nous frappe d’autant plus chez Makar Diévouchkine, qu’elle s’allie bizarrement à un esprit inculte. L’intelligence du pauvre homme est restée à l’état rudimentaire ; sa philosophie est enfantine, ses jugements littéraires sont d’une innocence qui fait sourire ; jamais ses idées ne dépassent le niveau de la banalité la plus plate, et il n’a pour les exprimer qu’un vocabulaire incertain dont il ne sait même pas se servir congrûment : tout en lui est médiocre, excepté le cœur.
Ce qui achève de caractériser le principal personnage des Pauvres Gens, c’est son humeur soumise et résignée, alors que toutes les circonstances extérieures devraient, ce semble, faire de lui un révolté. Phénomène drolatique ou touchant, comme on voudra, – il n’y a pas plus conservateur que ce pauvre diable qui n’a rien du tout à conserver. Loin de maudire la société dont il est un des parias, il l’accepte telle qu’elle est, satisfait du rang infime qu’il y occupe. Si parfois lui échappe une timide protestation contre les injustices de l’ordre social, ce n’est point parce qu’il en souffre, mais parce qu’elles font souffrir ceux qu’il aime, et encore ce léger mouvement de révolte, il se le reproche aussitôt comme un crime. C’en est un, en effet, aux yeux de ce chrétien qui voit dans toutes les choses humaines l’accomplissement d’un décret providentiel. Pourquoi s’irriter de l’inégalité des conditions, puisque chacun tient de la volonté divine sa place ici-bas ? « Celui-ci est destiné à porter les épaulettes de général, celui-là à servir comme conseiller titulaire ; tel a pour lot le commandement, tel l’obéissance craintive et silencieuse. Cela est réglé suivant les capacités de l’homme ; l’un est propre à une chose, l’autre à une autre, et les capacités sont données par Dieu lui-même. » Ainsi pense Makar Diévouchkine ; il se représente le monde comme une immense administration où chacun est molesté par son supérieur, et moleste son inférieur ; autrement, remarque-t-il, il n’y aurait pas d’ordre. Cette résignation, cette passivité si étonnante pour nous autres Occidentaux, est un trait ethnique plus encore qu’une particularité individuelle ; par là Makar Diévouchkine se montre vraiment Russe, il est bien le congénère de ce paysan dont parle Golovine, qui, battu par son soigneur, disait : « Le Christ a souffert et nous a ordonné de souffrir. »
Les amateurs de beau langage n’ont certainement pas oublié le discours où M. Renan, célébrant les vertus égayantes de la langue française, invitait la malheureuse race slave à y chercher des consolations. Cette compassion part d’un bon naturel ; d’un autre côté, il est grandement désirable, pour l’enrichissement de nos écrivains, que leurs livres, après avoir fait notre joie, aillent consoler à l’étranger le plus de gens possible. Toutefois il est permis de se demander si un peuple a besoin d’être consolé, quand il pense comme Makar Diévouchkine ou le moujik cité plus haut. En supposant même qu’il lui faille des consolations c’est encore une question de savoir si, en effet, notre littérature peut les lui fournir. Elle est fort gaie, dit l’éloquent conférencier. Possible ; mais si l’on songe qu’une plaisanterie du boulevard n’est pas toujours saisie au Marais, on a quelque lieu de douter que la gaieté soit un article d’exportation. En revanche, ce qui ne fait doute pour personne, c’est la supériorité de la langue française en tant que véhicule des idées révolutionnaires. Tous les peuples ne comprendront peut-être pas un numéro du Tintamarre, mais tous comprendront le Contrat social. Nous l’avons compris les premiers, et qu’en est-il advenu ? Des revendications continuelles dont l’absolue justice et l’absolue inutilité sont également incontestables, des espoirs toujours trompés et une irritation sans cesse grandissante à mesure que les déceptions se multiplient : voilà depuis cent ans notre histoire. Ce n’est pas très gai, et s’il est vrai, ainsi qu’on le croit généralement, que notre littérature ait contribué pour beaucoup à amener cet état de choses, il est quelque peu audacieux de la proposer aux Russes comme un élément de gaieté. En homme borné qu’il est, Makar Diévouchkine se fait de la société une conception fort naïve à coup sûr, mais cette façon de voir lui procure, du moins, quelque tranquillité morale : la conception égalitaire dont nous sommes férus, outre qu’elle n’est peut-être pas beaucoup plus intelligente, a l’inconvénient de nous agiter sans relâche. Laissons donc le pauvre tchinovnik croire au droit divin des conseillers d’État actuels, etc. ; ce n’est pas la peine de le désabuser, il n’en sera pas plus heureux.
En regard de son employé, l’auteur a placé une jeune fille, victime comme lui d’une fatalité malheureuse. Le caractère de Varvara Alexéievna est tracé avec beaucoup d’art ; mais, nonobstant le charme que Dostoïevsky a essayé de répandre sur ce personnage, Makar Alexéiévitch tire à lui tout l’intérêt du livre : dans le voisinage d’un saint, quel prestige peut conserver une simple fille d’Ève ?
Autour de ces deux figures principales gravitent plusieurs autres « pauvres gens »; ce sont des comparses dont il y a peu à dire ; parmi eux pourtant se détache avec un relief particulier le bonhomme Pokrovsky, ce vieillard crapuleux que relève au milieu de son abjection sa maladive tendresse pour un fils dont il n’est pas le père. La rédemption de l’ivrogne par le sentiment de la famille est, d’ailleurs, une idée chère à Dostoïevsky et sur laquelle il reviendra plus d’une fois. Le Pokrovsky des Pauvres Gens contient déjà en germe le Maméladoff de Crime et Châtiment et le Snéguireff des Frères Karamazoff.
Nous venons de nommer les deux maîtresses œuvres de notre romancier. Pour atteindre ces cimes de son talent, le débutant de 1846 a encore bien du chemin à faire : il lui reste à acquérir les secrets de la terreur comme il a déjà trouvé ceux de la pitié ; il faut qu’il apprenne à promener son lecteur, d’épouvantement en épouvantement, à travers le dédale savamment compliqué d’une vaste composition ; mais surtout il faut qu’il devienne à moitié fou ; ce sera l’affaire de quelques années passées dans un bagne sibérien. Pour le moment, nous n’avons pas encore « toute la lyre »; du moins en a-t-on entendu vibrer avec une intensité incomparable la corde la plus humaine, quand on a lu la douloureuse correspondance de Makar Diévouchkine.
Je m’en voudrais de terminer cette préface sans adresser une parole de remerciement aux écrivains dont les précieux encouragements m’ont soutenu dans le cours de mes travaux. Ma traduction de Crime et Châtiment, entre autres, a reçu de la presse un accueil très bienveillant. À l’exception de M. Philippe Gille, tous les critiques chargés de la bibliographie dans les grands journaux de Paris ont jugé à propos de signaler ce livre, et plusieurs avec éloge. Je dois une reconnaissance particulière à MM. Paul Ginisty, Paul Bourde, Valery Vernier et E. Lepelletier, lesquels n’ont pas attendu le retentissant article de M. E.M. de Vogüé pour appeler l’attention du public sur l’ouvrage de Dostoïevsky. On dira que je ressemble ici à l’âne chargé de reliques et prenant pour lui l’honneur rendu à l’idole. Soit ! j’aime mieux m’exposer à ce ridicule qu’au reproche d’ingratitude.
VICTOR DERÉLY.
Oh ! ces conteurs ! Au lieu d’écrire quelque chose d’utile, d’agréable, de récréatif, ils mettent au jour tous les dessous de la vie !… Voilà, je leur défendrais d’écrire ! Allons, à quoi ça ressemble-t-il ? Vous lisez… involontairement vous devenez pensif, – et alors toutes sortes d’absurdités vous viennent à l’esprit ; en vérité, je leur défendrais d’écrire, je le leur interdirais absolument.
Prince V.F. ODOÏEVSKY.
8 avril.
MON INAPPRÉCIABLE VARVARA ALEXÉIEVNA !
Hier j’ai été heureux, excessivement heureux, on ne peut pas plus heureux ! Une fois, du moins, dans votre vie, entêtée, vous m’avez écouté. Le soir, à huit heures, je m’éveille (vous savez, matotchka, que j’aime à dormir une couple d’heures quand je suis revenu du bureau), je m’étais procuré une bougie, j’apprête mon papier, je taille ma plume ; soudain, par hasard, je lève les yeux,– vraiment, mon cœur s’est mis à sauter si fort ! Ainsi, vous avez tout de même compris ce que je voulais, ce dont mon cœur avait envie ! Je vois qu’à votre fenêtre un petit coin du rideau est relevé et accroché au pot de balsamine, exactement comme je vous l’avais insinué l’autre jour ! J’ai même cru alors apercevoir votre visage à la fenêtre ; il m’a semblé que vous aussi me regardiez de votre chambrette, que vous aussi pensiez à moi. Et qu’il a été vexant pour moi, ma chère, de n’avoir pas bien pu voir votre joli petit minois ! Il fut un temps où nous aussi voyions clair, matotchka. Vieillesse n’est pas liesse, ma bonne amie ! Maintenant je vois toujours trouble ; pour peu que je travaille le soir, que je fasse quelques écritures, le lendemain matin j’ai les yeux rouges et larmoyants ; devant les étrangers je suis même honteux de pleurer ainsi. Pourtant, en imagination, j’ai vu briller votre sourire, mon petit ange, votre bon, votre affable petit sourire, et dans mon cœur ç’a été tout à fait la même sensation que quand je vous ai embrassée, Varinka, – vous en souvenez-vous, mon petit ange ? Savez-vous, chérie, il m’a même semblé que vous me menaciez du doigt ! Est-ce vrai, espiègle ? Ne manquez pas de me retracer tout cela en détail dans votre lettre.
Eh bien, mais comment trouvez-vous notre invention au sujet de votre rideau, Varinka ? Très gentille, n’est-ce pas ? Que je me mette au travail, que je me couche, que je m’éveille, je sais que là vous aussi pensez à moi, que vous vous souvenez de moi, que vous-même êtes bien portante et gaie. Vous baissez le rideau, – cela signifie : « Adieu, Makar Alexéiévitch, il est temps de se coucher ! » Vous le relevez, – cela veut dire : « Bonjour, Makar Alexéiévitch ; comment avez-vous dormi ? » ou : « Comment va votre santé, Makar Alexéiévitch ? Quant à moi, grâce au Créateur, je vais bien et suis contente ! » Voyez-vous, mon âme, comme c’est bien imaginé ! On n’a même pas besoin de s’écrire ! Un truc ingénieux, pas vrai ? Et c’est moi qui ai eu cette petite idée ! Hein, quel homme je suis pour ces choses-là, Varvara Alexéievna !
Je vous apprends, matotchka, Varvara Alexéievna, que, contre mon attente, j’ai dormi convenablement cette nuit, ce dont je suis très content ; en général, on ne dort pas bien dans un nouveau logement la première fois qu’on y couche ; c’est la même chose et ce n’est pas la même chose ! Ce matin, je me suis levé tout guilleret, tout joyeux ! Quelle belle matinée aujourd’hui, matotchka ! Chez nous on a ouvert une fenêtre ; le soleil brille, les oiseaux gazouillent, l’air est embaumé des senteurs du printemps, et la nature entière se ranime ; – eh bien, tout le reste ici correspondait à cela, tout était dans la note, printanier. J’ai même fait aujourd’hui des rêves assez agréables, qui tous avaient trait à vous, Varinka. Je vous ai comparée au petit oiseau du ciel, créé pour la joie des hommes et pour l’ornement de la nature. Je songeais aussi, Varinka, que nous autres hommes, qui vivons dans les soucis et l’agitation, nous devions envier le bonheur innocent et calme des oiseaux du ciel, – et toutes sortes d’idées dans ce genre-là ; je veux dire que je faisais toujours de ces comparaisons lointaines. J’ai là un livre, Varinka, où se trouvent les mêmes pensées ; tout cela y est développé très longuement. C’est pour vous dire, matotchka, que les rêveries sont de diverses sortes. Maintenant nous sommes au printemps ; eh bien, on a des idées agréables, fines, piquantes, et l’on fait des rêves tendres ; tout est couleur de rose. Voilà ce que je voulais vous dire ; du reste, j’ai pris tout cela dans le livre. L’auteur exprime le même souhait en vers, il écrit :
Il y a encore là d’autres pensées, mais laissons-les ! Et vous, Varvara Alexéievna, où êtes-vous allée ce matin ? Je n’étais pas encore parti pour mon bureau quand vous vous êtes envolée de votre chambre, tout à fait comme un petit oiseau du ciel ; vous avez traversé la cour d’un air si gai ! Avec quel plaisir je vous ai contemplée ! Ah ! Varinka, Varinka ! ne vous abandonnez pas à la tristesse ; les larmes ne remédient à rien ; je sais cela, matotchka, je le sais par expérience. Maintenant vous êtes si tranquille, et puis votre santé s’est un peu améliorée. – Et votre Fédora ? Ah ! quelle brave femme c’est ! Vous m’écrirez, Varinka, comment vous vivez toutes deux à présent et si vous êtes contentes sous tous les rapports. Fédora est un peu grondeuse ; mais ne faites pas attention à cela, Varinka. Que Dieu lui pardonne ! Elle est si bonne !
Je vous ai déjà écrit au sujet de notre Thérèse, – c’est aussi une femme bonne et sûre. Mais que j’étais déjà inquiet pour notre correspondance ! Comment nos lettres nous seront-elles transmises ? me demandais-je. Et voilà que Dieu a envoyé Thérèse pour notre bonheur. C’est une femme bonne, douce, silencieuse. Mais notre logeuse est vraiment sans pitié. Elle la fait travailler comme une esclave.
Dans quel trou je me suis fourré, Varvara Alexéievna ! Voilà un logement ! Autrefois, vous le savez vous-même, je vivais comme un ermite – au milieu du calme et du silence ; une mouche ne pouvait pas voler chez moi sans qu’on l’entendit. Et ici un bruit, des cris, un tumulte ! Mais vous ne savez pas encore comment tout cela est organisé ici. Figurez-vous, par exemple, un long corridor, très obscur et très malpropre. À droite de ce corridor, un mur plein ; à gauche, une suite de portes, comme dans les hôtels garnis. Eh bien, ces portes sont celles des logements, lesquels se composent chacun d’une seule chambre, et dans cette pièce unique habitent jusqu’à deux et trois personnes. Ne cherchez pas d’ordre chez nous, c’est l’arche de Noé ! Du reste, les locataires paraissent être de braves gens, des hommes cultivés, instruits. Parmi eux se trouve un employé (il a quelque part un service littéraire), c’est un érudit : il parle d’Homère, de Brambéous et de divers écrivains, il parle de tout ; – un homme intelligent ! Il y a aussi deux officiers qui jouent tout le temps aux cartes. Il y a un enseigne de vaisseau, il y a un Anglais qui donne des leçons. Attendez, je vous amuserai, matotchka ; dans ma prochaine lettre je les décrirai satiriquement, c’est-à-dire que je vous ferai le portrait individuel et détaillé de chacun d’eux. Notre logeuse, – une vieille femme très petite et très sale, – est toute la journée en pantoufles et en robe de chambre ; toute la journée elle tarabuste Thérèse. Je demeure dans la cuisine, ou, pour mieux dire, voici comment je suis logé : ici, à côté de la cuisine, il y a une chambre (et chez nous, je dois vous le faire observer, la cuisine est propre, claire, fort belle), une petite pièce, un petit réduit si discret… ou, pour m’exprimer avec plus de justesse encore, la cuisine, vaste et recevant le jour par trois fenêtres, est coupée transversalement par une cloison, ce qui fait comme une nouvelle chambre, un logement surnuméraire ; ce local est spacieux, confortable ; il a une fenêtre, – en un mot, il est très commode. Eh bien, voilà mon gîte. Parce que j’ai dit que je demeure dans la cuisine, n’allez pas, matotchka, chercher sous mes paroles je ne sais quel sens mystérieux. En effet, si vous voulez, je loge bien dans cette pièce, derrière la cloison, mais ce n’est rien ; j’ai là mon logis particulier où je vis très isolé, très tranquille. J’ai mis chez moi un lit, une table, une commode, deux chaises ; j’ai pendu un obraz au mur. Sans doute, il y a des logements plus beaux, beaucoup plus beaux même peut-être ; mais le principal, c’est la commodité ; j’ai choisi celui-ci parce qu’il est commode, n’allez pas croire que ce soit pour autre chose. Votre fenêtre est en face, il n’y a entre nous qu’une cour, et une petite cour, on vous aperçoit en passant ; – pour un malheureux comme moi ce logement n’en est que plus gai, outre qu’il me fait réaliser une économie. Ici, chez nous, la chambre la plus modeste, avec la table, revient à 35 roubles papier. Cela dépasse mes moyens ! Mon loyer est de 7 roubles papier, la table me coûte 5 roubles argent, voilà 24 r. 50 kop., et auparavant je payais juste 30 roubles ; en revanche je devais me refuser bien des choses ; je ne buvais pas tous les jours du thé, tandis que maintenant je me trouve avoir de l’argent de reste pour le thé et le sucre. Savez-vous, ma chère, on aurait honte en quelque sorte de ne pas boire de thé ; ici tous les locataires sont des gens à leur aise, voilà pourquoi l’on serait honteux. On en prend par respect humain, Varinka, pour le genre, pour le ton ; personnellement je n’y tiens pas, je ne suis pas sur ma bouche. Comptez maintenant l’argent de poche, – il en faut toujours un peu, – ajoutez les frais de chaussure et de vêtement ; combien restera-t-il ? Voilà tout mon traitement dépensé. Je ne me plains pas, je suis satisfait de ce que je gagne. Mes honoraires sont suffisants. Depuis quelques années déjà, ils le sont ; il y a aussi les gratifications. – Allons, adieu, mon petit ange. J’ai acheté un pot de balsamine et un pot de géranium, – pas cher. Mais vous aimez peut-être aussi le réséda ? Eh bien, vous me le direz dans votre lettre ; il y a aussi des résédas ; mais savez-vous, écrivez-moi tout avec le plus de détails possible. Du reste, ne pensez rien et ne vous tourmentez pas l’esprit à mon sujet, matotchka, parce que j’ai loué une telle chambre. Non, c’est la commodité qui m’a séduit, je n’ai été déterminé que par cela. J’amasse, matotchka, je mets de l’argent de côté ; j’ai un petit magot. Ne me considérez pas comme un pauvret qu’une mouche renverserait d’un coup d’aile. Non, matotchka, je ne suis pas un niais, et j’ai tout à fait le caractère qui sied à un homme d’une âme ferme et calme. Adieu, mon petit ange ! J’ai rempli près de deux feuilles, et il est plus que temps d’aller au service. Je baise vos petits doigts, matotchka, et reste
Votre très humble serviteur et fidèle ami
MAKAR DIÉVOUCHKINE.
P.S. – J’ai une prière à vous adresser : répondez-moi, mon petit ange, le plus longuement possible. Je vous envoie avec la présente, Varinka, une petite livre de bonbons ; veuillez y faire honneur ; mais, pour l’amour de Dieu, ne vous inquiétez pas de moi et ne soyez pas mécontente. Allons, adieu, matotchka.
8 avril.
MONSIEUR MAKAR ALEXÉIÉVITCH !
Savez-vous que décidément nous finirons par nous brouiller ensemble ? Je vous jure, bon Makar Alexéiévitch, qu’il m’est même pénible de recevoir vos cadeaux. Je sais ce qu’ils vous coûtent, je sais que, pour me les offrir, vous vous imposez les plus grands sacrifices, vous vous privez du nécessaire. Combien de fois vous ai-je dit que je n’ai besoin de rien, absolument de rien ; que je ne suis pas en mesure de reconnaître même les bienfaits dont vous m’avez comblée jusqu’à présent ! Et pourquoi m’envoyer ces pots ? Allons, passe encore pour la balsamine ; mais le géranium, pourquoi ? Il suffit qu’on lâche un petit mot sans y faire attention, comme, par exemple, au sujet de ce géranium, et tout de suite vous achetez ; cette plante a dû vous coûter cher, sans doute ? Que ses fleurs sont jolies ! Rouges et parsemées de petites croix. Où vous êtes-vous procuré un si beau géranium ? Je l’ai placé au milieu de la croisée, à l’endroit le plus apparent ; je poserai un escabeau sur le plancher, et sur l’escabeau je mettrai encore des fleurs ; seulement, voilà, laissez-moi devenir riche ! Fédora ne se sent pas de joie ; nous sommes maintenant ici comme en paradis, – notre chambre est propre, claire ! Eh bien, mais pourquoi des bonbons ? Vraiment, j’ai deviné tout de suite, en lisant votre lettre, que vous n’étiez pas dans votre assiette : – le paradis, le printemps, les parfums qui volent dans l’air, les petits oiseaux qui gazouillent. Qu’est-ce que c’est que cela ? me suis-je dit, n’y aurait-il pas aussi des vers ? En vérité, il ne manque que des vers à votre lettre, Makar Alexéiévitch ! Et les sensations tendres, et les rêves couleur de rose, – tout y est ! Pour ce qui est du rideau, je n’y ai même pas pensé ; il se sera sans doute accroché tout seul, quand j’ai déplacé les pots ; voilà pour vous !
Ah ! Makar Alexéiévitch ! Vous avez beau dire, vous avez beau dresser votre budget de façon à me faire croire que toutes vos ressources sont exclusivement affectées à vos besoins, vous ne réussirez pas à me tromper. Il est évident que vous vous privez du nécessaire pour moi. Quelle idée avez-vous eue, par exemple, de prendre un pareil logement ? On vous dérange, on vous trouble ; vous êtes à l’étroit, mal à l’aise. Vous aimez la solitude, et là que n’y a-t-il pas autour de vous ? Et vous pourriez vous loger beaucoup mieux, étant donné votre traitement. Fédora dit qu’autrefois vous viviez infiniment mieux qu’à présent. Se peut-il que vous passiez ainsi toute votre vie dans l’isolement, dans les privations, sans joie, sans une cordiale parole d’ami, installé dans un coin chez des étrangers ? Ah ! bon ami, que je vous plains ! Ménagez, du moins, votre santé, Makar Alexéiévitch ! Vous dites que vos yeux s’affaiblissent ; eh bien, n’écrivez plus à la lumière. Pourquoi écrire ? Sans doute votre zèle pour le service est déjà assez connu de vos chefs sans cela.
Je vous en supplie encore une fois, ne dépensez pas tant d’argent pour moi. Je sais que vous m’aimez, mais vous non plus n’êtes pas riche… Aujourd’hui, moi aussi j’étais gaie en me levant. Je me sentais si heureuse ; depuis longtemps déjà Fédora avait de l’ouvrage, et elle m’en a procuré. J’en ai été si contente, je ne suis sortie que pour aller acheter de la soie ; ensuite je me suis mise à travailler. Pendant toute la matinée j’ai eu l’âme si légère, j’ai été si gaie ! Mais maintenant les idées noires sont revenues, la tristesse et l’inquiétude ont repris possession de mon cœur.
Ah ! que deviendrai-je ? quel sera mon sort ? Il est cruel pour moi de vivre dans une pareille incertitude, de n’avoir pas d’avenir, de ne pouvoir même rien conjecturer quant à ma destinée future. Et si je reporte mes regards en arrière, je suis épouvantée. Le seul souvenir de ce douloureux passé me déchire le cœur. Toujours je me plaindrai des méchantes gens qui m’ont perdue !
Le jour baisse. Je dois me remettre au travail. J’avais bien des choses à vous écrire, mais le temps me manque ; j’ai une besogne pressée, il faut que je me dépêche. Sans doute les lettres sont une bonne chose, cela rend la vie moins ennuyeuse. Mais est-ce que vous-même ne viendrez jamais chez nous ? Pourquoi cela, Makar Alexéiévitch ? À présent nous sommes voisins, et vous saurez bien trouver parfois un moment de libre. Venez, je vous prie. J’ai vu votre Thérèse. Elle a l’air bien malade ; elle m’a fait pitié ; je lui ai donné vingt kopeks. Oui ! J’allais l’oublier : ne manquez pas de me donner tous les détails possibles sur votre genre de vie. Quels sont les gens qui vous entourent ? Vivez-vous en bonne intelligence avec eux ? Je tiens beaucoup à savoir tout cela. Ne manquez pas de me l’écrire, vous entendez ? Aujourd’hui je relèverai exprès le coin de mon rideau. Couchez-vous un peu plus tôt ; hier j’ai vu de la lumière chez vous jusqu’à minuit. Allons, adieu. Aujourd’hui je suis anxieuse, ennuyée et chagrine. Apparemment il y a des jours comme cela ! Adieu.
Votre
VARVARA DOBROSÉLOFF.
8 avril.
MADEMOISELLE VARVARA ALEXÉIEVNA !
Oui, matotchka, oui, ma chère, évidemment j’étais aujourd’hui dans un jour de malheur ! Oui, vous vous êtes moquée de moi, d’un vieillard, Varvara Alexéievna ! Du reste, c’est ma faute, c’est moi qui ai tous les torts ! À l’âge où je suis arrivé, quand je n’ai plus que quelques cheveux sur la tête, je n’aurais pas dû me lancer dans les amours et les équivoques… Et je le dis encore, matotchka : l’homme est quelquefois étonnant, fort étonnant. Et, saints du ciel ! quelles choses on est parfois entraîné à dire ! Mais à quoi cela aboutit-il ? qu’est-ce qui en résulte ? cela n’aboutit absolument à rien, et il n’en résulte que des sottises, dont Dieu veuille me préserver ! Moi, matotchka, je ne suis pas fâché ; seulement c’est si vexant de se rappeler tout cela, je suis si contrarié de vous avoir écrit en termes si figurés et si bêtes ! Aujourd’hui j’étais si faraud, si fringant en allant au service, mon cœur était comme illuminé. Sans motif aucun il y avait une telle fête dans mon âme ; je me sentais joyeux ! Je me suis mis consciencieusement à ma besogne – mais qu’est-ce qui s’en est suivi ? Sitôt que j’ai eu jeté un regard autour de moi, les choses ont repris à mes yeux leur aspect accoutumé, – leur couleur grise et sombre. Toujours les mêmes taches d’encre, toujours les mêmes tables avec les mêmes papiers, et moi toujours le même aussi ! Tel j’étais, tel je me suis retrouvé ; – dès lors pourquoi avais-je enfourché Pégase ? Mais qu’est-ce qui a donné lieu à tout cela ? C’est que le soleil brillait et que le ciel était bleu ! Voilà la cause, n’est-ce pas ? Et je vais parler d’aromates, quand dans notre cour, sous nos fenêtres, Dieu sait ce qui ne se rencontre pas ! Pour sûr, c’est dans un coup de folie que tout cela m’est apparu de cette façon. Mais il arrive parfois à l’homme de s’abuser ainsi sur ses propres sensations et de battre la campagne. Cela ne vient pas d’autre chose que d’une chaleur de cœur exagérée, stupide. Je suis retourné chez moi, ou, pour mieux dire, je m’y suis traîné ; il m’était venu soudain un mal de tête : sans doute une chose en amène une autre. (J’ai eu probablement un coup d’air.) Imbécile, je me réjouissais de l’arrivée du printemps, et j’étais sorti avec un manteau fort léger vous aussi, ma chère, vous vous êtes méprise sur mes sentiments ! Trompée par leur ardeur, vous les avez interprétés tout de travers. C’est une affection paternelle qui inspirait mes paroles, rien que la plus pure affection paternelle, Varvara Alexéievna. Je tiens, en effet, la place d’un père auprès de vous, puisque vous avez le malheur d’être orpheline ; je dis cela du fond de l’âme, dans la sincérité de mon cœur, en parent. Je sais bien qu’il n’y a entre nous qu’une parenté éloignée, et que, comme dit le proverbe, il s’en faut un cent de fagots que nous soyons de la même branche ; mais n’importe, les liens du sang ne m’en attachent pas moins à vous, et maintenant je suis votre parent le plus proche, votre protecteur naturel, car là où vous étiez le plus en droit de chercher protection et défense, vous n’avez trouvé que trahison et injure. Quant aux vers, je vous dirai, matotchka, qu’à mon âge il est inconvenant de s’adonner à cet exercice. Les vers, c’est de la sottise ! Dans les écoles même à présent on fouette les moutards qui en font… voilà ce que c’est que la versification, ma chère.
Que parlez-vous dans votre lettre, Varvara Alexéievna, de confort, de tranquillité, etc. ? Je ne suis pas difficile ni exigeant, matotchka ; jamais je n’ai vécu mieux qu’à présent ; pourquoi donc m’aviserais-je sur le tard de faire le dégoûté ? Je suis nourri, vêtu, chaussé ; qu’ai-je besoin de rechercher des fantaisies ? – Je ne suis pas le fils d’un comte ! – Mon père n’appartenait pas à la noblesse, et, tout chargé de famille qu’il était, il ne gagnait pas ce que je gagne. Je ne suis pas un efféminé ! Du reste, pour dire la vérité, tout était mieux dans mon ancien logement, il n’y a pas de comparaison ; on y était plus à l’aise, matotchka. Sans doute mon local actuel est bien aussi, plus gai même à certains égards ; si vous voulez, il offre plus de variété ; je ne dis pas le contraire, mais je regrette tout de même l’ancien. Nous autres vieilles gens, nous nous attachons aux vieilles choses comme par l’effet d’une sympathie naturelle. Ce logement, vous savez, était fort petit ; les murs étaient… – allons, pourquoi en parler ? – les murs étaient comme tous les murs, il ne s’agit pas d’eux ; mais voilà, tout souvenir de mon passé me rend chagrin… Chose étrange ! cette impression est pénible, et pourtant il s’y mêle une sorte de douceur. Même ce qu’il y avait de mauvais, ce qui parfois m’irritait, cesse dans mes souvenirs d’être mauvais et s’offre à mon imagination sous un aspect attrayant. Nous vivions tranquillement, Varinka, moi et ma logeuse, une vieille femme aujourd’hui défunte. Tenez, maintenant je ne peux pas me rappeler ma vieille sans un sentiment de tristesse ! C’était une brave femme, et elle ne prenait pas cher pour le loyer. Tout le temps elle tricotait des couvertures avec des aiguilles longues d’une archine ; elle n’avait pas d’autre occupation. Nous nous éclairions, elle et moi, à frais communs, et nous travaillions à la même table. Chez elle demeurait sa petite-fille Macha. Je me la rappelle encore enfant ; ce doit être à présent une fillette de treize ans. Elle était si gamine, si gaie, elle nous faisait toujours rire ; eh bien, nous vivions ainsi à trois. Dans les longues soirées d’hiver nous nous asseyions autour de la table ronde, nous buvions une petite tasse de thé, et puis nous nous mettions à l’ouvrage. Pour que Macha ne s’ennuyât pas, et pour la faire rester tranquille, la vieille commençait à raconter des histoires. Et quelles histoires c’étaient ! Non seulement un enfant, mais même un homme sensé et intelligent pouvait les écouter avec intérêt. J’allumais ma pipe et je prêtais une telle attention à ces récits que j’en oubliais ma besogne. Et l’enfant, notre gamine, devenait pensive ; elle appuyait sa joue rose sur sa petite menotte, elle ouvrait sa jolie petite bouche, et, si l’histoire était un peu effrayante, il fallait la voir se serrer contre la vieille ! Pour nous c’était un plaisir de la regarder ; et l’on ne s’apercevait pas que la bougie tirait à sa fin, on n’entendait pas l’ouragan mugir au dehors. – Nous menions une bonne vie, Varinka, et voilà comment nous avons passé ensemble près de vingt ans. – Mais pourquoi ce bavardage ? Un tel sujet ne vous plaît peut-être pas, et moi-même ce n’est pas que ces souvenirs m’égayent, – surtout maintenant : la nuit vient. Thérèse tracasse dans la chambre, j’ai mal à la tête, j’ai aussi un peu mal au dos, et il semble que je souffre également par le fuit de pensées si étranges ; je suis mélancolique aujourd’hui, Varinka ! – Qu’est-ce que vous m’écrivez donc, ma chère ? Comment irais-je chez vous ? Mon amie, que diront les gens ? Il faut traverser la cour, les voisins s’en apercevront, ils se mettront à questionner, ils feront des commentaires, des cancans, le fait sera faussement interprété. Non, mon petit ange, j’aime mieux vous voir demain aux premières vêpres ; ce sera plus sage et moins compromettant pour nous deux. Pardonnez-moi, matotchka, de vous écrire une pareille lettre ; je vois en la relisant combien elle est incohérente. Je suis un vieillard sans instruction, Varinka ; je n’ai pas fait d’études étant jeune, et maintenant rien ne m’entrerait dans l’esprit, si j’essayais de m’instruire. Je le reconnais, matotchka, je n’ai pas de talent descriptif, et je sais que si, sans critiquer ni railler personne, je veux écrire quelque chose d’un peu piquant, j’entasserai sottises sur sottises. – Je vous ai aperçue aujourd’hui à votre fenêtre, je vous ai vue baisser le store. Adieu, adieu ; que le Seigneur vous conserve ! Adieu, Varvara Alexéievna.
Votre ami désintéressé
MAKAR DIÉVOUCHKINE.
P.S. – Ma chère, maintenant je n’écrirai de satire sur personne. Je suis trop vieux, matotchka, Varvara Alexéievna, pour me livrer à un frivole persiflage. C’est de moi qu’on rirait ; comme dit le proverbe russe : « Celui qui creuse une fosse pour autrui y tombe lui-même. »
9 avril.
MONSIEUR MAKAR ALEXÉIÉVITCH !