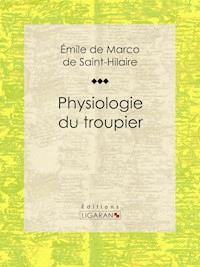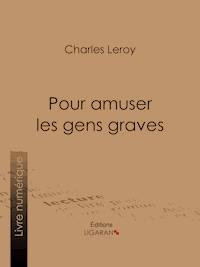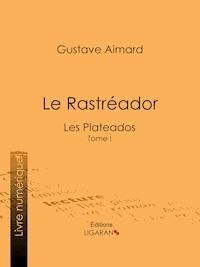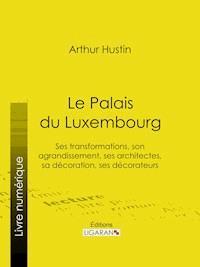Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "Dans toutes les branches des affaires humaines, la pratique a devancé la science. [...] L'Économie politique considérée comme science est toute moderne, mais l'objet dont elle s'occupe a de tout temps constitué l'un des principaux intérêts de l'humanité, et souvent même a pris dans les institutions des peuples une place à laquelle il n'avait pas droit."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335031072
©Ligaran 2015
Deux économistes, penseurs éminents tous les deux, ont vendu célèbre en Angleterre et dans le monde le nom de Mill : James Mill, l’ami de Bentham et de Ricardo, l’auteur de l’Histoire des Indes anglaises ; John Stuart Mill fils, élève et disciple du premier.
James Mili eut pour son lot les débuts difficiles, il connut l’âpre lutte pour la vie ; il dut sein diriger la culture et l’émancipation de son esprit.
D’humble condition, élevé grâce à la protection de sir John Stuart de Fettercain, comme boursier à l’université d’Édimbourg, en vue de la cléricature, il dut, n’ayant pas embrassé la carrière ecclésiastique que lui interdisaient ses opinions philosophiques, accepter une place de précepteur en Écosse ; il vécut ensuite de sa plume jusqu’au moment où il entra dans les bureaux de la Compagnie des Indes.
Dans ces conditions désavantageuses, il se maria, eut une nombreuse famille, se fit seul l’éducateur de ses enfants et trouva du temps pour mener à bien des travaux qui le placèrent au premier rang parmi les philosophes de l’Angleterre.
Son fils, qu’il nomma John Stuart, en souvenir de son bienfaiteur, ne connut pas la dureté des premières étapes, ni le trouble et l’incertitude qu’amènent les révoltes de la pensée contre les croyances primitivement acceptées et la recherche de voies nouvelles.
Il a pu dire qu’il était une des rares personnes d’Angleterre qui n’ont pas rejeté la croyance de la religion, mais qui ne l’ont jamais eue. Il grandit en science et en intelligence sous la forte direction de son père, suivant le sillon tracé, se développant dans une atmosphère de hautes pensées et de nobles aspirations, au contact d’esprits supérieurs et arriva, non sans travail, mais sans efforts douloureux, à la maîtrise de la pensée. Avant même d’avoir atteint sa majorité, il entra comme son père à la Compagnie des Indes, y trouva la sécurité de la vie et un travail qui tout en tenant son esprit en haleine, lui apportait un sérieux contingent d’expérience ; il put consacrer toute sa vie aux plus hautes spéculations de l’esprit.
Dans la première partie de sa vie, John Stuart Mill a été soumis à un régime peu ordinaire, et son éducation constitue une expérience qui mérite une mention.
Son père, James Mill, avait des idées très arrêtées sur la règle à suivre pour développer l’intelligence et tromper l’âme des enfants ; il croyait que :
« Les circonstances particulières qui entourent l’enfant forment les premières habitudes, et que les premières habitudes constituent le caractère fondamental de l’homme, que dès que l’enfant ou plutôt l’embryon commence à sentir, le caractère commence à se former, et que les habitudes qu’il contracte alors sont les plus dominantes et les plus opératives de toutes. »
Ces vues décidèrent du genre d’éducation, du procédé d’entraînement qui fut appliqué à John Stuart Mill.
Dès l’âge de trois ans, l’enfant apprit des vocables grecs.
À huit ans, il avait déjà lu dans le texte original Hérodote, la Cyropédie, les Entretiens mémorables de Socrate, une partie de Lucien, de Diogène Laërce, le Démonique et le Nicoclès d’Isocrate, six dialogues de Platon, etc. Il apprit alors le latin.
Il remplaçait le jeu de billes par la lecture de graves historiens : Robertson, Hume, Gibbon, Hook, Rollin, Millar (Considérations sur le gouvernement anglais), etc. ; ces lectures remplissaient ses heures de récréation.
À huit ans, il apprit le latin en renseignant à une sœur cadette. Il ne garda pas bon souvenir de cet exercice.
De huit à douze ans, il lut plus ou moins complètement parmi les latins : Virgile, Horace, Phèdre, Salluste, Ovide, Térence, Cicéron, Lucrèce, et parmi les grecs : Homère, Sophocle, Euripide, Aristophane, Xénophon, Démosthène, Eschine, Lysias, Théocrite, Denys d’Halicarnasse, Polybe. Il dut mettre en tableaux synoptiques la rhétorique d’Aristote.
Il apprit l’algèbre et la géométrie, il fut mis ensuite à l’algèbre supérieure et au calcul différentiel dont il dut se dépêtrer seul, son père ayant oublié cette partie des mathématiques.
Entre onze et douze ans, s’aidant de ses lectures, il composa une histoire du gouvernement romain ; il y discutait les questions constitutionnelles et prenait parti pour les démocrates de Rome.
À douze ans, il aborda la logique et les opérations de la pensée.
À treize ans, il fit une étude complète de l’économie politique et rédigea un abrégé assez bon pour que son père pût l’utiliser par la suite, quand il écrivit son traité. Pour rédiger son travail il devait faire la critique d’Adam Smith, en s’éclairant des travaux de Ricardo. À treize ans ! ! !
Pour qu’un tel surmenage n’aboutît pas à de fâcheux résultats, il a fallu que le maître et l’élève fussent d’une trempe exceptionnelle.
Un détail nous révèle ce qu’était le père. Il n’y avait pas alors de dictionnaire grec-anglais, le père en tenait lieu. Le père et le fils travaillaient dans la même pièce ; c’étaient des interruptions incessantes. James Mill s’interrompait et répondait ; or, c’était le moment où, au milieu de travaux de toute nature entrepris par nécessité pour faire vivre les siens, il préparait son œuvre magistrale : L’histoire des Indes anglaises.
Grâce à l’allure donnée à la pensée de l’enfant, ses facultés étaient toujours en jeu ; l’élève devait tout découvrir par lui-même ; les exercices de mémoire étaient bannis. L’intelligence toujours en éveil se développait au cours de renseignement. Dès le début, le jeune enfant pensa par lui-même et quelquefois d’une façon différente de son père.
Toute sa vie, John Stuart Mill s’est félicité d’avoir été soumis à cette culture intensive. Il a écrit modestement :
« Si j’ai pu accomplir quelque chose, je le dois, entre autres circonstances heureuses, à ce que l’éducation par laquelle mon père m’a formé m’a donné sur mes contemporains l’avantage d’une avance d’un quart de siècle. »
Il est hors de doute que, grâce à cette éducation, le cerveau de l’élève emmagasina des ressources et des énergies intellectuelles considérables. Dans l’ordre spéculatif, Stuart Mill a été un des plus vigoureux penseurs du siècle. Mais on doit reprocher à la méthode d’avoir négligé les leçons de choses, le contact avec les réalités, d’avoir aiguisé les facultés de raisonnement mais de n’avoir développé ni le goût des recherches des faits ni l’aptitude aux observations personnelles.
Autre lacune plus grave, l’éducation n’avait pas tenu compte des besoins du cœur et avait évité de donner des aliments à la tendresse et au sentiment.
La nature prit sa revanche.
Mais ce qui apparut tout d’abord, ce fut qu’à un âge où les autres jeunes gens avaient à peine terminé leurs humanités le jeune Stuart Mill avait conquis la maîtrise de la pensée.
La discipline à laquelle il avait été soumis avait cependant donné un certain pli à son caractère. On le trouvait, c’est lui qui nous l’a appris, d’une suffisance fort désagréable, parce qu’il était tranchant et raisonneur, plein de raideur convaincue, prompt à redresser ce qui lui paraissait entaché d’erreur.
Quand il fut mis en contact avec d’autres jeunes gens, il fut considéré tout d’abord par eux comme « un homme artificiel, comme un produit de fabrication qui portait comme une marque imprimée, certaines idées, et était seulement capable de les reproduire. » Et lorsque ses camarades le virent faire œuvre de dialecticien, faire preuve d’originalité et de souplesse d’esprit leur étonnement fut grand.
Ces allures revêches et cette apparence de machine se dissipèrent au grand air, au frottement de la vie. Mais le procédé d’éducation devait avoir d’autres effets et de particulièrement douloureux. J. Stuart Mill fut atteint jusqu’au plus profond de son être.
Les spéculations de l’esprit éclairent sans réchauffer, et selon le mot de Vauvenargues, le cœur a des besoins que l’esprit ne peut connaître. Stuart Mill avait, à vingt ans, des facultés éminentes et toute une encyclopédie dans le cerveau. Le développement inharmonique de sa nature le laissait vulnérable. Le doux philosophe qui ne savait rien de la vie connut les heures de prostration comme si son cœur eut été flétri ou brisé.
« Son âme, déprimée et comme engourdie, devint insensible à toute jouissance et à toute sensation agréable. » Son idéal s’obscurcit. Un jour, il se posa cette question : « Supposé que tous les buts que tu poursuis dans la vie soient atteints par toi, que tous les changements dans les opinions et les institutions dans l’attente desquels tu consumes ton existence puissent s’accomplir sur l’heure, en éprouverais-tu une grande joie, serais-tu bien heureux ? » Une voix intérieure répondit : « Non » ; il se sentit défaillir.
Pour poindre son état de souffrance, il a cité ces vers de Coleridge :
Son cerveau pouvait encore travailler mais machinalement, et comme en dehors de la conscience.
Le jeune penseur, grave et pur, se voyait sur la même rive d’angoisse et dans la même posture désespérée où le monde avait vu Byron déchu précoce, désabusé orageux et lyrique. « L’état d’esprit du poète ressemblait trop au mien pour qu’il ne me fût pas douloureux de le lire, » a-t-il écrit dans ses mémoires « son Childe Harold, son Munfred fléchissait sous le même fardeau que moi, » et il répétait les paroles que Macbeth, chargé de crimes, adresse à son médecin :
« Tu ne peux donc pas traiter un esprit malade, arracher de la mémoire un chagrin enraciné, effacer les ennuis écrits dans le cerveau, et grâce à quelque doux antidote d’oubli, débarrasser la poitrine gonflée du poids qui est sur le cœur ? »
Il étudiait son mal, y appliquait en vain ses facultés d’analyste. L’opinion de Carlyle contre l’influence débilitante de l’observation de soi-même lui semblait judicieuse ; il apercevait les effets destructeurs de l’esprit d’analyse qui rend clairvoyant mais ruine les fondements de toutes les vertus ; il ne guérissait pas. Son père avait des ressources de tempérament et de vitalité morale acquises au contact de la vie qu’on n’avait pas développées en lui.
Il était convaincu que le plaisir de la sympathie pour les hommes et les sentiments qui font du bien de l’humanité l’objectif de la vie sont la source la plus abondante et la plus intarissable du bonheur, mais il avait beau savoir qu’un certain sentiment lui procurerait le bonheur, cela ne lui donnait pas ce sentiment.
On s’explique pourquoi, dans la suite, le maintien d’un juste équilibre entre les facultés de l’âme lui parut de la dernière importance, et pourquoi la culture des sentiments devint un des points cardinaux de son symbole philosophique.
Un livre français, les Mémoires de Marmontel, commença sa guérison. Un trait l’émut. Une larme chassa l’obsession.
La lecture de Wordsworth lui fit du bien, elle lui fit sentir qu’il y a dans la contemplation tranquille des beautés de la nature un bonheur vrai et permanent, et éveilla en lui une source d’émotions capable de détruire les effets destructeurs de l’habitude la plus invétérée de l’analyse.
La maladie eut ses rechutes. Le surmenage y était-il pour quelque chose ? il eut toujours une affection nerveuse, des tics…
Ce qui, est hors de doute, c’est que son cœur fut guéri par l’amitié. Une femme fit ce miracle. Le détail en est tout au long dans le chapitre délicieux des mémoires intitulé « de l’amitié la plus précieuse de ma vie. »
John Stuart Mill eut le bonheur de rencontrer la digne amie qui, du contact de son âme d’élite, devait le ranimer et lui donner la joie de vivre dans le travail fécond de la pensée et l’apostolat de l’idée.
J. Stuart Mill avait vingt-cinq ans quand il vit Mme Taylor qui en avait vingt-trois. Après vingt ans d’une intimité sans tache, Mme Taylor devint veuve. « Rien ne m’empêchait, a-t-il écrit, de faire sortir de cet évènement malheureux mon plus grand bonheur. Mme Taylor devint, en 1851, Mme Mill… Sept ans et demi je jouis de cette félicité. »
Cette union de deux âmes a donné à l’Angleterre un de ses plus grands penseurs et à l’humanité un de ses meilleurs serviteurs.
Nous ne chercherons pas mettre au creuset la structure mentale de Mme Taylor et celle de John Stuart Mill pour y chercher le secret de leur collaboration.
D’autres ont tenté ce travail, quelques-uns avec malveillance, Mill a été comparé à Narcisse qui admirait en Mme Taylor le reflet de sa propre pensée. Un éminent publiciste a écrit :
« Il fallait un Dieu à son âme active, on lui donna comme Dieu l’humanité, mais ce Dieu ne lui suffit pas toujours, il en trouva un autre dans la personne d’une femme. »
On a écrit aussi :
« Hercule entre la vertu et le vice, Télémaque entre Mentor et Calypso furent moins hésitants que John Stuart Mill entre le souvenir de son père et Mme Taylor ; à la fin, l’influence de la femme fut la plus forte et sa machine raisonnante recommença à fonctionner sous l’influence du socialisme sentimental personnifié par Mme Taylor. »
Cette admirable amitié, commencée du vivant du mari, a paru choquante à de vertueux adversaires qui, entre deux critiques acerbes contre les doctrines du philosophe, ont disserté sur le cas :
« On ne comprend pas, a écrit l’un, que J. St. Mill fut fondé à s’affranchir des lois sociales sous le prétexte que la liaison dont il s’agit était purement platonique, comme il l’affirme et comme on se fait un devoir de le croire… Peut-on alléguer sérieusement qu’il est permis, à la condition de rester chaste, de donner son affection à un autre, d’en faire le principal objet de sa vie, de n’avoir avec lui qu’un cœur et qu’une pensée, et cela sans porter atteinte à sa réputation ou à l’honneur de son mari, sans violer enfin la loi morale. Quelques concessions que l’on doive aux éminences intellectuelles, l’indulgence ne saurait aller jusque-là. »
En France, nous ne ferons pas écho à ces accents indignés. Le spectacle de cette merveilleuse intimité a pour nous un charme profond.
Nous ne demanderons pas à Mme Taylor ou à J. St. Mill un supplément de renseignements : Mme Taylor n’est sortie de sa réserve que pour déclarer modestement qu’elle n’avait en rien collaboré aux œuvres de son mari ; d’autre part, John Stuart Mill, quand il parle de sa femme, tombe en extase ; il ne juge plus, il confesse sa foi ; du fond de son cœur sort un acte d’adoration :
« Mme Taylor était la plus admirable personne qu’il eût jamais connue ; elle approchait de l’idéal de la sagesse, son esprit était un instrument qui gardait la même perfection dans les hautes régions de la spéculation philosophique comme dans les plus petites affaires de la vie, son âme était ardente et tendre, son éloquence aurait fait d’elle un grand orateur… ; ses qualités, si la carrière politique avait été ouverte aux femmes, lui auraient assuré un rang éminent parmi les chefs de l’humanité ;… son caractère ôtait le plus noble et le plus équilibré, il n’y avait pas trace d’égoïsme en elle, elle avait la passion de la justice. »
Dans vingt passages de ses mémoires, il déclare qu’il lui doit l’inspiration de ses meilleurs écrits. À la fin des mémoires, il associe aussi Mlle Taylor, sa belle-fille, à son œuvre, écrivant :
« Quiconque, aujourd’hui comme plus tard, pensera à moi et à l’œuvre que j’ai faite, ne devra pas oublier qu’elle n’est point le produit d’une seule conscience, mais de trois. »
Il a attribué à l’inspiration de la femme ce qu’il considère comme la meilleure partie de ses Principes d’économie politique, ce qui a trait aux institutions possibles de l’avenir ; c’est elle, selon lui, qui a inspiré, presque dicté le livre sur La liberté. Il a fait d’ailleurs une déclaration encore plus nette dans ses mémoires :
« Durant la plus grande partie de ma vie d’auteur, j’ai rempli envers elle un rôle que j’avais d’assez bonne heure considéré comme le plus utile que je fusse en état de prendre dans le domaine de la pensée, celui d’interprète de penseurs originaux et de médiateur entre eux et le public. En effet, j’ai toujours ou une médiocre opinion de mes talents comme penseur original, excepté dans les sciences abstraites (logique, métaphysique et principes théoriques de l’économie politique et de la politique), mais je me croyais très supérieur à la plupart de mes contemporains par mon empressement et mon aptitude à apprendre de tout le monde…
J’avais donc marqué ce rôle comme une sphère d’utilité où je me sentais spécialement obligé d’employer mon activité… ; on comprendra aisément que lorsque je me trouvai en communion intellectuelle intime avec une personne de facultés très supérieures, dont le génie, à mesure qu’il grandissait et se déployait dans le domaine de la pensée, faisait jaillir des vérités de beaucoup on avance sur moi, sans que je pusse y découvrir aucun alliage d’erreur… on comprendra que la plus grande partie de mon développement mental consistât à assimiler ces vérités, et que la plus précieuse partie de mon travail intellectuel se réduisît à établir des ponts, à ouvrir des passages qui les missent en communication avec mon système général de pensées. »
On voit par ces passages quelle posture veut prendre au regard de la postérité le plus-modeste et le plus épris des philosophes.
Mais quoi ! les œuvres sont là. Leur genèse est enveloppée dans le mystère d’un tête à tête bienheureux ; à quoi bon percer le mystère ?
Quand nous admirons une rose nous ne nous demandons pas si c’est à la nature intime de la plante ou au soleil qui l’a fait éclore que nous sommes les plus redevables de son éclat et de son parfum.
Mme Taylor mourut la première. Elle repose dans le Comtat-Venaissin, aux environs de la fontaine de Vaucluse qui déjà a souri à un amour immortel, celui de Pétrarque. Un touriste a confié aux lecteurs, que, faisant un jour un pèlerinage à la fontaine et s’étant exalté jusqu’à dire des vers du poète il avait remarqué un grave Anglais qui souriait avec sympathie à son lyrisme. Ce grave Anglais, c’était J. Stuart Mill qui, comme un écho de ses souvenirs, écoutait les sonnets inspirés par la belle Laure.
Sur le tombeau de sa femme Mill fit mettre l’inscription suivante qui n’étonnera pas après, ce qu’on vient de lire :
Son cœur grand et aimant, son Âme noble, son intelligence claire, puissante, originale et encyclopédique firent d’elle le guide et le soutien, l’instructeur en sagesse, et l’exemple en bonté, alors qu’elle était déjà le seul plaisir terrestre de ceux qui avaient le bonheur de lui appartenir. Aussi sérieuse pour tout bien public quelle était généreuse et dévouée pour tous ceux qui l’entouraient, son influence a été sentie dans beaucoup des plus grands perfectionnements du siècle, et le sera dans ceux encore à venir.
« S’il y avait même peu de cœurs et d’intelligences comme les siens, cette terre serait déjà devenue le ciel espéré. »
L’éducation de John Stuart Mill avait, nous l’avons déjà remarqué, fait de lui un analyste et un dialecticien de premier ordre, et l’avait peu préparé au rôle d’observateur.
L’idée qu’on se faisait d’un benthamiste : une machine à raisonner, était vraie en ce qui le concernait : c’est lui qui nous l’a dit ; il aurait coupé des fils avec des scolastiques. La chimie elle-même lui avait été enseignée sans expériences.
Une telle culture qui le rendait propre aux recherches spéculatives semblait l’avoir disposé à mal accueillir de nouveaux apports de connaissance et le prédestiner à être un doctrinaire. La méthode comportait cependant des germes de progrès et d’évolution : l’éveil de l’esprit, la sincérité, l’amour de la vérité, le goût et le désir ardent de tout savoir.
Le champ de ses observations personnelles a cependant toujours été fort restreint ; il a noté son passage à la Compagnie des Indes pour les enseignements qu’il en avait tirés relativement au gouvernement des hommes, et dans son âge mûr il s’est félicité de l’occasion qu’il eut dans la courte période électorale qui précéda son élection de se trouver en contact avec des personnes de diverses classes.
Ce furent des livres, dont les principaux ont été écrits par des Français, qui sollicitèrent sa pensée et furent les agents actifs de ses progrès intellectuels.
Le cerveau du fils fut d’abord sous bien des aspects comme une seconde épreuve de celui du père. J.-S. Mill a appelé son père, qui l’avait formé à son image, le dernier des philosophes du dix-huitième siècle. Les grands rationalistes du siècle dernier ont été les précurseurs et les maîtres du nôtre, les uns par leurs vives critiques, les autres plus directement parce qu’ils se réclamèrent de l’expérience, mais à ceux-là même qui voulurent édifier sur la base de l’observation, les matériaux manquèrent, de là le dosage de leurs écrits : peu de faits, beaucoup de théories. Sur la base de quelques concepts, pris dans le courant de l’observation, ils aimaient à construire des édifiées magnifiques, des cathédrales non de pierre, mais d’idées.
Leur suprême effort tendait à mettre l’unité et l’harmonie dans l’ensemble de leurs systèmes rudimentaires de logique, de psychologie, de politique, d’économie.
John Stuart Mill ont ainsi dès le début son système où tout se tenait. À chaque acquisition nouvelle d’idée, si l’apport ne cadrait pas avec l’édifice ancien, il éprouvait un trouble véritable ; il se produisait une crise dans ses idées, vite il remaniait le tout pour rétablir l’harmonie. Comme il a noté toutes les phases essentielles de ses progrès nous pouvons aisément suivre les étapes de son évolution. Nous savons comment et sur quels points il modifia son premier credo, de quels côtés son horizon s’élargit, à quel moment il éprouva des inquiétudes sur la valeur de ses premières méthodes scientifiques.
James Mill le père était un esprit suffisamment vigoureux, personnel et original pour qu’on ne pût dire qu’il était le disciple de Bentham, mais sa pensée avait évolué dans le même ordre d’idées que celle de son illustre ami et l’avait souvent conduit aux mêmes conclusions. L’éducation de son fils John Stuart Mill fut en un sens un cours de benthamisme ; on lui enseigna à appliquer le critérium de Bentham, la notion « du plus grand bonheur. »
La lecture du résumé français des principales doctrines de Bentham par Dumont clarifia et fortifia en lui ces premières tendances. Ces doctrines, quoiqu’il les eût à l’état confus dans son cerveau, le frappèrent alors avec toute la force de la nouveauté. Il fut surtout impressionné par le chapitre où Bentham portait un jugement sur les modes de raisonnements communément usités en morale et en législation et déduits d’expressions telles que « les lois de la nature », la droite raison, » « le sens moral », la rectitude naturelle », etc. Bentham y montrait que ces raisonnements ne sont autre chose qu’un dogmatisme déguisé, avec lequel on impose ses sentiments à autrui en ayant l’air de bander des formules qui ne vendent pas raison du sentiment moral, mais qui n’ont pas d’autre raison que ce sentiment.
Le principe de l’utilité, compris comme Bentham le comprenait, et appliqué comme il l’appliquait, donna l’unité à ses conceptions des choses. « Dès lors, a-t-il écrit, j’eus des opinions, une croyance, une doctrine, et dans le meilleur sens du mot, une religion, de la démonstration et de la propagation de laquelle pouvais faire le principal objectif de ma vie. »
Il n’y eut point de cristallisation dans son cerveau. Il n’en resta pas à cette formule et plus tard, après quelques étapes de pensées, il écrira :
« L’idée naturelle d’un esprit supérieur tout comme la première leçon de la science et de la vie, c’est que nul principe, si grand qu’il soit, ne peut contenir et résoudre à lui seul une question politique, je dirais volontiers une question humaine. »
La vie de Turgot l’aura alors guéri de ses folies de sectaire et ses méditations l’auront conduit à un point où il évitera d’aborder certaines questions avec son père, tant certaines divergences lui sembleront profondes. Cependant même alors il se réclamera de son ancienne écolo, en ayant gardé beaucoup de vues essentielles. Il pensait d’ailleurs avec Platon que le titre de disciples d’un maître appartenait bien mieux aux penseurs qui se sont nourris de son procédé de recherche et qui se sont efforcés d’en acquérir le maniement qu’à ces autres qui se distinguent seulement par l’adoption de certaines conclusions dogmatiques.
Dans cette seconde phase de son évolution la façon dont il parle de Carlysle est également fort symptomatique.
Carlysle s’est peint dans un personnage dont il décrit ainsi les procédés de recherche :
« Sa méthode n’est jamais celle de la vulgaire logique des écoles, où toutes les vérités sont rangées en file, chacune tenant le pan de l’habit de l’autre, mais celle de la raison pratique, procédant par de larges intuitions qui embrassent des groupes et des royaumes entiers systématiques ; ce qui fait régner une noble complexité presque pareille à celle de la nature dans sa philosophie ; elle est une pointure spirituelle de la nature, un fouillis grandiose, mais qui, comme la foi le dit tout bas, n’est pas dépourvue de plan ».
La logique des écoles que raille Carlysle avait été et était peut-être encore celle de J.-St. Mill. Cependant Mill ne parle pas de Carlysle avec le ton de raideur convaincue qui lui était propre quand il avait vingt ans, et qu’il relevait des opinions, qui lui paraissaient entachées d’erreur. Il écrit : « Carlysle était poète et je ne l’étais pas, il découvrait avant moi bien des choses que je ne pouvais voir qu’après qu’on me les avait montrées, et que j’étais parvenu en tâtonnant à les prouver ; très probablement il en voyait qui étaient invisibles pour moi-même après qu’on me les avait montrées. Je savais que je ne pouvais faire le tour de Carlysle, et je n’étais pas sûr de voir plus haut que lui… J’attendais qu’il me fût expliqué par quelqu’un qui fût supérieur à nous deux.
John Stuart Mill n’eut pas tout d’abord conscience de la révolution qui se faisait dans sa manière de penser et dans ses idées.
Ce fut d’une attaque véhémente de Macaulay contre l’essai sur le gouvernement de James Mill que vint la révélation.
Macaulay reprochait à la doctrine de Bentham et de James Mill d’être une théorie, de procéder a priori, au moyen de raisonnements, au lieu d’employer l’expérience baconienne et il montrait que la base même en était étroite, que les prémisses de James Mill ne formaient qu’un petit nombre des principes généraux qui produisent des conséquences importantes.
James Mill répondit en accusant Macaulay d’avoir, dirigé une attaque irrationnelle contre la faculté du raisonnement, de fournir un exemple de l’aphorisme de Hobbes que lorsque la raison est contre un homme, un homme est contre la raison. C’était ne pas répondre, aux yeux de son fils. John Stuart Mill, en prenant connaissance des diverses écoles de gouvernement, avait bien déjà aperçu l’insuffisance de la doctrine benthamiste qui laissait en dehors d’elle un grand nombre de faits. Mais il pensait qu’il suffirait d’y faire quelques retouches. Il ne pensait pas qu’il y eût lieu de mettre en question le principe du procédé de recherche. Ce fut précisément ce que lui montra l’argumentation de Macaulay. Ce fut pour lui une révélation douloureuse.
Il ne donna pas cependant raison à Macaulay. Il réfléchit et ses méditations le conduisirent aux conclusions développées dans les chapitres de la logique qui sont relatifs aux sciences morales.
La conclusion de John Stuart Mill fut que James Mill et Macaulay avaient tort tous les deux. La méthode en politique ne lui semblait pas comparable à la méthode purement expérimentale de la chimie comme le prétendait Macaulay, ni à la méthode de la géométrie comme le prétendait James Mill, mais bien à la méthode déductive de la physique.
Cette conclusion ne paraît plus aujourd’hui très claire.
La physionomie des sciences a changé.
En chimie on emploie la déduction en vue de conclure à des applications pratiques, et aussi dans un but scientifique de recherche ou de contrôle pour découvrir de nouveaux aspects des choses en rapport avec ce que l’on sait déjà. Quant à la physique, science déductive, ne serait-ce pas celle dont M. Berthelot a célébré l’agonie dans son éloge du physicien Regnault, le si ingénieux expérimentateur ? « Avant lui, a-t-il dit, chaque physicien, accoutumé par Laplace et Fourier à la rectitude artificielle des représentations mathématiques, s’efforçait de tirer de ses recherches quelque expression générale, qu’il proclamait aussitôt une loi universelle de la nature. Regnault a concouru plus que personne à faire disparaître de la science de telles conceptions absolues pour y substituer la notion de relations approximatives vraies seulement en certaines limites, au-delà desquelles elles se transforment ou s’évanouissent. »
Nous pensons que Mill à cette époque estimait que les sciences politiques relevaient du même procédé de recherches que les sciences physiques du temps de Fourier et de Laplace. On voit le point où la thèse est vulnérable et ce qu’on peut y répondre : la science physique a modifié sa marche ; les sciences morales et politiques prendront de même une autre allure.
Toutes les sciences d’observations suivent le même chemin, à la première étape elles sont toutes pleines d’axiomes fondamentaux, de conclusions hors de proportions avec leurs prémisses ; leurs adeptes parlent haut comme des révélateurs. (Moins on sait plus on généralise vite.) Cependant le défrichement continue, de nouveaux côtés des choses sont mis en lumière, les systèmes apparaissent alors incomplets et vieillots ; les fidèles les restaurent, les dissidents en construisent d’autres ; on ne perd pas dès le premier jour le goût de ces édifices. Cependant la foi en eux s’en va à mesure qu’ils paraissent de plus en plus éphémères. Puis le goût se perd de ces théories qui ne sont vraisemblables qu’un jour ; on touche au rivage de la mer positive, et l’on s’aperçoit que ce qu’on sait le mieux c’est qu’on sait très peu de choses.
Les sciences morales et politiques ne sont pas au but ; mais l’imperfection de leur outillage de recherche ne prouve rien relativement à leur méthode définitive, ce n’est qu’une indication sur leur peu d’état d’avancement. Elles sont hérissées de principes, de lois de nature, que l’on rédige en formules de catéchismes dans les manuels, que l’on érige en apophtegmes sauveurs dans les polémiques ; elles ont même des amis qui les compromettent au point de leur attirer de sévères mercuriales comme celles de M. Cliffe Loslie, l’ami de J.-St. Mill :
« Aucune branche du savoir humain n’est plus imprégnée de ce réalisme de l’école scolastique du Moyen Âge qui attribuait une existence réelle à des notions générales et abstraites, c’est-à-dire à des mots. »