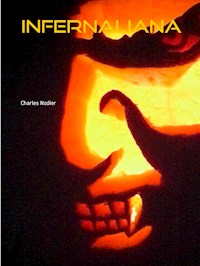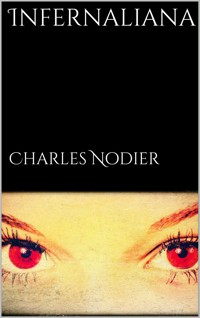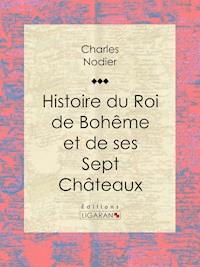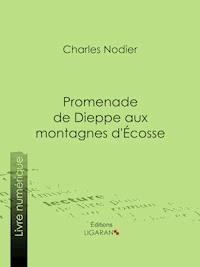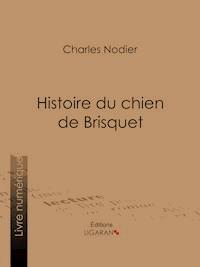Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je m'appelle Adolphe de S…, je suis né à Strasbourg, le 19 janvier 1777, d'une famille noble dont j'étais le dernier rejeton. J'ai perdu mon père dans l'émigration. Ma mère a péri dans une maison de détention pour les suspects ; je n'ai ni frères, ni sœurs, ni parents de mon nom. J'ai dix-sept ans et demi depuis quelques jours, et rien n'annonce que cette courte existence puisse se prolonger."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je m’appelle Adolphe de S…, je suis né à Strasbourg, le 19 janvier 1777, d’une famille noble dont j’étais le dernier rejeton. J’ai perdu mon père dans l’émigration. Ma mère a péri dans une maison de détention pour les suspects ; je n’ai ni frères, ni sœurs, ni parents de mon nom. J’ai dix-sept ans et demi depuis quelques jours, et rien n’annonce que cette courte existence puisse se prolonger j’en dirai même la raison plus tard, quoique ma position n’intéresse plus personne. Aussi, ce n’est pas pour le monde que j’écris ces lignes inutiles ; c’est pour moi, pour moi seul ; c’est pour occuper, pour perdre de tristes et désespérants loisirs qui seront heureusement bien courts. C’est pour ouvrir une voie plus facile aux sentiments qui m’oppressent, pour soulager mon cœur si le souvenir est un soulagement, ou pour achever de le briser.
J’avais suivi mon père à quatorze ans ; je venais de le perdre à seize. J’étais rentré à Strasbourg, rapportant pour tout bien son dernier adieu, ses derniers conseils, l’exemple de son dévouement, de son courage, de ses vertus privées, et je ne sais quelle émulation de malheur qui relève l’âme. Je cherchais ma mère ; on ignorait jusqu’à sa fosse. Nos biens n’étaient plus à nous. Nos parents étaient errants ou morts. Nos anciens amis auraient craint de me reconnaître, et probablement il y en avait parmi eux qui ne m’auraient plus aimé ; j’étais si à plaindre ! J’avais eu pour professeur de grec un moine qui s’appelait le père Schneider, et pour maître de musique un virtuose qui s’appelait M. Edelman. L’un et l’autre avaient embrassé avec violence le parti de la révolution ; je m’informai d’eux cependant, parce que je les avais vus s’honorer de l’amitié de mon père, et que leur pitié, à eux, était ma dernière ressource. Le premier venait d’être lié aux poteaux de l’échafaud dans un mouvement populaire ; je passai sur la place d’Armes ; je le reconnus pâle, défiguré, sanglant. La clameur publique l’accusait des forfaits les plus odieux ; mais il avait été mon maître, il m’avait peut-être aimé ; j’aurais volé à lui, si je n’avais craint que ma tendresse ne le chargeât d’un crime de plus. Je pleurai amèrement en cachant mon visage. M. Edelman avait été arrêté le même jour. Quelques mois après, m’a-t-on dit, ils sont tombés à Paris, sous cette faux terrible de la révolution qui n’épargne pas ses enfants.
Mon dernier assignat avait été échangé contre un peu de pain. Il faisait très froid, la journée s’avançait, et je ne savais où me retirer. Je me souvins que, dans une petite ville assez voisine, j’avais passé quelques jours de mon enfance chez la jolie hôtesse de… Ma reconnaissance, hélas ! n’ose pas la nommer. Comme elle était connue par son attachement à ce qu’on appelait les aristocrates c’était dans sa maison que nous avions couché, mon père et moi, la nuit qui précéda notre émigration. J’employai à ce voyage tout ce qui me restait de forces. J’arrivai à la nuit obscure ; je gagnai avec précipitation le cabinet de madame T…, et je me jetai, ou plutôt je tombai à ses pieds, car je ne pouvais plus me soutenir.
– Au nom de la charité, lui dis-je, un peu de vin pour se remettre, un peu de paille pour se reposer, à votre pauvre petit Adolphe ! Je meurs s’il faut que je passe encore cette nuit dans la neige !
Elle m’embrassa et pleura ; et comme ses larmes l’embellissaient ! Ensuite, elle me recommanda d’être prudent, et me conduisit dans une chambre écartée où il y avait trois lits. J’étais seulement prévenu que je n’avais rien à redouter de mes voisins. C’étaient des compagnons de malheur, mais je ne les connus pas ce jour-là. J’avais à peine achevé mon léger repas que tous mes sens furent liés par le sommeil. Quand je rouvris les yeux, il faisait jour.
Mes camarades m’embrassèrent en frères ; le nom de mon père ne leur était pas étranger. Nos sentiments étaient les mêmes ; notre fortune, notre destinée étaient communes ; ils m’offraient d’ailleurs quelque chose de plus que des consolations ; ils parlaient de grands dangers à courir, de quelque gloire à mériter. Ils voulaient changer mon sort, et j’étais jaloux déjà de partager le leur, quel qu’il fût.
L’amitié doit être un sentiment délicieux à toutes les époques et dans toutes les conditions de la vie ; mais, entre de jeunes âmes froissées par de nobles malheurs, c’est presque une religion.
L’un de ces messieurs avait dix-huit à vingt ans. C’était un jeune homme d’une figure affable mais sérieuse, plein de calme et de résolution, d’énergie et de présence d’esprit. Il s’appelait Forestier, et je crois qu’il était fils d’un cordonnier de Saumur ou de Cholet, je ne sais pas lequel. L’autre, qui avait pour lui la plus grande déférence, était de deux ou trois ans plus jeune et se nommait le chevalier de Mondyon. Quoiqu’il fût tout au plus de mon âge, il était beaucoup plus développé que moi. Ma petite taille, mes yeux bleus, la couleur un peu ardente de mes cheveux bouclés, la fraîcheur d’un teint animé que je tiens de ma mère et qui caractérise nos Alsaciennes, me donnait, à mon grand regret, quelque chose de féminin et de timide qui m’avait souvent exposé, sur mon passage, aux soupçons et aux railleries des voyageurs mal élevés.
– En vérité, dit Mondyon avec un ton de gaieté expansive qui ne l’abandonnait jamais, nous aurons peine à persuader au général que ce nouveau camarade ne soit pas une jeune fille déguisée.
– Je le détromperai de cette erreur, lui répondis-je, sur le premier champ de bataille où il y aura du sang à répandre pour le service du roi.
Forestier sourit et me serra vivement la main ; Mondyon, qui craignait de m’avoir mortifié, me sauta au cou.
Ces deux officiers venaient de se montrer avec le plus grand éclat dans les premières affaires de la Vendée. Leur intelligence, leur zèle, leur courage éprouvé, leur jeunesse même, qui repoussait à leur égard jusqu’au soupçon d’une mission importante, et peut-être décisive, les avait fait préférer par le brave la Rochejaquelein, pour être envoyés auprès des princes de la maison de Bourbon.
Ils étaient arrivés à leur armée au moment où l’on s’occupait d’établir avec la France des communications qui pouvaient la sauver, et ils avaient eu la généreuse témérité de réclamer ce nouvel emploi, plus fertile que cent batailles en dangereux hasards. Déjà la partie la plus importante de leurs instructions était remplie, et le succès le plus heureux, un succès même inattendu, et dont tous les résultats ne sont probablement pas perdus pour la génération à venir, avait couronné leurs entreprises.
Il ne leur restait plus, pour reprendre à travers la France le chemin de la Vendée, qu’à recevoir les passeports qui leur étaient promis par un des chefs du parti de l’intérieur. Ces papiers arrivèrent peu de jours après ; les liens de notre amitié avaient continué de se serrer dans l’intimité de notre solitude. Nous jurâmes que la mort seule nous séparerait les uns des autres.
La bonne dame T… nous procura des uniformes de volontaires, nous munit de quelques provisions pour notre voyage, et nous fit promettre de revenir la voir un jour, si nous échappions aux périls presque inévitables qui nous menaçaient. Je n’en doutais pas ; les premières chances de la vie n’étonnent point l’âme, elles l’enhardissent.
Tout réussit au gré de nos souhaits ; nous arrivâmes sous le drapeau blanc, non sans obstacle, mais sans accident.
Je passe sur ces évènements avec rapidité.
Qu’il me suffise de dire que cinq ou six actions d’éclat m’avaient mérité, malgré mon extrême jeunesse, l’estime de l’armée royale, la confiance de mes chefs et le commandement d’une compagnie, quelques semaines avant la déroute du Mans.
J’avais reçu plusieurs blessures dans les affaires antérieures ; quelques-unes n’étaient pas tout à fait fermées ; les fatigues des jours précédents pesaient encore sur moi. Pour comble de maux, je perdis mon cheval d’un coup de feu, et mon épée fut rompue près de la garde, dès le commencement de l’affaire.
Il faut avoir vu le désordre de l’armée, le tumulte et la confusion du peuple ; il faut avoir été témoin de cette journée de désastres, pour s’en former quelque idée : les plus braves de nos soldats erraient au hasard dans les rues, cherchant inutilement à se rallier, et augmentant de leurs mouvements incertains, de leurs cris de terreur et de rage, de tous leurs efforts sans objet, l’horreur de notre situation ; enfin je parvins à en rassembler quelques-uns autour de moi, au bas d’une rue escarpée dont la hauteur était occupée par un poste de républicains qui se hâtaient de l’encombrer de tous les débris qui se présentaient sous leurs mains.
Je m’y jetai avec ardeur, en encourageant ma petite troupe du geste et de la voix ; l’ennemi s’ébranlait et paraissait disposé à nous laisser la place ; mais, en l’abandonnant, il poussa vers nous avec une violence augmentée par la rapidité de la pente, quelques-uns de nos chars d’artillerie qui obstruaient le passage ; un de leurs timons me frappa dans l’estomac, et me renversa mourant sur un monceau de morts, où je passai la nuit sans autre sentiment qu’une perception confuse de douleur.
La fraîcheur du matin développa cette impression et la rendit plus distincte ; mes idées reprirent un peu d’ordre, un peu de netteté ; je revins à moi le jour était levé.
J’entendais une rumeur vague qui s’éloignait, qui se rapprochait tour à tour, qui me laissait de temps en temps reconnaître quelques sons, distinguer quelques paroles.
Elles étaient accompagnées du cliquetis des baïonnettes qui se heurtaient dans la marche. C’étaient évidemment les républicains ; je pensai qu’ils parcouraient tous les quartiers pour surprendre ceux d’entre nous qui s’étaient cachés ou pour compter les morts.
Il n’y avait pas une maison qui ne fût fermée avec le plus grand soin ; mais parmi les objets qui avaient servi à barricader la rue, je remarquai une échelle, je la dressai contre une muraille ; j’arrivai au toit au moment où une décharge de fusils brisait le dernier échelon sous mes pieds ; je n’étais pas atteint, mais je n’étais pas sauvé.
Je passai de ce toit sur un autre ; et toujours poursuivi, toujours en évidence, je parvins au détour de la rue avant les soldats qui rechargeaient leurs armes, et que cette opération avait retardés. Dans l’angle même, je me trouvai auprès d’une fenêtre dont le volet mal attaché céda au premier effort, et je tombai d’un saut au milieu d’une chambre dont l’aspect annonçait la demeure du pauvre.
Une jeune fille poussa un cri ; elle était couchée :
– Ne craignez rien, lui dis-je, sauvez un pauvre brigand et Dieu vous récompensera.
En prononçant ces mots, je m’étais jeté sur son lit, et j’avais retourné sur moi une partie de sa couverture. Mon chapeau était resté sur les morts : j’avais passé dans ma ceinture le tronçon de mon épée ; mes cheveux qui étaient très longs, tombaient épars sur mes épaules. Les soldats entrèrent, s’approchèrent du lit, regardèrent dessous, parcoururent la chambre et revinrent à nous.
Je fermais les yeux, et je cachais sous le drap mon front noirci du feu et souillé de la poussière de la bataille.
– Voilà qui est bien, dit l’un d’eux, je connais celle-ci ; c’est Jeannette.
– La blonde est sa jeune sœur, reprit l’autre, le brigand n’est pas ici.
La porte se referma enfin sur eux ; il en était temps pour ma compagne, dont les dents se choquaient de terreur.
Il n’y avait peut-être pas un moment à perdre pour éviter leur retour ; j’étais déjà debout derrière le rideau qui séparait le pied du lit de Jeannette de l’intérieur de la chambre.