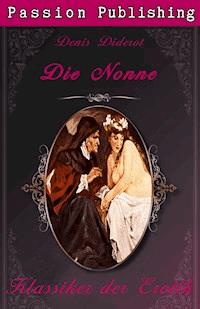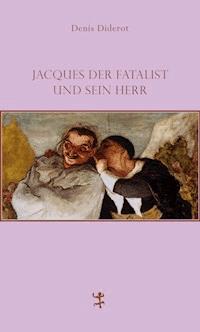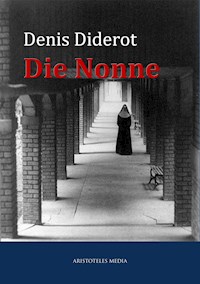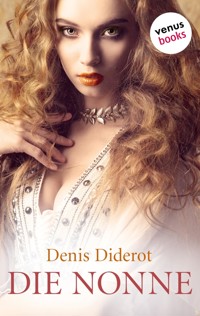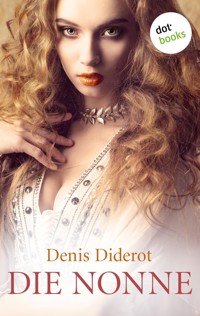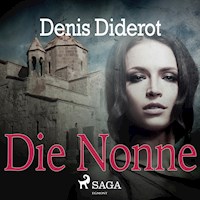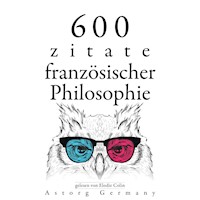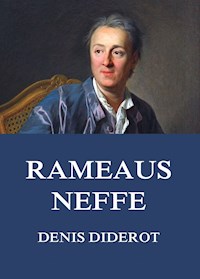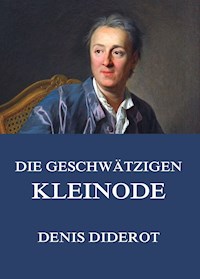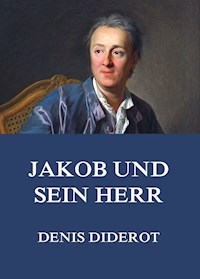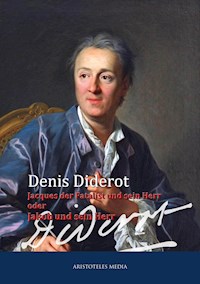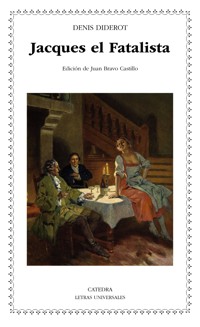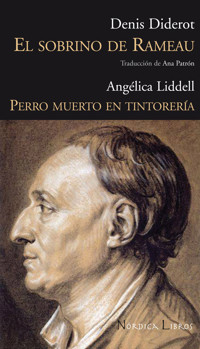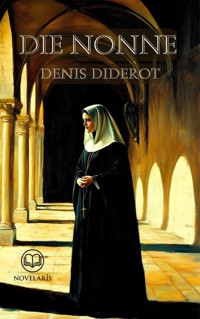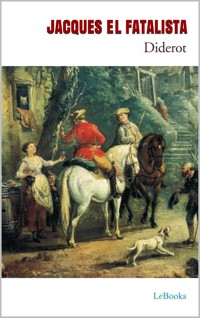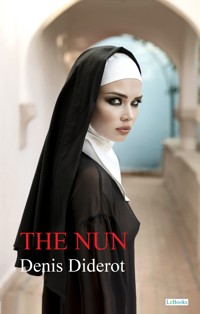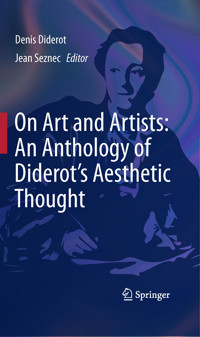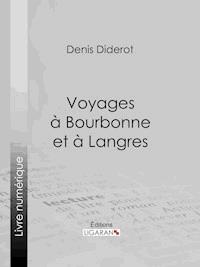
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Quand on est dans un pays, encore faut-il s'instruire un peu de ce qui s'y passe. Que diraient le docteur Roux et le cher Baron, si des mille et une questions qu'ils ne manqueront pas de me faire, je ne pouvais répondre à une seule ? Epargnons à mes amies le reproche déplacé d'avoir occupé tous mes moments, et préparons à quelque malheureux que ses infirmités conduiront à Bourbonne une page qui puisse lui être utile."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335017014
©Ligaran 2015
Quand on est dans un pays, encore faut-il s’instruire un peu de ce qui s’y passe. Que diraient le docteur Roux et le cher Baron, si des mille et une questions qu’ils ne manqueront pas de me faire, je ne pouvais répondre à une seule ? Épargnons à mes amies le reproche déplacé d’avoir occupé tous mes moments, et préparons à quelque malheureux que ses infirmités conduiront à Bourbonne une page qui puisse lui être utile.
J’allai à Bourbonne le 10 août 1770, après avoir donné quelques jours au plaisir de revoir mon amie, madame de Meaux, qui avait accompagné là sa fille malade d’une énorme obstruction à un ovaire, suite d’une couche malheureuse, et reçu les adieux de mon ami, M. Grimm, avec lequel j’avais fait le voyage de Paris à Langres et qui m’avait précédé de quelques jours à Bourbonne ; tandis qu’une mère tendre s’occupait de la santé de son enfant, le philosophe allait s’informant de tout ce qui pouvait mériter sa curiosité. Disons d’abord un mot de la malade qui m’intéressait le plus. En très peu de temps l’usage des eaux en boisson diminua presque de moitié le volume de la partie affectée. Le docteur Juvet chantait victoire ; et si madame de Prunevaux ne s’en retourne pas tout à fait guérie, peut-être n’est-ce pas la faute des eaux dont le succès dépend quelquefois d’une grande tranquillité d’esprit.
Mon père a fait deux fois le voyage de Bourbonne ; la première, pour une maladie singulière, une perte de mémoire dont il y a peu d’exemples. Quand on lui parlait, il n’avait aucune peine à suivre le discours qu’on lui adressait : voulait-il parler, il oubliait la suite de ses idées, il s’interrompait ; il s’arrêtait au milieu de la phrase qu’il avait commencée ; il ne savait plus ce qu’il avait dit, ni ce qu’il voulait dire, et le vieillard se mettait à pleurer. Il vint ici, il prit les eaux en boisson ; elles lui causèrent une transpiration violente, et en moins de quinze jours il reprit le chemin de sa ville, parfaitement guéri. Ni sa fille qui l’avait suivi, ni son fils l’abbé, ni ses amis ne purent lui faire prendre un verre d’eau de plus que le besoin qu’il crut en avoir. Il aimait le bon vin. Il disait : Je me porte bien ; j’entends vos raisons ; je raisonne aussi bien et mieux que vous ; qu’on ne me parle plus d’eaux ; qu’on me donne du bon vin : et quoiqu’il eût la soixantaine passée, temps où la mémoire baisse et le jugement s’affaiblit, il n’eut jamais aucun ressentiment de son indisposition.
Son second voyage ne fut pas aussi heureux. Le docteur Juvet avait dit très sensément que les eaux n’étaient pas appropriées à sa maladie. C’était une hydropisie de poitrine. Il se hâta de le renvoyer ; et cet homme, que les gens de bien regrettent encore, et qu’une foule de pauvres, qu’il secourait à l’insu de sa famille, accompagnèrent au dernier domicile, mourut ou plutôt s’endormit du sommeil des justes, le lendemain de son retour, le jour de la Pentecôte, entre son fils et sa fille qui craignaient de réveiller leur père qui n’était déjà plus. J’étais alors à Paris. Je n’ai vu mourir ni mon père, ni ma mère ; je leur étais cher, et je ne doute point que les yeux de ma mère ne m’aient cherché à son dernier instant. Il est minuit. Je suis seul, je me rappelle ces bonnes gens, ces bons parents ; et mon cœur se serre quand je pense qu’ils ont eu toutes les inquiétudes qu’ils devaient éprouver sur le sort d’un jeune homme violent et passionné, abandonné sans guide à tous les fâcheux hasards d’une capitale immense, le séjour du crime et des vices, sans avoir recueilli un instant de la douceur qu’ils auraient eu à le voir, à en entendre parler, lorsqu’il eut acquis par sa bonté naturelle et par l’usage de ses talents la considération dont il jouit : et souhaitez après cela d’être père ! J’ai fait le malheur de mon père, la douleur de ma mère tandis qu’ils ont vécu, et je suis un des enfants les mieux nés qu’on puisse se promettre ! Je me loue moi-même ; cependant je ne suis rien moins que vain ; car une des choses qui m’aient fait le plus de plaisir, c’est le propos bourru que me tint un provincial quelques années après la mort de mon père. Je traversais une des rues de ma ville ; il m’arrêta par le bras et me dit : Monsieur Diderot, vous êtes bon ; mais si vous croyez que vous vaudrez jamais votre père, vous vous trompez. Je ne sais si les pères sont contents d’avoir des enfants qui vaillent mieux qu’eux, mais je le fus, moi, de m’entendre dire que mon père valait mieux que moi. Je crois et je croirai tant que je vivrai que ce provincial m’a dit vrai. Mes parents ont laissé après eux un fils aîné qu’on appelle Diderot le philosophe, c’est moi ; une fille qui a gardé le célibat, et un dernier enfant qui s’est fait ecclésiastique. C’est une bonne race. L’ecclésiastique est un homme singulier, mais ses défauts légers sont infiniment compensés par une charité illimitée qui l’appauvrit au milieu de l’aisance. J’aime ma sœur à la folie, moins parce qu’elle est ma sœur que par mon goût pour les choses excellentes. Combien j’en aurais à citer de beaux traits si je voulais ! Ses bonnes actions sont ignorées ; celles de l’abbé sont publiques… Et Bourbonne ? Et les bains ? Je n’y pensais plus. Occupé d’objets aussi doux que ceux qui m’occupent, le moyen d’y penser !… Je ne sais ce qui m’est arrivé ; mais je me sens un fond de tendresse infinie. Tout ce qui distrait mon cœur de sa pente actuelle m’est ingrat… De grâce, mes amis, encore un moment. Souffrez que je m’arrête et que je me livre encore un instant à la situation d’âme la plus délicieuse… je ne sais ce que j’ai. Je ne sais ce que j’éprouve. Je voudrais pleurer… Ô mes parents, c’est sans doute un tendre souvenir de vous qui me touche ! Ô toi, qui réchauffais mes pieds froids dans tes mains ! Ô ma mère !… Que je suis triste !… Que je suis heureux ! S’il est un être qui ne me comprenne pas, fût-il assis sur un trône, que je le plains !
La fontaine ou le puits qui fume sans cesse est placé dans le quartier bas. C’est un petit bâtiment étroit et carré, ouvert de deux portes opposées dont l’antérieure est placée dans l’entrecolonnement de quatre colonnes dont la façade est décorée. Ce monument n’est pas magnifique ; il pouvait être mieux entendu, sans excéder la dépense. Je l’aurais voulu circulaire avec quelques bancs de pierre au pourtour ; mais tel qu’il est, il suffit à son usage. Combien d’édifices ou n’auraient pas été faits, ou seraient aussi simples si l’on avait consulté que l’utilité !
La profondeur de ce puits est de six pieds et son ouverture de quatre pieds en carré.
Les eaux sont si chaudes qu’on aurait peine à y tenir quelque temps la main. Elles sont plus chaudes au fond qu’à la surface. À la surface le thermomètre de Réaumur monte à 55°, au fond il monte à 62°. Un œuf s’y durcit en vingt-quatre heures. Cette année un jeune enfant s’y laissa tomber ; en un instant il fut dépouillé de sa peau et mourut. Cet accident devrait bien apprendre à en prévenir un pareil pour l’avenir.
Les eaux de ce puits sont conduites par des canaux souterrains à un bâtiment oblong, construit plus bas, et sont reçues dans des bassins carrés et séparés en deux par une cloison. Quand on se baigne on s’assied sur de longs degrés de pierre qui s’élèvent au-dessus ou descendent au-dessous les uns des autres et qui règnent le long des bords de ces bassins. C’est là le lieu des bains du peuple. Les particuliers se baignent dans les maisons dans des cuves de bois ou baignoires ordinaires. On y porte le soir sur les cinq à six heures les eaux qu’on prend au puits dans des tonneaux ; et sur les six à sept heures le lendemain, elles sont encore assez et même trop chaudes pour le bain. On tempère la chaleur des eaux selon la force ou la faiblesse du malade.
Des bains renfermés dans ce dernier bâtiment, il y en a deux qui sont de source et deux autres qui sont fournis par le puits. Ils ont tous quatre environ trois pieds de profondeur.
La quantité et la chaleur des eaux du puits et des bains de source sont constantes. La quantité ne s’accroît point par les pluies et ne diminue pas par les sécheresses. Les grands froids et les grands chauds ne font rien à sa chaleur.
On trouve sur le chemin du bâtiment carré vers l’hôpital un bain séparé qu’on appelle le bain Patrice. Il est de source, il est fréquenté. C’est aux environs de ce puits, dont le nom marque assez l’ancienneté, qu’il y avait autrefois des salines que le temps a détruites.
Les bains de source sont pour la douche. La douche se donne de trois pieds de haut. La colonne d’eau est d’environ huit lignes de diamètre. La peau rougit un peu sous le coup du fluide.
Les bains qui viennent du puits sont moins chauds que les bains de source ; cependant on ne les peut point supporter au-delà de vingt minutes.
On m’a dit que les paysans des environs venaient s’y jeter les samedis et qu’ils en étaient délassés.
Les habitants d’un village éloigné de quelques lieues, appelé la Neuvelle-les-Coiffy, ont le droit d’user des eaux de toute manière sans rien payer.
Ces eaux passent pour très énergiques. On s’y rend de toutes les provinces du royaume et des pays étrangers pour un grand nombre de maladies, les obstructions de toute espèce, les rhumatismes goutteux et autres, les paralysies, les sciatiques, les maux d’estomac, les affections nerveuses et vaporeuses, la colique des potiers, les entorses, les ankyloses, les luxations, les suites des fractures, les suites des couches et plusieurs maladies militaires. Leur effet est équivoque dans les suites de paralysies et d’apoplexies. Le paralytique éprouve un léger soulagement, souvent avant-coureur d’un grand mal.
Je n’ai garde de disputer l’efficacité constatée de ces eaux ; mais en général les eaux sont le dernier conseil de la médecine poussée à bout. On compte plus sur le voyage que sur le remède. À cette occasion, je vous dirai qu’un Anglais hypocondriaque s’adressa au docteur Mead, homme d’esprit et célèbre médecin de son pays. Le docteur lui dit : « Je ne puis rien pour vous, et le seul homme capable de vous soulager est bien loin. – Où est-il ? – À Moscou. » Le malade part pour Moscou ; mais il était précédé d’une lettre du docteur Mead. Arrivé à Moscou, on lui apprend que l’homme qu’il cherchait s’en était allé à Rome. Le malade part pour Rome, d’où on l’envoie à Paris, d’où on l’envoie à Vienne, d’où on l’envoie je ne sais où, d’où on l’envoie à Londres où il arrive guéri. Les eaux les plus éloignées sont les plus salutaires, et le meilleur des médecins est celui après lequel on court et qu’on ne trouve point.
Si le voyage ne guérit pas, il prépare bien l’effet des eaux par le mouvement, le changement d’air et de climat, la distraction. Celui des eaux de Bourbonne est quelquefois très prompt ; quelquefois aussi il est lent, et ne se fait sentir que plusieurs mois après qu’on en a quitté le lieu. C’est un espoir qui reste à ceux qu’elles n’ont pas soulagés. Ils se flattent de rencontrer au coin de leur foyer la santé qu’ils sont venus chercher ici. Que les hommes s’en imposent facilement sur ce qui les intéresse ! Les eaux de Bourbonne commencent souvent par accroître le malaise, un malade perd et recouvre alternativement l’espoir de guérir.
Elles se prennent en boisson, en douches et en bains. On use aussi des boues tirées du fond des bains.
Combien un homme éclairé sous la direction duquel seraient ces bains et les autres du royaume y tenterait d’expériences ! On fait à l’imitation de nature des bains purement artificiels. Combien l’art et la nature combinés n’en fourniraient-ils pas par l’intermède des sels mêlés aux eaux et par la variété des plantes qu’on y ferait pourrir ! Combien de qualités diverses ne pourrait-on pas donner aux boues ! Mais il faudrait que l’art cédât à la nature tout l’honneur des guérisons. Les bains seraient décriés, si l’on venait à soupçonner que l’industrie de l’homme eût quelque part à leur effet. On croirait ne quitter un médecin qu’on aurait à sa porte que pour en aller chercher un plus éloigné. Ô hommes ! Ô race bizarre !
Les eaux de Bourbonne, prises en boisson, passent pour purgatives, et le sont, pour fondantes, pour altérantes et pour stomachiques.
Quand elles cessent de purger, on les aide par un purgatif approprié à la maladie. On ordonne la panacée mercurielle dans les obstructions. La manne simple suffit dans d’autres cas.
On les boit le matin ; leur effet est de provoquer la sueur ; mais c’est, je crois, en qualité d’eaux chaudes.
Si l’on s’endort après les avoir bues, il est ordinaire qu’il s’élève de la chaleur dans le corps et qu’il survienne de la fièvre. Les eaux veillées sont innocentes ; les eaux assoupies sont fâcheuses. Quelle est la cause de cet effet ? Nature veut-elle tuer ou guérir ? Nature ne veut rien. Elle indique un remède salutaire ; elle pousse ensuite à un sommeil léthifère. Et sur ce, vous dirait Rabelais, croyez à la Providence et buvez frais.
La quantité de verres, d’eau ordonnée varie. On prend chaque verre à quelque intervalle l’un de l’autre. Cet intervalle est ordinairement d’un quart d’heure. Le buveur est debout ou couché, selon la nature de la maladie.
On se rend à ces bains en tout temps, même en hiver ; mais il y a des précautions à prendre dans la saison rigoureuse. Le voyage s’en fait communément dans le courant de mai, et le séjour dure jusqu’à la fin d’octobre.
On boit quelquefois les eaux sans interruption ; plus ordinairement on en coupe l’usage par des repos de vingt à trente jours. Les médecins du lieu disent que plus les repos sont longs, plus les eaux sont salutaires. Est-ce à la santé du malade ? est-ce à la pauvreté du lieu ? Il faut se méfier un peu d’un aphorisme qui s’accommode si bien avec l’intérêt de ceux qui le proposent. Le temps de l’usage du remède s’appelle une saison, la durée d’une saison est de vingt-sept jours.
On les distribue du puits en bouteilles. La bouteille contient deux livres d’eau, se paye deux sous, le bain dix sous dans le quartier d’en bas, seize sous dans le quartier d’en haut ; le salaire du doucheur et de la doucheuse est de quinze sous. Je n’entrerai pas dans ces détails minutieux, si j’avais beaucoup de choses importantes à dire, et puis il y a des questionneurs sur tout. Le prix des eaux est peut-être la seule chose que La Condamine m’eût demandée.
On boit depuis un verre d’eau par jour jusqu’à huit, plus souvent on s’en tient à six ; et ces six verres font la pinte et demie de Paris.
La durée de la douche est de vingt à trente minutes, le malade le plus vigoureux ne la supporte pas plus d’une demi-heure. On prend le bain à la suite.
La durée du bain après la douche est de demi-heure au plus.
La plus longue durée du bain qui n’a pas été précédée de la douche est d’une heure.
Le bain excite la transpiration, qui s’y condense sous la forme de glaires ou de blanc d’œuf léger. Je ne sais rien de plus sur la nature et la qualité de ces glaires, qui mériteraient peut-être d’être examinés de plus près. Leur quantité, leur qualité varient-elles selon l’état des malades et la nature des maladies ? Mieux connues, ne fourniraient-elles pas de pronostics au médecin ? Je l’ignore.
Le premier jour de la saison est de deux verres ; puis les autres jours de trois, de quatre, de cinq, de six. On se tient plus ou moins de temps à chacune de ces doses, dont la plus forte se prend pendant les derniers des vingt-sept jours de la saison.
Pour les obstructions, la saison est quelquefois de quarante jours sans interruption.
Le repos entre une saison et une saison varie. L’intervalle d’une saison à la saison suivante est communément de quinze à vingt jours, selon les forces ou la fatigue du malade.
Pendant l’usage des eaux le régime est austère ; il est ordonné de dîner de bonne heure, de souper de bonne heure, de se coucher de bonne heure, parce qu’il faut prendre les eaux de bonne heure. Il y a des mets ordonnés, il y en a de proscrits. Pendant le repos, on traite les malades avec un peu d’indulgence ; on se relâche un peu de la sévérité sur les heures des repas, de la veille et du sommeil, et l’on fait mal, car je sais qu’on en abuse.
Pendant que j’étais aux eaux, on y douchait un cheval. L’animal malade prêtait sans peine son épaule infirme à la douche ; il léchait l’eau. Quant à son épaule saine, il la refusait au remède. Le coup du fluide qui blessait celle-ci était peut-être moins sensible sur l’autre paralysée.
Le nombre courant des douches est de neuf à douze.
Les eaux présentent à ceux qui entrent dans les bains une odeur de foie de soufre assez forte ; mais y a-t-il ou n’y a-t-il point de soufre ? C’est une autre question. Voici des faits qui semblent contradictoires et sur lesquels on ne peut également compter.
M. Chevallier, chirurgien du lieu, homme véridique et instruit, m’a assuré qu’une cuillère d’argent suspendue à la vapeur du puits ne se noircissait pas, et qu’un nouet de litharge et de céruse ne s’y ternissait pas.
Ma sœur m’a assuré qu’au retour des bains, les eaux qu’elle avait apportées en bouteilles, et qu’elle réchauffait au bain-marie, dans un gobelet d’argent, noircissaient fortement ce gobelet ; et l’on peut compter sur son témoignage.
Au reste il n’est pas rare que des eaux exhalent une très forte odeur de soufre, sans qu’on en puisse obtenir un atome. Ce gaz subtil, ainsi que beaucoup d’autres, s’échappe même à travers le verre ; c’est un caractère qu’il a de commun avec la lumière. La lumière est sensible à la vue ; le gaz à l’odorat ; tous deux sont incoercibles. Combien d’agents ignorés dans la nature ! Combien de causes de phénomènes sensibles, qui n’ont pas même de rapport avec nos sens ! Autre animal, autre chimie, autre physique. Ce que l’un écrivait ne serait pas même intelligible pour l’autre, et puis soyez bien dogmatiques.
La boue des bains noircit l’argent et la céruse ; mais sans aucun autre caractère sulfureux.
Cette boue est un mélange de sable fin, ferrugineux, et de débris de végétaux : séchée, l’aimant la met en mouvement. Le fer y est si sensible que l’acide vitriolique ou nitreux en dissout une assez grande quantité, ainsi que d’une terre absorbante qui y abonde.
MM. Venel et Monnet ont fait séparément et à plusieurs années d’intervalle l’analyse des eaux. Je ne connais point ce dernier ; on le dit honnête homme. J’ai eu une liaison intime avec le premier, qui est maintenant professeur de chimie à Montpellier où il se promettait de faire les plus belles choses et où il végète amplement. C’est un homme d’un rare mérite, excellent chimiste, le plus grand amateur des aises de la vie, le contempteur le plus insigne et le plus vrai de la gloire et de l’utilité publique, et le moraliste le plus circonscrit que je connaisse. Le gouvernement l’employa à l’examen des eaux médicinales du royaume. Il y travailla pendant dix ans. Mais tant payé, tant tenu ; les travaux cessèrent du moment où cessa la finance. Avec un grain d’enthousiasme et d’amour du genre humain, car il en faut, il eût poursuivi ses voyages et ses analyses à ses dépens, et il eût complété un ouvrage dont les fragments précieux sont aujourd’hui abandonnés à la pâture des rats. Mais qu’est-ce que cela lui fait ? Il boit, il mange, il dort ; il est profond dans la pratique de la morale de Salomon, la seule qui lui paraisse sensée pour des êtres destinés à n’être un jour qu’une pincée de poussière. Sans l’amour de ses semblables, sans la folie sublime d’en être estimé, sans le respect pour la postérité, sans la belle chimère de vivre après la mort, on ne fait rien. L’on dit avec le poète Piron :
Les analyses des eaux de Bourbonne faites par MM. Venel et Monnet se sont exactement rapportées.
Une attention qui n’est pas à négliger c’est d’y employer des vaisseaux de verre. Les vaisseaux vernissés de terre, de plomb, se laissent attaquer, et les produits ne sont plus exacts.
Sur une livre d’eau l’analyse a donné 63 grains de sel marin à base alcaline,
4 3/4 grains de sélénite,
2 grains de terre absorbante.
Nul vestige de fer, si ce n’est dans les boues où ce fer peut provenir de végétaux pourris ; point de sel de Glauber, pas plus de sel marin à base terreuse.
Renfermées dans un vase clos hermétiquement, ces eaux se gardent inaltérées. Exposées à l’air libre, elles se putréfient et prennent l’odeur d’œuf pourri.
J’ai demandé pourquoi on n’usait pas à Bourbonne des bains de vapeurs. On m’a répondu qu’ils donnaient des vertiges sans aucun soulagement. Mais il y a quinze à vingt ans. Qui sait si la nature des eaux est aujourd’hui précisément la même ? Si les vapeurs seraient aussi infructueuses ? Si les premières tentatives ont été bien faites ? Rien de plus difficile qu’une observation, une expérience dont on puisse conclure quelque chose. On ignore le nombre des essais nécessaires pour en constater la généralité et la constance. Le phénomène qui a lieu dans un instant n’a pas lieu dans l’instant qui suit.
Lorsque j’allai à Bourbonne il y avait un assez grand nombre de malades de tout âge et de toute condition. Madame Rouillé, l’intendante de la province, le grand M. de Vaux, notre dernier commandant en Corse, le président de Gasq, l’abbé de La Rochefoucauld et sa sœur, madame de Pers avec son nombreux cortège, madame l’abbesse de Troye avec son jeune aumônier de vingt-neuf ans. J’aurais bien de quoi dire si j’étais louangeur, mais je me tais. Je ne saurais cependant refuser un mot à madame l’intendante, à qui des malins m’ont accusé de faire la cour en tapinois. Le ciel sembla l’avoir envoyée au secours des malheureux habitants pour les sauver des horreurs de la disette. Le blé arriva lorsqu’on s’y attendait le moins, et tout le lieu retentit de ce cri : Voilà du blé, voilà du blé. Qu’elle dut être heureuse en ce moment ! Je me mets à sa place, et mon cœur en tressaillit de joie. Elle fit cette bonne œuvre avec encore plus de modestie que je n’en parle.
Avec la ferme résolution de ne voir que ce bon et cette bonne madame de Sorlières, mon ancien camarade d’école, le prévôt de maréchaussée Maillardet, nos amies madame de Meaux et son enfant, j’ai presque vu tout le monde. Si je tenais beaucoup à ma parole, M. de Foissy, écuyer de M. de Chartres, me consolerait d’y avoir manqué. Nous étions porte à porte avec un parent de madame l’intendante, appelé M. de Jarrière, honnête, aimable et gai. On accordait beaucoup d’esprit à M. de Gasq, et ce n’était pas lui faire grâce. Il visita nos amies, qui ne lui trouvèrent point, comme vous pensez bien, cette liberté de propos que d’autres femmes lui reprochaient. Au moment où je dis des autres, les autres disent de moi. Je défraie mon prochain par mes ridicules et par mes bonnes qualités ; et cela est juste, car je suis défrayé avec l’avantage d’un contre cent.
Il y avait une madame de Nocé qui s’est fait doucher elle et son chien, ce que Naigeon ne croira pas, non plus que madame de Pers se soit fait doucher elle et son singe boiteux. Cette madame de Nocé est une voisine d’Helvétius… Elle nous apprit que le philosophe était l’homme du monde le plus malheureux à sa campagne. Il est environné là de voisins et de paysans qui le haïssent. On casse les fenêtres de son château ; on ravage la nuit ses possessions ; on coupe ses arbres, on abat ses murs, on arrache ses armes des poteaux. Il n’ose aller tirer un lapin sans un cortège qui fasse sa sûreté. Vous me demanderez comment cela s’est fait ? Par une jalousie effrénée de la chasse. M. Fagon, son prédécesseur, gardait sa terre avec deux bandoulières et deux fusils. Helvétius en a vingt-quatre avec lesquels il ne saurait garder la sienne. Ces hommes ont un petit bénéfice par chaque braconnier qu’ils arrêtent, et il n’y a sorte de vexations qu’ils ne fassent pour multiplier ce petit bénéfice. Ce sont d’ailleurs autant de braconniers salariés. La lisière de ses bois était peuplée de malheureux retirés dans de pauvres chaumières. Ce sont ces actes de tyrannie réitérés qui lui ont suscité des ennemis de toute espèce, et, comme disait madame de Nocé, d’autant plus insolents qu’ils ont découvert que le bon philosophe est pusillanime. Je ne voudrais point de sa belle terre de Voré, à la condition d’y vivre dans des transes perpétuelles. Je ne sais quel avantage il a retiré de sa manière d’administrer sa terre ; mais il y est seul, mais il y est haï, mais il y a peur. Ah ! que notre dame Geoffrin était bien plus sage lorsqu’elle me disait d’un procès qui la tourmentait : « Finissez mon procès ; ils veulent de l’argent ? J’en ai. Donnez-leur de l’argent. Et quel meilleur emploi puis-je faire de mon argent que d’en acheter le repos ? » À la place d’Helvétius, j’aurais dit : « On me tue quelques lièvres, quelques lapins ; qu’on tue. Ces pauvres gens n’ont d’asile que ma forêt, qu’ils y restent. » J’aurais raisonné comme M. Fagon, et j’aurais été adoré comme lui.
Les médecins des Eaux sont tous charlatans, et les habitants regardent les malades comme les Israélites regardaient la manne dans le désert. La vie et le logement y sont chers pour tout le monde, mais surtout pour les malades, oiseaux de passage dont il faut tirer parti.
Il y a environ cinq cents feux et trois mille habitants à Bourbonne.
Les malades y dépensent une année dans l’autre cinquante mille écus, cependant les habitants sont pauvres. C’est que de ces cinquante mille écus, il y a plus de cent mille francs qui sortent du finage ; c’est que l’argent qui tombe dans un endroit ne l’enrichit point, lorsqu’il fait un bond pour aller trouver ailleurs les denrées de consommation ; ceux qui apportent à Bourbonne ces denrées s’en retournent avec l’argent des malades dans leur bourse. L’argent ne reste pas où il est déboursé. Les terres rapportent peu. Celles qui entourent les eaux ne sont pas la propriété du village, qui est un lieu nouvellement fait. C’est cependant un gros marché à grains. Je ne m’en suis pas aperçu, parce qu’on ne vend point de grains, quand il n’y a point de grains.
C’est le prévôt de maréchaussée de Langres qui fait la police à Bourbonne pour le gouvernement. C’est une affaire de vingt-cinq louis pour lui, et il est aux ordres du ministre de la guerre. Il peut servir pour le logement et pour les vivres. C’est à lui qu’il faut s’adresser : mon condisciple Maillardet est un galant homme, qui cherche à se rendre agréable et qui y réussit.
Il y a un hôpital militaire tenu par des religieuses de l’ordre de Saint-Augustin, une paroisse et des Capucins.
Le jardin des Capucins est ouvert aux malades de l’un et de l’autre sexe, et sous ce prétexte il est public. Les femmes traversent le monastère pour s’y rendre. Ces pauvres moines envoient des fleurs et quelques fruits aux étrangers ; manière simple d’appeler une aumône honnête. C’est leur métier.
Bourbonne, ainsi que tous les autres lieux où se rassemblent des malades, est une demeure triste le jour par la rencontre des malades ; la nuit, par leur arrivée bruyante.
La souffrance et l’ennui rapprochent les hommes. Il est d’étiquette que le dernier venu visite les autres. Il va dire de porte en porte : Me voilà. On lui répond de porte en porte : Tant pis pour vous. Dans les visites qu’on se rend la demande est : Comment vous en trouvez-vous ? et la réponse : Tant pis ou tant mieux. Dites d’un malade qui ne se communique pas aux eaux qu’il est insociable. La morgue du rang est la première maladie dont on y guérit ; mais la rechute est sûre quand on les quitte. Rien n’apprend à l’homme qu’il est homme comme la maladie qui l’abandonne à la direction de tout ce qui l’environne. Deux malades sont frères.
Bourbonne est située dans un fond. Ceux qui s’y rendent de Paris ne l’aperçoivent que par l’extrémité du clocher de la paroisse qui perce au-dessus des montagnes, se montre et disparaît vingt fois, trompe le voyageur sur la distance et le fait donner au diable.