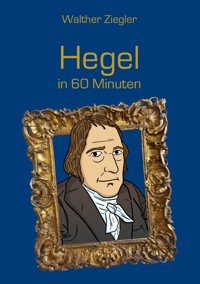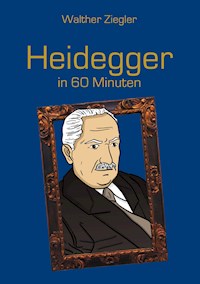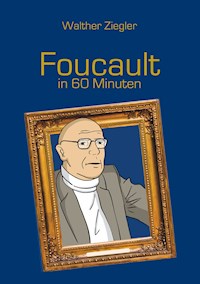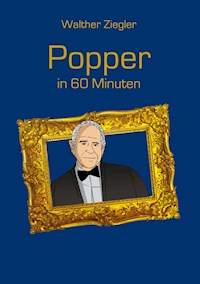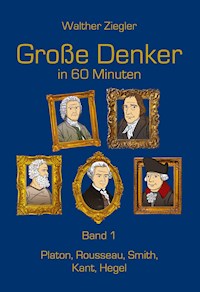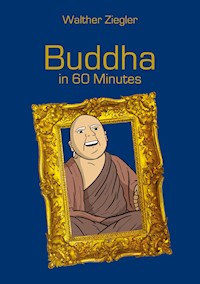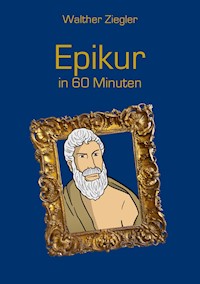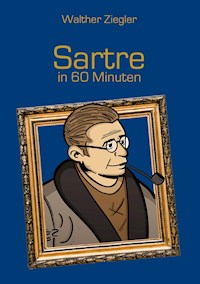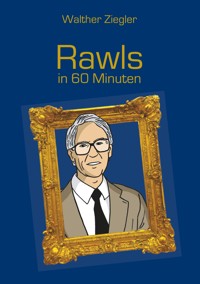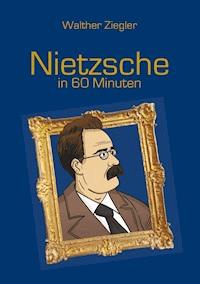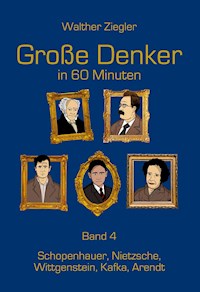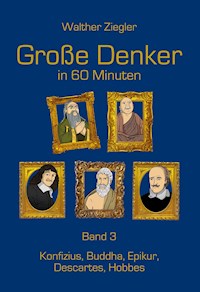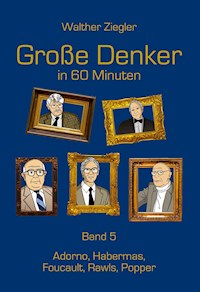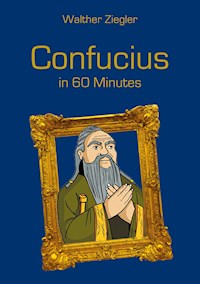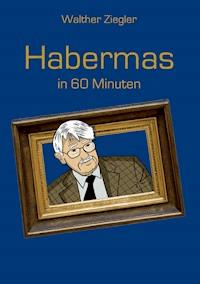Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Foucault est considéré comme l'un des plus illustres poststructuralistes. Déjà les titres de ses ouvrages témoignent d'une vision entièrement nouvelle des choses, titres tels que : " Histoire de la folie ", " Surveiller et punir ", " L'usage des plaisirs ", " Les mots et les choses ". Foucault est de ces philosophes qui, une fois disparus, voient leur prestige non pas diminuer, mais augmenter sans cesse. On peut à la fois s'en réjouir et s'en inquiéter. S'en réjouir, parce que la pensée de Foucault nous fascine encore par sa vitalité et sa pertinente croissante. S'en inquiéter, parce qu'elle couve quelque chose de troublant : " On peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable. " En avançant cette thèse de la " mort de l'homme ", Foucault ne prétend pas que nous, en tant qu'espèce, sommes en passe de disparaître, par exemple des suites du réchauffement climatique. Il entend nous faire comprendre que l'homme tel que nous le connaissons, c'est-à-dire l'être libre, autonome et jouissant spontanément de la vie, glisse lentement vers sa disparition. Il se dissout dans les discours et les structures de notre société coercitive - à la manière silencieuse d'un visage dessiné dans le sable qui se défait dans les vagues. Au 18e siècle, on a conçu une nouvelle prison de forme circulaire qui permet au surveillant d'observer tous les prisonniers à partir d'une tour centrale. Selon Foucault, ce sentiment d'être observé en tout temps traverse notre société dans son intégralité. Mais il nous montre non seulement l'origine des structures de la société coercitive d'aujourd'hui, mais aussi le concept d'un art de vivre moderne. En quoi consiste cet art de vivre ? Le sujet individuel peut-il s'affranchir de la société coercitive ? Foucault a-t-il raison de prétendre que son fameux paradigme carcéral gouverne notre société et que nous avons tous l'impression d'être sous surveillance permanente ? Nul doute - les mises en garde de Foucault demeurent d'une actualité dérangeante. Sa thèse centrale est illustrée par plus d'une centaine de ses citations les plus représentatives. Le livre est paru dans la série à succès " Grands penseurs en 60 Minutes ".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à Rudolf Aichner pour son infatigable travail de rédaction critique, à Silke Ruthenberg pour la finesse de son graphisme, à Angela Schumitz, Lydia Pointvogl, Eva Amberger, Christiane Hüttner, Dr. Martin Engler pour leur relecture attentive, et à Eleonore Presler, docteur en philosophie, qui a effectué une dernière relecture linguistique et scientifique du texte français. Je remercie aussi monsieur le Professeur Guntram Knapp à qui je dois ma passion pour la philosophie.
Je tiens à remercier tout particulièrement mon traducteur Stéphane Vézina.
Table des matières
La grande découverte de Foucault
La pensée centrale de Foucault
Archéologie du savoir : Comment nous sommes devenus qui nous sommes
Folie et société – Exclusion de la déraison
Surveiller et punir – Structure de notre société
Dispositif de la sexualité
L’ordre des choses et la disparition de l’homme
À quoi nous sert la découverte de Foucault aujourd’hui ?
La prison panoptique de Foucault : Prototype de la surveillance numérique ?
La main invisible derrière tout cela : Débusquer les dispositifs !
Si nous sommes empêtrés dans les structures du discours, comment s’en dépêtrer ?
L’héritage de Foucault : Faire de sa vie une œuvre d’art
Index des citations
La grande découverte de Foucault
Michel Foucault (1926-1984) est sans doute le philosophe le plus éblouissant du XXe siècle. On le considère comme l’un des plus illustres poststructuralistes, mais lui-même rejette tout qualificatif. En fait, sa pensée ne s’inscrit dans aucune tradition philosophique, affirme-t-il :
À la différence d’autres philosophes, il ne dispose d’aucune théorie passe-partout applicable à tous les sujets :
Foucault est en effet un penseur au style d’une rare singularité, comme en témoignent déjà les titres de ses ouvrages : Histoire de la folie, Surveiller et punir, Les mots et les choses, L’usage des plaisirs ou Le souci de soi. Nul autre philosophe n’a tant attisé le débat intellectuel des dernières décennies. Certes, il n’a pas fondé un courant ou une école de pensée ; en revanche, il est de ces philosophes dont le prestige ne s’est pas étiolé depuis sa disparition. Au contraire, plus le temps passe, plus son œuvre se révèle d’une actualité brûlante. On peut à la fois s’en réjouir et s’en inquiéter. S’en réjouir, parce que la thèse centrale de Foucault nous fascine encore par sa vitalité ; s’en inquiéter, parce qu’elle couve quelque chose de troublant et d’alarmant :
Foucault dessine un sombre scénario selon lequel l’homme est sur le point de disparaître, lentement et inexorablement. Dans les amphithéâtres pleins à craquer du Collège de France, l’université d’élite de Paris, le jeune professeur, alors âgé d’à peine quarante ans, annonce à ses étudiants consternés :
On pourrait penser à première vue que Foucault voit l’espèce humaine en péril, menacée qu’elle est par une guerre nucléaire ou les contrecoups du réchauffement climatique. Il n’en est rien – l’homme ne meurt pas avec fracas, mais dans le silence, en se décomposant imperceptiblement de l’intérieur. Ce n’est pas une mort physique, mais psychique. Foucault entend nous faire comprendre que l’homme tel que nous le connaissons – libre, autonome et jouissant spontanément de la vie – glisse lentement vers sa disparition. Il se dissout dans les discours et les structures de notre société coercitive – spectacle aussi peu spectaculaire que la disparition d’un visage dessiné dans le sable. À chaque vague, le contour se défait.
Foucault bouscule la vulgate dominante selon laquelle l’homme moderne se fait toujours plus maître de lui-même sous le signe des Lumières et jouit de libertés individuelles toujours plus étendues. Selon lui, notre monde ne s’améliore pas continûment dans le sillage du progrès scientifique et de la doctrine humaniste. Il n’en est rien, bien au contraire. Certes, à l’époque des Lumières, l’homme s’est mis en passe de se libérer de toutes les contraintes de nature physique et religieuse en s’appuyant sur la science et la force du sujet connaissant, mais en vérité, il s’est complètement fourvoyé en amassant du savoir :
Selon Foucault, le vouloir-savoir déchainé de l’homme a mené bien sûr à de grandes avancées technologiques depuis l’époque des Lumières. En outre, il nous a libérés des aberrations médiévales et de la superstition, mais il a créé dans sa foulée, en lieu et place du vieil irrationalisme, de nouvelles structures rationnelles qui, précisément parce qu’elles sont fondées en raison, restreignent la liberté de l’homme plus implacablement que jamais. Les nouvelles connaissances rationnelles de la science qui se targuent d’humanisme ne font progresser les choses qu’en apparence ; en réalité elles incarnent un savoir transfiguré en pouvoir, un corset d’acier qui enserre et discipline la société dans son ensemble.
Poussé par la raison effrénée, l’homme se précipite involontairement, mais systématiquement, vers sa propre autodissolution. Pour Foucault, les XVIIe et XVIIIe siècles marquent l’âge fatidique. C’est alors que s’amorce « l’abolition de l’homme ». En effet, les scientifiques érigent désormais l’homme lui-même en objet de recherche. Les sciences dites humaines, y compris la biologie, la psychologie, la psychiatrie et la criminologie, font leur apparition et engendrent un savoir inédit et systématique de l’homme. Pour la première fois, la science différencie de façon exacte le comportement normal du déviant, le sain du malade, le naturel du pervers. C’est à cette époque que, dans toute l’Europe, des établissements émergent destinés à éloigner les fous du milieu de la société :
Dans sa thèse de doctorat Histoire de la folie, qui a provoqué un tollé, Foucault montre que, des siècles durant, au Moyen Âge et au début des temps modernes, on faisait preuve de tolérance envers les anormaux. Bien entendu, dans les communautés villageoises, on les ridiculisait, on les raillait, on les traitait comme factotum, idiots du village ou autres figures obscures, mais on les intégrait dans la vie quotidienne. Mais aux XVIIe et XVIIIe siècles, une armée de scientifiques diagnostiquent ces anormaux comme fous dans leur manuel de médecine et on les enferme dans des asiles. À ce moment débute, dit littéralement Foucault, le « grand renfermement »8 de la folie. On sépare désormais la folie de la raison et on la définit comme dangereuse déraison. Ainsi par cette appréhension scientifique le fou devient-il irrévocablement un fou :
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, se fondant sur des découvertes scientifiques, on construit non seulement des institutions psychiatriques mais aussi, pour la première fois, de gigantesques prisons de masse. Le régime pénitentiaire règne dorénavant partout. Bien sûr, les siècles précédents connaissaient les donjons et les cachots dans lesquels on emprisonnait les malfaiteurs et les ennemis. En outre, on se plaisait à exposer les malfaiteurs dans des cages ou au « pilori », le poteau de la honte. Mais l’internement massif de dizaines de milliers de délinquants dans des établissements « pénitenciers », c’est un geste moderne.
Dans son ouvrage le plus lu et le plus célèbre, au titre significatif de Surveiller et punir, Foucault décrit l’introduction d’un modèle carcéral novateur et méticuleusement perfectionné par le juriste et philosophe Jeremy Bentham. En 1787, Bentham conçoit la prison dite « panoptique », dans laquelle toutes les cellules sont disposées de manière concentrique autour d’une tour centrale. Le surveillant peut voir tous les détenus autour de lui à travers une fente étroite, mais ceux-ci, à l’inverse, ne peuvent pas le voir :
Bien que le surveillant ne puisse jamais garder son regard sur toutes les cellules en même temps, il suffit, selon Bentham, que les prisonniers sachent que, théoriquement, le surveillant pourrait les voir à tout moment. Ils se comportent alors de leur propre chef comme s’ils étaient constamment observés. L’autodiscipline se substitue à la discipline. À la surveillance continue dans le système carcéral moderne s’ajoute un contrôle total sur le corps et la psyché au moyen d’une discipline stricte en termes de temps et de mouvement. Des injonctions sonores rythmées dictent au détenu le moment de se lever, de travailler, de manger, de dormir ou d’effectuer un entraînement physique – le tout en étant constamment localisable dans l’espace panoptique. C’est ici que Foucault formule la plus provocante et la plus célèbre de ses thèses :
Foucault explique comment, de par ses techniques disciplinaires de visibilité et d’invisibilité, la prison s’impose comme modèle et noyau de toute notre civilisation. Le professeur surveille ses élèves du haut de son pupitre surélevé, le patron ses ouvriers du haut de son bureau vitré surélevé. Le système de la prison panoptique s’immisce dans tous les domaines de la vie du corps social :
Dans les écoles, les casernes, les services administratifs, les établissements pour malades mentaux, sur le lieu de travail et même pendant une période de chômage, l’homme moderne se retrouve à chaque instant localisé, capté et contraint de se soumettre à des procédures rigides. Nos institutions modernes, tout comme la prison de Bentham, constituent des systèmes disciplinaires parfaitement aménagés pour exclure les déviants et tenir tous les autres en échec à titre de prévention. Car en effet, même ceux qui ne sont pas ou « pas encore » exclus de la société savent bien qu’ils peuvent à tout moment partager ce destin s’ils se refusent au conformisme. Les remarques lancées à la rigolade – « T’es dingue, toi » ou « Fais attention, sinon de gentils messieurs en blanc vont venir te chercher » – recèlent une vérité quelque peu inquiétante.
Foucault soutient que chacun de nous éprouve la crainte consciente ou inconsciente d’être déclaré anormal ou délinquant et d’être placé dans un établissement psychiatrique ou correctionnel, crainte qui exerce une pression continue au conformisme. L’impression d’être maintenu sous observation constante comme dans ces institutions façonne désormais aussi la vie quotidienne de millions de personnes dans notre société.
Foucault souligne que cette dissolution de l’homme et de la liberté humaine dans la société coercitive marque l’aboutissement d’une longue évolution que, tel un « archéologue », il s’efforce de mettre au jour et de documenter. Dans son principal ouvrage philosophique intitulé Les mots et les choses et dans d’autres écrits, il se revendique archéologue, il fouille les couches les plus profondes du savoir de ces époques qui dictent leur loi d’airain à notre société d’aujourd’hui et fixent ainsi « l’ordre des choses » :