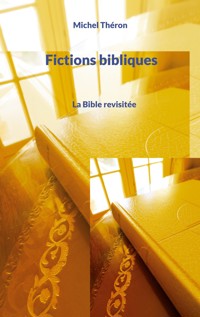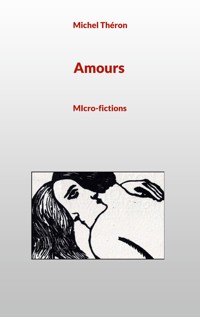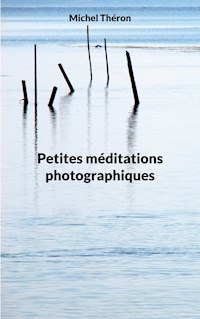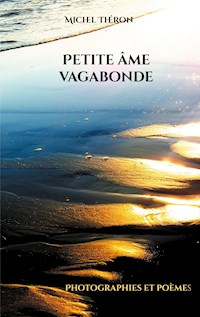17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La culture générale est une nécessité, à la fois face à l'ignorance et à la spécialisation. Encore faut-il éviter le catalogue et la juxtaposition, proposer des modèles d'intelligibilité de ce que l'on décrit. Ce livre le fait, en proposant une démarche et une exploration des choses basées sur la psychologie. On peut appliquer à la culture le mot que Vinci appliquait à la peinture : la culture est une chose mentale, "cosa mentale". La culture devrait être compréhensible au plus grand nombre. Les schémas d'interprétation qui sont ici proposés se veulent accessibles à tous. "Il n'y a pas de choses simples, disait Valéry, mais il y a une façon simple de voir les choses."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Table analytique
Avant-propos
Définitions
Nature et culture
Les lois de la nature
La part du féminin
Éros et Agapè
Le naturalisme
Le futur
Le rôle du langage
Miroirs instituants
Dominer les pulsions
Le sacrifice
Faits et normes
Monde réel et mondes imaginaires
Échanges et signes substitutifs
Force de l’habitude : l’intégration mentale
« Révolution copernicienne »
L’image de l’Autorité
Le pouvoir des peurs
Façons et coutumes : leur origine
Culture et traditions
Compensations symboliques
Deux sens possibles du mot
culture
Destin des constructions symboliques
Fragilité des constructions symboliques
Constructions symboliques et histoire des peuples
Défi et réponse
La contestation des constructions symboliques
Cycles
Début de la désymbolisation en Occident moderne : la Réforme
Symbolique et littéral
Le relativisme au XVI
e
siècle occidental
Le XVII
e
siècle
Le XVIII
e
siècle
Le regard tautologique
Le soupçon de manipulation
Les voies du relativisme
Nominalismes et conventionnalismes
La déconstruction des productions de l’esprit
Le XIX
e
siècle et la rationalité : le positivisme
Définalisations
La « loi des trois états »
Le scientisme
La barbarie savante
La barbarie première
Les hordes
Le particulier et l’universel
Critique des coutumes et défense de l’universel
Coutumes barbares
La « raison universelle »
Retour à l’enracinement et aux traditions
Ambiguïtés du culturalisme
Caractérisation et décaractérisation
Le problème
L’abstraction et l’amnésie modernes
Réhabilitation des constructions symboliques
Utilité des usages symboliques
Dangers de leur abandon
Les succédanés religieux
Relativisme et élargissement de l’esprit
Le langage symbolique
Le réductionnisme
Symbole et réalité positive
La barbarie biologique
L’intériorisation
La lettre et l’esprit
Exemples
L’examen impartial
Le souci de rationalisation
Logiques plurielles
Pensée close et pensée ouverte
Deux morales
La lutte du clos et de l’ouvert : le tragique historique
Paradoxe, oxymore et union des opposés
La loi d’ambivalence
Langage et ambiguïté
Les catégories de la logique symbolique
Disjonctions symboliques
Contenu manifeste et contenu latent
La stase psychique
La lecture inventive
Destins de l’intériorisation
Symbole et connaissance
Autoréférentialité des symboles
L’homme symbolique
Multipolarité de l’esprit
Animisme et holisme
Anthropologie de l’hypallage
L’expérience poétique
Prescience des mythes
Vérité des mythes
Fonction des constructions symboliques
Dangers de la désymbolisation
La fonction fabulatrice
Anthropologie du Diable
Dimensions incontrôlables
L’erreur de l’intellectualisme
Les impostures langagières
Le risque de déculturation
Le
démonique
L’exaltation et ses dangers
L’angélisme, individuel et collectif
Problématique de l’humanisme
L’homme sauvage
Les impasses anthropologiques
Psychologie de la transgression
Psychomachie, ou : le combat de l’âme
L’ombre et le masque
Genèse de l’ombre
Le masque social
L’idéologie sociale
La conscience : vigilance et contrôle
Ambivalence de la conscience
Culture et contre-culture
L’attrait de l’ombre
Fonction du rêve
Le bien et le mal
Prescience des rêves
La peur, l’inconscient, l’agressivité
Problématique de la différenciation sexuelle
Interprétation et contexte
Rêve et productions symboliques
Les images symboliques
Cauchemars
Persistance des images archaïques
Extraversion et introversion
Anthropologie du sport
La réussite sociale
La fuite hors de soi
Recours aux images
Désymbolisation et unidimensionnalité
Le
dernier homme
La transcendance
La fin de la transcendance : le bonheur
Bonheur, plaisir, joie
Du symbole au réel
L’
homme-masse
Les oublis
La vie légère
La santé et le corps
Sublimation et désublimation
Psychologie du désir humain
Désir et absence
Le rôle de la rhétorique
Langage et nature
La désublimation dans le langage
Style et transcendance
Le kitsch
Pseudo-mythologies
L’
idéal
et l’
image
: deux types de pensée
La représentation de l’idéal
Fonction du style dans l’image artistique
Philosophie du maquillage
Proximité des images aujourd’hui
Image et homme moyen
Image et contre-culture
L’unidimensionnalité de l’image
Culture et finitude
Exaltation et banalisation
Pathologie de la banalisation
Folies
L’
homme-loup
L’exaltation collective
Mécanique
et
mystique
Le problème
La finitude
L’humour salvateur
Typologie des constructions symboliques
Lutte et soumission
Masculin et Féminin
La peur du féminin
La lutte des sexes
Père et Mère
L’archétype paternel
Parents réels et parents mythiques
Le Père et le langage
L’
anima
et ses représentations culturelles
Nécessité du symbole ; dangers de la projection
La femme et l’
animus
Anima
et
animus
comme pôles des cultures
Polarités secondes
Chamanisme
et
manisme
Rêve et ivresse
Le jour et la nuit
Modèles et métaphores
Statut des schémas explicatifs
Les représentations religieuses
L’homme agissant et dominateur
Nature et Histoire
Dominer la nature
Le
prométhéisme
L’humilité
Vie active et vie contemplative
Statut du
monde
Les rythmes et la sagesse
L’Orient et la soumission
Le fatalisme et l’Occident
Le christianisme et l’idée d’incarnation de Dieu
Problématique de l’Incarnation
Incarnation et proximité du divin
Christianisme oriental et christianisme occidental
Christianisme et recul du destin
La représentation de la transcendance
Culture et images
Cheminements de l’humanisation
Les âmes des cultures
Orient et Occident comme pôles de l’âme
La tentation de l’absurde
Hindouisme
L’évasion mystique
Bouddhisme
La tentation du silence
L’éloge du vide
La fin du moi
Éléments communs aux différentes religions
Le détachement vis-à-vis des fruits de l’action
Les sédimentations religieuses
Anthropologie de l’action
L’action et le tragique
Le chaos
Le gaspillage et l’inévitable
Pantragisme
L’action collective : le tragique historique
Réalisme et machiavélisme
Idéalisme et nihilisme
Le culte de l’Histoire
Les utopies
Les effets pervers
La notion de limite
La mesure
Pensée absolue et pensée relative
Les vertus et l’excès
Psychologie politique
Hétéronomie ou autonomie ?
La vraie autonomie
Difficultés de l’autonomie
Psychologie de l’hétéronomie
Justifications de l’hétéronomie
Anthropologie du droit
Pathologie de la démocratie
La névrose égalitaire
Riposte et vengeance
Rancune et morale chrétienne
La falsification des valeurs
L’idéologie de l’effort et du mérite
L’esprit moderne : relativisme et subjectivisme
L’
invidia democratica
Remèdes ?
Esthétique de la modernité
L’esthétique, notion moderne
Regard abstrait et déculturation
La modernité comme esthétique
Du symbole au signe
La société de consommation
Décor humain ou inhumain
La réification
Consommation de la consommation
La contre-culture récupérée
Les deux visages du kitsch
Humour et modernité
L’œuvre et la structuration ironique
Esthétique de l’abrupt
Modernité et postmodernité
Requiem pour une culture
Épilogue
Petit index des notions-clés
Du même auteur
Avant-propos
« Il est bien plus beau, disait Pascal, de savoir quelque chose de tout, que de savoir tout d’une chose ». La culture générale est une nécessité, à la fois face à l’ignorance et à la spécialisation.
Encore faut-il éviter le catalogue et la juxtaposition, proposer des modèles d’intelligibilité de ce que l’on décrit. Ce livre le fait, en proposant une démarche et une exploration des choses basées sur la psychologie.
Il part de l’idée essentielle que la culture est faite de constructions symboliques. Elles vivent du crédit que l’esprit leur donne. D’abord collectivement héritées dans la vie, elles sont ensuite revisitées par chacun grâce à un examen personnel. Si l’esprit s’y reconnaît, si elles correspondent à ses propres structures et orientations, aux scénarios qu’il s’est forgés sur l’existence, il les adopte. Sinon, il les abandonne. De toute façon, même si à l’évidence elles influencent et modèlent la vie, elles n’ont de réalité qu’en tant que constructions mentales. On peut appliquer à la culture le mot que Vinci appliquait à la peinture : la culture est une chose mentale, cosa mentale.
Je pense que la culture devrait être compréhensible au plus grand nombre. Les schémas d’interprétation que je propose ici se veulent accessibles à tous. « Il n’y a pas de choses simples, disait Valéry, mais il y a une façon simple de voir les choses ».
Les références des livres dont je me suis inspiré figurent en notes de bas de page. En s’y reportant, on aura ainsi une petite bibliographie. Un index des notions-clés placé en fin d’ouvrage permet de se guider dans la matière d’ensemble du livre.
Remarque : La première édition de cet ouvrage est parue chez Ellipses en 1991, sous le titre Comprendre la culture générale. Par rapport à elle, la présente édition a été entièrement revue et considérablement augmentée.
1 Définitions
Que serions-nous, sans le secours de ce qui n’existe pas ? (Paul Valéry)
Nature et culture
La culture est ce qui, en l’homme, s’oppose à la nature.
Cela est sûrement vrai pour la vie de chaque homme, pris en particulier. Mais cela est vrai, aussi, de la vie en société. La culture est ce qui s’oppose, en chaque groupe, à la vie de la nature, à la vie selon les lois naturelles.
De quelle sorte sont ces lois ? Que veut la nature, en vérité ?
Dans la vie personnelle de l’individu, la nature le pousse à assouvir immédiatement ses instincts, à réaliser ses pulsions, bref, à faire, tout de suite, tout ce dont il a envie.
La culture se dresse peut-être moins contre les instincts que contre l’adhésion immédiate, ou par réflexe, aux instincts.
Les lois de la nature
La nature n’est jamais répressive. Elle ignore l’exclusivité et le choix. Cela se voit dans les œuvres marginales, anomiques au sens de Durkheim, où la nature, par défi contre la culture environnante, est réhabilitée, parfois avec impertinence. On le voit bien dans Les Liaisons dangereuses, de Laclos :
On se lasse de tout, mon ange, c’est une loi de la nature, ce n’est pas ma faute... (lettre CXLI)
Don Juan disait, en substance, la même chose. Voyez sa profession de foi au début de la pièce de Molière (I, 1). En fait il est moins un séducteur qu’un homme constamment séduit (« La beauté me séduit partout où je la trouve... »), et donc condamné au nomadisme perpétuel (« Si tôt qu’on en est maître une fois, tout le beau de la passion est fini, etc. »).
Dans la vie amoureuse, la nature est donc complètement amorale. Elle ignore la monogamie, la fixation unique, le choix ou l’élection, en quelque sens que ce soit. Monogamie : Monotonie... Il n’y a rien à répondre à la lettre de Valmont : elle est un modèle de cynisme, de muflerie, et, dans son ordre, de vérité.
« L’amour, disait Chamfort, n’est que l’échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes ». La nature tyrannise nos corps, nous ôte toute liberté. « Madame, la nature a parlé ! », disaient, pressant leur belle, les libertins du XVIIIe siècle. On s’éprend, on se méprend, on se reprend. La sagesse populaire le dit bien. Tout passe, tout lasse, tout casse. Si l’amour fait passer le temps, le temps fait passer l’amour, etc.
Tout cela est hors de notre pouvoir. Lorsque la passion nous quitte, nous nous flattons de la croyance que c’est nous qui la quittons : les constatations du moraliste rejoignent les remarques du psychologue sur les « intermittences du cœur ». Tel est l’ordre de la nature. « Comme il n’est jamais en notre pouvoir d’aimer ou de cesser d’aimer, dit La Rochefoucauld, l’amant ne peut se plaindre à bon droit de la légèreté de sa maîtresse, ni celle-ci de l’inconstance de son amant. » Tout au plus peut-on exiger des autres, sinon une fidélité qui ne dépend pas d’eux, la lucidité sur eux-mêmes et au moins la sincérité, l’aveu de leurs sentiments. La nature cependant est tragique : l’effort même que l’on fait pour demeurer fidèle à quelqu’un que l’on n’aime plus est pire qu’une infidélité. Adolphe, de Benjamin Constant, illustre cela.
Ces lois biologiques ou physiologiques sont la part naturelle de notre destin. Peut-être parce que quelque chose, en nous, de plus grand que nous se manifeste, ainsi que le dit Phèdre :
C’est Vénus toute entière à sa proie attachée. (I, 3)
Plus grand, peut-être, mais anonyme... Nous pensons dans l’amour choisir notre partenaire librement. Mais c’est une illusion : nous croyons poursuivre des fins individuelles, nous ne poursuivons que des fins génériques. Schopenhauer le montre dans sa Métaphysique de l’amour : la nature se sert de nous comme de pantins ou de marionnettes, ou d’esclaves, pour à travers nous perpétuer l’espèce.
Mais Lucrèce l’a dit avant lui, dans son De natura rerum. Vénus ou la libido fait en sorte que poussés par le désir les hommes se reproduisent de génération en génération : Efficis ut cupide genaratim saecla propagent (I, 20). Évoquant la vie des premiers hommes, vivant sous l’ordre de la nature, il écrit : « Et Vénus dans les forêts unissait les corps des amants » – Et Venus in silvis jungebat corpora amantum (V, 961). Esclaves de Vénus, les amants ne sont donc pas libres de s’aimer : notez bien que ce in silvis (dans les forêts) renvoie à la vie sauvage (silvatica), la forêt incarnant un monde et un milieu traditionnellement à l’opposé de la vie de la culture.
Finalement, quand on aime on ne compte pas. Ce n’est pas de nous qu’il est question, mais de la continuation de la vie. Non du corps individuel ou du soma, qui est périssable, mais de la semence de la vie, qui est immortelle : le germen. Nous aimons pour autre chose que nous-mêmes. L’être qui vit, transmet la vie, puis meurt. Les vagues passent, mais la mer ne passe pas. L’enjeu nous dépasse ; le jeu est grandiose et ridicule à la fois. Le vouloir-vivre générique l’emporte sur tous nos projets. La comédie nous asservit. Et comme des coureurs, les hommes se passent le flambeau de la vie : Et quasi cursores vitae lampada tradunt (II, 79).
Voyez la description tout à fait cruelle que donne le même Lucrèce de l’amour : « Au milieu des délices de l’amour surgit quelque chose d’amer qui prend à la gorge » – Surgit amari aliquid quod in ipsis floribus angat... (IV, 1133-1134). Peut-être en effet l’impression de tristesse qui suit l’accouplement vient-elle de là : de l’impression d’avoir été trompé, dupé, par la nature, qui ignore l’individualité de chacun. Voilà pourquoi la chair est triste, comme on dit, tout animal est triste après l’union amoureuse : omne animal post coïtum triste.
Le déterminisme de la nature a certes sa grandeur. On y vibre à l’unisson du cosmos, comme dit Saint-John Perse dans Amers : « Ces larmes, mon amour, n’étaient point larmes de mortelle... J’ai cru hanter la fable même et l’interdit. » Mais aussi, si l’on ne se contente pas de vivre immédiatement ces instants, mais si l’on y réfléchit à froid, le déterminisme naturel qui les commande a toute son ironie. Nous y sommes manipulés. Valéry écrit dans « Le Cimetière marin » :
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu !
La part du féminin
Il semble pourtant que les femmes ne connaissent pas cette dépression, qui vient pour elles non pas post coïtum (où elles sont plus dopées que dupées), mais parfois post conubium (après les noces, le weeding blues), et surtout post partum (après l’accouchement, le baby blues). Peut-être est-ce donc elles qui ont inventé la contextualisation affective de l’amour, face à l’abstraction dépersonnalisante de la nature, façon de voir qui serait plutôt masculine. À elles convient bien alors la phrase de Rousseau : « Les sensations sont ce que le cœur les fait être. » Au Viagra, une femme préférera toujours le coup de téléphone du lendemain. À l’aventure d’un soir, la parole et l’échange, aussi le rêve et le fantasme qui dure : y penser toute la semaine...
Pensons aux Précieuses du XVIIe siècle, que Molière a injustement condamnées : ce sont elles qui ont voulu civiliser les hommes, leur apprendre politesse et bonnes manières, les initier aux méandres de la psychologie, tels qu’on les voit exposés dans la Carte du Tendre. De ce point de vue ce pourrait être les femmes qui, contre le déterminisme naturel dont l’acceptation fait parfois bien l’affaire des hommes, ont initié en regard et face à lui, un autre espace, celui de la culture, qui s’est progressivement imposé à tous les êtres humains.
Éros et Agapè
En effet ces derniers ont finalement inventé face au monde des pulsions, ou au monde naturel, un autre univers. Dans bien des œuvres, ces deux mondes s’affrontent.
La Femme du Boulanger, de Pagnol, d’après Giono, est une admirable allégorie de la culture s’opposant à la nature : à l’incendie de la chair, de la pulsion, de la passion (adultère), s’oppose la tendresse (conjugale), où est toute la culture : comme on le voit dans l’admirable discours du boulanger à la fin du film ; de la même façon, au berger, nomade, s’opposent les villageois, sédentaires. Les deux univers s’opposent, les enjeux vont bien au-delà du cas personnel de l’héroïne.
Que dit le boulanger à sa femme ? Qu’il y a la beauté, évidemment, et le désir des sens ; mais aussi le don, l’offrande, le sacrifice de soi : cela n’est pas négligeable. « Et la tendresse, que fais-tu de la tendresse... ? » Ce n’est pas le berger qui se serait levé la nuit pour voir si elle dormait, était bien couverte, etc. ; ce n’est pas lui non plus qui lui aurait apporté le petit déjeuner au lit, aurait pris plaisir à la regarder manger, etc. Bref, on est là dans un tout autre monde que celui des pulsions naturelles ; on est dans le monde, non des sensations, mais des sentiments ; non de la passion, mais de l’action. C’est un monde substitutif, qui n’est pas un pis-aller ou le deuil du précédent. Évidemment ce monde est le contraire de la passion, et pour cette raison il paraît n’être pas passionnant. Mais on aurait tort de le mépriser. Par lui les hommes se sont élevés au-dessus des déterminismes, ou au moins ont-ils eu l’impression de le faire.
Ainsi il y a éros, ou la pulsion naturelle, et agapè, amour de don. Les théologiens opposent ici l’amour de désir ou de convoitise, captatif (amor concupiscientiae), et l’amour d’offrande, oblatif (amor benevolentiae). Pour comprendre la différence il suffit de penser au jugement de Salomon dans la Bible : de deux femmes qui se disputent un enfant Salomon s’apprêtant à le partager en deux choisit finalement comme sa vraie mère la seconde, qui préfère que l’enfant vive et soit à une autre, plutôt que d’avoir la moitié d’un enfant mort. Voyez aussi ce que dit Atalide dans Bajazet de Racine :
J’aime assez mon amant pour renoncer à lui.
La fidélité alors prend un sens, qu’elle n’avait pas tout à l’heure. Promettre fidélité à quelqu’un n’est pas s’engager à ne désirer que lui ou qu’elle, ce qui est absurde puisque le désir ne dépend pas de nous : je peux aimer ma femme, et désirer la première fille qui passe dans la rue. Mais c’est s’engager à rendre quelqu’un heureux. La fidélité, absurde dans une perspective de causalité, prend son sens dans une perspective de finalité. Si on promet à quelqu’un de lui être fidèle, ce n’est pas qu’on ne désirera personne d’autre : on s’engage simplement à s’intéresser à quelqu’un. Qu’on ne tienne pas sa promesse est une autre question : au moins a-t-on été capable de la faire.
Le mariage monogamique, qui est une absurdité naturelle, s’éclaire alors. On épouse quelqu’un non pas parce qu’on l’aime, mais pour l’aimer. Ils s’aiment, non pour ce qu’ils sont, mais pour ce qu’ils deviendront l’un par l’autre par cet engagement. « Aimer, dit Saint-Exupéry, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans la même direction. » Ce n’est pas regarder ensemble la télévision, rituel où sombrent beaucoup de couples, et dans ce cas-là mieux vaut ne pas se marier, car c’est se mettre à deux pour résoudre des problèmes qu’on n’aurait pas si l’on était tout seul. Non, c’est se proposer un but commun, et y fixer son regard.
On voit bien cela dans la liturgie latine du mariage : Ego conjungo vos in matrimonium – Je vous unis pour le mariage. Il y a un accusatif, matrimonium, qui indique la destination, le lieu vers lequel on va, et non pas un ablatif, in matrimonio, qui n’indiquerait que le lieu où l’on se trouve. La formule française habituelle « Je vous unis en mariage » ne rend pas compte de cela. Preuve qu’il ne faudrait jamais perdre son latin...
Projet, perspective, futur, anticipation, on quitte par là le monde de la nature pour entrer dans un autre monde, celui de la culture.
Le naturalisme
Il y a une mode, assez répandue depuis le XVIIIe siècle, qui consiste à faire l’éloge de la nature. On parle de la belle nature, on fait l’éloge du naturel. Le naturalisme, ou culte de la nature, emplit les esprits et les bouches. Il nous envahit dans les slogans par exemple : « produit naturel », « soyez naturel », etc. Cependant cette position est assez courte.
En esthétique, par exemple, l’art consiste non pas à imiter la nature, mais à la réformer. Une prairie sauvage offre une profusion de fleurs, mais tout à fait désordonnée ; et parfois cette exubérance végétale nous submerge et nous inonde, par son absence manifeste de but ou d’intention, jusqu’au malaise et à la nausée. Une prairie sauvage n’est jamais une œuvre d’art. Un bouquet, au contraire, fait par art, met de l’ordre dans cette profusion. La nature ne choisit rien ; l’art est choix.
Et ce qui est vrai de l’esthétique l’est aussi de l’éthique. La nature n’interdit nullement le cannibalisme, l’inceste, la zoophilie, etc. Méfions-nous, insiste Baudelaire dans son « Éloge du maquillage »1, des idéologies, rousseauistes ou autres, du retour à la « belle nature ». Tout l’effort, éthique et esthétique, de l’humanité, s’est toujours fait contre la nature, qu’il ne s’est jamais agi d’« imiter ».
Œdipe-roi, de Sophocle, montre la tentation de l’inceste ; Pasiphaé, de Montherlant, La Vouivre, de Marcel Aymé, ou le film de Borowczyk, La Bête, celle de la zoophilie ; La Bête humaine, de Zola, celle du meurtre sauvage ; Vendredi, de Michel Tournier, celle de l’animalisation de l’homme... Figures destinales... Éclate alors, au profit de la nature, la barrière des normes et des codes : de la culture. Montrer cette destruction est souvent une des fonctions de l’art. Il montre, autant que ce vers quoi l’homme s’est élevé, d’où il est parti et ce vers quoi il peut encore revenir. Écoutons encore Phèdre :
Ô haine de Vénus, ô fatale colère !
Dans quels égarements l’amour jeta ma mère ! (I, 3)
Le futur
En général la nature ne nous invite nullement, à différer, dans le temps, la réalisation d’un désir, par réflexion d’un inconvénient qui en pourrait survenir. Ce délai que l’on se fixe alors, ou cette frustration que l’on s’impose, supposent toujours une distance prise par rapport au monde des pulsions, tout à fait étrangère aux lois du monde de la nature.
Supposons que je renonce à une promenade alors qu’il fait beau, pour rester chez moi à travailler en vue de la réussite à un examen, je me situe dans une perspective d’anticipation, et je sacrifie un bien présentement tout à fait accessible, à un autre bien, celui-là totalement hypothétique, mais préféré et escompté pour l’avenir. Ici encore, la prévision et la prévoyance donnent une finalité à ma conduite, qui échappe dès lors aux déterminismes et aux causalités – choses seulement naturelles...
Je passe, comme disent les philosophes, de l’ordre du désir, à celui de la volonté. Vouloir vraiment, disent-ils, est vouloir ce qu’on ne veut pas : c’est-à-dire, dire non à son désir.
Peut-être l’essentiel du processus de culture est-il là : la culture serait toujours une sorte de distance prise vis-à-vis des instincts. En ce sens, la culture est le sens du futur, qui la caractérise toute entière. L’élément décisif est l’anticipation. Valéry disait très bien : « Toute civilisation est perspective. » Si je dis seulement : « Demain, je ferai cela », je ne suis plus dans la sphère de la nature. Le futur, considéré même comme temps grammatical, définit toute la culture.
Le rôle du langage
Dans le cas du projet, de l’attente intériorisée du lendemain, de la promesse et de l’engagement, c’est le langage qui relaie les pulsions et les remplace. On pourrait dire que la verbalisation toute entière fonde et sous-tend la culture, par opposition à la domination des actes-réflexes. Ce n’est pas la même chose, par exemple, que de faire l’amour sans parler, et de le faire en parlant. Des représentations sont permises, qui autorisent, comme on l’a dit, non le parce que, mais le pour que : promesse, engagement. L’homme est le seul être capable de promesse. Qui ne voit qu’une déclaration d’amour nous engage bien plus qu’un geste d’amour, qui peut très bien n’être qu’instinctif ou réflexe. Dire « Je t’aime » à quelqu’un, est autre chose que lui prendre la main. La caresse même, il n’est pas sûr qu’elle soit toujours un acte (volontaire). Souvent on dit qu’on caresse quelqu’un ; mais en réalité on ne fait que se caresser à lui. Un chat ne nous caresse pas, il se caresse à nous. « Quand je me joue à ma chatte, disait Montaigne, qui sait si elle ne passe pas son temps de moi, bien plus que je ne fais d’elle ? »
Au contraire, il y a un poids ontologique des mots, qui leur confère une importance, une conséquence, que jamais n’ont les simples gestes. Brice Parain l’a bien montré, dans ses Recherches sur la nature et les fonctions du langage2. L’aveu même augmente la faute, ce qui n’est pas dit n’existe pas, ou pas autant :
Quand tu sauras mon crime, et le sort qui m’accable,
Je n’en mourrai pas moins, j’en mourrai plus coupable. (Phèdre, I, 3)
Par le langage, l’homme échappe au présent, entre dans la perspective du futur. Elle est celle de l’espoir, de l’attente ou de la représentation du désir essentiel. Au Moyen-Âge, par exemple, l’homme occidental a inventé le Purgatoire. Il l’a évoqué, raconté, désiré et espéré. La verbalisation du Purgatoire, les représentations mentales qu’elle a permises, l’ont délivré de la peur : il suffit de lire, à cet égard, le livre de Jacques Le Goff, L’Invention du Purgatoire.
Cette fonction est cathartique, ou thaumaturgique. Évoquer est faire venir, evocare. Or quelle présence est la plus haute, celle de ce qui s’étend sous nos yeux, ou celle de ce qui est évoqué ? Qu’est-ce qui attire le plus, les choses mêmes que l’on voit, ou la chose que l’on espère et attend ? Le langage n’a pas qu’une fonction utilitaire, désignative ou référentielle. Il a une fonction incantatoire, suscitante : éveiller des présences-absences.
Si je dis que la neige tombe, que la cloche sonne dans le silence du soir, je ne vois pas tomber la neige, je n’entends pas sonner la cloche. Et cependant la neige qui tombe et le son de la cloche sont bien présents en moi. C’est autre chose, un autre type de présence, sûrement bien supérieur aux présences de la perception. Heidegger insiste là-dessus, dans Acheminement vers la parole3. Tout se crée par notre attente. Les objets de langage sont et ne sont pas, et par conséquent sont bien plus que tout ce qui est. Il suffit de lire « Les pas », de Valéry :
... Ne hâte pas cet acte tendre,
Douceur d’être et de n’être pas,
Car j’ai vécu de vous attendre,
Et mon cœur n’était que vos pas.
« Douceur d’être et de n’être pas... » Présence des choses absentes... C’est exactement ici l’opposé du monde des instincts, des réponses immédiates ou réflexes, purement réactionnelles, à des stimuli extérieurs : c’est le monde de l’anticipation, de l’image mentale, des mots qu’on dit ou qu’on se dit.
Miroirs instituants
Le langage me précède de toute façon et la parole en moi est parlante qui me modèle et façonne ma vie. Je n’existe que figuré dans un discours ou un langage, quel qu’il soit (images comprises), et représenté. La norme, c’est de me reconnaître dans une représentation de moi qui me préexiste. Ainsi Paolo et Francesca, raconte Dante, ont l’idée de s’embrasser en lisant le récit d’un baiser :
Il me baisa la bouche tout tremblant…
« Sans les romans, disait Valéry, comment pourrait-on s’y prendre pour faire la cour à une femme ? » Voyez aussi l’épigraphe valéryenne concernant les mythes mise en tête de ce chapitre : « Que serions-nous, sans le secours de ce qui n’existe pas ? » En vérité, nous sommes les fils de nos propres fictions. Pour vivre, pour jouer notre rôle dans le Grand Théâtre, pour bien figurer dans notre pièce, nous avons besoin de nous rattacher à des œuvres qui nous modélisent et nous modèlent, comme par exemple les chansons. C’est visible dans bien des films : On connaît la chanson, d’Alain Resnais ; Tout le monde dit ‘I love you’, de Woody Allen ; Les Chansons d’amour, de Christophe Honoré ; Huit femmes, de François Ozon, etc.
Les choses essentielles nous sont moins naturelles qu’inscrites déjà dans les systèmes représentatifs, langages et œuvres, qui nous guident et dirigent. C’est l’idée chère à Pierre Legendre du miroir qui structure. Le miroir est une « instance tierce ». Il ne propose pas un reflet à l’identique, qui participerait d’un narcissisme mortifère, mais un modèle vital d’identification. On voile les miroirs dans les chambres des morts, et le vampire, un mort-vivant, ne se reflète dans aucun miroir. Nous n’existons que reflétés. Morts, plus de reflet. Pareillement le schizophrène ne reconnaît pas son corps. Et l’enfant aussi a besoin de se reconnaître pour devenir un être. Il n’y a aucune présence possible pour celui qui nulle part n’est représenté. Et cela, même si derrière l’instance représentante il n’y a rien, ou le vide, comme dans La Lunette d’approche de Magritte, exemple pris par Legendre dans La Fabrique de l’homme occidental4.
Le rôle transcendant du miroir représentatif de l’être se voit sur la couverture de mon livre Laquelle est la vraie ?5 L’image reflétée par le miroir est nette, et le visage lui-même, flou. On voit par là lequel des deux est le plus important. Là les choses sont bien mises au point – dans les deux sens de l’expression. L’image est nette, et notre vie, floue. Secours indispensable de ce qui n’existe pas (le reflet), et qui pourtant nous fait exister, en nous donnant une vraie figure. La vérité (ce qui mérite d’être, ce qu’on imagine) n’a rien à voir avec la réalité (ce qui est). Voyez le calligramme d’Apollinaire « Cœur, couronne et miroir » :
Dans ce miroir, je suis enclos vivant et vrai comme on imagine les anges et non comme sont les reflets.
Dominer les pulsions
On comprend alors que grâce à ces propriétés de « lieu-tenance » du langage, comme à la magie substitutive inhérente à tous les systèmes représentatifs, peuvent être rendus possibles la répression consentie et le sacrifice volontaire des pulsions – l’essentiel du processus de culture.
De cette répression nécessaire, on voit un parfait exemple dans le conte, habituellement considéré seulement comme pour enfants, des Trois petits cochons : la signification anthropologique, relativement à la Culture, en est très profonde : les deux premiers cochons, qui n’ont songé qu’à gambader et folâtrer, n’ont pas eu le temps de construire une maison solide. Résultat, le Loup les a dévorés. Comprenons qu’ils ont été submergés par leurs pulsions. Le troisième cochon, qui a pris le temps de bâtir sa maison, donc qui a su intégrer des frustrations, a bâti une maison solide, que le Loup n’a pu démolir. Comprenons qu’il s’est édifié une personnalité solide, bien structurée, non dévorable. Le troisième cochon venge ses frères, et l’enfant-lecteur, qui s’identifie avec lui, oublie aisément la mort des deux premiers. Il tire de cette histoire plus de courage et de désir d’être à l’avenir plus qu’un paquet de pulsions, qu’il n’en recueille par exemple de la fable, La Cigale et la Fourmi, dont la donnée est analogue (il faut travailler, on ne peut pas toujours s’amuser), mais le résultat bien plus tragique, et, pour lui, choquant : non seulement la fourmi refuse d’aider la cigale, mais elle la raille dans son refus.
Un autre exemple d’un être dévoré par ses propres instincts, et donc animalisé, est celui d’Actéon, tel que le rapporte Ovide dans ses Métamorphoses : ayant vu Diane se baigner nue, il fut par celle-ci changé en cerf, et dévoré par ses propres chiens.
Freud a appelé ça (es) le monde pulsionnel, et moi la personnalité qui doit se construire et se solidifier autour du surmoi, ou idéal du moi, qui sont les modèles de la culture (Jung parlerait ici de persona, ou masque social). Le ça attire l’homme vers le « principe de plaisir », qui est le principe de la nature. Comme Virgile le dit dans ses Églogues : Trahit sua quemque voluptas – Chacun est entraîné par son plaisir (II, 65). Trahere est un mot très fort, qui doit être médité : suivre son désir, est-ce être libre ?
Mais le surmoi ou idéal du moi, doit modeler le moi selon les exigences du « principe de réalité ». Le processus psychologique ici, celui-là même qui est à l’œuvre dans la construction d’une culture, est l’édification d’une personnalité solide, stable et forte, sachant s’auto-réprimer, pour acquérir force et durée. En d’autres termes, et comme dit Freud, « là où est le ça, faire advenir le moi ». C’est bien là ce qui se voit dans Les Trois petits cochons, et c’est ainsi que Bettelheim a interprété cette histoire dans sa Psychanalyse des Contes de Fées6.
Valéry, dans son essentielle préface aux Lettres persanes de Montesquieu7, dit en substance que la nature ne connaît que des faits, qu’elle ne juge pas. Et précisément, la barbarie, ou soumission absolue à la nature, pourrait se définir par l’ère du fait, et de la domination du fait. Mais ensuite, au monde des faits, la culture impose un ordre, celui (discipliné) des sacrifices consentis. Dès lors, les perspectives, anticipées et imaginaires, du futur, restreignent celles, bien tangibles pourtant, du présent.
De la même façon, les psychanalystes (Freud, Lacan, Kristeva...) opposent le « narcissisme biologique », qui renvoie l’être à ses désirs immédiats, et le « culturel symbolique », qui est fait de frustrations intégrées et consenties. Ce dernier est à la source de toutes les sublimations. Par exemple je désire m’unir à ma mère, et je prie la Vierge Marie.
Le sacrifice
Peut-être la culture est-elle toujours un Sacrifice, et peut par ce mot se définir.
Et il est bien vrai que, psychologiquement, on se construit parfois par le renoncement. « Meurs et deviens », disait Goethe. Mais déjà ce thème, essentiel pour comprendre la genèse de toute culture, est développé dans l’Évangile :
Si le grain ne meurt, il ne porte aucun fruit... (Jean, 12/24)
Quiconque veut sauver sa vie la perdra, quiconque veut la perdre la sauvera... (Matthieu, 16/25)
On pourra objecter que la frustration peut affaiblir, au lieu de fortifier. La culture toute entière a été considérée par certains comme engendrant une gigantesque névrose – point essentiel qu’il ne faut jamais oublier. Pensons par exemple à Malaise dans la civilisation, de Freud.
Cependant, il ne faut pas oublier, non plus, que le but du sacrifice ou de la frustration acceptée, peut aussi être l’inverse de celui auquel on pense habituellement : non pas la suppression des désirs, mais leur exacerbation. Je peux, comme le dit Gide dans Les Nourritures terrestres, différer la satisfaction d’un désir, non parce que sa satisfaction serait en elle-même dommageable, mais pour augmenter le plaisir de cette satisfaction, accrue elle-même par les délais de l’attente. Supposons que j’aie soif, et qu’un verre d’eau fraîche soit à portée de ma main ; si j’attends un peu pour le boire, j’en retirerai plus de plaisir... Je peux aussi, comme dit Montaigne, me faire éveiller exprès, pour jouir davantage des plaisirs du sommeil, etc. Attitude hautement raffinée : savoir attendre et s’imposer des privations, dans un but strictement hédoniste, pour mieux profiter des plaisirs. On pourrait dire de la culture ce qu’on dit de l’art : que c’est l’homme ajouté à la nature : homo additus naturae.
Faits et normes
Considérons maintenant la vie des hommes entre eux, la vie collective. Là encore, la nature ne connaît que le monde du fait : plus précisément celui du fait accompli, c’est-à-dire l’ascendant de la puissance, la loi de la force. Seul survit dans la nature le mieux adapté, au terme d’une lutte sans merci, d’une compétition ou d’un combat que Darwin a appelé « lutte pour la vie » (struggle for life). Le combat, la guerre (polemos), disait Héraclite, est le père de tout. La nature ignore la bonté, ou la compassion pour les plus faibles : telles qu’on les voit historiquement apparaître, peut-être pour la première fois dans l’histoire de notre culture, chez les Prophètes Juifs.
La nature humaine elle-même n’est pas spontanément portée vers l’altruisme et l’entraide. Il suffit d’observer à cet égard le comportement des enfants. « Cet âge est sans pitié », dit La Fontaine dans « Les Deux pigeons ». Et Hugo, dans « Le Crapaud » (La Légende des siècles) : « L’enfant rit quand il tue ». Le fait que les enfants ont ordinairement des souffre-douleurs fait justice de l’idée naïve d’une âme enfantine sans agressivité. Freud appelait l’enfant un « pervers polymorphe ». Cette méchanceté foncière, constitutive de la nature humaine elle-même, et visible dans l’âme enfantine, est peut-être ce qu’exprime le dogme chrétien du péché originel, qui par là recèle, comme disait Jung, une très profonde vérité psychologique. Il n’y a pas de bonté naturelle, ni hors de l’homme ni en l’homme : Sa Majesté des mouches, de William Golding, l’illustre parfaitement.
On peut certes tirer du spectacle de la nature l’idée d’un bon fonctionnement ou d’une intelligence : il y a au sein de la nature des équilibrages constants qui se font, biologiques, écologiques, etc. Par exemple si l’on ôte les brochets d’une rivière, la faune va aussitôt dégénérer, car le rôle du brochet était précisément d’empêcher cette dégénérescence en mangeant les poissons invalides, traînards, affaiblis, etc. Mais à l’évidence, si ce mécanisme de sélection naturelle fonctionne bien, aucune règle morale, aucune norme dans la nature n’est lisible. En fait la nature se dévore elle-même, elle est autophage. Hugo le disait :
Le monde est un spectacle où le meurtre fourmille,
Et la création se dévore en famille.
C’est sûrement cette indifférence de la nature qui a suscité, en réaction, l’effort de réforme de toutes les cultures : le désir d’ordre, de compensations, etc. La nature est-elle vraiment pitoyable aux hommes ? Certains romantiques l’ont cru, ou l’ont voulu, comme Lamartine :
Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime,
Plonge-toi dans son sein, qu’elle t’ouvre toujours...
Mais plus lucide est la vision d’une nature sans compassion, celle de Vigny dans « La Maison du Berger » :
On me dit une mère, et je suis une tombe.
Toujours le prestige et la domination acceptée du plus fort, l’adhésion et l’entraînement du maître, ont été la loi de la nature ; Vae victis !, dit la nature – Malheur aux vaincus ! :
La raison du plus fort est toujours la meilleure...
dit La Fontaine dans « Le Loup et l’Agneau ». Voici donc se dessiner le point essentiel : ni l’acceptation personnelle d’un sacrifice ou d’une frustration, ni la prise en compte, au sein d’un groupe, des droits du plus faible, n’ont une origine naturelle. Ils supposent sans doute un changement de plan, un dépassement de l’ordre immédiat des faits, jugés au nom de normes, de règles ou de valeurs, qui ne peuvent pas en être déduits. Comme dit Alain par exemple à propos de la justice : « La justice n’existe point. La justice appartient à l’ordre des choses qu’il faut faire justement parce qu’elles ne sont point. »
On voit que nature et culture s’opposent dans l’homme et dans les groupes d’hommes comme réalité et norme, être et devoir-être, instincts et idéaux, faits bruts et buts réfléchis, désirs de réalités immédiates d’une part, et de l’autre mécanismes de frustration, définis en croyances, fictions, dispositifs irréels ou perspectives inventées. Ces dernières instaurent un autre monde que celui des satisfactions instantanées : c’est proprement le monde de la culture.
Il faut y voir de plus près, explorer ce monde plus avant, à l’intérieur de chacun et de chaque groupe.
Monde réel et mondes imaginaires
Au monde réel de la nature, s’opposent les « forces fictives », c’est-à-dire les perspectives imaginaires de la culture. Comme aux tendances instinctives ou pulsionnelles ou hormiques, les valeurs réfléchies.
C’est la pulsion qui est la donnée naturelle de base. La faim, la soif, sont naturelles. Mais non la grève de la faim. Là, on change d’ordre. Quelque chose d’autre est attesté : le désir d’une liberté, d’une dignité. Un animal peut-il faire la grève de la faim ? La fable de La Fontaine, « Le Loup et le Chien », oppose le monde de la nature (manger quand on a faim), qui est celui de la satisfaction recherchée et du bonheur au sens de bien-être, et celui de l’idéal ou de l’honneur. Il n’y a culture, que lorsque les faits sont jugés au nom d’une instance qui dépasse le monde des faits.
On échange alors une satisfaction tangible, réelle et effective, contre une perspective d’un tout autre ordre, qui n’a plus rien à voir avec le réel. Cet échange est d’une terrible inégalité. Pensons, par exemple, à tout ce qu’impliquent de sacrifices pour l’immédiat, la promesse, l’engagement, le serment prêté, la signature...
Les mondes culturels sont des mondes symboliques, en ce sens totalement fictifs ou mythiques, par lesquels le monde réel se trouve jugé, dévalorisé, ou au moins ordonné et restreint. Mais, si l’on y réfléchit, la Culture est toujours la victoire du non existant sur de l’existant. Elle est un monde de l’irréel.
Échanges et signes substitutifs
« J’appelle ‘mythe’, disait Paul Valéry, ce qui n’existe qu’ayant la parole pour cause ». On a vu que c’est le langage, par le délai, et les relais, qu’il implique face à la vie, qui sous-tend toute la culture. Un subtil réseau de signes, ramifiés et étendus, s’installe, qui a vertu de substitution, ou de « lieutenance » : le mot, le nom, le geste, tiennent lieu de la chose. Une culture sans signes substitutifs n’est pas pensable.
Une comparaison fera comprendre cela, tirée du monde de l’économie : j’échange un bien réel et effectif, contre un simple morceau de papier, un billet de banque : quelle inégalité, quelle disproportion objective, et donc, en un sens, quelle folie ! Cet acte, en apparence si simple, suppose une confiance maximale, et quasi-magique, en la vertu de remplacement du papier-monnaie. Si le symbolique de l’opération n’est plus vu, perçu, ou cru, tout s’écroule : par rapport à l’usage du papier-monnaie, le simple troc des biens est évidemment bien plus naturel, ou raisonnable...
Et la monnaie même se déréalise de plus en plus. Les pièces trébuchantes qui enchantaient l’avare de naguère, comme Harpagon ou Grandet, sont remplacées par des chiffres : chèque bancaire, carte bleue. Picsou ne se vautre plus sur un tas d’or, Danaé est séduite par un chiffre sur un chèque. La pluie d’or n’est plus sentie ou sensible. Les écrans d’ordinateur achèvent la déréalisation. Pleinement, ils font écran entre eux et notre vie...
L’ensemble des constructions culturelles est à l’image de cet exemple : il ne tient que par enchantement et par magie... Il ne subsiste que par la confiance qu’on lui accorde, et que lui confèrent l’habitude, et la transmission par l’éducation : respect « fiduciaire », confiance, ou fiducia, à partir de laquelle Valéry pensait tous les problèmes politiques et sociaux. Je respecte le juge, le prêtre, les pouvoirs établis, les signes qui les représentent, de façon autant absolue qu’irraisonnée.
Force de l’habitude : l’intégration mentale
Lors du dressage des animaux humains, la force de ces perspectives imaginaires, substance des cultures, n’est jamais mise en question : les parents, les éducateurs, tout l’appareil des institutions, contribuent à leur intégration dans l’esprit, ne serait-ce que parce que leur fonction, leur rôle ou leur existence même, s’en nourrit.
Soit par exemple une interdiction. La désobéissance à cette interdiction engendre un châtiment. Mais, chose remarquable, le soupçon et la peur seuls de ce châtiment, suffisent le plus souvent à faire respecter l’interdiction. La vue de l’uniforme ou du képi du gendarme inspire la prudence. Mieux, sans qu’il soit besoin de percevoir les signes effectifs de l’autorité, une représentation mentale, purement intérieure, retient le bras du malfaiteur. La pensée de la norme empêche le fait. Vinci disait de la peinture qu’elle était chose mentale (cosa mentale). On pourrait en dire autant de la culture. Elle disparaît quand on en vient ou revient au : Pas vu, pas pris. Car on ne peut pas mettre des caméras de surveillance partout.
Le langage, qui permet ce recul, parce qu’il est fait de représentations, non de réalités, a dès l’origine été considéré comme civilisateur. Ainsi selon Boileau, dès le début de l’histoire, le Logos, le mot ou la raison, arrachant l’homme aux actions-réflexes, et bornant les pulsions,
De l’aspect du supplice effraya l’insolence... (Art poétique, IV, 143)
Il est indispensable, disait Valéry, qu’un homme se sente sur le point d’être pendu s’il s’imagine mériter de l’être. Et ainsi, suivant un tyran de l’ancienne Athènes, les dieux ont été inventés pour punir les crimes secrets. Cette façon de voir les choses est peut-être cynique, mais elle n’est pas sans profondeur. Là est l’utilité sociale des représentations culturelles : la foule est effrayante si elle ne craint pas (terret vulgus, nisi metuat). Le pragmatisme, s’il en était besoin, suffirait ici à justifier toute la culture.
On peut désormais tenir pour acquis le point suivant : la culture est faite d’images et de mots, de représentations et de constructions symboliques, efficaces dans l’esprit, qui se substituent aux choses concrètes ou réelles, aux faits. Et la première vérité de la culture est son utilité.
« Révolution copernicienne »
Que le respect de l’Autorité et du Pouvoir soit, non pas le résultat d’une expérience ou la constatation d’un fait, mais une chose totalement mentale (ou, comme dirait Jung, une affaire de projection), c’est ce qu’on voit parfaitement dans toute l’œuvre de Kafka. La Lettre au Père nous montre qu’il y a dans l’âme de l’enfant une grande image, ou un archétype, d’un être à admirer et à respecter, incarnation et légitimation de la Loi : cet être n’est pas au départ objet d’expérience véritable, mais est l’objet d’une attente, est le fruit d’une disposition constitutive de la psyché. Par la suite, il y a confrontation entre la réalité du père, et cette image a priori : le père réel ne sort pas grandi de cette confrontation...
Nous commençons notre vie par un regard en contre-plongée ou hyperbolique. Choses et êtres nous paraissent plus grands qu’ils ne sont en réalité. En fait, c’est nous qui sommes petits, situés au-dessous d’eux. Nous les admirons. Nous nous retournons sur leur passage, les respectons : respicere dit cela, en latin. Puis nous grandissons, et dominons les choses, qui désormais nous paraissent rapetissées. Alors nous pouvons regarder d’en-haut, et de haut, c’est-à-dire les mépriser : despicere. Le regard est en plongée, c’est-à-dire dépréciatif. Telle est l’image du Père, d’abord admiré (« Mon père, ce héros... »), puis méprisé (« Mon père, ce zéro... » selon le mot plaisant de Georges Fourest). Grandir, c’est voir son père petit. C’est ce que dit Créon à son fils Hémon dans Antigone d’Anouilh.
Les cultures ordinairement commencent par le regard hyperbolique, qui en littérature est celui de l’épopée, où tout est grandi. Puis elles finissent par le regard dépréciatif ou désillusionné, qui est celui du roman, forme du désenchantement ou de la « virilité mûrie », selon le mot de Lukacs dans sa Théorie du roman. Le passage de l’un à l’autre de ces deux genres littéraires reproduit le cheminement psychologique que chacun fait sans sa propre vie.
Le Château de Kafka montre la même chose : les fonctionnaires n’y sont grands et n’y ont de prestige qu’à proportion que K. le leur donne, et les redoute. S’il vient à se rebeller et à avancer, alors ils reculent. On dit aujourd’hui que le respect se perd : c’est peut-être la clairvoyance qui augmente...
On voit par ces deux exemples de Kafka que l’Autorité est totalement une création de notre esprit. Et cette autorité est d’autant plus puissante que, précisément, nous ignorons qu’elle provient de notre esprit... Une « révolution copernicienne », analogue à celle que Kant a opérée pour la connaissance, nous éclairerait ici sur les vraies conditions de nos soumissions...
Avant Copernic, on pensait que la terre était immobile, et que le soleil tournait autour d’elle. Depuis Copernic, on sait que c’est l’inverse. De même, avant Kant, on pensait que les choses existaient hors de l’esprit humain, et que celui-ci ne faisait que les refléter, ou les recueillir. La vérité était conçue comme modelage de l’esprit sur les choses, correspondance des choses et de l’esprit : adaequatio rei et intellectus. Mais depuis Kant, on sait que le monde est constitué et construit par l’esprit lui-même, en fonction de ses propres structures ; il n’y a pas de fait brut, les faits sont faits : par l’esprit. La connaissance fabrique son objet. Ce qui est vrai pour la théorie de la connaissance, la gnoséologie, selon la doctrine kantienne, l’est aussi s’agissant des représentations symboliques de la culture : d’où vient l’autorité de ces dernières ? Toute la structure sociale est basée sur la croyance et la confiance. Et cette croyance ou confiance sont d’autant plus puissantes et contraignantes que nous ignorons qu’elles viennent de notre esprit, de sa structure même. La moindre réflexion nous le montre : les représentations symboliques, les constructions culturelles, n’ont de pouvoir sur nous qu’à proportion que nous le leur donnons.
L’image de l’Autorité
On a cité Kafka. Mais la fiction n’est pas la seule à montrer l’origine entièrement psychologique de l’autorité. Il suffit de voir les expériences faites par le professeur américain Stanley Milgram sur la soumission, dans son livre Soumission à l’autorité8. Elles montrent qu’il suffit qu’un être soit investi d’un pouvoir institutionnel, voire doté d’une simple apparence particulière, pour être obéi : un scientifique, ou quelqu’un qui serait simplement revêtu d’une blouse blanche, peut faire faire à n’importe qui des monstruosités, sous caution d’expériences, et le faire se comporter en bourreau. Henri Verneuil a tiré parti de cet exemple non fictif dans son film I comme Icare.
Le film de Francis Veber, Le Jouet, montre qu’entre celui qui exige une obéissance dégradante, et celui qui l’accepte, le plus méprisable n’est peut-être pas le premier. Caligula, de Camus, fait voir de la façon la plus provocante qu’on peut exiger l’obéissance pour savoir jusqu’où l’homme va s’abaisser, et jusqu’à quel point on peut le mépriser. Pareillement fait le film de Bertrand Tavernier, Coup de torchon. « Obéissez », disait Frédéric le Grand à ses sujets. Mais en mourant : « Je suis las de régner sur des esclaves ». Cette parole, que Camus rapporte dans L’Homme révolté, rejette les masques ; elle signifie que l’obéissance au maître n’est pas perception objective de ce qu’il est, mais projection subjective sur lui. Le maître est objet de fantasme, d’imagination ; il n’est que l’alibi de la soumission.
On voit quel degré d’intégration mentale et de complicité intérieure suppose la soumission à l’autorité. La Boétie, dans son Discours de la servitude volontaire9, souligne qu’il est absurde qu’un peuple entier se soumette à obéir à un tyran, objectivement le plus faible et le plus avili de tous. Des tyrans il dit : « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Et La Fontaine fait dire au « Paysan du Danube » exploité par les Romains :
Rome est par nos forfaits, plus que par ses exploits,
L’instrument de notre supplice.
Il est évident que la Culture toute entière apparaît aujourd’hui, en une époque mûrie ou lucide, comme un immense édifice de conditionnements, non seulement par l’imposition de conduites extérieures, mais de pensées, de représentations totalement intériorisées. Une conduite imposée est la politesse, par exemple : la main qui tient la tasse de thé ne peut plus gifler l’interlocuteur. Et une pensée imposée est la peur, de Dieu d’abord, du gendarme ensuite : on redoute d’abord le Jugement dernier, puis le jugement tout court. Au début, il y a un dressage. Puis, chose remarquable, l’habitude, prise et acquise, de penser et de se comporter de telle ou telle façon, finit par faire paraître naturels ces pensées et comportements. L’habitude, disait Pascal, est une seconde nature. Il n’y a rien qu’elle ne rende naturel, il n’y a naturel qu’elle ne fasse perdre.
Elle mène à respecter des signes, des apparences, un décorum, un costume : le pouvoir du juge réside dans sa robe, du militaire dans son uniforme, etc. Un président de la République en pyjama perd son aura : je pense à la mésaventure du malheureux Paul Deschanel, tombé nuitamment du train présidentiel, et recueilli par un garde-barrière. Était-il encore président ? Si grand est l’emprise aliénante de cette « force de la grimace », de cette imagination dont Pascal dit qu’elle est une « puissance trompeuse » !
Il dit aussi à cet égard, de façon tout à fait cynique et ironique : « Il ne faut pas que le peuple sente la vérité de l’usurpation : elle a été autrefois introduite sans raison, elle est devenue raisonnable ; il faut la faire regarder comme authentique, éternelle, et en cacher le commencement si on ne veut pas qu’elle prenne bientôt fin. » Cette phrase sert d’épigraphe à L’Horreur économique de Vivianne Forrester. Quand il faut qu’il y ait de plus en plus de chômeurs pour que la Bourse monte, faut-il encore donner confiance à ce système ? Pareillement Brecht, dans sa Vie de Galilée, écrit : « On épuise la confiance à trop exiger d’elle. » La réflexion ici est évidemment déconstructrice.
Le pouvoir des peurs
L’habitude induit des comportements masochistes, basés sur le conditionnement, la peur, la projection. Nous chérissons notre esclavage, baisons la main qui nous frappe. Baudelaire le dit dans « Le Voyage » :
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant...
Par exemple, il peut y avoir une soumission ordinaire à l’autorité en milieu scolaire. Stella Baruk, dans L’Âge du capitaine, dit qu’on peut poser des problèmes de mathématiques absurdes à un élève (« Étant donné telles caractéristiques sur par exemple la taille ou la vitesse du bateau, etc., quel est l’âge du capitaine ?) sans qu’il sourcille : il cherchera la solution, sans réfléchir. Pourtant le but de l’école n’est pas a priori de flatter le conformisme, mais d’éveiller d’esprit critique.
Le professeur Kitting, dans le film de Peter Veir Le Cercle des poètes disparus, fait monter ses élèves sur les tables pour leur apprendre le perspectivisme des visions, le danger d’un regard seulement admiratif ou soumis, et qu’il faut s’émanciper des conditionnements. (Aujourd’hui d’ailleurs dans certains collèges il n’y a pas besoin de faire monter les élèves sur les tables : ils le font tout seuls, mais non pas dans l’intention de manifester leur esprit critique !) – De toute façon la fin de ce film est tragique, et tout à fait vraisemblable : le professeur est congédié. Comme dit Guy Béart : « Le premier qui dit la vérité / Il doit être exécuté... »
Très souvent donc ce sont nos peurs qui font l’Autorité. Voyez comment le médecin Knock, dans la pièce de Jules Romains, se soumet tout un canton simplement en instrumentalisant les peurs de ses habitants. Il les persuade que tout être bien-portant est un malade qui s’ignore, il exploite leur hypocondrie naturelle pour régner sur eux sans partage.
Ou bien voyez encore le poème de Prévert dans Spectacle :
Sardines protégées par une boîte. Boîte protégée par une vitre. Vitre protégée par les flics. Flics protégées par la peur. Que de protections pour de simples sardines !
La vie est un combat constant entre les projections et les perceptions. – Voyez aussi sur cette question le chapitre « Projections » de mon ouvrage Sur les chemins de la sagesse10.
Façons et coutumes : leur origine
À l’évidence, la déconstruction de tous ces dispositifs projectionnels ne doit pas être systématique, et il y a une intelligence du respect, sous peine, ayant tout déconstruit, de se trouver à l’arrivée devant un champ de ruines. Simplement, il faut réfléchir aux véritables conditions de nos adhésions : elles viennent de nous certes, mais si nous les accordons que ce soit non pas aveuglément, mais en toute conscience, eu égard par exemple à leur utilité psychologique ou sociale. Rien de pire que le conformisme. Mais aussi rien de mieux que l’enquête. Allons donc à la recherche de nous-mêmes, pour savoir pourquoi nous agissons comme nous le faisons.
Si l’on nous demandait pourquoi nous levons notre chapeau pour saluer quelqu’un, nous serions bien en peine de répondre. Nous avons même l’impression qu’il en a toujours été ainsi. L’origine de cette coutume s’est perdue pour nous. Elle nous semble normale, naturelle, universelle. Nous ne faisons pas réflexion qu’elle était ignorée par exemple des Anciens Grecs et Romains, et qu’elle est ignorée aujourd’hui par bien d’autres que nous. Elle remonte à l’époque médiévale : se découvrir alors, ôter son casque, pour le guerrier, était se mettre à la merci de l’autre. C’était un signe d’allégeance et de confiance maximale, comme de tendre à quelqu’un sa main droite, en principe la plus forte des deux.
De même, s’effacer devant une femme pour lui permettre de pénétrer avant nous dans une pièce, se lever pour lui céder la place dans les transports publics, etc., sont des attitudes de galanterie qui remontent à la civilisation courtoise. L’homme occidental a alors senti le besoin de compenser l’infériorité physique féminine par des égards particuliers. Des civilisations entières ont ignoré ce type de conduite. D’autres l’ignorent encore aujourd’hui. Que si ces usages actuellement venaient à disparaître, sous prétexte qu’ils sont hypocrites, ou conduisent à une discrimination entre les hommes et les femmes, il n’est pas sûr que ces dernières aient beaucoup à y gagner. Veut-on en revenir à l’homme des cavernes, tenant d’une main sa femme par les cheveux, et de l’autre sa massue ?
Beaucoup de coutumes chez nous viennent du Moyen Âge. Par exemple le fait de choquer les verres, pour boire en commun. On avait peur à cette époque d’être empoisonné, et cet usage mêlant le liquide d’un verre dans l’autre permettait la confiance mutuelle. Pareillement l’usage est encore quand on dresse la table de disposer le couteau avec le côté tranchant de la lame tourné vers soi, en signe de non-agression vis-à-vis de son voisin.
Le christianisme aussi modèle nos usages. Croiser les doigts, toucher du bois renvoie à la Croix, à son bois et au supplice salvateur du Christ. Pareillement la superstition consistant à ne pas vouloir être treize à table se souvient du Dernier repas pris par le Christ avec ses douze disciples, dont un, suivant la version courante, le trahit. Même le fait de ne pas vouloir passer sous une échelle a une signification religieuse. Le faire, ce serait briser le triangle formé par la paroi, le sol, et l’échelle, qui est une image de la Trinité.
L’arbre de Noël, les œufs de Pâques, qui connaît encore leur signification aujourd’hui ? Au début de l’hiver, au moment tragique du solstice, où les nuits sont les plus longues, et dans l’incertitude angoissée de voir les beaux jours revenir, on célèbre magiquement le retour du printemps, et la fête du soleil invaincu (sol invictus), par l’installation dans la maison d’un arbre vert. L’homme se délivre alors d’une vieille terreur (et si le soleil ne revenait pas ?). Il n’est point indifférent que le symbole soit un arbre. En outre, il a une généralité, un pouvoir d’universalité ou d’abstraction, que n’a pas, par exemple, la crèche, bien événementielle ou anecdotique en regard de lui. Cet usage de l’arbre vient des pays protestants ou réformés, où il était dirigé contre l’idolâtrie de la crèche (mais c’est aussi la survivance d’une vieille pratique païenne ou agreste). Voilà ce qu’on pourrait appeler les arrière-plans, ou tout l’implicite du sapin de Noël, qu’il est intéressant de connaître ou de redécouvrir, pour enrichir par l’intelligence l’observation de cette coutume, et pour la justifier.
De la même façon, l’usage d’offrir des œufs, coloriés ou non, le jour de Pâques, vient du fait qu’on a considéré l’éclosion de l’œuf comme un symbole de la résurrection du Christ.