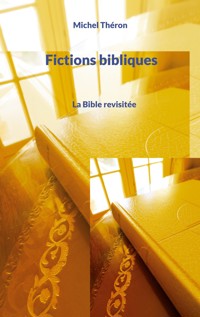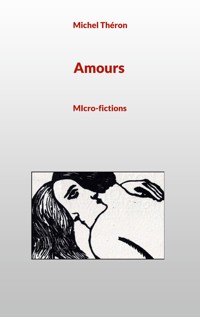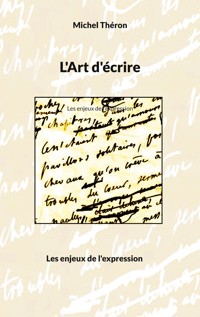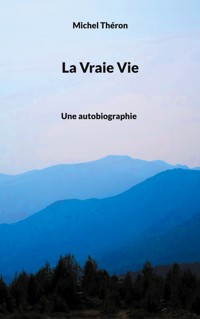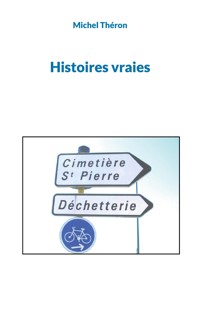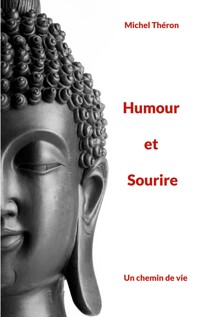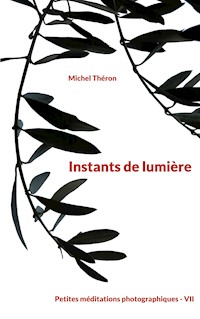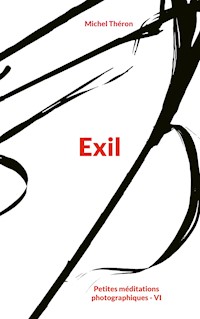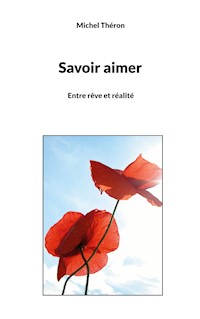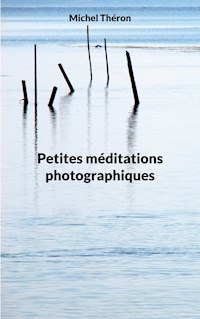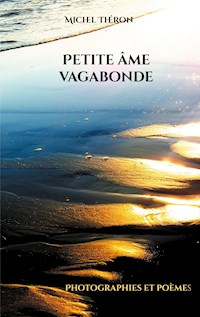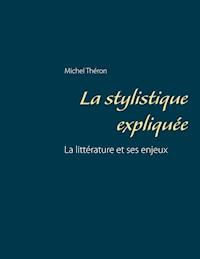
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Les multiples figures et procédés de style qu'on peut rencontrer dans l'étude d'un texte sont exposés dans cet ouvrage, dans une perspective interdisciplinaire. Des rapprochements sont faits avec les arts du visible (photographie, peinture), dont les procédés présentent des analogies avec ceux du texte. Les enjeux culturels impliqués par le style sont constamment et systématiquement évoqués. D'abord manuel d'étude stylistique, destiné aux professeurs et étudiants littéraires, ce livre n'est pas un ouvrage de linguistique mais un livre d'esthétique générale et comparée, qui à ce titre pourra intéresser tous les curieux du monde de l'expression.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« La Littérature est, et ne peut être autre chose qu’une sorte d’extension et d’application de certaines propriétés du Langage. »
(Paul Valéry, « De l’enseignement de la poétique au Collège de France », 1937)
Avant-propos
Ce livre est une recension et une description des différents procédés de style qu’on peut relever dans les textes littéraires, mais qui sont aussi présents dans le langage courant, ainsi qu’une réflexion sur leurs enjeux.
Ils sont classés selon trois catégories : ceux qui relèvent des matériaux mêmes du langage, ou du vocabulaire (questions 1 à 68) ; ceux qui relèvent de l’agencement de ces matériaux, de l’organisation, ou de la syntaxe (questions 69 à 88) ; et ceux qui relèvent de la perspective, ou du point de vue sous lequel l’esprit considère le contenu de l’expression et le langage qu’il emploie (questions 89 à 99).
Par exemple, selon le plan adopté, une métaphore relève du vocabulaire ; un zeugme, de la syntaxe ; une antiphrase ou une mise en abîme, de la perspective. Cette répartition, qui va du plus simple au plus complexe, est utile pédagogiquement pour la présentation des procédés de style, même si, évidemment, toutes les figures et tous les procédés sont mêlés dans un même texte, et si aussi plusieurs figures peuvent se fondre entre elles, par concaténation (voir question 25).
On peut donc, bien sûr, feuilleter le livre au hasard et le consulter ponctuellement. Mais il faut savoir qu’il y a un plan et une progression déterminés dans le classement des figures.
Comme ces dernières ne me semblent pas être des ornements du discours logique, mais véritablement des catégories vivantes de la perception (voir question 26), j’ai fait des rapprochements entre elles et le monde de la représentation visuelle (photographie, peinture), qui les fait bien voir et sentir.
Dans cette perspective, le présent ouvrage n’est pas une simple description formelle des procédés et figures. Il s’occupe d’en analyser chaque fois l’esprit, les implications et les enjeux, esthétiques mais aussi souvent philosophiques et civilisationnels, culturels au sens large. Il se situe donc dans une dimension délibérément interdisciplinaire. Ce n’est pas une morphologie, mais une anthropologie du style.
Les références aux livres dont je me suis inspiré figurent dans le texte entre crochets : [ ]. Cet indice permet à chacun de se faire une petite bibliographie de la question traitée.
Pour une consultation plus sélective de ce livre, on pourra, pour voir la liste des questions elles-mêmes, se reporter au sommaire, ou bien, pour voir les notions traitées, s’aider de l’index général des thèmes et procédés étudiés, tout cela au début de l’ouvrage.
Remarque : La première version de ce livre est parue en 1993 aux éditions du CNDP/CRDP de Montpellier, sous le titre : 99 réponses sur les procédés de style. Elle est aujourd’hui épuisée. Par rapport à cette édition, le texte de ce livre a été considérablement remanié et enrichi.
Sommaire
1/ MATÉRIAUX
1.
Y a-t-il un lien entre le signe verbal et la chose qu’il désigne ?
2.
Quels sont les procédés musicaux permettant de conjurer l’arbitraire du signe verbal, et de réchauffer le langage ?
3.
La musique des mots dans un texte peut-elle être le tout du texte ?
4.
Quels sont les procédés visuels permettant de lutter contre l’arbitraire du signe verbal ?
5.
Quels sont les procédés permettant d’augmenter la caractérisation lexicale d’un texte ?
6.
Nommer et caractériser sont-ils toujours faciles à distinguer ?
7.
Que gagne-t-on à caractériser un objet ?
8.
La caractérisation est-elle toujours un avantage ?
9.
Quel est l’inconvénient ordinaire de la caractérisation ?
10.
Quelle figure de style traditionnelle incarne le pôle de la caractérisation ?
11.
Quelle est l’énigme artistique majeure de la caractérisation ?
12.
Quel est le paradoxe essentiel de la caractérisation littéraire ?
13.
Quel est le destin historique de la caractérisation en littérature ?
14.
La caractérisation dans le texte est-elle plus fournie que dans l’image ?
15.
Qu’est-ce qu’une caractérisation fictive ?
16.
Qu’est-ce que la caractérisation intellectuelle dans un texte, par rapport à la caractérisation lexicale ?
17.
Qu’est-ce qu’une caractérisation négative ?
18.
La caractérisation intellectuelle est-elle réaliste ?
19.
Qu’est-ce que la présentation comportementaliste, ou behaviouriste, dans le récit ?
20.
Y a-t-il un lien entre la caractérisation et l’empire de la rhétorique ?
21.
Quel est l’équivalent dans les arts plastiques du refus de la caractérisation dans le texte, et quel en est le danger ?
22.
Quels sont les dangers du refus de l’analyse, dans le texte ?
23.
L’homogénéité des tons est-elle une règle dans le texte ?
24.
L’expression s’oppose-t-elle, pour l’essentiel, au langage parlé ?
25.
Comment peut-on classer les figures de style, dans le texte, et ce classement est-il utile ?
26.
Les figures sont-elles un ornement du discours logique ?
27.
Le nom des figures de style est-il rigoureux ?
28.
Quels sont les deux choix principaux du style, en matière de vocabulaire ?
29.
Le brouillage des signes dans le texte est-il toujours réel ?
30.
Quelle est la figure principale du brouillage des signes lexicaux ?
31.
Qu’est-ce qu’une périphrase ?
32.
Quel est un des buts courants de la périphrase ?
33.
Quels sont les enjeux culturels de la périphrase ?
34.
Que signifie anthropologiquement la périphrase ?
35.
Que risque-t-il de se passer, quand la complexité des filtres et des signes brouillés disparaît du langage ?
36.
Qu’est-ce que la figure appelée
abstraction
, dans le texte ?
37.
Qu’est-ce qu’une synecdoque ?
38.
Que traduit la synecdoque dans le texte ?
39.
La synecdoque augmente-t-elle la caractérisation ?
40.
Qu’est-ce qu’une métonymie ?
41.
Qu’est-ce qu’une métalepse ?
42.
Qu’est-ce qu’une métaphore ?
43.
Comment peut-on classer les métaphores ?
44.
Comment le partage du sens est-il assuré dans la métaphore ?
45.
Qu’est-ce qu’une métaphore visuelle ?
46.
Toutes les métaphores du texte sont-elles visualisables ?
47.
Qu’est-ce qu’une allégorie ?
48.
Le sens d’une figure ou d’un procédé stylistique est-il toujours sûr ?
49.
Comment voit-on aujourd’hui la métaphore et l’allégorie ?
50.
Que perd-on, et que gagne-t-on, à métaphoriser ou allégoriser les textes ?
51.
Qu’est-ce qu’une hypallage grammaticale ?
52.
Que sont, en poésie, les synesthésies et les correspondances ?
53.
Que manifeste l’hypallage, d’un point de vue anthropologique ?
54.
Qu’est-ce qu’une hypallage perceptive ?
55.
Comment peut-on réaliser des hypallages visuelles ?
56.
Qu’est-ce qu’un oxymore ?
57.
Que signifie l’oxymore, philosophiquement ?
58.
Que peut traduire l’oxymore, dans le texte ?
59.
L’oxymore est-il visualisable ?
60.
Quelle est la pathologie ordinaire affectant les matériaux du langage ?
61.
Quel est le destin ordinaire de la périphrase et de l’expression détournée ?
62.
Quel est le rythme périodique général et alternant, en littérature ?
63.
En quoi la rhétorique peut-elle devenir ridicule ?
64.
En quoi la rhétorique peut-elle devenir dangereuse, ou inadmissible ?
65.
À quel type d’expression mènerait le refus total de la rhétorique et du besoin humain de sens ?
66.
Quelle figure de rhétorique pourrait incarner, contre la tautologie, le besoin humain de sens ?
67.
Comment l’expression, en période même de rhétorique, peut-elle se prémunir contre la possibilité de ses propres excès ?
68.
Qu’est-ce qu’une figure étymologique ?
2/ ORGANISATION
69.
Quels sont les deux grands types d’organisation syntaxique dans le texte ?
70.
Qu’est-ce qu’une ellipse dans le discours ?
71.
Quels sont les avantages de la parataxe ?
72.
Qu’est-ce qu’une anacoluthe ?
73.
Quelles sont les deux orientations fondamentales du style, relativement à l’organisation ?
74.
Quels sont les risques bien visibles aujourd’hui de la parataxe pour l’esprit ?
75.
Quels sont les enjeux de la ponctuation ?
76.
Quel est le paradoxe essentiel de la symétrie ?
77.
Qu’est-ce qu’une prolepse ?
78.
Quels sont les deux types de syllepse ?
79.
Qu’est-ce qu’une hyperbate ?
80.
Qu’est-ce qu’un hendiadyin ?
81.
Quels sont les deux types de zeugme ?
82.
Quelle est la signification poétique et philosophique du zeugme ?
83.
Qu’est-ce qu’une synchyse, et quel en est le risque ?
84.
Quel pourrait être un équivalent visuel de la synchyse verbale ?
85.
Qu’est-ce qu’une anastrophe, et quel effet produit cette figure ?
86.
Qu’est-ce que la concordance des temps ?
87.
Que peut traduire le mélange systématique des pronoms dans le texte ?
88.
Quelle figure rhétorique traditionnelle pourrait résumer la confusion de l’organisation, généralisée à l’époque moderne ?
3/ PERSPECTIVE
89.
Qu’est-ce qu’une hyperbole ?
90.
Qu’est-ce qu’une litote ?
91.
Qu’est-ce qu’une prétérition ?
92.
Qu’est-ce qu’une antiphrase ?
93.
Peut-on réaliser des antiphrases visuelles ?
94.
En quoi l’antiphrase, figure stylistique, permet-elle de comprendre un aspect fondamental du discours littéraire ?
95.
Comment le texte narratif répartit-il sa matière ?
96.
Qu’est-ce que le point de vue porté sur le langage ?
97.
Qu’est-ce qu’une mise en abîme ?
98.
Que perd-on et que gagne-t-on à déconstruire la représentation ?
99.
Que signifie l’intertextualité ?
Index général
Les chiffres renvoient aux numéros des questions
A
Abstraction, en art →, →, →, →, →
Abstraction, figure du texte →, →
Acronyme →
Acrostiche →
Actualisation du sens →
Adynaton →, →, →
Allégorie →
Allégorisation des textes →, →-→, →
Alliance de mots →
Allusion →, →-→
Amnésie et hypermnésie en art →
Amphibologie →
Anacoluthe →, →, →
Anagramme →
Anaphore →
Anastrophe →, →, →, →
Animisme →, →, →
Antanaclase →, →
Antilogie →
Antiphrase →-→, →, →-→
Antiphrase plastique ou visuelle →
Antithèse →-→
Antonomase →, →, →
Aphérèse →
Apocope →
Apologue →
Apophatisme →
Aposiopèse →
Archaïsme →, →
Asyndète →, →
Aura de l’œuvre →, →, →, →
Autoréférentialité du langage →, →
Autonomie de l’art et de l’expression →, →
B
Barbarisme →
Baroque →
Besoin de sens →-→, →
Biographie et style →
Brouillage chronologique →
Brouillage lexical →-→, →, →, →-→, →
Brouillage pronominal →
Brouillage syntaxique →, →
Burlesque →
C
Calligramme →
Caractérisation →-→, →, →
Caractérisation fictive →
Caractérisation humoristique →
Caractérisation négative →, →
Caractérisation intellectuelle (par analyse) →
Caractérisation par qualification →
Cartésianisme →
Casuistes →
Catachrèse →, →, →
Chassé-croisé →
Chiasme →
Citation →
Classement général des figures →
Classicisme →, →
Cliché →, →, →, →
Comparaison →
Comportementalisme →
Concaténation des figures →, →, →, →, →, →
Conceptuel (art -) →
Concordance des temps →
Conscience de l’écriture →-→, →-→
Consonance ou dissonance (du texte avec l’idéologie sociale) →-→, →
Construction concrète →
Contrepèterie →
Correspondance →
Cryptographie →
Cubisme →, →, →-→
Culture générale, indispensable pour comprendre l’expression →
Cyniques →
D
Déconstruction artistique →, →-→
Déconstruction des cultures →-→
Déconstruction narrative →
Déconstruction philosophique →
Déconstruction psychique →
Déculturation →, →, →
Degrés du langage →, →-→
Démonique →
Dénégation →
Dénudation →-→
Diaphore →
Didactisme du langage →, →
Discours intenable →, →, →
Dislocation syntaxique →, →
Dissonance ou consonance (du texte avec l’idéologie sociale) →-→, →
Distance, dans la vision →, →, →, →
Distance, distanciation, dans le texte →, →-→
E
Écriture, différente de style →
Einfühlung →, →-→, →, →, →, →
Ellipse →-→, →-→
Emphase →, →
Énallage →, →
Énallage de temps, de pronom, de nom →
Énallage perceptive →
Épopée et roman →
Étymologisation des mots →
Euphémie, euphémisme →, →, →-→
Extension de sens, par synecdoque-métonymie, ou par métaphore →
Extension et compréhension, en logique du concept →
F
Fable →
Fait de langue et fait de style →, →, →
Faute →, →, →, →
Fiducia littéraire →
Figure à double fonction, sémantique et musicale →, →
Figure, catégorie de la perception →, →, →, →-→, →, →, →, →
Figure créée par le lecteur →-→, →, →
Figure culturelle →-→
Figure de contenu sensible, et - de contenu intellectuel →, →-→, →
Figure étymologique →
Figure sclérosée, substitution intellectuelle à la réalité sentie →
Focalisation →, →
Focalisation, modes de la - →
Folie →-→, →, →, →
Forme non représentative, et - représentative, de tous les arts →-→
G
Glossolalie →
Grammaire normative →
Guidage des métaphores →-→
H
Haïku →-→, →
Harmonie imitative →-→
Hendiadyin →, →, →
Héroï-comique (style) →
Hésitation feinte →
Homonymie →
Holisme (et symbiose) →
Humour →
Humour noir →
Hypallage →, →-→
Hypallage de perception →, →
Hypallage de qualification →
Hyperbate →, →, →
Hyperbole →-→, →, →
Hyperréalisme →, →, →, →
Hyponymes et hyperonymes →, →
Hypotaxe et parataxe →, →, →-→, →
Hypotypose →
I
Idolâtrie et iconoclasme →
Illusion référentielle →, →-→, →, →, →-→
Impressionnisme →, →-→, →, →
In praesentia et in absentia, modalités de la métaphore →-→
Intériorisation du sens →, →, →
Intertextualité →, →
Introversion et extraversion →
Ironie →, →, →-→
J
Jeu de mots →, →, →
K
Kitsch →, →, →, →, →-→, →, →, →
Kitsch aigre, et - doux →
Kitsch, déconstruction du - →-→
Kitsch et camp →
Koan →, →, →
L
Langage expressif, et - idiomatique →, →, →
Legato et staccato →
Lettrisme →
Lexicalisation →, →, →
Lexicométrie informatisée →, →-→
Linéaire et pictural, en peinture →
Litote →, →-→
Littéralisme →, →, →
Littérarité →
Logolâtrie et misologie →
M
Maniérisme →, →
Métalepse →
Métalinguistique (fonction – du langage) →, →, →
Métaphore →, →, →, →, →, →-→, →-→
Métaphore conventionnelle →, →
Métaphore disproportionnée →
Métaphore filée →
Métaphorisation des textes →-→, →, →
Métonymie →, →, →, →-→, →
Midrash →
Mise en abyme →, →-→
Montage cinématographique →
Musique du texte →, →
Mythe →
N
Naturalisme →, →
Nature et culture →-→
Néologisme →
Niveau de langue →
Nom propre et nom commun →
Nom variable des figures →, →
Nominalisme →
Non-dualité →-→
O
Œuvre en gestation →
Onomatopée →-→
Oxymore →-→, →
P
Pacte narratif →
Palimpseste →
Palindrome →
Parabole →
Parataxe classique, et - moderne →, →
Parataxe et hypotaxe →, →, →-→, →
Paronomase →-→
Paronymie →
Pastiche, et style →
Patronyme →
Perception et ellipse →
Perception et projection, en psychologie →, →
Perception, pathologie de la - →, →
Pérégrinisme →
Période →
Périphrase →-→, →
Périphrase conventionnelle →
Périphrase humoristique →
Perspective de l’énonciation →, →, →, →
Perspective mentale →, →, →, →-→, →
Perspective visuelle →, →, →, →
Perspectivisme du sens →, →
Phébus →
Phénoménisme →
Phrase nominale →
Phraséologie →
Pittoresque →
Pléonasme →
Point de vue, dans le texte →, →, →
Point de vue porté sur le langage →-→
Polytonalité de l’œuvre →
Ponctuation →, →, →
Pop art →, →
Précarité du sens →-→
Préciosité →, →, →, →, →
Prétérition →
Procédé, et style →, →, →, →
Processus de civilisation →, →
Prolepse →, →, →
Pronoms, mélange des - →
Prosopopée →
Pseudo-brouillage →
Pseudo-tautologie →
Psychanalyse →, →
Psychologie de la forme →
R
Raisonnement →
Réalisme esthétique →, →-→, →
Réalisme linguistique →
Réception créatrice →-→, →, →-→
Représentation et présence →-→, →
Représentation et reproduction →, →-→, →, →-→
Restauration lexicale →, →
Restauration syntaxique →, →
Réticence →
Rhétorique acceptée ou refusée, en littérature →, →
Rhétorique dangereuse →-→
Rhétorique positive →, →
Rhétorique ridicule →-→, →
Romantisme →, →
S
Sacré →
Schématisation →
Sigle →
Slogan →
Solécisme →, →
Sophistes →
Style indirect →
Sublimation et désublimation, en psychologie →-→
Subordination, types de - →
Surréalisme →, →
Syllepse de sens →, →, →, →
Syllepse grammaticale →
Syllepse visuelle →, →
Syllogisme →
Symbole, symbolisation →, →, →-→, →
Symétrie et dissymétrie →
Synchyse →, →-→, →
Synchyse graphique ou visuelle →, →
Synecdoque →, →-→, →-→, →, →, →
Synecdoque-métonymie →, →, →
Synesthésie →
Syntaxe →
Syntaxe visuelle →
T
Tautologie →, →-→
Thème et phore, dans la métaphore →-→, →
Tmèse →
Trajet (intellectuel, nécessaire à la communication de l’œuvre : →, →, →
Transparence ou opacité des signes →-→
Type psychologique, du lecteur ou du récepteur →, →
U
Unidimensionnalité psychologique →, →
V
Valeur sémantique →, →, →, →, →-→, →, →, →
Vanité, en peinture →
Visible et verbal →, →, →-→, →, →-→, →, →
Voix de l’auteur →, →, →
X
Xénisme →
Z
Zen →
Zeugme →, →, →
Zeugme, poétique du - →
Zeugme grammatical, et - sémantique →-→
Zoom →
I / Matériaux
1. Question : Y a-t-il un lien entre le signe verbal et la chose qu’il désigne ?
Réponse : Non ; mais l’effort de l’expression essaie toujours de le rétablir
Un mot est un signe à trois visages ou aspects : un son (sonore), sensible à l’oreille ; une image, vue sur la page (si le mot est écrit) ; et un sens, ou une signification, dans l’esprit.
Y a-t-il un lien direct entre ces trois visages du mot, et la chose qu’il désigne ? On le croit ordinairement. Et pourtant...
Soit le mot en tant que son. Par exemple, je dis le mot : « fleur ». Je peux penser qu’il y a un lien naturel entre ce mot fleur, et la fleur que j’ai sous les yeux. Mais aussitôt je réfléchis que cette pensée est naïve, qu’en d’autres langues « fleur » se dit différemment : anthos en grec, par exemple. Je vois donc ce que les linguistes appellent l’arbitraire du signe verbal, et que la Bible matérialise par l’épisode de Babel, ou de la confusion des langues. Comme toutes les langues sont différentes, les signes-sons qui désignent les choses sont différents. C’est un divorce tragique, irrémédiable. Tout écrivain, ou quiconque parle même, doit l’affronter.
Pour ce qui est de la graphie du mot, dans les langues alphabétiques, le signe est tout aussi coupé de la chose qu’il désigne. Les langues encore enracinées dans le dessin (idéographiques), sont peut-être plus proches des choses...
Cependant, là encore un peu de réflexion me montre que l’image d’une chose n’est pas cette chose, mais seulement une représentation (arbitraire, d’autres étant possibles), de cette chose. L’illusion référentielle existe tout autant dans le monde du dessin ou de la peinture, que dans le monde des mots. Les signes ne sont pas les choses. Il y a un fossé ou un abîme entre la chose elle-même et sa représentation par le signe (aussi bien verbal que visible). Ni l’image d’un chien, ni le mot « chien » ne mordent.
On voit la naïveté de ceux qui croient dans le domaine religieux à l’idée de blasphème dont seraient responsables les mots ou les images enfreignant les interdits de la représentation. Ni les premiers ni les secondes en effet ne sont la chose. C’est là une illusion pré-babélienne. On pourrait aussi parler de « cratylisme », par référence au dialogue de Platon, dont le héros éponyme défend la théorie d’une relation motivée entre les mots et les choses. Il est partisan d’une adhérence magique de la chose au signe. Illusion très répandue néanmoins : par exemple « image » est l’anagramme de « magie ». Mais ce n’est qu’une illusion, en regard de l’idée d’arbitraire du signe, bien mise en évidence par exemple par Ferdinand de Saussure.
En ce qui concerne enfin la représentation mentale éveillée dans mon esprit par « fleur » (que ce soit le son que j’entends, ou le signe écrit que je lis sur la page), elle est générale, universelle, donc abstraite et coupée de ce que je vois de mes yeux : cette fleur particulière. Ainsi la représentation mentale générale remplace la chose concrète. C’est l’idée ou le concept de fleur que le mot recèle, et non la réalité concrète de la fleur.
Il est inévitable qu’il est soit ainsi : sans cette abstraction du langage, nous ne pourrions sans doute pas même penser, c’est-à-dire tailler dans le tissu de tout ce que nous percevons (« supputer » et « amputer » ont la même racine latine : putare, émonder, tailler), donc réduire les aspects toujours changeants du monde à quelques idées-notions qui les résument [voir là-dessus « Funes ou la mémoire », dans Fictions de Borges]. Mais il est dangereux aussi qu’il en soit ainsi. Le monde nous échappe dans sa concrétude, sa particularité.
... Heureusement alors qu’il y a, au service du langage et en particulier de l’écriture, ce qu’on appelle les procédés stylistiques ...
A quoi servent-ils ? La plupart du temps, à rapprocher le signe de la chose, à établir un nouveau contact, un lien perdu, entre le signe et la chose.
Par exemple je peux suggérer l’émotion que m’inspire la fleur que je vois en jouant sur la sonorité même du mot, avec tous les échos musicaux et sémantiques susceptibles alors d’être appelés (et non plus comme dans l’activité banale et routinière de l’esprit, rappelés), par ce jeu : « fleur », appelle « flore », et « Florence », femme et ville à la fois... Pour mieux voir physiquement la fleur, je peux en faire un calligramme. Pour rendre plus concrète la représentation mentale de la fleur, je peux la caractériser en la précisant par un nouveau nom plus particulier (rose, œillet, etc.), ou en la qualifiant (belle fleur, grande fleur, etc.), ou aussi en brouillant ses qualifications ordinaires, au bénéfice de nouvelles qualifications plus originales (hypallage, oxymore, etc.) : « la beauté parfumée de la fleur », son « éloquent silence », etc. Je peux enfin brouiller le signe lui-même en lui en mêlant d’autres. C’est le jeu sans fin des métaphores : « la robe de la fleur », « la jeune fille en fleur », etc.
L’activité de l’esprit ému de façon désintéressée devant une fleur est sans frein, elle se joue de la logique. Si le texte lui aussi dans ses opérations est sans frein, alors il rend compte de la présence de la fleur, non parce qu’il la reproduit (effectivement) devant les yeux, mais parce qu’il la représente à l’esprit, et parce que, ce faisant, il fait exactement, dans le monde du langage, ce que fait l’esprit en présence de la fleur elle-même : créer ses propres visions ou perspectives, sans aucune borne. Au fond, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qu’on imite, mais ce que fait l’esprit quand il les perçoit profondément. C’est le maximum qu’on puisse faire, et c’est déjà bien assez.
En élargissant, on comprend mieux ce qu’il faut entendre par l’expression connue, selon laquelle « L’art imite la nature ». Il ne la copie pas dans ses résultats, il l’imite dans son opération, il fait simplement ce qu’elle fait. Elle crée, donc il crée lui aussi.
2. Question : Quels sont les procédés musicaux permettant de conjurer l’arbitraire du signe verbal, et de réchauffer le langage ?
Réponse : Onomatopée, harmonie imitative, allitération, paronomase
Peut-être y a-t-il eu, à l’origine, un lien entre les mots et les choses. Mais aujourd’hui, il n’y en a plus. On peut s’amuser à chercher des oppositions évidentes entre le son et le sens des mots : elles sont plus fréquentes que les ressemblances ou les correspondances. Par exemple, « compendieusement », en français, veut dire : « bref ». « Jour » est obscur par le son, et « nuit » est clair. Inversement, des mots qui se ressemblent phonétiquement n’ont rien à voir l’un avec l’autre sémantiquement. Ainsi, « citadelle » fait rêver, mais « mortadelle » fait rire...
Face à cette malédiction, le langage dispose de procédés pour se réchauffer en quelque sorte, pour réaliser à nouveau un rapprochement des mots et des choses, pour renouer un lien perdu, conjurer un divorce ancien : ou au moins donner l’illusion de le faire... Même si les deux mondes, celui des signes et celui des choses, sont hétérogènes, on a parfois l’impression qu’on peut passer de l’un à l’autre, d’établir des ponts entre les deux. Cette illusion est vitale. Sans elle, aucun homme n’écrirait.
On pourra ainsi distinguer l’arbitraire du signe vu isolé (« le hasard demeuré aux termes », selon l’expression de Mallarmé), et l’effort qu’on fait pour rompre cet arbitraire, par l’agencement des mots entre eux. Certes « nuit » est clair par le son, et « jour » obscur. La phonétique s’oppose à la sémantique. Mais si « jour » lui-même est ainsi obscur, je peux, dans la phrase elle-même ou le texte pris dans son ensemble (Mallarmé pensait au vers), essayer de l’éclaircir...
Comment classer les procédés musicaux dans le texte ? Considéré en tant que son, le mot peut être rapproché des choses elles-mêmes et de leur expérience sensible de deux façons : de façon directement imitative, ou de façon musicale pure, sans ambition directement imitative.
L’onomatopée consiste à imiter en un seul mot un bruit réel. Le coucou est un oiseau qui fait « coucou » (onomatopée). On peut quand on parle ou écrit vouloir créer des onomatopées, outre celles qui existent déjà dans la langue.
Lorsque plusieurs mots sont en question, on parle d’harmonie imitative. Ainsi dans : « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? », on peut croire effectivement entendre le bruit du sifflement des serpents. L’essentiel de ce type de figures est l’imitation, la reproduction, la mimésis.
Il peut au contraire exister une musique des mots qui ne soit pas imitative, mais pure, formelle. Cette musique agit directement sur la sensibilité, sans passer par le rappel ou la référence d’une notion. A ce moment-là, on parle d’allitération. Ainsi dans : « Tout m’afflige et me nuit et conspire à me nuire... », on peut sentir la nervosité de Phèdre par l’emploi strident du son « i » répété. Le son ne renvoie à rien de réel ou de concret, mais agit directement. Allitération et harmonie imitative se distinguent, exactement comme en musique, la musique formelle ou pure, construction autonome, se distingue de la musique imitative. Assurément la première a plus de noblesse que la seconde. Quand il n’est pas référentiel, le procédé artistique est moins grossier.
Enfin, on peut avoir recours à la paronomase, qui consiste à rapprocher deux ou plusieurs mots se ressemblant phonétiquement. La paronomase peut être imitative, mais la plupart du temps ce n’est pas le cas. Exemples : « Il faut que le cœur se brise ou se bronze. » (Chamfort) « Ces ménages et ces âges... » (Rimbaud), « Espèces d’espaces » (Perec). Tout se passe comme si la juxtaposition des sons eux-mêmes ajoutait quelque chose au sens, un sens formel au sens sémantique. Dans ces agencements musicaux, la pression de la forme est grande, et le son va chercher le sens, et l’enrichit par de nouveaux échos (appel du sens), au lieu de s’y soumettre et de le rappeler simplement à l’esprit, comme cela se passe habituellement.
En général, c’est un trait de l’écriture baroque ou précieuse que d’aller des signes eux-mêmes, et de leur agencement, au sens. Chez le baroque ou le précieux, le signe appelle ou suscite le sens. Chez l’écrivain classique, au contraire, le signe sert le sens, qu’il se contente de rappeler. Mais au fond, toute activité concrète d’écriture contient les deux mouvements.
En rapprochant ces procédés avec la musique, on peut dire que les procédés imitatifs et les procédés non imitatifs du texte se distinguent exactement comme la musique formelle ou pure, construction autonome, se distingue de la musique imitative : L’Art de la fugue, par exemple, de Pierre et le Loup.
Pour ce qui est des arts du visible, on pourra comparer cette pression des matériaux sonores à ces « effets latéraux », dont parle Valéry [dans Le Voyage en Hollande], à propos des peintres du clair-obscur. L’esprit perçoit le sujet (après une réflexion plus ou moins marquée), mais l’œil sent immédiatement le clair-obscur, qui est le second langage (plastique) de l’œuvre, insidieux mais peut-être plus profond. Exactement de la même façon, la musique du texte, par-delà sa propre référence, est son second langage. Le paradoxe est qu’alors des mots choisis au départ pour leur musique même puissent susciter dans l’esprit de nouveaux sens.
En élargissant le problème à l’esthétique toute entière, on remarquera qu’il y a dans tous les arts une forme pure, non représentative, et une forme impure, ou représentative. Ainsi l’arabesque se distingue du dessin, la danse de la pantomime, etc. [voir là-dessus le livre de Souriau La Correspondance des arts, et le tableau qu’il dresse des arts d’après cette répartition]. Il semble bien que, quand un art est voué par sa nature à une référence (c’est le cas de l’art des mots, où les signes signifient, c’est-à-dire sont toujours signes d’autre chose qu’eux-mêmes), la nécessité de cette dernière voue toujours l’œuvre à une certaine impureté. L’art a toujours la nostalgie d’une forme pure : la signification est une impureté, mais parfois nécessaire, de la forme.
3. Question : La musique des mots dans un texte peut-elle être le tout du texte ?
Réponse : Non. Si elle l’était, ce serait une terrifiante régression
Il ne faut pas dans l’art des mots survaloriser la musique propre des signes. Pour plusieurs raisons...
Prenons d’abord le cas de la musique imitative. Cette ambition directement mimétique dans le texte est naïve. Ni l’onomatopée ni l’harmonie imitative elles-mêmes ne reproduisent les bruits du monde à l’identique. « Toc-toc » en français se dit « ratatap » en anglais. Le coq français fait « cocorico », le coq allemand, « kikeriki », l’italien, « kikiriki ». En fait ce n’est pas le coq qui chante dans le texte, mais le langage. Ce n’est pas la réalité que contient une œuvre, mais une langue, son système phonique, ses structures particulières, etc. C’est pourquoi il ne faut jamais dire qu’un texte rend ou reproduit la réalité ; il la représente, ce qui est tout autre chose. D’un côté, il y a les bruits du monde ; et de l’autre, il y a la phonétique, la syntaxe, les règles propres du texte, etc. Entre eux, un fossé.
Qu’en est-il maintenant de la soi-disant musique pure du texte ? Les signes du texte (au moins traditionnel), sont bien une musique, certes, mais cette musique se déploie toujours sur un sens, sur du sens. Ainsi, « La fille de Minos et de Pasiphaé... » n’était pas, pour Racine et ses contemporains, de la poésie pure, comme l’a prétendu l’abbé Brémond. C’est aussi une fiche signalétique : la fille du Juge aux Enfers et de la Démente. Une fiche d’état-civil, un renseignement. Comme la caractérisation, la musique dans le texte, aux époques classiques du moins, est toujours soumise, subordonnée, à une volonté de démonstration, qui est intellectuelle. On a fait ensuite de cette musique initialement soumise une musique pure, exactement comme on est passé à l’époque romantique de la caractérisation didactique des classiques, à la caractérisation gratuite, ludique, ou pittoresque (voir question 13).
C’est le propre des critiques modernes esthétisants que de voir de la musique pure où il y avait simplement une volonté (même musicale) de démonstration. Mais, et on ne le remarque pas assez, c’est aussi le propre des périodes de déculturation, où l’émotion formelle, pure ou simplement esthétique (aïsthesis : sensation) l’emporte sur la réflexion, que d’oublier dans les œuvres l’opération didactique initiale de l’esprit. Cela va de pair avec l’oubli total des contenus. On s’extasie sur « la fille de Minos et de Pasiphaé », quand on est esthète, mais tout aussi bien quand on est ignorant : quand ne sait plus à qui ces noms renvoient, de qui ils sont signes. Au fond, cette idée d’une autoréférentialité des signes est très redoutable : elle peut habiter chez les plus grands esprits (les esprits des esthètes modernes), et aussi chez les plus incultes...
Mais si, dans le monde des mots, en choisissant le son contre le sens, c’est-à-dire la représentation mentale, on peut enrichir le sens, on peut aussi l’appauvrir. On enrichit le sens émotionnel, on appauvrit le sens notionnel. On peut même vouloir le supprimer totalement. Le lettrisme s’est essayé à cet usage non significatif du langage, abstrait comme on le dit au sens pictural. Pensons aussi aux glossolalies, langage inventé, cris divers, d’Artaud par exemple. C’est assurément problématique.
Ce n’est pas pour rien que les procédés musicaux du langage aujourd’hui sont très répandus. Il y a actuellement une tendance à généraliser l’usage purement prosodique des mots. Dans le slogan, par exemple, on ne veut plus stimuler le discours, la réflexion, mais susciter directement l’émotion, par contagion ou empathie. Ainsi la publicité veut stimuler directement, par exemple par l’harmonie imitative, ou par l’onomatopée, ou par la paronomase. Pour signifier que telle voiture va vite et consomme peu, on peut dire : « Vroum-vroum, pas glouglou ». Pour signifier la rapidité, on peut dire : « Crac-crac ». Pour engager à utiliser les transports en commun, on dit : « ticket chic-ticket choc », etc. C’est qu’il s’agit en publicité de stimuler en simulant (paronomase !), de manière élémentaire, et non pas de faire réfléchir : si on réfléchit, en effet, on n’achète pas...
On pourrait d’ailleurs communiquer, et très efficacement, de cette façon, très rudimentaire. Les abeilles et les fourmis communiquent très bien, elles, simplement en remuant le derrière... Aujourd’hui très souvent le stimulus supplée au vide du cerveau. Mais l’expression y gagne peu, car communiquer n’est pas s’exprimer. « Miam-miam » dit sûrement plus la faim, que « j’ai faim ». Mais « j’ai faim » peut dire autre chose que la faim...
Il ne faut pas s’extasier à tout propos sur la seule forme phonique ou musicale d’un texte, indépendamment de sa signification. Qu’en serait-il de mots qui ne seraient que des sons ? Une musique strictement émotionnelle, comme on la voit fleurir dans les époques de déculturation. L’usage du langage comme pure prosodie peut-être extrêmement régressif. Le langage du nouveau-né, ne l’oublions pas, n’est que prosodie pure...
Esthètes et ignorants, au fond, se retrouvent au même point, en valorisant la musique seule des mots : l’émotion (musicale) peut être le naufrage de la réflexion. En fait, il y a toujours dans le texte une part incontournable d’impureté (la part de la référence) : aucun texte ne se réduit à la musique de ses mots.
4. Question : Quels sont les procédés visuels permettant de lutter contre l’arbitraire du signe verbal ?
Réponse : Calligramme, et cryptographies diverses : palindrome, acrostiche, anagramme
Si je considère que le mot tel qu’il se présente dans les langues alphabétiques, est décidément trop éloigné de la chose, je peux vouloir l’en rapprocher par une graphie plus appropriée. J’entre alors dans le domaine des calligrammes. Le dessin étant toujours, à tort ou à raison, supposé être plus près de la chose que le mot, la première idée qui vient à l’esprit est de mimer étroitement le sens du mot par l’image qui le transcrit. C’est le calligramme mimétique, du genre de ceux qu’Apollinaire a pratiqués. Ainsi je peux écrire « fleur » en tâchant d’imiter avec les lettres du mot la configuration physique ou visuelle elle-même de la fleur. Le signe graphique transcrivant « fleur » dessinera la fleur.
Mais aussi, de façon plus fine, je peux décider de faire un calligramme non imitatif de la fleur, écrire le mot en suggérant la fleur : de façon oblique, cursive ou penchée, florale, etc. Ce dernier procédé est moins grossier, dans la mesure où il cherche des équivalences, des atmosphères ou des contrepoints, et non l’imitation directe.
La différence ici est la même que celle qu’il y a, pour les procédés phoniques ou musicaux, entre l’harmonie imitative et l’allitération. On a vu à la question 2 que la musique pure, toujours, est plus subtile et riche que la musique mimétique ou représentative. Pareillement pour le calligramme, musique plastique. Les Calligrammes d’Apollinaire pèchent parfois par trop de mimétisme. Ceux de Jean Tardieu [dans Obscurité du jour, par exemple] sont plus purs, plus abstraits, plus directement expressifs.
Cependant il y a la même ambiguïté ici pour les procédés visuels que pour les procédés phoniques. La réalité n’est jamais atteinte dans l’œuvre Même le calligramme qui se veut imitatif n’est jamais la chose elle-même. On croit d’habitude que l’image mimétique est plus proche de la chose que le mot, signe arbitraire. Mais cette vision est naïve. L’image est elle aussi un signe, ou faite de signes, et elle ne reproduit pas le monde. Comme le mot, elle se borne à le représenter. Les choses réelles sont absentes du monde des images et des mots. Ni le mot « fleur », ni l’image de la fleur, ne sont une fleur. Magritte dessine de façon très ressemblante, en trompe-l’œil, une pipe, et inscrit en-dessous : « Ceci n’est pas une pipe ». Il a raison : ce n’en est que l’image. On peut appliquer cette remarque au calligramme, surtout à celui qui a une ambition imitative. Sans doute est-il d’autant plus naïf qu’il se veut mimétique.
D’autres procédés que les calligrammes sont disponibles pour donner au langage plus de présence, plus de poids. Le texte semble alors en acquérir plus de densité. La graphie peut devenir cryptographie (langage secret). Qui ne s’est un jour, face à la dégradation ordinaire du langage, inventé un langage secret ? Les choses toujours paraissent plus désirables, de demeurer cachées. Et aussi l’esprit jubile, de trouver la solution à un rébus, ou une énigme.
On peut jouer sur l’agencement graphique visible des mots par le palindrome. Roma en latin s’enrichit et s’embellit d’être lu à l’envers et de donner Amor. L’amoureux de Sète peut se réciter dans les deux sens : « Sète sonne en nos étés ». Ève se lit dans les deux sens. Larousse donne comme exemple de palindrome : « Élu par cette crapule ». Un magnifique palindrome en latin est la formule qui a servi de titre à un film de Guy De-bord : In girum imus nocte et consumimur igni (Nous tournons en rond dans la nuit et sommes consumés par le feu). On notera qu’il y a les vrais palindromes, où l’on obtient le même mot ou la même expression en lisant dans les deux sens, et les « faux », où l’on obtient un autre mot ou une autre expression. Si on retourne « Trop », on a : « Port ».
Le palindrome renverse l’ordre habituel de lecture, qui s’effectue chez nous de gauche à droite. Le bouleversement est donc culturel autant que textuel. La vision elle aussi chez nous s’effectue en balayant les choses de gauche à droite. Il peut être intéressant de renverser cet ordre. L’équivalent oral du palindrome était le javanais naguère, il est le verlan aujourd’hui.
On peut aussi vouloir lire non plus horizontalement, mais verticalement. C’est le sens de l’acrostiche en poésie : la lecture verticale de la première lettre de chaque vers donne un nouveau mot.
Pensons aussi au mélange des lettres dans l’anagramme. Tout amoureux s’est essayé à retourner, renverser ou mêler les lettres du nom de sa bien-aimée. Ce nom lui a été plus cher, plus nécessaire, et même plus enrichi sémantiquement par le jeu formel. Si j’aime une femme qui s’appelle « Marie », je peux retourner les lettres de son nom, et je trouve : « Aimer ». Le nom en devient plus cher, plus valorisé. – Métaphoriquement, et d’un point de vue spirituel, on peut même voir le monde comme une immense anagramme, un puzzle à reconstituer pour retrouver le texte premier en son unité : c’était la vision des anciens gnostiques.
Ces procédés sont intéressants, comme toute transgression. Il suffit parfois de bouleverser l’ordre coutumier, l’usage perceptif commun, pour entrer dans un autre monde, plus secret et intéressant, ésotérique et hermétique. On s’initie à autre chose. Le texte se rapproche des formules magiques, religieuses. Il redevient un tissu épais (ce que dit son étymologie : textus en latin signifie « tissu »). En tant que tissu serré, désormais il ne s’effiloche plus, il échappe à la vie – où tout s’effiloche. Le langage n’est plus la pièce de monnaie qui ordinairement passe de mains en mains, et s’encrasse et s’use de cette façon. Il redevient sacré.
Ainsi sacralisé, certains ont pensé que le langage pouvait donner les clés du monde. Pensons à la Gematria dans la Bible hébraïque, forme d’exégèse dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter. La Kabbale la pratique couramment, et ne recule pas devant la permutation (Tserouf), qui est l’équivalent de notre contrepèterie. Évidemment, en un sens, cela est dérisoire, et peut faire sourire. Aucun des résultats obtenus ne tient dans une autre langue, par exemple. Mais malgré tout, des Grands Rhétoriqueurs d’autrefois aux recherches formelles de l’OULIPO aujourd’hui, on n’a cessé de penser que les mots n’étaient pas arbitraires. Ou du moins, de faire comme s’ils ne l’étaient pas. Sans cette illusion, personne n’écrirait.
5. Question : Quels sont les procédés permettant d’augmenter la caractérisation lexicale d’un texte ?
Réponse : Le recours à la qualification, l’indication des circonstances entourant le sujet, mais aussi le choix d’une précision plus grande des noms eux-mêmes
La piste de la caractérisation est la première piste fondamentale qu’il faut suivre lorsqu’on aborde l’étude d’un texte. On peut envisager d’abord la caractérisation dans le vocabulaire, ou caractérisation lexicale proprement dite. Puis, la caractérisation par analyse, qu’on peut appeler intellectuelle (voir question 16). Cependant, on peut aussi parler ensemble de ces deux phénomènes, et traiter de la caractérisation en général : la caractérisation est aussi un pôle essentiel de l’art, et une question de fond en esthétique.
La caractérisation lexicale tient évidemment pour une grande part à l’abondance au sein du texte de la qualification. Ainsi, on peut opposer les textes où figure le nom seul des choses, les textes basés par conséquent seulement sur la nomination, et les textes où au nom lui-même s’adjoignent un ou des qualifiants, qui précisent les circonstances en les actualisant. Ces qualifiants habillent le nom, vêtent la chose. Ils donnent le poids de terre, de terrestre, à la chose. Ils permettent aussi connivence, reconnaissance, complicité, avec notre univers proche. Ils favorisent l’Einfühlung, mot allemand qui signifie reconnaissance des choses du monde, et aussi gratitude, remerciement, envers ces choses, senties comme proches et familières. Choses, êtres et actes, en général, peuvent donc être dans le texte présentés seuls et nus (nommés), ou habillés (présentés de façon médiate : qualifiés).