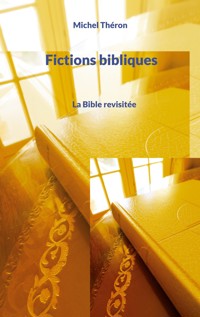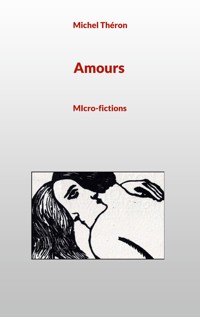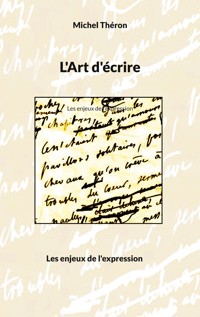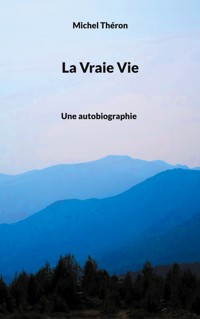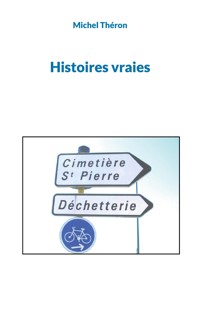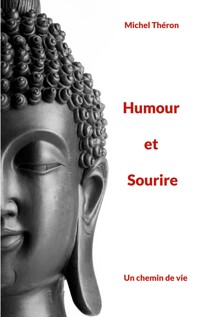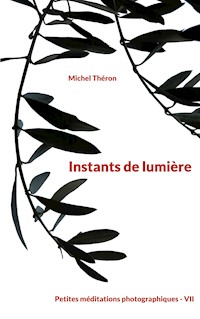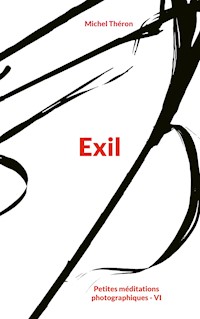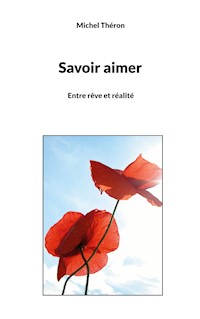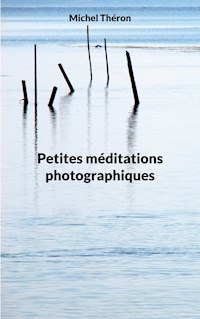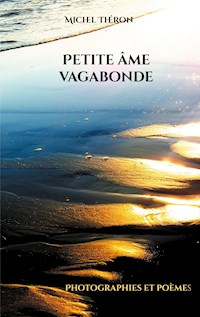Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Esthétique
- Sprache: Französisch
A partir de différentes images d'un même visage féminin, l'auteur nous donne à la fois un recueil de méditations et de rêveries, une enquête sur le fonctionnement du langage, un manuel de photographie, un traité d'esthétique, et un petit roman policier de l'identité. Les Notes finales initient à l'intertextualité du discours, et les Clés répondent aux questions de stylistique, d'esthétique et d'anthropologie culturelle qu'on pourra ici se poser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table
Avant-propos
Laquelle est la vraie ?
À deux visages
Ailleurs
Ici
Sous le plancher
Sans regard
Vues
Deux vies
Maya
Abîmes
Ce qui se perd dans l’ombre
À l’œil nu
Main mise
Dans les nuages
Les Feux de la rampe
Dans l’attente du jour
Lumière de la nuit
Étouffée sous les fleurs
Pourquoi si lointaine ?
Infinis fugitifs
Cinémas
Larmes
Faux jour
Décalages
Suppositions
Rideau
Notes
Clés
Index
Pour approfondir...
Avant-propos
Ce livre compare systématiquement le monde des images avec celui des mots. Regarder les premières mène inévitablement à penser, et on ne peut penser qu’au moyen des seconds. Voyez ce que dit Valéry, à propos de la peinture :
On doit toujours s’excuser de parler peinture. – Mais il y a de grandes raisons de ne pas s’en taire. Tous les arts vivent de paroles. Toute œuvre exige qu’on lui réponde... Ôtez aux tableaux la chance d’un discours intérieur ou autre, aussitôt les plus belles toiles du monde perdent leur sens et leur fin.
Remplacez ici « peinture » par « photographie », « tableaux » et « toiles » par « clichés », et vous avez l’orientation et l’intention principales de ce livre.
Tous les textes qui suivent sont des méditations sur des photographies argentiques, réalisées entièrement par mes soins (prise de vues, développement, agrandissement), assorties d’une réflexion sur le discours intérieur que je me suis tenu en les contemplant, et sur les procédés langagiers dont ce discours était fait. Je me suis demandé si ces procédés avaient un équivalent dans le style même des images que je regardais alors.
Comme ce livre traite très souvent des procédés du langage verbal, on pourra se reporter pour le compléter à mes deux autres livres qui les analysent et en dressent la liste : La Stylistique expliquée – La Littérature et ses enjeux, paru chez BoD en 2017, et Le Style par l’image, paru chez BoD en 2018. Avec eux il fait un ensemble organique.
Mais là n’est pas son seul but.
D’abord de ces méditations la poésie et la sensibilité, je l’espère, ne sont pas toujours absentes. C’est pourquoi d’abord il faut regarder longue-ment l’image qui leur sert de support, au début de chaque chapitre, et s’interroger sur elle. Ensuite il faut lire le texte lentement, éventuellement le lire par petits morceaux (chaque chapitre même est divisé en sections pour permettre l’arrêt de la lecture), fragments qu’on peut aussi au besoin lire plusieurs fois pour mieux s’en imprégner. Ce texte en effet est dense, et tient plus de l’alcool fort que du long drink. À déguster donc par petites gorgées...
Ensuite, comme l’ouvrage présente différentes visions ou versions d’un visage féminin, photographié en noir et blanc, il permet de se poser la question : « Laquelle est la vraie ? », tirée d’un poème de Baudelaire que je reproduis ci-après. La dernière image, en couleurs, reproduit l’origi-nal objectif, avec son identification, ses dimensions et son échelle. On le comparera utilement avec tout ce qu’on aura vu précédemment, pour mesurer les différences, qui sont innombrables et sans aucune limite prévisible.
Ce livre est donc à la fois un recueil de méditations et de rêveries, une enquête sur le fonctionnement du langage, un manuel de photographie, un traité d’esthétique comparée, et un petit roman policier de l’identité.
Le corps du texte lui-même comporte des citations directes ou des allusions indirectes à d’autres textes et ouvrages, qui sont indiquées au moyen d’un astérisque (*). Bien que ce ne soit absolument pas obligatoire, on pourra s’amuser à chercher l’origine de ces citations et allusions cachées. Par ce jeu de pistes ou de devinettes, l’ouvrage peut ainsi devenir un Trivial Pursuit de citations et d’allusions. En s’amusant, on verra qu’aucun texte, quel qu’il soit, n’est sûr : « Lequel est le vrai ? ».
Si l’on est impatient d’avoir les solutions, on les trouvera dans les Notes de la fin, pour éclairer cette intertextualité du discours qui, avouée ou non, est la règle en littérature.
Cependant, si le texte littéraire peut se nourrir de citations ou d’allusions, explicites ou implicites, ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas original. L’essentiel est de bien utiliser l’emprunt en l’insérant dans le courant naturel d’une pensée. Les abeilles, dit Montaigne, butinent çà et là les fleurs, mais font après le miel, qui leur appartient en propre : « ce n’est plus thym, ni marjolaine ». Et Pascal remarque aussi que quand on joue au jeu de paume, on joue toujours avec la même balle, mais l’essentiel est de bien la placer.
Pour rappeler au lecteur les enjeux de stylistique, d’esthétique et d’anthropologie culturelle posés par l’ouvrage, j’ai adjoint une partie récapitulative intitulée Clés, qui procède par questions / réponses.
Enfin un Index permet de récapituler les notions essentielles du livre.
Cet appareil critique sacrifie aux exigences professorales et universitaires et répond à la vocation pédagogique qu’a eue le livre dans sa première édition. Notes, Clés et Index constituent donc comme un second livre, explicatif, dans le premier, sensible. Dans ces deux façons différentes d’aborder le même sujet le lecteur privilégiera celle qu’il voudra, selon ce qu’il attend d’un ouvrage.
En tout état de cause le savoir, me semble-t-il, ne dispense jamais de la saveur. Devinons donc, devisons et glosons, amusons-nous, et interrogeons-nous.
M.T. – décembre 2020
Remarque : La première édition de ce livre est parue en 1997, aux éditions du CNDP / CRDP de Montpellier. Cette édition est épuisée. La seconde est parue chez BoD en 2018. La présente édition donne de l’ouvrage une version revue et enrichie.
Laquelle est la vraie ?
J’ai connu une certaine Benedicta, qui remplissait l’atmosphère d’idéal, et dont les yeux répandaient le désir de la grandeur, de la beauté, de la gloire et de tout ce qui fait croire à l’immortalité.
Mais cette fille miraculeuse était trop belle pour vivre longtemps ; aussi est-elle morte quelques jours après que j’eus fait sa connaissance, et c’est moi-même qui l’ai enterrée, un jour que le printemps agitait son encensoir jusque dans les cimetières. C’est moi qui l’ai enterrée, bien close dans une bière d’un bois parfumé et incorruptible comme les coffres de l’Inde.
Et, comme mes yeux restaient fichés sur le lieu où était enfoui mon trésor, je vis subitement une petite personne qui ressemblait singulièrement à la défunte, et qui, piétinant sur la terre fraîche avec une violence hystérique et bizarre, disait en éclatant de rire : « C’est moi, la vraie Benedicta ! C’est moi, une fameuse canaille ! Et pour la punition de ta folie et de ton aveuglement, tu m’aimeras telle que je suis ! ».
Mais moi, furieux, j’ai répondu : « Non ! non ! non ! ». Et pour mieux accentuer mon refus, j’ai frappé si violemment la terre du pied que ma jambe s’est enfoncée jusqu’au genou dans la sépulture récente, et que, comme un loup pris au piège, je reste attaché, pour toujours peut-être, à la fosse de l’idéal.
(Charles Baudelaire,Petits poèmes en prose, 1869, XXXVIII)
1. À deux visages
Multiples, tous les êtres le sont pour nous. Mais moi-même je ne pense pas l’être. Aussi la plupart du temps je peux croire à l’unicité de mon regard et de mon discours, ce qui évidemment est faux. Des êtres je vois toujours plusieurs aspects, passant très vite de l’un à l’autre. Et des choses je pense toujours et me dis intérieurement plusieurs choses, se succédant très vite elles aussi.
Je viens d’écrire : « Multiples, tous les êtres le sont pour nous. Mais moi-même je ne le suis pas... ». Je viens de changer de pronom. Constamment, sans la plupart du temps m’en rendre compte, je change les perspectives ou les modes de mon discours, quand bien même je n’y ferais pas attention. Voyez encore ce que je viens d’écrire à l’instant : « Je change les perspectives ou les modes de mon discours, quand bien même je n’y ferais pas attention... » Spontanément je suis passé du présent de l’indicatif au conditionnel.
Ces altérations plus ou moins légères, dans le discours, s’appellent des énallages. On change les pronoms, les temps, les modes, etc. – toutes les modalités ou les perspectives de l’énonciation, qui sont aussi toutes les visions intérieures de celui qui parle.
La conscience en effet est mobile, non unifiée. Le discours parlé est plein d’énallages, et le discours écrit aussi, quand il est vivant et non ordonné ou hiérarchisé par la logique. À cela servent ce qu’on appelle les transgressions ou les écarts du style : à retrouver la vie, l’état vivant du langage. Ce qu’on appelle style n’est pas fleurs ou enjolivements, ornements, surajoutés ou superposés à la pensée postérieurement à son déploiement, mais retours à la vie même, immédiatement sentie, à son surgissement, par-delà l’unification logique. La logique elle-même n’est qu’un massacre d’expressions.
Pourquoi n’en serait-il pas de même dans tous nos regards, toutes nos visions ? Ma photo mêle deux visions distinctes du même visage. Mais à quoi bon ne retenir ou ne figurer d’un être qu’une seule de ses images, vue d’une seule façon ? Ce n’est pas comme cela en effet que nous fonctionnons au fond de nous-mêmes. Le souvenir d’un être (non pas intellectuel et contraint, volontaire, mais affectif et rêveur, surpris soudain et comme envahi à l’improviste), est flou, non pas net. Il mêle des visions, ne s’arrête à aucune précisément. Éparpillée, la conscience suit ses impressions bien plus qu’elle ne les domine. Tout s’échange, s’interpénètre. Rien n’est discriminé, situé à part, distingué clairement et séparé du reste. Le résultat est synthétique et totalisant, et non pas fixé et séparant, analytique et discriminant – comme dans cette photo, qui synthétise deux images ordinairement séparées...
Pareillement dans mon langage. J’échange très souvent les réalités quand je parle. Me souvenant d’un être, je peux dire de ce souvenir lui-même, comme je viens de le faire, qu’il est « surpris soudain et comme envahi à l’improviste... ». Mais c’est ce souvenir qui en vérité, logiquement, m’envahit et me surprend : il n’est pas lui-même envahi et surpris. Spontanément et sans m’en rendre compte je fais une hypallage ou inversion perceptive, un échange de repères. Comme l’énallage, l’hypallage est échange (allagè, en grec) au bénéfice de la vie immédiate. Peut-être est-ce une absurdité rationnelle. Mais qu’est-ce qui est le plus important : moi-même, qui prétends active-ment et librement me souvenir, ou l’invasion soudaine en moi du Souvenir, occupant et occupé à la fois ?
Il est sûrement absurde, en les décrétant irrationnelles, de corriger ces inversions. Qui le ferait ou voudrait le faire serait cancérisé par la logique. Beaucoup d’êtres (et aussi de manuels et de professeurs de littérature !), sont dans ce cas. Sont-ils vivants ? Dans ces opérations de correction (on veut corriger pour rendre correct), l’holisme initial (la fusion de celui qui perçoit et de ce qui est perçu), et en général toute poésie, seraient irrémédiablement perdus.
Diabolique est la distinction, la séparation (Diable, Diabolos : celui qui sépare). Diaboli-ques, la fixation, l’analyse, l’assignation à chaque réalité d’une place immuable et déterminée. Chi-mérique, l’unification du moi. Mais vivantes, la synthèse et l’unité globale, l’union mêlée des impressions, des sensations et des visions.
Quand je suis rêveur, c’est-à-dire en marge, non ordonné à la rationalité, à l’unification, au masque aussi et à la persona, au fonctionnement social, qui condamne l’éparpillement au nom de la concentration utilitaire, quand mon comportement se définalise au profit de l’évasion intérieure (la phantasia, l’imaginaire), me voici assiégé par des fantômes, vagabonds, errants. Savoir si je vis pour moi revient à savoir qui je hante.*1 Et qui me hante, qui vit en moi. Citadelle détrônée...
Habitant de mes pensées, elles sont des catins que je suis, et non un objet précis que je fixe.* Je les suis, même, au double sens des deux verbes homonymes. Alors moi-même je suis, nous-mêmes ne sommes pas fixés, immobiles, mais rendus à une ambulation intérieure. Tout bouge et vit.
Il est évident que pour percevoir une telle photo, qui mélange deux photos prises à des distances différentes, une à distance moyenne, l’autre beaucoup plus rapprochée, je dois intérieurement, mentalement, me déplacer. Cette photo est bien plus vivante que la vue unique, parce que je dois bouger à chaque fois à l’intérieur de moi-même pour la voir. Dans la vue unique, je suis immobile, ligoté. Fixe et fixé, mon regard est paralysé. Multiple, il est libre. Meurt ici le spectateur unique et comme ligoté de l’image, celui de la Renaissance Italienne par exemple. Le regard y est intrusif et voyeur, prédateur aussi et violeur : fixé sur sa proie par la perspective attentive (perspicere), découvrant indiscrètement une scène à laquelle il n’a pas été invité. Mais ici divers êtres en moi regardent, en divers lieux ou de divers lieux. Je n’inspecte pas, j’erre à l’aventure, toujours surpris par de nouveaux objets.
Et comme il y a plusieurs spectateurs en moi, mon discours intérieur varie. Je peux si je veux me parler à moi-même différemment. Je regarde, tu vois, il considère, etc. À chaque fois je ne suis pas le même, mon moi se démultiplie.*
Et aussi, le visage que je vois, n’étant pas à distance égale, je lui parle différemment. Assez lointain de moi, en français au moins, je peux lui dire vous. Mais plus proche, je lui dis tu. Un être que pour la première fois je tutoie, quel changement, et combien émouvant ! Quel dommage de se priver de ce magique instant, en tutoyant comme aujourd’hui tout le monde d’emblée... Que nos cœurs sont rudimentaires ! On ne sait pas ce dont on se prive, en supprimant ce passage décisif, en bradant ou ignorant superbement les possibilités de la langue. L’obligation de proximité annule les possibilités de changement. Fascisme du langage à la mode. Systématique et imposée, l’intimité n’a plus de valeur. L’être se perd alors, se rétrécit, se mutile. Nous devenons unidimensionnels.
Quand on voit quelqu’un pour la première fois, on ne le voit jamais de près, mais de loin. Visage lointain. Vous. L’amour peut naître (et peut-être aussi grâce à cette distance, celle de la plupart des portraits). Puis ce même visage, on le voit, aussi pour la première fois, de près. Il y a ainsi une magie irremplaçable du premier baiser. On la perd en s’embrassant à tout bout de champ, comme aujourd’hui. Mais dans le premier baiser on voit de limpides yeux démesurément agrandis, proches des nôtres. Deuxième image de la photo, deuxième négatif en sandwich sous l’agrandisseur, deuxième élément surimprimé. Tu.
Tu, toi, celle que j’aime. Celle à qui j’ai commencé par dire vous. Tu t’es rapprochée – mais comme vous étiez loin, comme j’ai pu rêver de vous... Maintenant tout cela se mêle, l’émotion ne peut plus distinguer entre les visions. Les instants de l’amour ne sont pas ceux de l’observation froide et mesurante, ils mêlent proche et lointain, les parties du corps se superposent, dans l’égare-ment, dans l’ivresse. Émotionnellement, le mélange des visions est plus juste, rend plus compte du chavirement de tels moments. Jamais on n’y est lucide. L’espace de l’émotion est fragmenté, juxtaposé, ou totalisant, mais jamais unifié.
Mais aussi, comme il était beau ce passage du vous au tu, où un nous s’est construit ! Le tu seul pourra s’enliser dans l’habitude, la routine. Nostalgie alors du vous, qui était promesse.* Le vous initial est la restauration authentique, archétypale de l’amour dans la vie quotidienne. Il faut pouvoir y revenir – et pour cela évidemment l’avoir quitté – pour restaurer l’essence, menacée par le refroidissement et l’entropie, la chute inhérente à tout accomplissement, meurtrier de la promesse.
La rhétorique de l’énallage est comparable au cubisme de la figuration plastique. Mais au fond cela ne fait que masquer, pesamment et pédantesquement comme toujours, un secret de la vie. La psyché est double, à deux faces, comme Janus (bifrons). Ces deux visages (et laquelle est la vraie ?), je leur parle différemment, et ils me parlent différemment. L’un dit : « Je t’aime », et l’autre : « Je vous crois ».*
1 L’astérisque (*) indique la présence d’une citation ou d’une allusion, le texte renvoyant alors à d’autres textes (intertextualité). La référence se trouve dans la partie Notes, à la fin du livre.
2. Ailleurs
Rêver est être absent. Occupé ailleurs. Ne plus être là. Être là et ailleurs en même temps. L’âme absente occupée aux enfers...* Ce visage est ailleurs, comme moi-même le regardant je suis ailleurs, au pays de mes rêves. Visage prétexte, objet de mes projections, nourriture de mes fantasmes. Femme alibi (alibi : ailleurs).
Pourquoi est-elle ailleurs ? Parce qu’elle regarde ailleurs.
Une figure peut être présentée frontalement, me fixant et me sondant, m’hypnotisant ou s’em-parant de mon regard, figure présente comme maintes figures sacrées, me renvoyant à moi-même et au secret centre de mon cœur, regard fixe de serpent sur sa proie. C’est le regard des icônes, comme aussi des photos d’identité...
Au contraire comme ici la figure peut être présentée de biais, ou de 2/3 face, ou de 3/4 face, semi-profil, etc. Elle ne me regarde pas, mais elle regarde autre chose, dans une autre direction. Et moi-même je la surprends regarder ailleurs. Ce n’est plus son regard qui est prédateur, mais le mien. Je surprends une intimité qui ne m’était pas destinée. Je la vois et elle ne me voit pas. Elle rêve et je rêve sur elle, comme elle, d’elle...
Ce n’est plus la figure potentiellement sacrée que je viens d’évoquer à propos des icônes, inspirante, voulant par sa présence m’insuffler souffle, force, esprit, figure venant d’un monde qu’on peut dire ainsi spirituel (spiritus, souffle, en latin). Cette figure, on la trouvera au chapitre suivant. – La figure ici n’appartient pas au monde de l’Esprit, ou du Vent qui emporte tout, mais au contraire parle à mon âme (psyché, en grec), donc relevant de la psychologie, sollicitant sentiments, fantasmes, inspirations, fictions, rêveries – précisément par son absence, sa non-disponibilité au présent.* Non pas surnaturelle ou d’un ailleurs assignable, mais irréelle ou venant d’ailleurs indistincts, suggérant des directions non encore sues ou explorées.*
On ne réfléchit pas assez au hors-champ dans une image. Parfois le champ d’une image n’est que le support d’un hors-champ bien plus vaste, bien plus important. Si ce qu’on appelle la poétisation est l’augmentation de la suggestion et du non-dit, tout ce qui indique un hors-champ ou une perspective extérieure à soi l’augmente. Amplifié aussi est le désir : il se nourrit de son propre manque.
Hypothèse d’un visage. Que voit-il, que fixe-t-il ? Si regarder quelqu’un en face est le juger ou se livrer à lui, regarder ailleurs est lui échapper. Regard fuyant, regard en fuite. Femme fuyante, toujours m’échappant. Par là précieuse, évidemment. Je ne poursuis que ce qui me fuit. Rien ne m’est que prétexte, et tous mes désirs sont mes alibis. Tortures de l’ailleurs, jalousie – ou adoration, comme ou voudra ou comme on sent son âme, mais toujours en questions... À la question, en questions, en question... Cette image n’est pas affirmative.
Rêve atteignable, ou inaccessible ? La proximité du point de vue ici (cadrage resserré, très proche du sujet) ne doit pas tromper. Il faut aussi considérer l’angle de vue, qui est ici la contre-plongée. Cette dernière (l’appareil étant situé plus bas que le sujet), dit-on souvent, met en valeur. Mais pourquoi ? Peut-être parce qu’elle nous rapetisse, nous infériorise. Jamais nous ne serons à ce niveau. Et si ce visage est proche (la prise de vue s’approche de la macro), il nous domine. On peut peut-être le toucher, mais avec précaution ou égard. Allégeance, soumission, prière, dépôt des armes ou reddition, tout cela est impliqué par le choix de la contre-plongée. Respect, révérence réitérée. Regarder de bas en haut pour admirer (suspicere). Se retourner pour la même raison (respicere). À cela s’oppose la vue en plongée, ou d’en haut, qui méprise (despicere).
Aussi la douceur. La lumière est transitionnelle, non violemment ou brutalement contrastée. Le tirage n’est pas dur, comme si accuser fortement les traits d’un visage le rendait à son tour accusateur. Le rêve se gagne quand l’image se perd dans le flou et la brume. À cela servent en photo les diffuseurs, les filtres, les éclairages doux ou tamisés. Images glamour (studio d’Harcourt, etc.), aux éclairages savants et valorisants.*
Aussi la pose. Car en même temps l’accent expressif créé par le cadrage s’oriente vers la nostalgie, la mélancolie, la tristesse. De toute façon, même si le visage est pris en contre-plongée, le regard de la figure domine ce qu’elle regarde, le point de fuite étant situé plus bas que les yeux (on peut créer cet effet soit par un léger basculement du cadrage, soit par une légère inclinaison de la tête du modèle – mais le résultat est le même). Comme si le désenchantement valorisait. Le bonheur attire peu. La tristesse nous étreint davantage. L’ailleurs triomphe du présent. La nostalgie, de tout voyage. Ce visage séduit, enchante – comme par désenchantement.
Certains visages sidèrent, somment à être, ou bien invitent à se découvrir, à se trouver ou à se retrouver, à scruter au fond de soi. Ils conduisent, font trouver un chemin, aussi font comprendre l’Essentiel. – Mais celui-ci dé-route l’esprit ou le dé-vie. Il séduit, écarte de soi (seducere) : j’y rêve, et je m’y perds.
3. Ici
Apparition-surgissement. Fantomatique. Non pas ailleurs comme dans l’image précédente, bien présente au contraire, mais d’ailleurs. D’un monde plus dense que celui-ci, ou que je pressens tel par la densité même de ce regard posé sur moi. Impossible d’y échapper. Regard d’hypnose, hypnotisant. Magie et magnétisme. Femme magique, magicienne. Ensorceleuse et envoûtante (ce mot vient de vultus : visage, regard).
Ici, sans doute, mais non d’ici. C’est au-jourd’hui peut-être que je la vois, mais il me semble que c’est de toujours. Ici, maintenant, hic et nunc, certes... Mais aussi de toujours, pour toujours, à toujours. Et nunc et semper. – Regard fixe dans un monde changeant, regard d’éternité : il vient d’un au-delà, d’un sur-monde, d’un lieu originel sans changement ni variation.* Tel nous nous imaginons parfois, posé sur nous, le regard de Dieu. Regard sans âge, venu du fond des âges. Œil grand ouvert (les francs-maçons n’en figurent pas la paupière, pour exprimer son éternité).
Ce regard est dense parce que maquillé. Du charbon entoure les yeux. Fixes et me fixant. Toute femme qui se maquille ainsi s’arrache à la vie, et fait de son visage une icône. Elle rejoint les masques sacrés, les figures-totems des premiers âges. Nouvelle prêtresse, entourée d’aura ou de feu sacré, elle se dore pour être adorée. De loin... L’idole toujours est faite par la distance, et les dieux ne meurent que d’être parmi nous.*
Femme idéale, ou plutôt femme-idée, suis ton destin d’éloignement : tu te pares et te sépares.
Toute figure maquillée est une figure hors-vie. On ne doit pas s’en étonner. La vie est impure, mêlée. Toutes les aspérités et imperfections s’y voient, comme sur une peau laissée naturelle, non maquillée. Pas d’unité en elle – celle que précisément sur le visage le fond de teint donnera. Pas de style dans la vie, pas de stylisation. On n’y peut rien zapper. Il y faut tout prendre, le sordide et le noble, le vaudeville et la tragédie. Bien flous et indistincts sont tous nos moments. Il nous faut donc élaguer, gommer, simplifier, pour accuser ce qui reste.
Exactement comme maquiller un visage est lui donner du style, créer un schéma, une épure géo-métrique. Le khôl, le crayon, l’eye-liner, le mascara pour teindre, allonger ou épaissir les cils, le fard à paupières, etc., amplifient par contraste l’intensité du regard. L’œil s’agrandit d’être ainsi cerné. Sa profondeur s’augmente de l’ombre qui l’entoure. Il s’ouvre sur un au-delà, vraie fenêtre sur l’infini. Artifice évidemment, mais le plus beau. Portée réellement métaphysique du maquillage : non pas dissimuler des défauts pour abuser ou tromper, par exemple pour effacer des ans l’irréparable outrage, mais pour purifier. Viser l’essence derrière la circonstance, l’idée derrière l’événement, l’infini derrière le fini.*
Présence absente, tu es éclairée par une lumière autre que la nôtre (ici, le flash). Lumière violente, ignorant les transitions, les passages, d’ici-bas. Lumière d’éternité, ou surnaturelle. On ne voit pas d’où elle provient, et elle semble surgir de la figure même. Exactement comme dans l’icône la source de lumière n’est jamais indiquée, et toute la clarté émane du fond d’or. La lumière n’est pas accidentelle, événementielle, ponctuelle ou circonstanciée (terrestre), mais inondant tous objets, choses et êtres, comme irra-diant d’eux-mêmes, profuse ou prodiguée, surnaturelle (céleste).
Jamais on ne voit dans la vie un être frontalement et uniformément éclairé, comme ici, avec tous ses traits durcis et schématisés, accusés. La simplification dans cette photo argentique a été amplifiée encore par le tirage dur, qui augmente le contraste : on peut réduire en photo les gris (les nuances et les valeurs de la vie), jusqu’à leur suppression complète, pour créer comme un effet de lithographie. Seuls peuvent subsister le noir et le blanc. Le poids ontologique du sujet (sa dimension essentielle) l’emporte alors sur toutes ses caractérisations existentielles. En somme, cette figure sommante et accusée est aussi accusatrice de la vie en moi. Le contraire de la douceur.
Nous rêvons des absents, de leur visage ou de leur voix : l’inflexion des voix chères qui se sont tues.* Mais nous sommes transpercés par certaines présences, et comme à jamais saccagés. Comme dans nos vies il y a des absences en réalité proches parce que bien douces, il y a aussi des présences bien lointaines, parce que déchirantes. À côté des rêves où l’on peut se complaire, il y a les éblouissements subits et subis.
Ce sont des instants magiques, des fulgurances, et puis subsiste seulement leur reste (leur souvenir, leur nostalgie, leurs regrets). D’abord la vision de l’étoile (sidus) et la sidération corrélative. Et puis sa perte, son abandon, son désir ou son regret (desiderium). De l’astre au désastre. Début et fin d’une vie. Ce fut comme une apparition... Et ce fut tout...*
La beauté convulsive sera érotique-voilée, ex-plosante-fixe, magique-circonstancielle, ou ne sera pas.* C’est là une bipolarité fondamentale. Dans cette image la magie, l’immobilité, l’essence, l’emportent sur le reste : la circonstance, l’événement. Contre l’empathie, l’Einfühlung, la chaleur de la vie, cette figure est abstraite, subju-guante, interdit le toucher.* Il ne faut pas toucher aux idoles : la dorure en reste aux mains.* Les fantômes sont numineux. Ils sont ici sans être d’ici. Présences ressuscitées : noli me tangere, ne me touche pas.*
On ne peut voir Dieu et vivre.* Tout contact avec le divin anéantit ou réduit en cendres. Dieu protège Moïse de son regard, mais Jupiter foudroie Sémélé, Diane Actéon, et Psyché perd Cu-pidon de l’avoir vu. Notre lot ordinaire n’est pas celui-là. Il est plutôt celui de l’attente ou de la remémoration de l’essentiel que celui du contact avec lui. Tu me verras de dos, dit Dieu, c’est-à-dire quand je serai passé.* Passé, il est du passé. On s’en souvient et on l’attend. Voilà notre mesure. La pure présence pétrifie, nous fait périr.
Pareillement pour la Beauté. Le beau véritable fait peur, comme toute expérience extrême. Certains êtres sont totalement protégés par leur beauté. Y toucher serait profanation. La beauté retranche de la vie, et il n’est pas dit qu’il faille la souhaiter à quiconque. Elle engendre inaptitude au bonheur, et pour celui qui la possède, et pour celui qui la contemple.* C’est pourquoi la beauté n’est pas avenante. Elle est accablante. On meurt en elle, on meurt en beauté. Elle est catastrophique, étymologiquement par le retournement de l’être qu’elle opère. Torsion, déchirure. Le beau est le commencement du terrible, comme ces anges qui nous déchirent par leur vue ou leur voix.* Excessive, la beauté est surhumaine ou supra-humaine, non à la mesure des hommes. Le teasing du maquillage nous fait entrevoir autre chose, déchire nos jours gris, pour notre malheur. Celles qui se maquillent ne savent pas le mal qu’elles nous font.
Beauté destinale, fatale (fatum veut dire destin en latin). L’appel que tu suscites en moi me dérange et me déstabilise. Que ne puis-je fermer les yeux ? La beauté est sommation, surrection, appel : kalos, beau, est parfois rapproché de kaleîn, appeler. Cette vocation, peut-on faire autrement que la fuir ? Mais quelle nuit hagarde jeter, lambeaux, sur ce regard navrant ?*
Tu me tues, tu me fais du bien.* Beauté oxymorique, tu menaces, car je ne serai jamais à ton niveau. Excessive, too much. Triste, car tu le sais. Inquiétante, car j’y perds mon repos. Tu ne me fais pas agir, tu me pétrifies. Stupéfait, je m’immobilise. Catalepsie, hypnose. Aucun désir physique même ne se lève d’un visage vraiment beau. L’absorption dans la contemplation s’oppose au vouloir-vivre. C’est un vouloir-mourir au contraire. Le désir est sans remède. On meurt de ne pas mourir. Le papillon se brûle à la flamme qui l’attire. Aussi l’éphémère ébloui qu’est tout homme ici-bas. Aussi l’amoureux de la beauté, caressant son propre tombeau.*
On n’a plus aucune envie quand on n’est plus en vie. Si on ne peut voir Dieu et vivre, alors il faut mourir pour Le voir. Beauté de sur-monde, morte en effet à ce monde-ci. Regard hors-vie. Regard aussi fixe des morts. Masques des morts yeux ouverts. On ne les supporte pas. On ferme leurs yeux. Beauté morte qui me tue. J’adhère à ma mort et la désire. Volontairement je consens à ma propre destruction. Pantin d’un être créé par mon propre regard, esclave de mon adoration, fruit de mon secret désir de mourir, je me soumets à tout ce que je sacralise. J’obéis.
Ici. Elle me somme d’être ici. Ici (viens !) le chien. Au pied. Fascisme du dressage, et en général de toute chose sacrée ou sacralisée. Ici (viens !) enfant. Ici (viens !) élève. Ici (viens !) disciple. Ici (viens !) amant, etc. Comme les orants des icônes, me voici dressé : debout et soumis, obéissant aux ordres.
Démaquillée, la figure s’affaiblira. Belles de jour, laides de nuit... Mais peu importe, car je ne vois pas ordinairement ces transformations. Le regard égare. Ici je vois bien que les êtres ne sont pas que lumineux. Le numineux les habite, et la peur les crée tout autant que l’admiration ou le désir.* Je continuerai de voir la Circé tyrannique aux dangereux parfums...* La projection continuera. Et l’illusion ? – Mais laquelle est la vraie ?
4. Sous le plancher
Reconnaissance signifie identification, situation, localisation, mémoire – mais aussi remerciement, gratitude. Dans les deux cas, l’humain est présent en nous. L’allemand a un mot pour exprimer cela : Einfühlung. C’est l’empathie, la projection affective (incluant les connotations psycho-sentimentales) que nous faisons sur un être, objet ou personne, que nous sentons proche de nous, ou proche de l’image qu’ordinairement nous nous faisons de nous-mêmes. Cela nous rassure, et flatte notre narcissisme. Comme c’est cela, c’est bien proche de nous, c’est bien ainsi dans notre vie, cela nous ressemble, c’est bien nous ! Nous sommes au chaud en nous-mêmes, tributaires de l’humanité. Fraternelles, nous éprouvons toutes choses. Et très vite ces images, devenues coutumières, restent sages – comme des images...
Visage – vie sage....
Mais parfois tout cela tombe, s’effondre, comme ici. Soudain, l’être que nous croyions connaître, voici qu’il apparaît comme autre, étrange et bizarre, parfois même singulièrement menaçant. Tombent toutes les projections idéa-lisantes, sublimantes. Quelque chose apparaît que nous ne soupçonnions pas : inquiétante étrangeté. L’habitude l’avait gommée, pour nous rassurer. Elle nous avait pris entre ses bras, comme un petit enfant qu’on console, pour nous rendre le monde habitable : pensons aussi à ces chambres nou-velles où nous avons été, d’abord hostiles, puis par l’accoutumance devenues proches et apprivoisées, tels des visages ou êtres tutélaires, protecteurs, veillant sur nous.* Mais maintenant ce monde proche n’existe plus. Plus de reconnaissance : seulement de l’inhumain. Figure défigurée.
Mais quand on dit à quelqu’un : « Je ne te reconnais plus », n’est-ce pas qu’on commence à le connaître ? Et quand on se dit à soi-même qu’on ne se reconnaît plus, n’est-ce pas qu’enfin on se découvre ?
J’ai aimé un être doux. Un ange. Puis un démon est apparu. J’ai connu une certaine femme, dont j’ai rêvé. Elle est morte. Une autre est apparue à sa place, qui m’a fait regretter la première. De celle-ci je suis en deuil, je l’ai portée en terre, et maintenant, un pied dans la fosse de l’idéal, je suis inconsolable. Mais la mégère, le monstre est là qui me rudoie, me tance.*
En fait, les deux femmes sont les mêmes. La mégère simplement est la femme qu’on n’aime plus. Bien banal et commun : l’épouse tue la fiancée, le réel le rêve. On se veut et on s’enlace, puis on s’en lasse et on s’en veut. Le temps passe, et fait passer toutes passions. Passer et trépasser...
Pareillement d’ailleurs la mère acariâtre d’au-jourd’hui tue en nous (enfants grandissants) la bonne mère d’autrefois, le père-ogre tue le dieu protecteur, comme aussi (quand nous sommes parents) l’adolescent-légume tue en nous l’enfant gracieux d’hier.* Appelons cette femme, comme Baudelaire, Benedicta. Bénie elle était. Maudite maintenant elle est. Monde en confusion, comme un langage en synchyses (voir le début du chapitre suivant)... – Mais laquelle est la vraie ?