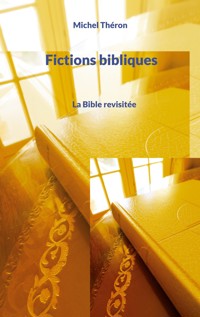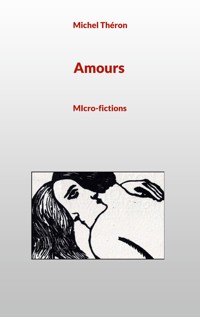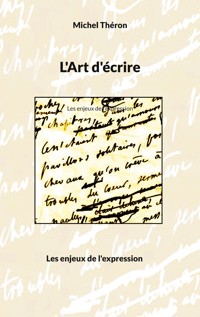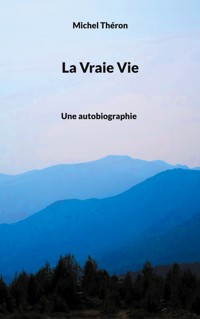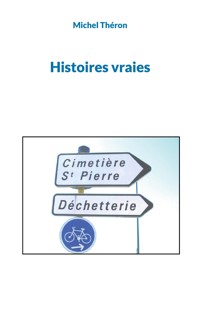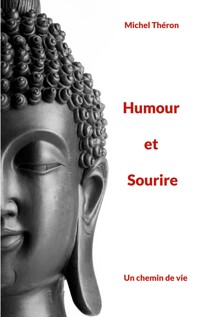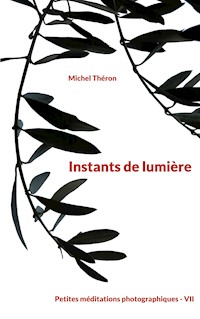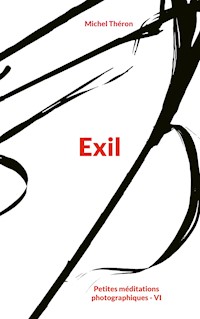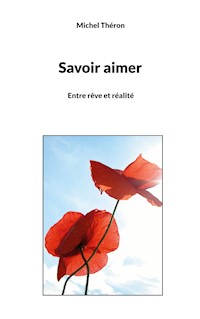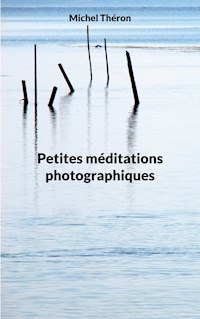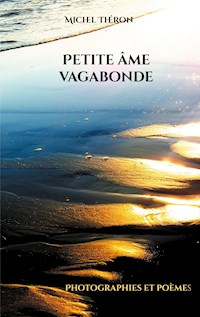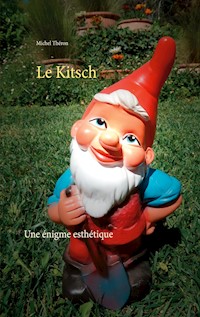
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Esthétique
- Sprache: Französisch
Le Kitsch est un problème d'esthétique fondamental couvrant plusieurs domaines : arts visuels et architecture, mais aussi musique, littérature, arts du design, habillement, etc. C'est un formalisme, sans contenu profond, que l'on dénigre ordinairement. Pourtant la question est plus complexe. On peut en effet le réutiliser en le prenant avec humour, et aussi parfois le réhabiliter quand on se trouve dans une situation émotionnelle particulière. C'est à quoi ce livre invite, en évitant tout parti-pris à son sujet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table des Matières
Avant-propos
Les aventures de la Beauté
La Beauté hors-vie
La Beauté meurtrière
La Beauté banalisée
La Beauté menacée
La Beauté brisée
Un monde formel
L’esthétique, notion moderne
La fin de la Transcendance
Fin de l’éthique
Ludisme
La consommation des signes
La vie légère
Visages du kitsch
Exemples quotidiens
Le kitsch littéraire
Le kitsch musical
Le kitsch dans quelques arts visuels
Questions
Énigmes
Stratégies et récupérations
Bibliographie
Pour approfondir...
Avant-propos
Le kitsch est un problème d’esthétique, au sens le plus large du terme, couvrant plusieurs domaines : arts plastiques et architecture bien sûr, mais aussi musique, littérature, arts du design, habillement, etc., au point qu’il semble impossible qu’un domaine quelconque puisse lui échapper. Mais il pose aussi à la base un problème d’anthropologie culturelle, de civilisation, que ce livre analyse. Par là ce dernier dépasse la simple évocation descriptive des objets kitsch ou dits de mauvais goût, pour analyser quelle image de l’homme et de sa situation dans l’existence est ici sous-tendue et impliquée.
À cet égard un point de méthode me paraît capital. En général, pour définir une notion, il importe d’abord voir ce qu’elle n’est pas, ce à quoi elle s’oppose. Tout choix, dit fort justement Spinoza, est une exclusion, une négation : Omnis determinatio est negatio.
Aussi, pour bien comprendre ce qu’est le kitsch, il faut voir d’abord ce par rapport à quoi et contre quoi il s’édifie et se constitue, ce avec quoi il fait un absolu contraste. Aussi beaucoup de considérations de ce livre seront-elles consacrées à ce qu’il n’est pas, dans tel ou tel domaine ou telle ou telle discipline. Par là on ne sort pas du sujet, comme on pourrait le croire : au contraire, on verra mieux, par comparaison, ce qu’est la chose dont on s’occupe.
Si par exemple le kitsch correspond à ce que Malraux dans Les Voix du Silence appelle un « anti-art » (« Ce qui naît là où les valeurs meurent »), il faut au moins suggérer ce qu’est le vrai art, et en généralisant la vraie réussite dans le domaine de la création, quelle qu’elle soit.
Enfin si beaucoup d’analyses de ce livre sembleront être pour le lecteur une condamnation sans appel du kitsch, la conclusion sera tout imprégnée d’un certain scepticisme, et par là pourra surprendre. S’il est aisé de définir négativement le kitsch, en montrant ses manques, ses carences, il semble trop rapide, toutes réflexions faites, de le condamner irrémissiblement.
D’une part, il y a certaines stratégies qui permettent de lutter contre lui tout en le reproduisant, en semblant l’incarner : en l’intégrant par exemple dans une œuvre à aura qui le fait admettre, ou bien par le moyen de la distance et du second degré (le camp).
Mais aussi, plus radicalement, le vertige peut prendre celui qui y réfléchit beaucoup. Qu’est-ce qui n’est pas kitsch ? Est-on sûr soi-même de lui échapper ? Et est-on plus satisfait de le critiquer ? Vaut-il mieux dans la vie être lucide et malheureux, ou bien naïf et heureux ?
Cela ne veut pas dire que les analyses le concernant qui auront précédé soient invalidées. Simplement si la condamnation se fait (et est-il nécessaire qu’elle se fasse toujours ?), ce sera avec une certaine mansuétude, avec circonstances atténuantes.
Je remercie ici l’artiste Sonia Orduna, qui m’a donné aimablement accès à sa collection d’objets kitsch.
M.T. – juin 2020
1 Les aventures de la Beauté
La Beauté hors-vie
Pour comprendre ce qu’est le kitsch on peut partir de la notion de Beauté, équivalente à celle de perfection ou de réussite dans la création en général, et dont le kitsch apparaît comme une dégradation.
Dans le monde du kitsch, la beauté semble une évidence, quelque chose de naturel, qui procure de l’agrément. Une fois perçue, on continue sa vie comme si de rien n’était, en attendant la prochaine rencontre, nouvelle halte de bonheur, mais qui ne met pas la vie ordinaire en question. De cette dernière on s’accommode, et ce qu’on trouve beau, on peut bien dire que cela embellit la vie, mais on ne soupçonne jamais que cela puisse lui tourner radicalement le dos.
Mais c’est ne rien comprendre à ce qu’est la vraie Beauté, et au saisissement qu’elle procure quand on la perçoit. Loin d’être naturelle et procurant de l’agrément, elle est en réalité hors-vie et crée en nous une sidération difficile à supporter par l’excès même de perfection qu’elle implique.
Généalogiquement, la Beauté peut être vue comme l’imposition au monde naturel d’un ordre que ce dernier, dans sa confusion essentielle, ne connaît pas. Elle transforme le chaos ou le tohubohu du monde en un cosmos ordonné, selon le processus qui se voit dans tous les récits cosmogoniques, de la Théogonie d’Hésiode à la Genèse biblique. On peut en avoir un bel exemple dans l’art du maquillage, et ce n’est pas pour rien d’ailleurs que le mot cosmos (ordre et beauté en grec) a donné précisément : cosmétique.
Le maquillage humain est un art, dans le sens où il sépare l’homme de l’ordre de la nature pour l’élever dans un autre ordre, celui de sa correction ou de sa réformation. Se vérifie bien l’adage latin, selon lequel l’art est l’homme ajouté à la nature (ars homo additus naturae).
La nature dans sa profusion ne choisit rien, ne sépare rien, tandis que l’art est choix. Une prairie regorgeant de fleurs nous donne peut-être l’idée d’une immense exubérance végétale, parfois d’ailleurs ressentie jusqu’à la nausée, mais un bouquet agencé avec art (pensons à l’Ikebana japonais), est le fuit d’une sélection souvent draconienne, qui est la part du style, et comble notre attente. Il y a sacrifice : on élimine certains éléments, pour accentuer et mettre en valeur ceux qui restent.
Et c’est précisément ce fossé entre la vie naturelle et l’œuvre de beauté véritable que le kitsch ignore. Il ne s’occupe pas du divorce essentiel, constitutif, entre l’art et la vie ordinaire, puisque précisément il ne voit rien d’autre au-delà de cette dernière. Il ne choisit ni n’élimine rien à des fins vraiment expressives, ne stylise pas de façon hardie, n’est pas effleuré par un quelconque besoin d’échapper au monde qu’on voit et d’en désirer un autre, d’entrevoir une quelconque Transcendance. Au contraire, il reproduit banalement les choses sans les déformer, et fait reddition à l’apparence toute simple des choses.
Laissé nu, un visage a plein d’imperfections. Le maquillage féminin, par exemple, a pour but de l’arracher à la vie, à l’existence mêlée et contingente, pour en faire une essence, un archétype. Il ne s’agit pas du tout de le rendre avenant, proche de nous. Il faut au contraire l’éloigner de nous, tourner le dos à la vie habituelle, et comme nous faire honte de la nôtre.
Qualifier le maquillage comme un lifting trompeur, « pour effacer des ans l’irréparable outrage », prendre le mot lui-même dans un sens péjoratif comme on le fait souvent, est extrêmement superficiel et trivial. En fait c’est n’y rien comprendre. Le but n’est pas de plaire, ou de séduire, comme quand on confond, comme fait le kitsch par total aplatissement et par réconciliation avec la vie, le beau avec le joli, l’agréable.
Ou bien s’il y a séduction il faut prendre le mot dans son sens très fort : nous détourner (se-ducere) de notre vie banale pour nous en faire voir, ou deviner, une tout autre. Et la sidération qui s’y produit peut nous mener aux plus tragiques destins.
Hiératique, le masque, vers quoi tend tout beau maquillage, résume cette situation. Par le fond de teint, la femme crée une unité abstraite, sur laquelle se dessineront quelques traits accentués, lignes simplificatrices très stylisées. Comme dit Baudelaire dons son « Éloge du maquillage » (Le Peintre de la vie moderne), elle doit se dorer pour être adorée, pour s’élever à la dignité sacrée de la prêtresse. Ainsi nous tient-elle à distance, récuse toute approche : il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains.
Voyez le visageicône de Garbo, par exemple dans le film La Reine Christine. C’est un masque de plâtre, maximalement simplifié, qui semble venir du fond des âges. Elle est tellement hors-vie (on l’appelait la « Divine ») qu’elle ne suscite en nous même aucun désir physique. Elle est bien au-delà. Elle a quelque chose d’asexué, qui correspond d’ailleurs à son habillement dans le film susdit, où elle est vêtue en homme. Tant l’androgynie, l’hermaphrodisme nous déracinent, hors-même de toute convoitise de chair !
Objectivement, la beauté de ce visage n’est qu’une question de structure osseuse, et aussi de photogénie valorisée artificiellement (éclairage, etc.). Et pourtant il est archétypal, idée au sens de Platon, pour qui le monde que l’on voit n’était que fantomatique, irréel, simple reflet d’essences définitionnelles qui le garantissaient. Il y a bien sûr et au contraire des visages mobiles, sur lesquels on peut se projeter par empathie, par Einfühlung. Ils sont non plus Idée, mais Événement. Ainsi au visage de Garbo, Barthes dans ses Mythologies oppose celui d’Audrey Hepburn. Chez nous naguère on pouvait opposer le visage de Catherine Deneuve à celui de Marlène Jobert.
Proches de nous, et moins dérangeants, c’est évidemment ces derniers que peut préférer l’homme ordinaire, puisqu’ils lui ressemblent plus volontiers, étant apparemment davantage dans la vie.
La beauté, disait Stendhal, n’est que la promesse du bonheur. Promesse seulement, et non pas octroi garanti. Et même un visage juvénile, non maquillé nonobstant ce que je viens de dire, peut nous faire mal à le regarder. Car cette beauté particulière (la fameuse « beauté du Diable », irremplaçable et invincible), nous sentons bien qu’elle ne durera pas. Les « Jeunes filles en fleur » dont parle et rêve Proust, que seront-elles vingt ans plus tard, sinon des matrones alourdies et chargées d’enfants ?
C’est l’éphémère qui nous chavire, comme la floraison des cerisiers au Japon, ou le flamboiement automnal des érables au Canada. Le Japon même a un mot pour signifier la nostalgie de la saison que qui vient de nous quitter : Nagori – littéralement « le reste des vagues ». Un livre portant ce nom, écrit par Ryoko Sekiguchi, vient d’être consacré à ce sentiment (Folio, 2020). Ce sentiment d’impermanence sous-tend beaucoup de haïkus. Mais cette nostalgie des choses qui s’en vont existe aussi chez nous, par exemple dans la saudade portugaise.
Il n’y a de vraie Beauté qu’accompagnée du sentiment de notre insuffisance à côté d’elle, de notre finitude. Prenons-garde donc à ces moments certes bénis, mais où se sent leur proche disparition. Voyez ce que dit Paul-Jean Toulet, dans une de ses Chansons :
Dans Arles, où sont les Aliscans,
Quand l’ombre est rouge, sous les roses,
Et clair le temps,
Prends garde à la douceur des choses.
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton cœur trop lourd ;
Et que se taisent les colombes :
Parle tout bas, si c’est d’amour,
Au bord des tombes
Le kitsch, dit justement Abraham Moles dans sa Psychologie du kitsch, est l’art du bonheur. Mais du bonheur précisément il faut toujours parler tout bas, et non pas le claironner ou en être fier, car il peut à n’importe quel moment nous être enlevé. Il faut le voir comme précaire, c’est-à-dire obtenu par prière (du latin precari, prier).
Le vrai Carpe diem n’est pas comme on le croit souvent une invitation à jouir de l’existence sans entraves. Il est tragique, comme il se voit à la fin de l’ode d’Horace d’où il est tiré :
Cueille le jour. Fie-toi le moins possible au lendemain.
(Carpe diem. Quam minimum credula postero)
À la Renaissance, le thème a été traité chez nous de la même façon, par exemple par Ronsard dans son poème « Mignonne allons voir si la rose... », tiré des Amours :
Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté.
Le Dum vivimus, vivamus ! (Pendant que nous vivons, vivons !) des épicuriens implique un sentiment profond du problématique, de la brièveté de la vie. Ce sens anxieux de la précarité, de l’éphémère, totalement ignoré du monde du kitsch (monde de la satisfaction), est bien senti aussi dans le film de Peter Weir, Le Cercle des poètes disparus, quand le professeur Keating en fait leçon à ses élèves pour les inciter à mordre dans la vie. Songeons enfin à l’exclamation du poète romantique :
Aimez ce que jamais on ne verra deux fois...
La Beauté meurtrière
Au fond la vraie beauté fait peur, nous déracine, nous effraie, et c’est ce que le kitsch, le monde du kitsch (l’homme du kitsch), ne peuvent comprendre, ou ont oublié : la beauté y est abâtardie, réduite à l’agréable, et le bonheur, croit-on, s’y trouve réellement.
Souvenons-nous de nos expériences premières, quand notre sensibilité la plus profonde s’y est manifestée, et avant que l’habitude blasée ne s’installe. Un beau visage nous fait fuir, pour rien au monde on n’y toucherait :
Il est des visages
Dont la perfection
Laisse en héritage
Le mal qu’ils nous font...
Véritablement il y a des êtres qui sont protégés par leur beauté, et on ne doit peut-être pas la souhaiter à personne : elle est plutôt une malédiction qu’autre chose, car elle est trop loin de la vie ordinaire, de nos jours quotidiens, si confortables au fond.
Dans le film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi, Carole Bouquet est malheureuse d’être belle, car par sa beauté même elle fait le vide autour d’elle, à commencer par son mari, qui préfère avoir pour maîtresse une femme commune, moins dérangeante et plus rassurante. Ce film montre aussi que l’extrême beauté dans la musique (comme dans le film celle de Schubert) provoque trop l’homme ordinaire et suscite par réaction une violente hostilité.
On a fait venir le grec kalos, beau, de kaleîn, appeler. Même si cette étymologie est discutable, elle est intéressante. La vision de la beauté est un appel, une vocation, une surrection, une sommation à être (enfin). L’effleurement de l’essentiel, si insupportable à notre bien-être. On peut fuir un appel, car il incommode trop. Combien le font, dans bien des contextes : voyez par exemple l’histoire de Jonas, dans la Bible : appelé par Dieu pour se rendre à Ninive, il fuit sa vocation en partant dans la direction opposée. Il fuit en vérité celui qu’il doit être. J’ai commenté cet épisode dans mon ouvrage La Source intérieure (BoD, 2017).
Je pense aussi à la chanson de Jacques Brel Sur la place. Dans l’étouffante chaleur de midi une belle fille danse sur la place. Mais les hommes ferment bientôt leurs fenêtres pour ne plus la voir, car elle les dérange trop :
Ainsi certains jours paraît
Une flamme en nos cœurs,
Mais nous ne voulons jamais
Laisser luire sa lueur.
Nous nous bouchons les oreilles
Et nous nous voilons les yeux,
Nous n’aimons point les réveils
De notre cœur déjà vieux…
Telle est la vraie Beauté. Elle est, disait Breton, une catastrophe, c’est-à-dire, au sens grec du mot, un retournement de tout l’être. Oxymorique, elle est excessive, elle est too much, elle est trop... Beauté fatale, qui nous juge et nous tue : on meurt en Beauté.
C’est un monde du paradoxe, et comme dit Ferré dans C’est extra un « mal qui nous fait du bien » Voyez aussi ce qu’écrit Marguerite Duras dans Hiroshima mon amour :
Tu me tues... Tu me fais du bien...
Cette ambivalence, cet « effroi du beau », qu’a analysé J-L. Chrétien dans L’Effroi du beau, sont bien illustrés dans la première Élégie à Duino