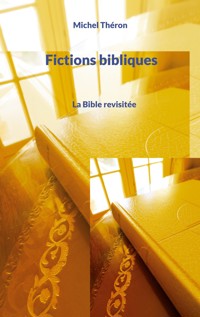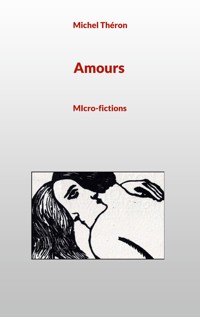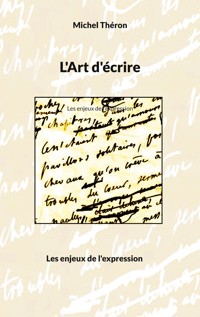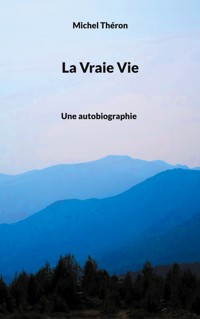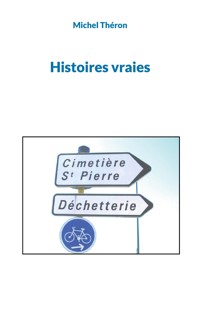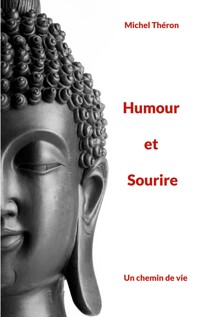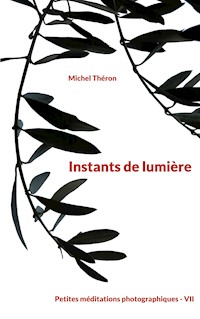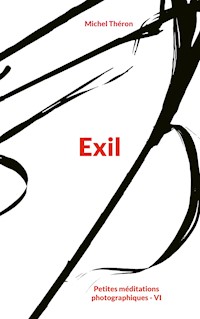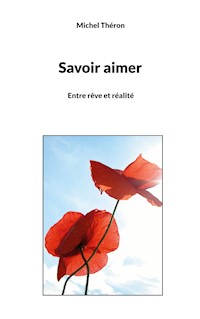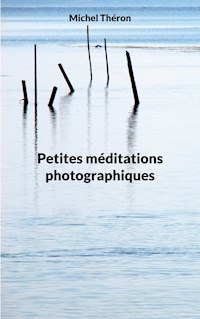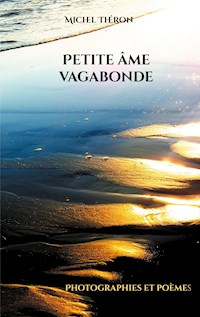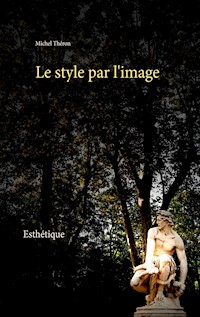
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Ce livre illustre, de façon systématique et ordonnée, l'ensemble des procédés et figures de style, au moyen de photographies prises par l'auteur dans un même lieu (un jardin public), qui donnent à la démarche une unité. Proposant une approche concrète et nouvelle, ce livre s'adresse non seulement à ceux qui s'intéressent au langage verbal, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'expression photographique et artistique, ainsi qu'à la comparaison des deux langages.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
Ce livre illustre, de façon systématique et ordonnée, l’ensemble des procédés et figures de style, au moyen de photographies toutes prises dans un même lieu (un jardin public).
J’ai fait ces photographies, en technique argentique, dans le parc Jean-Hugo à Lunel (Hérault), à l’automne 1992. Le lieu unique donne à ce livre une unité. Et aussi, il permet de mieux voir l’essence du style : celui-ci tient moins au sujet lui-même qui est représenté dans l’œuvre, qu’aux différentes visions, ou versions, qu’on peut en proposer. C’est pourquoi beaucoup de photographies vont par deux, le paramètre technique, à la prise de vue, ou bien ensuite au tirage, changeant dans chaque cas. Le style, aussi bien dans le monde des mots que dans celui des images, ne se voit bien que par comparaison, confrontation, opposition constantes.
On peut lire ce livre comme on veut, le feuilleter, le parcourir au hasard. Mais il est préférable sans doute de le lire d’abord du début à la fin, en suivant la succession des chapitres que j’ai adoptée, et qui n’est pas indifférente.
J’ai rangé les figures et procédés dans le même ordre que j’ai utilisé ailleurs, quand j’ai écrit sur le style du texte seul. Comme dans mon livre La stylistique expliquée – La littérature et ses enjeux (éd. BoD, 2017), il y a ici trois parties générales : Matériaux, Organisation, Perspective. La partie Matériaux comprend les figures et procédés stylistiques concernant les signes eux-mêmes, ou le vocabulaire. La partie Organisation comprend les figures et procédés concernant l’agencement lui-même des signes, la syntaxe. Et la partie Perspective comprend les procédés et phénomènes les plus complexes, ceux où il faut sentir une distance entre ce qui est dit, et ce qu’il faut comprendre ; et aussi ceux dans lesquels l’esprit prend de la distance vis-à-vis du langage lui-même qu’il utilise.
Un style, certes, comporte toujours tous ces paramètres ensemble. Mais il est bon de les distinguer et de les étudier à part, pour la clarté pédagogique du propos.
L’index final, qui regroupe tous les procédés, figures et phénomènes stylistiques étudiés dans le livre, permettra d’en avoir une vision d’ensemble.
Ce livre permet de faire mieux comprendre, par la visualisation, ce qu’est le style dans le texte ; mais aussi, il permet de mieux voir et interpréter les images elles-mêmes, qu’elles soient photographiques ou picturales.
L’enquête sur le style, en effet, gagne à ne pas se limiter aux mots. Dans l’expression, tout est lié. On comprend mieux les choses quand on en a une vision interdisciplinaire. La fin de ce livre à cet égard dépasse largement la description formelle du style, pour aborder des questions générales d’esthétique, sur la position de l’art aujourd’hui. Il va de soi que ce que je dis n’engage que moi.
J’espère au moins qu’après la lecture de ce livre les figures de style apparaîtront enfin pour ce qu’elles sont en effet, non des ornements du discours logique, mais des modalités vivantes de la perception.
M.T.novembre 2018
Nota : La première version de ce livre est parue en 1993, aux éditions du Centre Régional de Documentation Pédagogique de Montpellier (34). Par rapport à cette version, aujourd’hui épuisée, la présente édition a été complètement revue et enrichie.
Table
Avant-propos
Première partie: Matériaux
1. Caractérisation augmentée : la profondeur de champ
2. Caractérisation réduite : la profondeur de champ
3. Caractérisation : le cadrage
4. Degrés de la caractérisation
5 Caractérisation réduite : macrophotographie
6. Caractérisation réduite : l’exposition en clair-obscur
7. Caractérisation augmentée : le tirage doux
8. Caractérisation réduite : le tirage dur
9. Caractérisation : l’énigme de l’
Einfühlung
10. Caractérisation refusée : l’abstraction géométrique
11. Caractérisation indécise ou pléthorique : l’abstraction lyrique ou informelle
12. Caractérisation paradoxale : oxymore intellectuel
13. Caractérisation paradoxale : oxymore sensible ou perceptif
14. Perceptions brouillées : métaphore, hypallage
15. Figures de l’interprétation : synecdoque, métonymie,métaphore, allégorie
16. Métaphore effective : reflet
17. Métaphore effective : surimpression
18. Métaphore
in praesentia
: la vitesse d’obturation
19. Métaphore
in absentia
: l’instantané
Deuxième partie: Organisation
20. Prolepse ou anticipation expressive : la mise au point
21. Prolepse ou anticipation expressive : le cadrage
22. Composition par subordination : hypotaxe
23. Subordination brouillée : énallage
24. Composition par juxtaposition : parataxe, asyndète
25. Décousu syntaxique : hendiadyin
26. Parataxe et dislocations : anastrophe, hyperbate, synchyse, zeugme
27. Brouillage de l’ordre visuel : anacoluthe
28. Figures de pensée : hyperbole
Troisième partie: Perspective
29. Figures de pensée : litote
30. Figures de pensée : antiphrase
31. Point de vue et focalisation narrative :
32. Le point de vue porté sur le langage : la mise en abyme - I
33. Le point de vue porté sur le langage : la mise en abyme - II
34. Le point de vue porté sur le langage : le problème de la « garantie des signes »
Index
Du même auteur, parutions récentes
1. Caractérisation augmentée : la profondeur de champ
Dans le texte, on appelle « caractérisation » le nombre des circonstances, occurrences particulières ajoutées au sujet lui-même, et entourant l’objet du propos.
Ce sont, soit des éléments de qualification, avec aussi mention de détails, de circonstances, précisant la désignation des choses (caractérisation qualificative ou circonstancielle proprement dite), soit des éléments d’analyse et de jugement, enrichissant intellectuellement le sujet (caractérisation intellectuelle, d’intention comparable à celle de la caractérisation qualificative, mais ne s’y réduisant pas). Le but de ces deux caractérisations est le même : l’ajout des précisions aux choses mêmes que je vois.
Par exemple, « Banc vide dans un jardin public » est une caractérisation qualificative (« vide »), et circonstancielle (« dans un jardin public ») ; si j’ajoute « invitant au repos », j’ai une caractérisation intellectuelle, avec ajout d’une analyse, ou d’un sens supplémentaire aux choses.
La caractérisation intellectuelle, dans la perception visuelle des choses, implique l’approfondissement du discours intérieur du spectateur. Elle suppose toujours l’ajout supplémentaire d’une réflexion à ce que les yeux voient immédiatement.
La caractérisation qualificative, ou circonstancielle, correspond davantage à la perception immédiate des choses, à la façon dont elles sont reconnues tout de suite et désignées.
Dans le texte, cette caractérisation, traditionnellement, s’oppose à la nomination (simple). Par exemple, si je dis « banc », je ne caractérise pas, je nomme ou me contente de nommer. Si je dis « grand banc », ou « petit banc », je commence à caractériser l’objet, par ajout de qualifiants. Si j’ajoute « banc dans une allée bordée d’une haie, conduisant à une statue se découpant sur fond d’arbres », je caractérise évidemment encore davantage, par ajout de circonstances.
Dans l’ordre du visible, cela revient d’une part à situer l’objet dans une scène plus large, et d’autre part à voir plus d’objets avec netteté.
Dans le texte, bien sûr, la caractérisation et la nomination simple ne s’opposent pas si nettement. Ce sont choses toujours relatives. La caractérisation, par exemple, ne tient pas seulement à la présence effective dans le texte de qualifiants (adjectifs, etc.), mais aussi au plus ou moins grand degré de précision des noms eux-mêmes que je choisis pour nommer les choses. Ainsi, le nom : « siège » caractérise moins que le nom : « banc », parce que « siège » est plus large et générique que « banc ». La qualification verbale est une modalité de la nomination elle-même. – Voyez ici le chapitre 4 : Degrés de la caractérisation.
Dans l’image, la venue à l’esprit d’un nom plus large et générique peut s’obtenir en restreignant le champ. Par exemple, si je masque avec ma main la moitié supérieure de cette photo, et n’en considère que la moitié inférieure, j’ai un « siège », non un « banc ». Si on fait cette réduction, on verra que la moitié inférieure de l’image est beaucoup moins nettement caractérisée que l’image prise dans son ensemble.
On peut donc augmenter la caractérisation dans l’image en augmentant l’étendue du champ visuel, au moyen du cadrage.
Mais aussi, comme ici, en augmentant la profondeur du champ visuel. On joue alors, non sur le nombre d’objets vus de façon frontale et bidimensionnelle, dans la dimension horizontale et verticale du cadre, mais sur le nombre d’objets vus nettement sur les différents plans de profondeur. La perception de la profondeur, d’une hiérarchie précise dans les distances, est une donnée supplémentaire de la caractérisation visuelle. À cadrage identique, le nombre d’objets vus dans une image peut être bien différent, suivant que les objets sont nets en profondeur, ou non. Alors la caractérisation visuelle, elle aussi, peut être très différente.
Ici, tout est net dans cette photo, du premier plan à l’arrière-plan, du début en quelque sorte à la fin de l’acte de vision. L’acuité de perception est très grande. Il y a un maximum d’éléments nettement visibles (feuille morte, banc, statue, arbres, etc.), un maximum de détails, de circonstances, d’informations. En ce sens, compte tenu de son cadrage, c’est une photo qui peut prétendre à l’exhaustivité.
Dans de tels cas, où tout est net ou à peu près, on dit que la profondeur de champ est maximale. On obtient une profondeur de champ maximale, en photo, en prenant un objectif de courte focale, qui élargit le champ visuel, et une fois l’objectif choisi, en diaphragmant l’objectif le plus possible. Le diaphragme est comme l’iris de l’œil : pour voir plus nettement, il faut cligner des yeux. Étymologiquement, par exemple, un « myope » est quelqu’un qui cligne les yeux (en grec muein) pour mieux y voir.
Le diaphragme ici est tout petit, maximalement fermé : il se voit d’ailleurs sur la photo, à cause du reflet parasite de la lumière en contre-jour. Ce sont les deux petits hexagones blancs sous la statue : c’est un peu un phénomène (non prévu au départ !), de réduplication du regard, ou de mise en abyme (survenue de l’œil lui-même ou du dispositif de vision présent dans l’image, comme de la parole dans le discours)...
On voit qu’on peut augmenter la caractérisation visuelle (toujours relative, comme la caractérisation verbale), soit en élargissant le champ, soit en augmentant la profondeur de champ, soit par les deux procédés à la fois. Le but est le même : dans tous ces cas-là, on augmente le nombre des objets vus nettement.
On augmente aussi la perspective, qui est simplement le fruit d’une vision plus attentive, l’œil restant immobile et la paupière mi-close pour mieux voir (en latin perspicere). Plus on multiplie ainsi les caractérisations visuelles, le nombre et la netteté des objets présents dans le champ, plus on guide le regard, et plus on peuple le monde de tous ses détails divers et occurrences.
Comme le discours s’étoffe et s’enrichit de circonstances, ainsi l’image se précise de tous ses détails.
On appelle parfois hypotypose, en rhétorique, une grande accumulation des circonstances et des détails descriptifs dans un texte. Une hypotypose visuelle serait, alors, une image réalisée avec une très grande profondeur de champ.
Que gagne-t-on en général, et que perd-on à caractériser ? Par la caractérisation, on précise les choses (dans le texte et dans l’image), on donne renseignement sur renseignement, on tient lecteur ou spectateur par la main.
Mais ce choix est d’une grande ambivalence. Si j’écris ou décris, ou si je vois et fais voir « un banc vide dans un jardin public, au bord d’une allée elle-même bordée d’une haie, conduisant à une statue se découpant sur fond d’arbres », j’enrichis mon banc, mais aussi je le mutile. J’élimine par exemple le banc de mon propre jardin, le banc occupé, etc. bref, tous les autres bancs... Je peux certes vouloir à certains moments reconnaître les circonstances qui entourent les choses et les actualisent en les précisant, mais aussi, à d’autres, vouloir méditer sur des essences. À cela peuvent servir, dans l’image, des fragments, des détails isolés ; et dans le texte, des noms seuls, des ellipses ou les suggestions. De mon banc alors j’éliminerai l’allée, la statue, etc., pour en généraliser la présence.
Lorsque le travail de l’écriture est de caractériser, ce jeu est bien cruel. Sans doute tout l’effort de l’art en général est-il de caractériser ; mais aussi tout art peut mourir de la caractérisation. Dans l’accident et l’événement, la circonstance, meurent l’essence, la définition. Ce qui étoffe, étouffe.
2. Caractérisation réduite : la profondeur de champ
Ainsi, de la phrase : « Feuille morte, sur un banc vide, dans un jardin public, au bord d’une allée elle-même bordée d’une haie, conduisant à une statue se découpant sur fond d’arbres », je peux éliminer tous les caractérisants, pour ne garder que les deux substantifs initiaux : « feuilles mortes et banc ». L’allée, la haie, la statue, disparaissent.
De même, dans la photo ci-contre : au premier regard on ne voit pas l’allée, la haie, la statue. Seuls le banc et la feuille morte sont nets : le reste est flou. Pour réduire la caractérisation visuelle de cette photo, le cadrage et la mise au point étant les mêmes que dans la précédente, on a simplement réduit la profondeur de champ, en augmentant la taille du diaphragme. Celui-ci est largement ouvert (tache hexagonale gris clair environ au tiers supérieur gauche de la photo), ce qui crée le fond flou.
On obtient donc dans les deux images deux visions très différentes : une vision du tout net, et une vision d’un seul objet net, se détachant sur un fond flou. Laquelle des deux visions est la plus fréquente ou normale, disons la plus naturelle ?
Nous sommes tellement habitués au tout net, à voir des représentations des choses les plus nettes possibles, que nous penserons peut-être que la vision la plus nette possible est la plus naturelle. Ainsi dans les photos nous recherchons souvent la plus grande netteté possible, ce qu’on appelle le piqué. Une image nous semble rater son but, quand elle est floue ou contient beaucoup de flou.
Sans doute de la même façon, dans le langage, nous pensons que l’accumulation des détails et circonstances, le développement de la caractérisation, est une opération normalement enrichissante, et quasi obligatoire : qualité de la perception et richesse de la caractérisation nous semblent intimement liées. Mais est-ce bien sûr ? Il ne faut pas confondre un conditionnement (celui du regard, par la contemplation d’images déjà existantes, et celui du langage, par l’éducation et l’école), avec une opération naturelle ou spontanée, reflet de notre expérience immédiate du monde.
Je pense, au contraire de ce que pensent beaucoup, que la vision avec prédominance du flou, ou d’un seul objet net se détachant sur un fond flou, est plus naturelle et normale que la vision du plus possible d’objets nets, pour laquelle le regard doit être attentif, tendu. Bref, cette deuxième version du banc me semble bien plus naturelle, c’est-à-dire immédiate ou sensible, que la précédente, où c’est l’esprit qui est sollicité, beaucoup plus que les sens. Par bien des côtés, la contention et l’effort mêmes, nécessaires au regard de toute vision maximalement nette, montrent son caractère artificiel : c’est une opération bien plus intellectuelle que sensible.
Et de même, en peinture, les peintres du contour net (primitifs, flamands, etc.), sont des peintres intellectuels, qui reproduisent, non ce qu’ils voient, mais ce qu’ils savent. Les peintres du contour flou (peintres du sfumato, peintres impressionnistes), qui diluent les formes de leurs fonds, reproduisent eux, ce qu’ils voient. Ils sont plus réalistes.
Ou bien il faut dire qu’il y a deux réalismes : un réalisme sensible, et un réalisme intellectuel. Le premier est un réalisme du fond flou, de l’ellipse ou de la suggestion ; au contraire, le réalisme du fond net, des circonstances exhaustives, remplaçant ce qu’on voit par ce qu’on sait, est un réalisme intellectuel, construit, et non pas immédiat, sensible.
Flaubert par exemple est un réaliste sensible, qui dit seulement, d’une scène, quelques détails vus ou entrevus, non l’ensemble. Et Balzac est un réaliste intellectuel, qui dit le maximum de choses, mais beaucoup sont des choses qu’il sait déjà : il dit bien plus de choses qu’il ne pourrait en voir à la fois, avec ses yeux seuls.
Le héros de Flaubert s’assiérait sur le bout du banc, et se contenterait de remarquer la feuille morte. Mais celui de Balzac, une fois assis, laisserait à l’auteur le soin de tout décrire et caractériser autour de lui : le jardin, la saison, l’époque, etc. Flaubert suggère un décor minimal, abstrait ; il écrit « à diaphragme ouvert ». Balzac veut épuiser les choses par la vision attentive ; il écrit « à diaphragme fermé ». Flaubert : F. 1,8. Balzac : F. 22.
Par exemple lors de l’« apparition » de Madame Arnoux à Frédéric, au début de la dernière Éducation sentimentale, Flaubert dit qu’elle était en train de « broder quelque chose », sans préciser quoi. C’est bien normal, de la part d’un regard sidéré par la seule vision d’un visage. Frédéric ne peut voir le reste, et le narrateur n’a pas à le remplacer...
Mais Flaubert suit Balzac. Et d’ailleurs ici il vaudrait mieux parler du dernier Flaubert, puisque le premier écrit encore comme Balzac... Si donc la vision floue est plus naturelle ou normale que la vision nette, comment se fait-il qu’elle puisse lui succéder ?
Dans la vie, on commence toujours par la vision floue, la vision sensible, surprise par des détails proches ou des fragments des choses. Mais très vite ensuite, on en vient mentalement à la vision nette, on s’occupe, en faisant effort, de situer et préciser les choses, c’est-à-dire reconstruire des ensembles : on croit enrichir les objets, en les recouvrant de médiations intellectuelles, et donc on les caractérise de plus en plus. Cela se fait à mesure que l’éducation, l’école, nous modèlent. Les représentations exhaustives ou d’ambition exhaustive, alors, nous paraissent normales et naturelles. – Enfin, quand on est lassé de ces belles constructions, quand on y voit trop d’artifice, on peut déconstruire tout cela, revenir au flou. On revient aux surgissements sensibles, proches ou immédiats, par lesquels on avait commencé, et dont on s’était éloigné. Alors, la caractérisation diminue, et avec elle l’ambition d’expliquer le monde, d’en rendre compte par élargissement du regard, épuisement des choses par la vision.
La caractérisation comprise comme le choix du net, est une opération, non pas première, mais facilement explicable et justifiable. Par la caractérisation, on se protège de l’inconnu menaçant du monde. Au contraire, si on choisit le flou, on revient aux présences sensibles et immédiates, au surgissement initial des choses devant le regard. Apparaît alors, à nouveau, le risque de l’« inquiétante étrangeté »...
On dira peut-être que les enfants, les primitifs, c’est-à-dire nos prédécesseurs ou nos ancêtres, dans leurs représentations préfèrent le net. Mais en fait, ce n’est pas étonnant. Ils veulent se protéger de l’indistinct, du flou menaçant. Ils dessinent schématiquement ce qu’ils savent (à leur niveau, symbolique), non ce qu’ils voient